L’environnement pour une ville plus durable : état des lieux
- Alimentation
- Espaces verts
- Mobilité
- État des lieux de l'environnement
- Étude
- Santé
Sommaire
-
Plans environnementaux pluriannuels
-
Mise en place de la Zone de Basses Emissions : attentes
-
Mise en place de la Zone de Basses Emissions : quel bilan ?
-
La mobilité des entreprises par les plans de déplacement d’entreprises 2017
-
Good food : Agriculture professionnelle en Région bruxelloise
-
Potagers collectifs et familiaux, arbres fruitiers partagés
-
La stratégie "Good food" en milieu scolaire
-
Impact de l'alimentation sur l'environnement
-
Collecte de données sur la biodiversité bruxelloise par les citoyens ("crowdsourcing")
-
Recherche et synthèse de connaissances : Perception du cadre de vie
-
Le maillage jeux
-
Sport et espaces verts en Région bruxelloise
-
Métabolisme urbain, bilan des flux de matières et d'énergie
-
Quels ont été les effets du premier confinement COVID-19 sur l'environnement ?
-
Végétaliser pour refroidir les espaces urbains : des solutions fondées sur la nature
-
Végétaliser pour réduire localement l’exposition à la pollution de l’air : des solutions basées sur la nature
-
Végétaliser pour réduire localement l’exposition au bruit : des solutions fondées sur la nature
-
Poursuivre la lecture
Depuis plusieurs années, la Région met en place un grand nombre d’actions, à différentes échelles (bâtiment, quartier, ville), visant à inscrire Bruxelles dans une dynamique de ville durable. L’objectif est de concilier de manière équilibrée développement économique, qualité de vie et solidarité tout en répondant aux multiples enjeux environnementaux auxquels est confrontée la Région.
De manière générale, l’ensemble des politiques environnementales menées au niveau régional participent à augmenter la durabilité de la ville en diminuant son impact environnemental (tant au niveau local que global), en accroissant sa résilience et en améliorant la qualité de vie des Bruxellois.
Par ailleurs, certaines actions menées en matière d’environnement s’inscrivent dans le cadre de politiques transversales menées à différentes échelles et qui participent à la mise en œuvre d’une stratégie « ville durable », alliant des préoccupations environnementales, sociales et économiques.
Plans environnementaux pluriannuels
Focus - Actualisation : janvier 2024
Plans stratégiques pour la politique de l'environnement et de l'énergie
La réponse apportée par la Région aux pressions exercées sur l'environnement et la qualité de vie passe par une multitude d'outils, allant du législatif à la sensibilisation. Toute une série de plans ou programmes en lien avec l'environnement sont ainsi mis en place par Bruxelles Environnement, seul ou en collaboration avec d'autres instances publiques.
Les plans repris ci-dessous concernent pour la majorité d'entre eux l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC).
Ils ont été regroupés par domaine environnemental sur lequel ils portent.
Qualité de l'air, énergie et changement climatique
La problématique dans ces 3 domaines étant étroitement liée, la Région a développé une politique intégrée pour atteindre les objectifs régionaux en termes de réduction de la consommation d’énergie, d'amélioration de la qualité de l’air et de restriction des émissions de gaz à effet de serreGaz qui absorbe une partie des rayons du soleil et les restitue sous la forme de rayonnements, lesquels rencontrent d'autres molécules de gaz et reproduisent ainsi le processus, entraînant l’effet de serre, qui engendre une augmentation de chaleur. Les principaux gaz à effet de serre dont l’origine est essentiellement liée à des activités humaines sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’ozone troposphérique (O3).. Le volet légal de cette politique intégrée correspond au COBRACE ou Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie. Celui-ci a été approuvé le 2 mai 2013. Il comporte entre autres la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments, la qualité de l’air, les plans de déplacements, le système européen d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, etc. Il fournit une base légale à une série de mesures telles que celles relatives à la "Low Emission Zone", au stationnement hors voirie, à l'amélioration des performances environnementales des véhicules, aux investissements internationaux en matière de climat, etc. Ce code a été adapté plusieurs fois depuis, dont en juin 2021 afin notamment de reprendre les objectifs de réduction des émissions régionales de gaz à effet de serre pour les décennies à venir.
Ce code prévoit l'obligation de planifier les mesures à venir dans les domaines de l'air, de l'énergie et du climat de façon intégrée, notamment par le biais de la publication, tous les cinq ans, d'un plan régional Air-Climat-Energie:
- Plan Régional Air-Climat-Energie (.pdf) : ce plan aborde les principaux secteurs émetteurs et tous les aspects de ces trois thématiques, y compris l'efficacité énergétique, la surveillance de la qualité de l’air, l'adaptation aux changements climatiques et les énergies renouvelables). Ce plan a été adopté le 27 avril 2023.
Cette deuxième version du PACE s’inscrit dans la rehausse de l’ambition régionale en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre et met l’accent sur l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Ce plan cible les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques (bâtiment, transport, etc.) et encourage aussi la production d’énergie renouvelableL’énergie renouvelable est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz. (DIRECTIVE 2009/28/CE).
D'autres plans sont également à relever par rapport à ces thématiques :
- Le Plan d'urgence en cas de pics de pollution: arrêté publié le 31 mai 2018
- La stratégie RENOLUTION, correspondant à la stratégie 2030-2050 de rénovation du bâti, qui a pour objectif d'améliorer la performance énergétique de celui-ci. Le chauffage des bâtiments (logements et bureaux) représente en effet plus de 70% de la consommation énergétique régionale.
- Le plan régional de mobilité Good move (voir dans les plans d'autres instances ci-dessous : mobilité), qui a une influence importante sur la qualité de l’air et le climat, puisque le secteur du transport est le principal secteur émetteur de polluants atmosphériques, et le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre.
Eau
- Plan de gestion de l’eau 2022-2027 (.pdf) : ce plan se veut une réponse globale et intégrée à tous les défis en lien avec la gestion de l'eau en Région bruxelloise. Il intègre en outre 2 documents importants : le plan de gestion des risques d'inondation et le registre des zones protégées. Cette 3e version du Plan de Gestion de l’Eau a été approuvée le 22 juin 2023. Elle vise toujours l’atteinte progressive d’ambitieux objectifs environnementaux établis pour les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.), les eaux souterraines et les zones protégées en conformité avec la Directive-cadre eau européenne. Ce plan tient compte des spécificités de notre ville-région (imperméabilisation importante des sols, forte densité de population) pour apporter les réponses adéquates. Il vise à augmenter la résilience de notre ville face aux changements climatiques -et comporte à ce titre des mesures de prévention et de gestion face aux épisodes de sécheresse-, à promouvoir une utilisation rationnelle et durable de l’eau, ou encore à préserver les cours d’eau, plans d’eau et zones humides de notre milieu urbain. Le plan envisage également l’eau comme source d’énergie renouvelable.
- Programme régional de réduction des pesticides 2018-2022: approuvé le 19 juillet 2017 (voir plus bas).
Santé
- Voir dans les plans d'autres instances ci-dessous : Plan d'action national Environnement-Santé
- Programme régional de réduction des pesticides 2018-2022: approuvé le 19 juillet 2017 (voir plus bas).
Déchets et matières premières, économie circulaire
- Cinquième "Plan Déchets", le "Plan de gestion des ressources et des déchets 2018-2023" (en collaboration avec l'Agence régionale de la Propreté - ARP ou Bruxelles Propreté) : celui-ci cherche à tendre vers le « zéro déchetL’expression « zéro déchet » recouvre une idée, un mode de vie et un mouvement sociétal. L’idée, mise en avant par quelques pionniers, est pour un citoyen, un ménage, une organisation ou encore un processus industriel de progresser vers un fonctionnement qui tende à ne plus produire aucun déchets, et en corollaire quasi automatique, de consommer moins de ressources. Bien que le « zéro déchet » absolu soit sans doute impossible à atteindre, la radicalité de l’expression dénote son ambition : il s’agit de réévaluer toutes les facettes d’un fonctionnement pour diminuer massivement la production de déchets.», via un objectif triple : ancrer une transformation des pratiques de consommation plus durables et plus circulaires ; maximiser la préservation et la valorisationToute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. de la matière, si possible localement ; et entrainer le secteur économique de l’offre dans la pratique circulaire. Il a été approuvé le 22 novembre 2018.
Il a fait l'objet d'une évaluation intermédiaire en mai 2021, qui a permis d’analyser les résultats concrets à mi-parcours, de consulter et recueillir l’avis des parties prenantes bruxelloises afin de tirer une série de recommandations à mettre œuvre durant la seconde partie de la période.
- Shifting Economy, nouvelle stratégie de transition économique 2022-2030 de la Région de Bruxelles-Capitale, co-pilotée par Bruxelles Environnement, Bruxelles Economie et emploi, Hub.brussels et Innoviris : suite du Programme régional en économie circulaireL'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur. (ou PREC) de 2016, sa portée est néanmoins plus large et son ambition plus importante. Elle vise en effet à la transformation de l’économie bruxelloise pour qu’elle soit décarbonée, régénérative, circulaire, sociale, démocratique et digitale. Elle a été adoptée le 31 mars 2022.
Espaces verts, biodiversité, Forêt de Soignes
- Plan nature 2016-2020 : ce plan met en place des mesures visant à combiner développement urbain et nature, en mettant l’accent sur la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., la protection et le développement de la nature. Il a été approuvé le 14 avril 2016.
- Stratégie bruxelloise pour les insectes pollinisateurs 2023-2030 : adoptée le 15 décembre 2022, cette stratégie vise à favoriser les conditions nécessaires à la conservation et au développement des populations d’insectes pollinisateurs et auxiliaires. Elle s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie nationale belge 2021-2030.
- Plan de gestion des zones Natura 2000 : 3 zones Natura 2000 ont été identifiées via des arrêtés de désignation en Région Bruxelloise :
- BE10000002 : Zones boisées et ouvertes au Sud de la Région bruxelloise – complexe Verrewinkel – Kinsendael : approuvé le 24 septembre 2015. Cette zone a fait l'objet d'une extension , approuvée le 7 février 2019.
- BE10000003: Zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise : approuvé le 14 avril 2016.
- BE10000001 : La forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe – complexe Forêt de Soignes – Vallée de la Woluwe : approuvé le 14 avril 2016.
Par l'approbation de ces différents arrêtés, le Gouvernement a reconnu ces zones comme Zone spéciale de conservation (ZSC). Bruxelles Environnement doit maintenant établir pour celles-ci, en collaboration avec les éventuels propriétaires et utilisateurs concernés (autres que la Région), un plan de gestion.
- Plan de gestion pour la Forêt de Soignes bruxelloise , rédigé par Bruxelles Environnement en collaboration avec les Monuments et Sites : approuvé par l'arrêté du 4 avril 2019.
- Schéma de structure (interrégional) pour la Forêt de Soignes : signé par les 3 Régions en 2008.
- Plan Directeur pour la zone interrégionale de Neerpede (Région de Bruxelles-Capitale) et Vlezenbeek-St-Anna-Pede (Région flamande) : approuvé en septembre 2014.
- Programme régional de réduction des pesticides 2018-2022 : approuvé le 19 juillet 2017 (voir plus bas)
- Voir dans les plans d'autres instances ci-dessous : Stratégie nationale belge biodiversité 2020
Bruit
- Plan QUIET.BRUSSELS , troisième plan de prévention et de lutte contre le bruit pour la Région de Bruxelles-Capitale, adopté le 28 février 2019. Ses objectifs : réduire les effets du bruit sur la santé, permettre à chacun d’avoir accès au calme et maintenir l’attractivité de la ville.
Pesticides
- Programme régional de réduction des pesticides 2018-2022 , qui vise essentiellement à la réduction des risques et des effets des pesticides (ainsi que plus secondairement des biocides): approuvé le 19 juillet 2017. La version 2023-2027 du plan a été soumise à la consultation publique entre janvier et mars 2022. L'adaptation du projet de plan est actuellement en cours, en vue d'une publication en décembre 2022.
Alimentation
- Stratégie Good Food « Vers un système alimentaire plus durable en Région de Bruxelles-Capitale » portée par Bruxelles Environnement et la cellule Agriculture du Service public régional de Bruxelles (SPRB): elle vise à placer l’alimentation au cœur de la dynamique urbaine, en l’abordant dans toutes ses dimensions, économiques, sociales et environnementales. Son ambition est double: « mieux produire », c’est-à-dire cultiver et transformer localement des aliments sains et respectueux de l’environnement ; et « bien manger » ou rendre accessible à tous une alimentation savoureuse et équilibrée, composée d’un maximum de produits locaux. Elle a été adoptée en mars 2015.
L'évaluation de cette stratégie, réalisée en 2020, a montré des avancées tangibles en la matière, mais aussi des faiblesses et des opportunités pour la suite. La stratégie GoodFood2 (2022-2030) fait l'objet en 2021 d'un processus de co-construction avec tous les acteurs de terrain, pour l'identification des orientations et objectifs clés, qui seront déclinés en actions en 2022.
Sols
- La stratégie "Good Soil", initiée pour développer une gestion intégrée et durable des sols, et qui vise la protection et la restauration du sol bruxellois et de toutes ses fonctions essentielles, en abordant toutes les menaces : au-delà de la contamination des sols par les polluants chimiques, elle s'intéressera également aux aspects physiques et biologiques du sol. Le principe de base de cette stratégie est de déterminer l'utilisation appropriée du sol (nature, agriculture, gestion de l'eau ou du climat, infrastructures, …), pour chaque sol. Et ce, notamment sur base de la connaissance de la qualité des sols, qui est à développer.
Plans d'autres instances ayant un impact environnemental important
Les résultats de la politique environnementale et énergétique de la Région sont inévitablement influencés par des mesures et priorités définies dans des domaines politiques connexes. L'énumération ci-dessous se limite aux principaux plans et programmes pluriannuels.
Déclaration de politique régionale
Plan Régional de Développement Durable
Le Plan Régional de Développement Durable (PRDD) a été approuvé le 12 juillet 2018. Les objectifs visés constituent les fondements de nombreuses mesures et actions reprises dans le plan air-climat-énergie, le plan de gestion de l'eau ou le plan nature par exemple, qui précisent les modalités des piliers d'actions du PRDD, tels que la mobilité, l'aménagement du territoire, la gestion du maillage bleuLe Maillage bleu est un programme mis en œuvre depuis 1999, qui vise plusieurs objectifs : séparer les eaux usées des eaux propres afin de limiter l'apport d'eau aux stations d'épuration, restaurer certains éléments du réseau hydrographique de la Région, réaménager des tronçons de rivières, des étangs et des zones humides pour leur rendre toute leur valeur biologique, et leur faire éventuellement bénéficier de mesures spéciales de protection, et assurer la fonction paysagère et récréative de ces sites., etc.
Plan Mobilité
Le plan régional de mobilité 2020-2030 Good Move a été approuvé par le Gouvernement en 2020. Il définit les grandes orientations politiques dans le domaine de la mobilité.
La Région s’appuie également sur une série de plans stratégiques thématiques, comme le plan piéton, le plan vélo, le plan sationnement ou le plan marchandises. Une actualisation de ces outils est en cours afin d’assurer leur adéquation avec les ambitions du nouveau plan Good Move 2020-2030 en matière de mobilité et de sécurité routière. Ces nouveaux documents seront appelés « feuille de route ».
Les mesures prévues dans le chapitre consacré au transport du plan air-climat-énergie (ACE) complètent ce plan dans le but d'atteindre les objectifs régionaux en matière de qualité de l’air et d'émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, le Plan ACE prévoit plusieurs actions en vue de rationaliser l'utilisation de la voiture et de promouvoir des alternatives à la voiture personnelle.
Polluants organiques persistants
En Belgique, la Convention de Stockholm en matière de POP(Polluants organiques persistants) Groupe de composés organiques d'origine anthropique qui résistent à la dégradation biologique, chimique et photolytique. Ils sont donc persistants dans l'environnement. Ils sont peu solubles dans l'eau et très solubles dans les lipides, ce qui cause une bio-accumulation des POP dans les graisses des organismes vivants. Semi-volatils, ils circulent en passant par plusieurs cycles d évaporation, de transport atmosphérique et de condensation (« effet sauterelle »). Ils parviennent ainsi à parcourir rapidement de grandes distances et se retrouvent partout dans le monde, même où ils n'ont jamais été utilisés. relève des compétences dites "mixtes", c'est-à-dire qu'aussi bien le fédéral que les Régions sont compétents et peuvent prendre des décisions dans les matières concernées.
- Le troisième plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur pour les polluants organiques persistants 2014-2018 a été élaboré en 2009 et sa mise à jour, adoptée par la Conférence interministérielle Environnement le 29 janvier 2019, est disponible via le site de la Convention (voir "COP7 amendments") .
Plan national d'action Environnement-Santé
Avec le National Environment and Health Action Plan (NEHAP) , la Belgique entend non seulement répondre à ses obligations vis-à-vis de la communauté internationale, et en particulier de l'organisation mondiale de la santé (OMS), mais aussi et surtout mettre les questions de la santé et de l'environnement sur la table au sein de l'Etat fédéral belge. Le plan regroupe un maximum d'informations au profit des nombreuses instances qui, en Belgique, sont compétentes pour des matières en lien avec l'environnement et la santé, à savoir les communautés et diverses institutions fédérales et régionales.
- Plan national d'action Environnement-Santé 2009-2013: programme opérationnel NEHAP2 : ce programme comprend les actions communes qui ont été approuvées par la Conférence interministérielle mixte Environnement Santé.
- L'évaluation du NEHAP2, initialement prévue pour 2015, a pris du retard et a été réalisée en 2017. Cette évaluation -ainsi que la déclaration d'Ostrava adoptée en juin 2017- doit permettre de dessiner les contours du NEHAP3. Un nouveau plan d'action nécessitant beaucoup de préparations, la cellule a mis en place un «portfolio national» en 2018, qui présente un résumé des activités de la cellule nationale, des partenaires au sein de la cellule et des collaborations avec des partenaires extérieurs au NEHAP. Ce travail volumineux fournit une image de la situation actuelle en matière de santé environnementaleDésigne les aspects de la santé et des maladies humaines influencés par des facteurs liés à l'environnement. Ce terme réfère également à la théorie et à la pratique visant à évaluer et à contrôler les facteurs environnementaux qui peuvent potentiellement affecter la santé. La santé environnementale inclut les effets pathologiques directs des produits chimiques, des radiations et de certains agents biologiques. Elle inclut également les effets (souvent indirects) de l'environnement physique, psychologique, social et esthétique sur la santé et le bien-être.. Il jette également les bases des travaux futurs de la cellule nationale et du NEHAP 3. Le 3ème NEHAP est en cours d'élaboration et verra probablement le jour en 2022.
Stratégies nationales liées à l'adaptation aux changements climatiques
La Commission nationale Climat (CNC) a été créée en 2002 afin d’assurer la coordination de la politique belge en matière de climat au niveau national. Il s'agit d'un organe constitué de représentants de l'Etat fédéral et des 3 Régions. Différents plans et stratégies ont été mis en place dans ce cadre, en lien avec l'adaptation aux changements climatiques, dont :
- Stratégie nationale d'adaptation aux changements climatiques (.pdf) , approuvée en déc. 2010. Elle a été complétée en 2020 par la Stratégie à long terme de la Belgique sur les changements climatiques, à l'horizon 2050.
- Le Plan national d'adaptation 2017-2020 : adopté le 19 avril 2017. Ce plan fédéral complète les plans d'action régionaux. Il identifie les mesures d'adaptation pour les dix secteurs pour lesquels le fédéral peut influencer l'adaptation aux changements climatiques: transport, économie, énergie, environnement marin, recherche, soins de santé, coopération au développement, sécurité internationale, gestion de crise en cas de catastrophe naturelle et agriculture. Il comporte également plusieurs mesures transversales. Ce plan a fait l'objet d'une évaluation finale fin 2020, qui a identifié les points de travail restants. Ceux-ci pourraient constituer la base d’un suivi après une mise à jour des priorités. Le plan d'action bruxellois sur le sujet correspond au chapitre sur l’adaptation du plan intégré Air-Climat-Énergie (voir plus haut).
- Le Plan National intégré Energie Climat Belge 2021-2030 a été approuvé par la CNC et CONCERE (groupe de concertation fédéral-régional mis en place autour des matières d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique) en décembre 2018 et la version définitive a été remise à la Commission Européenne fin 2019. La contribution bruxelloise à ce plan, le Plan énergie climat 2030 de la Région de Bruxelles-Capitale, a été remplacée par le 2e plan Air-Climat-Energie (voir plus haut).
Coordination dans le cadre du plan "Forte chaleur et pics d'ozone"
Durant l'été 2003, l'Europe a été frappée par une vague de chaleur d'ampleur exceptionnelle. Suite à cet épisode, de nombreux états ont entrepris de mettre en place ou de renforcer leurs structures de gestion de crise en lien avec ce type d'événements via des plans de gestion de canicule ou de vague de chaleur. En Belgique, il a été choisi d'associer la gestion des fortes températures et la question des pics d'ozone qui y sont souvent liés.
- La mise en œuvre du plan "Forte chaleur et pics d'ozone" adopté en 2015 a fait l'objet d'un protocole de coordination entre les 3 Régions et CELINE (Cellule interrégionale de l'Environnement)
Biodiversité
- Stratégie nationale belge biodiversité 2020 : correspond à une actualisation de la version couvrant la période 2006-2016. Elle a été approuvée le 13 novembre 2013 par la Conférence interministérielle Environnement (CIE). Avec les plans d'action régionaux, cette stratégie nationale pour la biodiversité constitue le principal instrument de mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique (Rio 1992).
Pesticides (produits phytosanitaires)
La transposition de la directive européenne 2009/128/CE « Pesticides » en droit belge nécessite d'accorder au préalable les compétences fédérales et celles des 3 Régions. Le programme national de réduction des pesticides - NAPAN, pour Nationaal Actie Plan d'Action National– est donc constitué du programme fédéral et des programmes des trois Régions.
- Plan national d'action ou NAPAN 2018-2022, qui reprend notamment le programme régional bruxellois de réduction des pesticides 2018-2022 (approuvé le 19 juillet 2017). Comme précisé plus haut, la version 2023-2027 du plan a été soumise à la consultation publique début 2022, en vue d'une publication en novembre 2022.
Mise en place de la Zone de Basses Emissions : attentes
Focus - Actualistion : février 2020
Le principe d'une zone de basses émissions est d'interdire progressivement aux véhicules les plus polluants de circuler. Objectif ? Réduire les émissions dans l'air de polluants provenant du transport routier. En RBC, en 2025, un tiers du parc de véhicules actuel serait concerné par les restrictions d'accès. Suite à la mise en place de la LEZ et aux évolutions technologiques des véhicules, les émissions de NOx et de particules fines devraient être sensiblement réduites d'ici à 2025, avec un impact positif sur la qualité de l'air. Les normes européennes actuelles pour le NO2 seraient ainsi respectées dans l’ensemble des stations de mesure de la Région entre 2020 et 2025.
Quel est l'impact du transport routier sur la santé et la qualité de vie ?
Le transport routier est responsable d’émissions de polluants atmosphériques, qui altèrent la qualité de l’air. Ces émissions sont de deux types :
- Les gaz d’échappement contiennent des substances telles que des oxydes d’azote (NOx), des particules fines (PM10 et PM2.5, Black Carbon), des oxydes de soufre (SOx), du monoxyde de carbone (CO) et plusieurs métaux lourdsNom générique d'un groupe de métaux de densité relativement élevée, tels que le plomb, le mercure, le zinc et le cadmium. Ces métaux sont présents naturellement dans l'environnement et sont même nécessaires à certains processus naturels. Ils sont toutefois nocifs en concentrations élevées. Les principales sources de métaux lourds sont l'industrie non ferreuse, la combustion de combustibles fossiles, l'incinération de déchets et le trafic.. Ces émissions varient en fonction du type de carburant et de la norme EURO (et de l’âge) du véhicule.
- L’abrasion des pneus, des freins et du revêtement de la route est source d’émissions de particules fines et de métaux lourds, qui varient notamment en fonction du poids du véhicule.
À Bruxelles, le transport routier correspond ainsi à l'une des principales sources d’émissions de substances acidifiantes, de précurseurs d'ozone -dont les oxydes d’azote (NOx)- et de particules fines.
Ces émissions ont une incidence négative sur la qualité de l’air (voir les indicateurs sur la concentration en NO2 et en PM10). Elles sont par conséquent susceptibles d'impliquer des problèmes de santé pour l’ensemble de la population. Le lien est ainsi fait avec des décès prématurés et des problèmes de santé importants (maladies respiratoires et cardio-vasculaires, …), en particulier pour les personnes les plus vulnérables comme les enfants et les personnes âgées (Bruxelles Environnement, 2015 ; OMS, 2018). Les gaz d’échappement des moteurs diesel sont en outre classés comme « cancérogènes pour l’homme » du fait de leur contribution à un risque accru de cancer du poumon (OMS, 2012).
Ainsi, notamment, le nombre de décès prématurés en Belgique dus à l’exposition aux particules fines, au dioxyde d’azote et à l'ozone était estimé pour 2016 à 7.600, 1.600 et 180 respectivement (AEE, 2019).
Une "Zone de Basses Emissions" : c'est quoi, et pourquoi ?
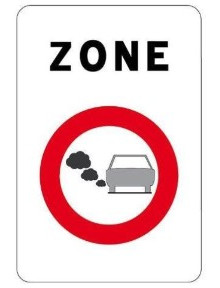
L’objectif d'une zone de basses émissions (en anglais « Low Emission Zone » - LEZ) est d’améliorer la qualité de l’air en interdisant progressivement aux véhicules les plus polluants de circuler dans la zone. À Bruxelles, une LEZ a été mise en place depuis le 1er janvier 2018. Elle couvre l’ensemble de la Région, à l’exception du Ring et de certaines voiries permettant d’accéder à des parkings de transit.
L'accès à la LEZ est conditionné par l'âge et le type de véhicule. En effet :
- Les véhicules les plus anciens, de norme EURO inférieure, émettent en moyenne plus de polluants nocifs pour la santé que les véhicules récents.
- Les véhicules diesel émettent en moyenne plus de polluants que les véhicules essence, à l'exception des gaz à effet de serreGaz qui absorbe une partie des rayons du soleil et les restitue sous la forme de rayonnements, lesquels rencontrent d'autres molécules de gaz et reproduisent ainsi le processus, entraînant l’effet de serre, qui engendre une augmentation de chaleur. Les principaux gaz à effet de serre dont l’origine est essentiellement liée à des activités humaines sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’ozone troposphérique (O3). (notamment les oxydes d’azote : les émissions mesurées en conditions réelles sont jusqu'à environ 10 fois plus importantes que celles des moteurs à essence, même pour les véhicules récents de norme EURO 6 – icct, 2014). Leurs gaz d’échappement sont en outre, comme précisé plus haut, considérés comme cancérogènes pour l’homme.
Certains véhicules sortent du champ d’application de la LEZ bruxelloise (notamment les deux-roues ou les véhicules électriques) : elle concerne les voitures, camionnettes (≤ 3.5t), (mini-)bus et autocars, qu'ils soient immatriculés en Belgique ou à l'étranger. Les poids-lourds sont pour leur part soumis à un système de tarification spécifique, indépendant.
Concrètement, en 2018, l’interdiction de circulation ne portait que sur les véhicules diesel les plus anciens (âgés d'au moins 22 ans). Les critères d’accès se renforceront ensuite chaque année :
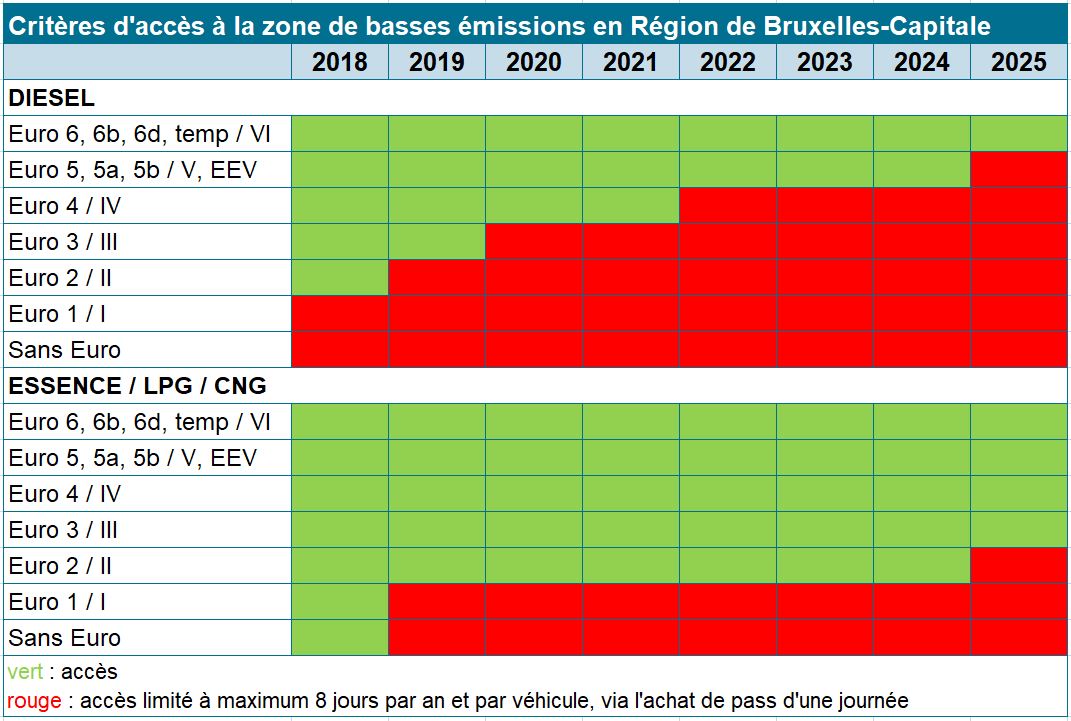
L'année 2018 a en outre représenté une année charnière, avec une phase transitoire de 9 mois pendant laquelle l'information a été privilégiée, de façon générale comme de façon plus ciblée (via des courriers d'avertissements) ; les infractions ont été verbalisées à partir du 1er octobre 2018.
Combien de véhicules seraient concernés ?
Estimer les implications de la mise en place de la LEZ nécessite d'estimer l'évolution du nombre de véhicules « trop » polluants que contiendrait le parc de véhicules bruxellois entre 2018 et 2025, et dont la circulation serait évitée grâce à celle-ci.
Différentes hypothèses ont été posées pour faire cette projection :
- Le taux de croissance du parc de véhicules est estimé via une extrapolation linéaire de l'évolution durant les années précédentes ;
- L’évolution de la composition du parc (répartition entre les carburants et les normes Euro) ne tient pas compte des changements de comportement ou de choix d’achat de véhicules que pourraient susciter les politiques de mobilité mises en place ;
- Le modèle ne tient pas compte non plus du fait que certains véhicules, comme par exemple certaines voitures de plus de 30 ans, puissent déroger à l’interdiction de circuler ;
- Enfin, les véhicules qui ne sont pas immatriculés en RBC ne font pas partie de l’analyse, en raison du manque d’informations fiables sur le nombre et les caractéristiques environnementales de ces véhicules.
Evolution modélisée du nombre de véhicules (voitures, camionnettes, bus/autocars) immatriculés en RBC qui seraient concernés par l'interdiction de circuler entre 2018 et 2025 en cas d'application des critères de la LEZ (à politiques et comportements inchangés)
Source : Modélisation réalisée par Bruxelles Fiscalité, Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité, à partir de la composition du parc en septembre 2016, sur base -entre autres- des données de la Direction de l’Immatriculation des Véhicules (DIV)
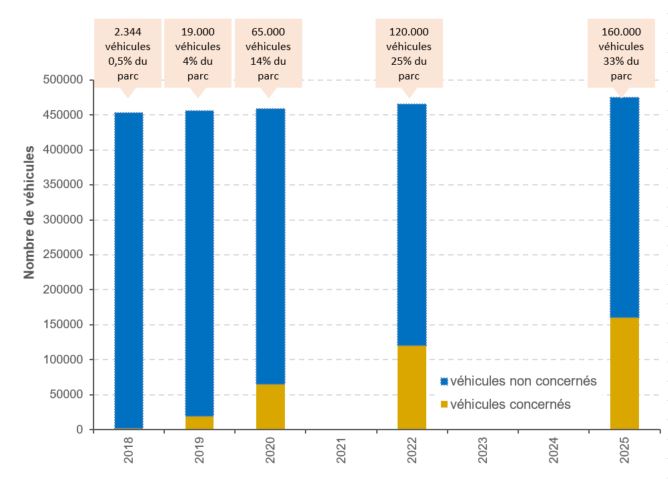
On estime ainsi qu’en 2018, dans une situation d’évolution sans LEZ, environ 0,5% du parc automobile immatriculé à Bruxelles (hors leasing) aurait été concerné par l’interdiction de circuler. Cette part augmenterait progressivement pour atteindre environ un tiers du parc en 2025. La majorité des véhicules bruxellois concernés par l’interdiction de circuler sont des voitures (57% en 2018, 80% en 2020).
Quel impact sur les émissions du parc de véhicules ?
L’évolution projetée des émissions provenant du transport routier a également été estimée à l’horizon 2025, selon deux scénarios :
- Un scénario « sans LEZ », mais tenant compte de l’effet de l’ensemble des législations existantes (principalement l’application de normes Euro au niveau européen, qui participe à un renouvellement du parc dans son ensemble) ;
- Un scénario « avec LEZ », en utilisant le modèle de projection des émissions du transport routier développé au sein de Bruxelles Environnement.
Pour des raisons techniques, le parc de véhicules pris en compte cette fois est plus large que celui utilisé ci-dessus : il correspond à l’ensemble des véhicules motorisés, y compris les voitures de leasing, poids-lourds et deux-roues.Ces estimations reposent sur un certain nombre d’hypothèses, à savoir que :
- La LEZ n’influencerait pas le comportement des Bruxellois en matière de choix de mobilité : on estime que le nombre de kilomètres parcourus reste identique par catégorie de véhicules. Toutefois, en incitant les citoyens concernés à opter pour des alternatives à la voiture, l’objectif de la LEZ est de contribuer à une réduction du nombre de kilomètres parcourus.
- En tenant compte des dérogations, de l’achat de pass journaliers et des potentielles infractions, on estime que 25% des véhicules interdits continueront de rouler.
- Les estimations tiennent compte de l’effet des nouvelles procédures d’homologation des véhicules qui devraient permettre de mieux maîtriser les émissions de NOx des véhicules diesel en conditions réelles.
Evolution estimée des émissions de polluants dans l'air (NOx, Black Carbon, PM2,5 et PM10) provenant du transport routier, en 2020 et 2025 par rapport à 2015
Source : Modélisation réalisée par Bruxelles Environnement
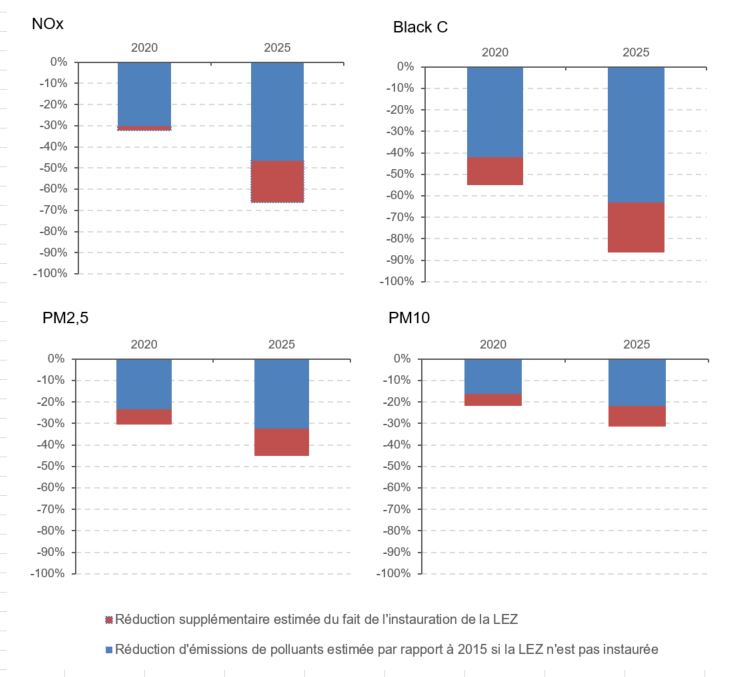
Selon ces modélisations, la mise en œuvre de l’ensemble des législations existantes et de la LEZ devrait permettre une réduction significative des émissions de polluants issus du transport routier à l’horizon 2020 et 2025 :
- les émissions de NOx provenant du transport routier en RBC devraient être réduites d’environ 32% d’ici 2020 et 66% d’ici 2025 (par rapport aux émissions de 2015).
- Les émissions de black carbon provenant du transport routier devraient, elles, diminuer d’environ 55% d’ici 2020 et 86% d’ici 2025
- L'effet sur les émissions de particules fines par le transport routier serait un peu moins marqué mais quand même sensible : une réduction des émissions de PM2.5 de 45% est attendue d'ici à 2025 (par rapport à 2015), et de 31% pour les PM10.
Quel impact sur les concentrations de polluants dans l'air ?
L'impact de la réduction des émissions issues du transport routier sur la qualité de l'air (ou les concentrations de polluants dans l'air) peut être estimé pour les zones dont la qualité de l'air est fortement influencée par le trafic : l’hypothèse faite est que les concentrations diminuent proportionnellement à la diminution des émissions. Cette méthodologie ne s’applique qu'à des polluants dont les émissions sont fortement liées au trafic routier, comme c’est le cas du NO2 et du Black Carbon.
Ainsi, pour chaque station de mesure concernée, l’importance relative des différentes contributions (internes et externes à la Région) sur les concentrations mesurées peut être estimée par comparaison avec les concentrations mesurées dans certaines stations représentatives :
- de la pollution de fond belge, via une station située hors RBC non affectée par des sources locales ;
- de la pollution urbaine de fond combinée à la contribution transrégionale (station située à Uccle, relativement éloignée de sources d’émissions directes) ;
- de la contribution urbaine, principalement liée au trafic (station située à Molenbeek), et
- de la pollution supplémentaire éventuelle provenant du trafic à la station même.
La réduction des émissions est appliquée à la part de la concentration estimée comme provenant du trafic.
Quatre stations sont envisagées ici : Ixelles (station représentative d'une "street canyon"), Molenbeek-Saint-Jean, Woluwé-Saint-Lambert et Belliard (NO2 uniquement dans ce dernier cas).
Concentrations annuelles observées en 2015, 2016 et 2017 et concentrations prévues avec mise en œuvre de la LEZ aux stations Belliard, Ixelles, Woluwé-Saint-Lambert et Molenbeek-Saint-Jean
Source : Modélisation réalisée par Bruxelles Environnement
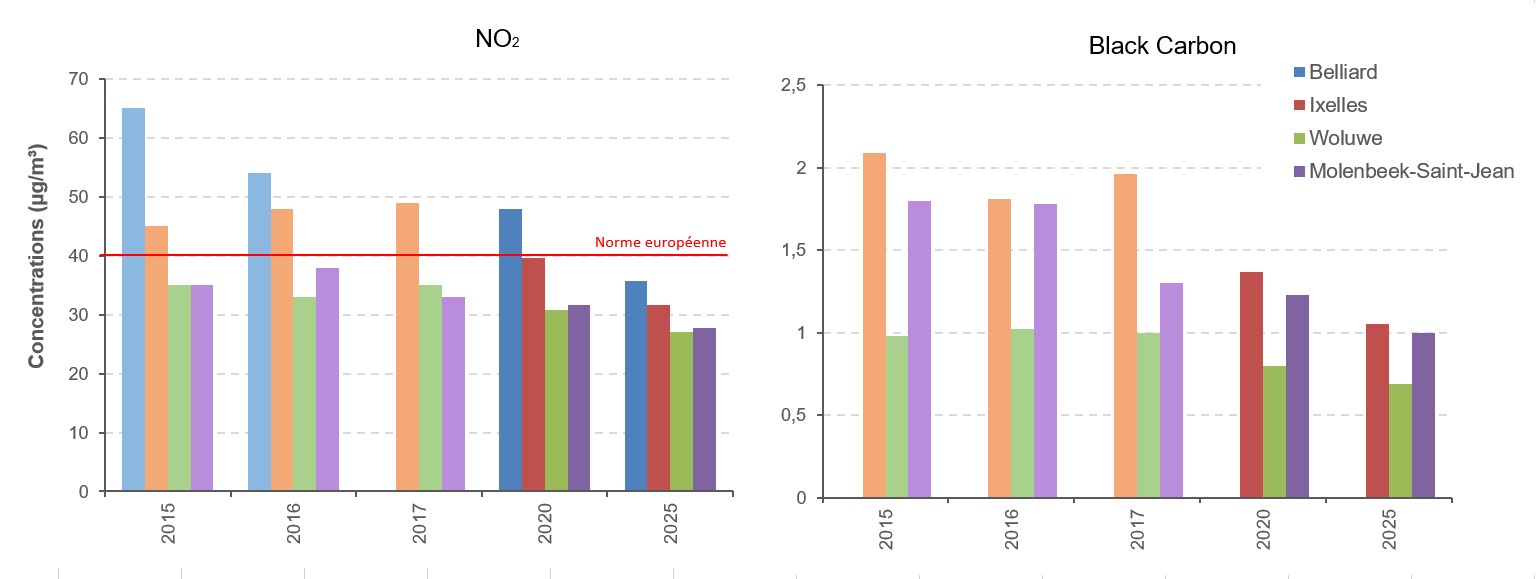
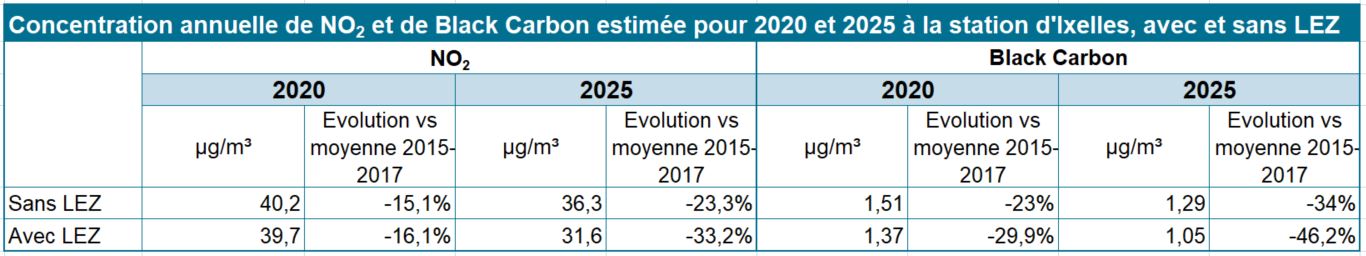
Les concentrations en NO2 et BC présenteraient une tendance à la diminution, avec ou sans LEZ. La LEZ viendrait accentuer cette tendance, en particulier aux endroits où le trafic est le plus dense.
Ainsi, par exemple, à la station d’Ixelles (caractéristique d’un milieu urbain sous forte influence du trafic et donc pour laquelle les diminutions seraient les plus marquées), les concentrations en NO2 diminueraient (avec LEZ) de 16% d’ici 2020 et de 33% d’ici 2025 par rapport à une moyenne des concentrations observées en 2015, 2016, 2017. Par rapport à un scénario sans LEZ, la LEZ permettrait d’obtenir une réduction supplémentaire de 1% en 2020 et de 10% en 2025.
À la même station, les concentrations en Black Carbon diminueraient (avec LEZ) de 30% d’ici 2020 et 46% d’ici 2025. La LEZ permettrait d’obtenir une réduction supplémentaire de 7% en 2020 et de 12% en 2025.
Selon ces modélisations, la norme légale européenne actuellement fixée pour les NO2 (concentration annuelle de 40 µg/m³) serait respectée dans l’ensemble des stations de mesure rapportées à l’Union européenne en 2020. Pour Belliard (station non rapportée à l'Union Européenne, en application de la directive 2008/50), la limite serait respectée entre 2020 et 2025. À noter qu’à la station Belliard, la norme pour le NO2 serait dépassée en 2025 dans un scénario sans LEZ (la concentration annuelle étant estimée à 42,8 µg/m³ dans ce cas de figure).
Il convient néanmoins de souligner que le calendrier actuel de la LEZ ne permet pas à lui seul d’atteindre les normes de qualité de l’air préconisées par l’Organisation Mondiale de la Santé, ni les engagements de la Région en matière de décarbonisation du transport, nécessaire à la lutte contre le réchauffement climatique. D’autres mesures devront par conséquent venir compléter la LEZ, tant au niveau de la mobilité (notamment la mise en œuvre de la sortie des moteurs thermiques et du plan GoodMove porté par Bruxelles Mobilité) que dans d’autres secteurs (comme le chauffage des bâtiments notamment).
À télécharger
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Rapport sur les incidences environnementales de "l’avant-projet de plan Régional Air-Climat-Energie" (voir en particulier les p. 52 et suivantes, .pdf)
- Low Emission Zone.brussels, 2019, "Effets attendus de la zone de basses émissions dur le parc automobile et la qualité de l'air en Région bruxelloise", Brochure, 21 pages,
- Bruxelles Environnement, 2018, "Evaluation de l’impact de réduction d’émissions de polluants sur leurs concentrations, rapport méthodologique", document interne
Etudes et rapports
- EEA, 2019, "Air quality in Europe - 2019 report", EEA Report n°10/2019, 104 pages
- icct, 2014, "Real-world exhaust emissions from modern diesel cars a meta-analysis of PEMS emissions data from EU (euro 6) and US (tier 2 bin 5/ulev ii) diesel passenger cars", white paper, 59 pages
- OMS, Centre International de Recherche sur le Cancer, 2012, "Les gaz d’échappement des moteurs Diesel cancérogènes", Communiqué de presse n° 213, 3 pages (.pdf)
- OMS, 2018, "Ambient (outdoor) air quality and health" (consulté en août 2019)
Liens utiles
Mise en place de la Zone de Basses Emissions : quel bilan ?
Focus - Actualisation : décembre 2023
Depuis la création de la Low Emission Zone à Bruxelles en 2018, un changement important de la composition du parc de véhicules en circulation dans la Région a été constaté. Ce changement s’accompagne d’une réduction des émissions d’oxydes d’azote (NOx), de particules fines (PM) et de Black Carbon. Découvrez si cela a un impact sur la qualité de l'air à Bruxelles.
Une zone de basses émissions à Bruxelles depuis le 1er janvier 2018
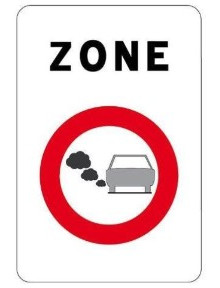 Dans l'objectif d’améliorer la qualité de l’air, une zone de basses émissions (ou en anglais « Low Emission Zone » - LEZ) a été mise en place à Bruxelles depuis le 1er janvier 2018. Elle couvre l’ensemble de la Région, à l’exception du Ring et de certaines voiries permettant d’accéder à des parkings de transit. Les voitures, les camionnettes (≤ 3.5t), les bus et autocars, qu'ils soient immatriculés en Belgique ou à l'étranger, sont concernés. Le principe poursuivi est d'interdire progressivement aux véhicules les plus polluants de circuler dans la zone, les critères d'accès (liés à la norme EURO et au type de carburant) se renforçant progressivement jusqu'en 2025 (voir le focus "Mise en place de la Zone de Basses Emissions : attentes" pour plus de détail). Ce calendrier a été étendu en 2022 jusqu’à 2036, avec pour objectif une disparition progressive des véhicules thermiques.
Dans l'objectif d’améliorer la qualité de l’air, une zone de basses émissions (ou en anglais « Low Emission Zone » - LEZ) a été mise en place à Bruxelles depuis le 1er janvier 2018. Elle couvre l’ensemble de la Région, à l’exception du Ring et de certaines voiries permettant d’accéder à des parkings de transit. Les voitures, les camionnettes (≤ 3.5t), les bus et autocars, qu'ils soient immatriculés en Belgique ou à l'étranger, sont concernés. Le principe poursuivi est d'interdire progressivement aux véhicules les plus polluants de circuler dans la zone, les critères d'accès (liés à la norme EURO et au type de carburant) se renforçant progressivement jusqu'en 2025 (voir le focus "Mise en place de la Zone de Basses Emissions : attentes" pour plus de détail). Ce calendrier a été étendu en 2022 jusqu’à 2036, avec pour objectif une disparition progressive des véhicules thermiques.
Concrètement,
- en 2018, l’interdiction ne portait que sur les véhicules diesel les plus anciens (sans norme EURO ou de norme EURO1). L'année 2018 a représenté une année charnière, avec une phase transitoire de 9 mois pendant laquelle l'information a été privilégiée, de façon générale comme de façon plus ciblée (via des courriers d'avertissements à partir de juillet 2018) ; les infractions ont été verbalisées à partir du 1er octobre 2018.
- De nouveaux véhicules ont été interdits de circulation en janvier 2019 : les véhicules diesel de norme EURO2 et les véhicules essence sans norme EURO ou de norme EURO 1. Une période de transition de 3 mois a été appliquée avant de passer à la verbalisation.
- En 2020, ce sont les véhicules diesel de norme EURO3 qui ont été concernés. Cette année a en outre été particulière de par la situation sanitaire (pandémie de COVID-19), qui a influencé fortement le nombre de véhicules en circulation. Aussi, les amendes ont été suspendues temporairement lors du confinement du printemps 2020 (mars-juin).
- Enfin, depuis le 1er janvier 2022, les voitures, minibus, camionnettes et bus ayant un moteur Diesel de norme EURO4 sont interdits. Il s’agit de la dernière génération de voitures diesel qui ne sont pas équipées de manière systématique d’un filtre à particules, ce qui correspond un à un jalon important en termes d’amélioration attendue de le qualité de l’air. A nouveau, une période de transition de 6 mois a été appliquée avant de passer à la verbalisation.
Les données issues des caméras LEZ : une source d’informations sur les véhicules en circulation en RBC
Pour analyser la mise en œuvre de la LEZ, la combinaison de deux sources de données est utilisée :
- Les données des caméras ANPR (ou "Automatic Number Plate Recognition", c'est-à-dire permettant d'identifier les plaques des véhicules), et
- des données provenant de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV), permettant d'obtenir des informations (anonymisées) sur le nombre de véhicules ayant circulé chaque jour dans la LEZ, ainsi que certaines de leurs caractéristiques comme le type de carburant, la norme EURO, ou la date de première immatriculation.
Notons que les données techniques des véhicules (norme EURO, carburant, etc.) ne sont renseignées que pour les véhicules belges et les véhicules étrangers qui se sont enregistrés, à l’exception des véhicules provenant des Pays-Bas. En outre, si les données obtenues par les caméras LEZ permettent d’avoir une information sur la composition du parc en circulation, elles ne permettent pas de connaître le nombre de kilomètres parcourus par ces véhicules.
Grâce à ces données, la composition du parc de véhicules en circulation en RBC est connue de façon beaucoup plus précise que précédemment (lorsque les données des véhicules immatriculées en Région bruxelloise étaient utilisées).
Ainsi, sur base des données des véhicules immatriculés en Belgique et circulant un jour moyen dans la LEZ en 2022, on observe que :
- La grosse majorité des véhicules belges en circulation sont des voitures (véhicules de catégorie M1, 87%). Les camionnettes (N1) représentent 10,5% du parc. Les autres types de véhicules sont sensiblement moins représentés.
- Environ 52% des véhicules sont immatriculés à Bruxelles, contre 36% en Flandre et 12% en Wallonie.
- 33,0% des voitures (M1) étaient des voitures diesel, 55,1% des voitures essence, 9,4% des véhicules hybrides (dont 8/10e avec un moteur thermique essence) et 2,4% étaient des véhicules électriques. Le parc de voitures en circulation présente un taux de véhicules diesel en nette diminution depuis mi-2018 (où il était de 62,3%). La part des véhicules électriques est quant à elle en nette croissance, même si encore limitée.
- La quasi-totalité des camionnettes (N1) en circulation a une motorisation diesel (93%).
Une nette réduction du nombre de véhicules belges concernés par les interdictions qui circulent
L’évolution de la composition des véhicules flashés permet d'appréhender l'effet de la LEZ. Une nette réduction du nombre de véhicules concernés par les interdictions en circulation par jour est ainsi observée : mi-2023, 99,2% des véhicules visés par la LEZ ayant circulé dans la zone étaient conformes, ou couverts par une dérogation ou par l’achat d’un day pass.
- Entre mi-2018 et début 2023, la part des voitures interdites début 2020 est passée de 4,5% à 0,1%, et celle des voitures interdites début 2022 de 14% à 0,5%.
- L’évolution est identique au niveau des camionnettes (N1) : entre mi-2018 et début 2023, la part des camionnettes interdites début 2022 est passée de 21% à 1,7%.
Une réduction importante de la proportion de voitures concernées par les interdictions en circulation
Source : Bruxelles Environnement sur base des données reçues par Bruxelles Fiscalité, 2023 ; données pour les voitures (M1) concernées par les interdictions mises en place début 2020 et début 2022 (en haut) et pour les camionnettes (N1, en bas)
Différents types de véhicules concernés peuvent circuler avec une dérogation. Celle-ci peut être octroyée de façon automatique (par exemple pour les véhicules de plus de 30 ans ayant une plaque "O" ou les autocaravanes), ou sur demande (comme par exemple des véhicules équipés pour les personnes en situation de handicap ou adaptés pour les marchés) :
- Mi-2023, le nombre de véhicules non conforme à la LEZ bénéficiant d’une dérogation est relativement faible : il s’agit de 0.1% du trafic (491 véhicules par jour sur les 364.000 qui circulent dans la LEZ chaque jour).
- La catégorie la plus importante correspond aux véhicules 'old-timer' de plus de 30 ans. Viennent ensuite les véhicules prioritaires et les véhicules adaptés pour les personnes à mobilité réduite d’une part et pour les marchés, foires, parades et commerces ambulants d’autre part.
Environ 500 véhicules par jour circulent en moyenne mi-2023 dans la LEZ sous le couvert d’une dérogation
Source : Bruxelles Environnement sur base des données reçues par Bruxelles Fiscalité, 2023
#mise-en-place-de-la-zone-de-basses-emissions-attentesPour ce qui est des véhicules immatriculés à l’étranger, en 2022 :
- la part des véhicules étrangers ayant circulé dans la LEZ est de 5% en moyenne par jour ;
- le taux d’enregistrement est de 11,7%, ce qui représente une augmentation par rapport aux années 2020 et 2021 qui connaissaient un taux de 9% mais présente encore un grande marge de progression.
Quel impact sur les émissions de polluants dans l'air par le transport routier en RBC ?
Les émissions d’oxydes d’azote (NOx), de particules fines (PM 10 et PM2.5) et de Black Carbon (type de particules très fines pour rappel) provenant des véhicules en circulation ont été estimées pour chaque année depuis la mise en œuvre de la LEZ, pour une semaine de référence :
- La composition du parc lors de la semaine 25 de 2018 (fin juin) sert de base à la comparaison et représente la situation pré-LEZ (avant l’envoi des premières amendes) ;
- La semaine 40 (début octobre) est sélectionnée comme semaine de référence pour les années suivantes, en raison de sa représentativité : elle se situe en dehors des périodes de vacances scolaires et n'est pas influencée par d'autres événements susceptibles de perturber la mobilité à Bruxelles.
Notons que cette analyse se distingue des résultats des projections (repris dans le focus "Mise en place de la Zone de Basses Emissions : attentes") de deux manières :
- l’analyse menée ici porte sur une période écoulée (observations) et non pas sur l’avenir (projections) ;
- cette analyse se base sur les données du parc en circulation obtenues par les caméras ANPR et non sur le parc de véhicules immatriculés dans la Région à l'époque.
Les données suivantes ont été utilisées :
- le nombre de véhicules tous types confondus en circulation sur base des images caméras ANPR, avec répartition en fonction du type de carburant (essence, hybride-essence, gasoil (moteur diesel) et LPG) et de la norme EURO (données provenant de la DIV) ;
- la distance moyenne parcourue chaque année par chaque catégorie de véhicules sur la période étudiée, selon le dernier inventaire d’émissions de la RBC portant sur l’année 2021 (inventaire soumis en 2023). A noter que, pour isoler le mieux possible l’effet de la composition du parc (principal paramètre influencé par la LEZ) sur les émissions, l'hypothèse posée est que le nombre total de kilomètres parcourus est constant. Cette distance totale est répartie entre les différents types de véhicules en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par chaque type de véhicules. Ceci rend les résultats théoriques : dans les faits, par exemple, le nombre de kilomètres parcourus en 2020 a diminué de manière importante du fait du confinement.
- Les facteurs d’émissions pour chaque sous-catégorie de véhicule, selon le dernier inventaire d’émissions de la RBC portant sur l’année 2021 (inventaire soumis en 2023). Notons que les facteurs d’émissions sont définis de manière standardisée à l’échelle européenne (COPERT), qui sont régulièrement mis à jour pour tenir compte des dernières connaissances disponibles.
Ainsi, une réduction importante des émissions totales du parc en circulation, modélisées pour 2018 à 2022, est observée :
- Réduction de 31% pour les NOX
- Réduction de 62 % pour le black carbon
- Réduction de 19 % pour les PM10
- Réduction de 30 % pour les PM2.5.
Les émissions du trafic en circulation ont fortement diminué depuis l’instauration de la LEZ
Source : Bruxelles Environnement sur base des données reçues par Bruxelles Fiscalité, 2023 ; émissions tous véhicules confondus 2018 = 100
Concernant le CO2, les émissions sont restées constantes. Ceci s’explique principalement par le shift des motorisations diesel vers essence, alors que les motorisations zéro-émission à l’échappement (véhicules électriques) restent encore marginales dans le parc total.
La réduction du nombre de véhicules les plus polluants en circulation observée depuis la mise en œuvre de la LEZ explique cette évolution. La LEZ y contribue via les interdictions de circulation de ces véhicules, et car elle oriente le choix lors de l’achat (tout comme d’autres mesures comme l’évolution de la fiscalité sur les voitures (de société) ou l’évolution des accises sur les carburants).
Quel impact sur les concentrations de polluants dans l'air ?
L’objectif de la mesure étant d’améliorer la qualité de l’air en RBC, le suivi de l’évolution des concentrations de polluants mesurées aux différentes stations de mesure de la Région est fondamental pour l’évaluation de la LEZ. Les polluants dont les émissions sont fortement liées au trafic routier sont en particulier intéressants dans ce cadre : le NO2 et le Black Carbon. Cela permet de vérifier si les effets anticipés de la LEZ sur la qualité de l’air seront matérialisé dans les faits (voir le focus "Mise en place de la Zone de Basses Emissions : attentes" pour plus de détail).
De manière générale, on observe une tendance positive, à la baisse, de l’évolution des concentrations de l’ensemble des polluants mesurés en RBC:
- Sur la période 2018-2022, une réduction des concentrations en NO2 de 10% par an est observée en moyenne sur l’ensemble des stations de mesures bruxelloises. Ainsi, les valeurs limites européennes pour le NO2 entrées en vigueur en 2010 ont été respectées en 2020, 2021 et 2022sur l’ensemble des stations rapportées auprès de l’UE (voir aussi l'indicateur "Qualité de l'air : concentration en dioxyde d'azote (NO2)"). Cependant, toutes les stations demeurent au-dessus de la valeur recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
- Les concentrations de Black Carbon sont en forte baisse sur l’ensemble des stations bruxelloises, quel que soit le type d’environnement : depuis 2020, elles sont de l’ordre de 1 μg/m³ ou moins. Ceci s’explique notamment par le fait que le Black Carbon est principalement émis par les motorisations diesel, et en particulier, celles qui ne sont pas équipées d’un filtre à particules, qui sont en nette diminution.
Bon à savoir
En agissant sur le changement de motorisation du parc automobile, la LEZ contribue donc aux réductions observées, dans la mesure où les concentrations de NO2 et Black Carbon sont fortement liées au trafic. Toutefois, il n’est pas possible de quantifier de manière précise dans quelles proportions la LEZ contribue à ces améliorations. D’autres facteurs influencent en effet les concentrations observées, en particulier les conditions météorologiques ou la réduction du trafic en 2020 suite aux confinements.
Un exercice de modélisation de la qualité de l’air a également été mené en 2022. Celui-ci permet d’isoler et donc d’évaluer l’impact de l’évolution du parc automobile sur les concentrations de polluants respirés dans la capitale.
Cet exercice de modélisation a été réalisé dans le cadre d’un projet mené par Bruxelles-Environnement et l’Université Catholique de Louvain, financé par Bloomberg Philanthropies, sur base :
- des émissions sur une semaine (la semaine 40 des années 2018 à 2022) calculées au point 1 Emissions,
- de la topologie du réseau de voiries de la Région,
- du modèle SIRANE.
Notons que, à nouveau, seul l’impact de la modification du parc en circulation entre 2018 et 2022 sur la qualité de l’air a été analysé, à mobilité constante (les kilomètres parcourus sont identiques chaque année) et à météo et pollution de fond similaire.
Les résultats mettent en évidence que l’évolution de la composition du parc qui circule a un impact significatif sur la qualité de l’air dans la capitale. Ainsi, dans les zones les plus touchées par la pollution de l’air (les axes les plus fréquentés comme le ring, les entrées de ville, la petite et la grande ceinture ou les rue de la Loi et Belliard), elle a permis de diminuer les concentration en NO2 d'environ 30% entre juin 2018 (avant la mise en place de la LEZ) et octobre 2022.
Une concentration moyenne en NO2 modélisée en réduction entre 2018 et 2022
Source : Modèle SIRANE, projet Bruxelles-Environnement et Université Catholique de Louvain financé par Bloomberg Philanthropies (2023)
À télécharger
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Mise en place de la Zone de Basses Emissions : attentes
- Caractéristiques environnementales du parc automobile bruxellois
- Qualité de l'air : concentration en dioxyde d'azote (NO2)
- Qualité de l'air : concentration en particules fines (PM10)
- Qualité de l'air : concentration en particules très fines (PM 2.5)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Bruxelles Environnement, 2022, "Evaluation de la zone à basses émissions – rapport 2022", Rapport technique, 32 pages
Liens utiles
La mobilité des entreprises par les plans de déplacement d’entreprises 2017
Focus - Actualisation : février 2020
Obligatoire pour toute entreprise occupant plus de 100 travailleurs sur un même site à Bruxelles, le Plan de Déplacements d’Entreprise (PDE) vise à sensibiliser les travailleurs à opter pour des moyens de transports plus durables. Cette obligation en vigueur depuis 2004 pousse les entreprises à élaborer une politique de mobilité interne. Tous les 3 ans, celles-ci sont tenues de mettre le plan à jour. Les données présentées sont issues de la dernière mise à jour des PDE en 2017.
Les plans de déplacement d’entreprise
Le Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE) est une obligation en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale depuis 2004. Elle oblige les entreprises comptant plus de 100 personnes travaillant sur un même site à mener une politique interne de mobilité durable. Le plan, établi pour une période de trois ans comporte deux volets : un ‘diagnostic’ et un ‘plan d’actions’ et porte tant sur les déplacements domicile-travail des employés, que sur les déplacements professionnels ainsi que ceux des visiteurs. L’objectif des PDE est de rationaliser les déplacements motorisés et de provoquer un transfert vers des modes plus durables, avec à terme une amélioration de la qualité de l'air et du trafic de la Région de Bruxelles-Capitale.
Choix modaux des travailleurs
Pour la mise à jour prévue en 2017, Bruxelles Environnement a reçu 478 dossiers de PDE complets, ce qui représente 85% des entreprises soumises à l’obligation.
Au total, 40% des travailleurs de la RBC sont concernés par les PDE, dont une majorité provient de l’extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale (65% de l’échantillon). L’analyse de leurs choix modaux prend uniquement en compte le mode principal de transport, c’est-à-dire celui utilisé le plus souvent et sur la plus longue distance.
Les données transmises pour 2017 montrent que le train est devenu le mode de transport le plus utilisé (36.2% de part modale), devant l’usage de la voiture individuelle (34.1%). La voiture affiche en effet un déclin progressif depuis une dizaine d’année.
Par ailleurs, l’usage du vélo est en forte augmentation, passant de 2.8% de part modale à 4.5 % en l’espace de 6 ans. L’usage de la STIB est relativement stable (19%) tandis que la marche est en très légère diminution.
Figure 1 : Les parts modales (échantillon de 313 entreprises)
Source : Les plans de déplacements d’entreprise en Région de Bruxelles-Capitale - Bilan de la situation 2017. Bruxelles Environnement, 2019
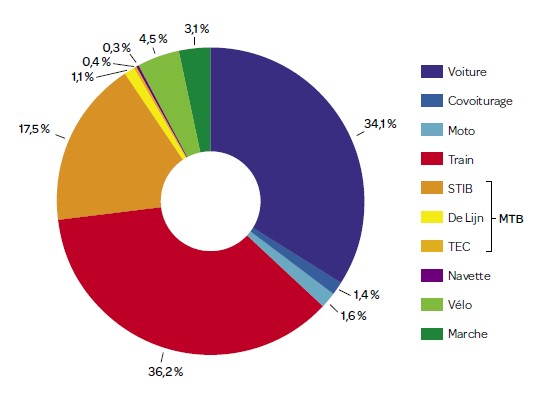
L’accessibilité versus la distance
Les choix modaux des travailleurs sont influencés par différents facteurs, dont les deux principaux sont le niveau d’accessibilité de l’entreprise en transport en commun (lié à la localisation de l’entreprise) et le lieu de résidence des travailleurs (dans ou hors de la région bruxelloise).
À Bruxelles, deux logiques de localisation d’entreprise coexistent :
- D’une part, des localisations favorisant l’accessibilité en transports en commun, où une bonne desserte en train se conjugue à un accès aisé en métro.
- D’autre part, des localisations en bordure de grands axes routiers.
La carte ci-dessous présente la répartition des modes de déplacements domicile-travail en fonction de la localisation des entreprises. Les entreprises de la zone centrale de la Région bruxelloise, les mieux localisées du point de vue de l’accessibilité des transports en commun, présentent les parts modales de train les plus élevées et celles des modes motorisés (notamment la voiture) les plus basses. A contrario, les modes de déplacements motorisés sont privilégiés dans la zone d’accessibilité « moyenne », qui correspond aux localisations plus périphériques.
La zone où l’accessibilité est « bonne » présente une plus grande diversité de schémas de répartition modale, avec une prépondérance des transports en communs urbains et des modes doux que sont le vélo et la marche. Dans cette zone, les entreprises emploient davantage des travailleurs bruxellois, dont les distances domicile-travail sont souvent inférieures à 10 km, ce qui explique la part importante de ces modes de proximité (Bruxelles Environnement, 2019). L’usage de la voiture apparaît finalement davantage corrélé à une faiblesse de l’accessibilité en transports en commun qu’à la distance domicile-travail (voir la Fiche documentée « Défis et solutions pour une mobilité durable : Les plans de déplacement d’entreprise 2017 » ).
Répartition modale des déplacements domicile-travail des travailleurs en fonction de la localisation de l’entreprise
Source : Bruxelles Environnement, 2020, sur base des données PDE 2017
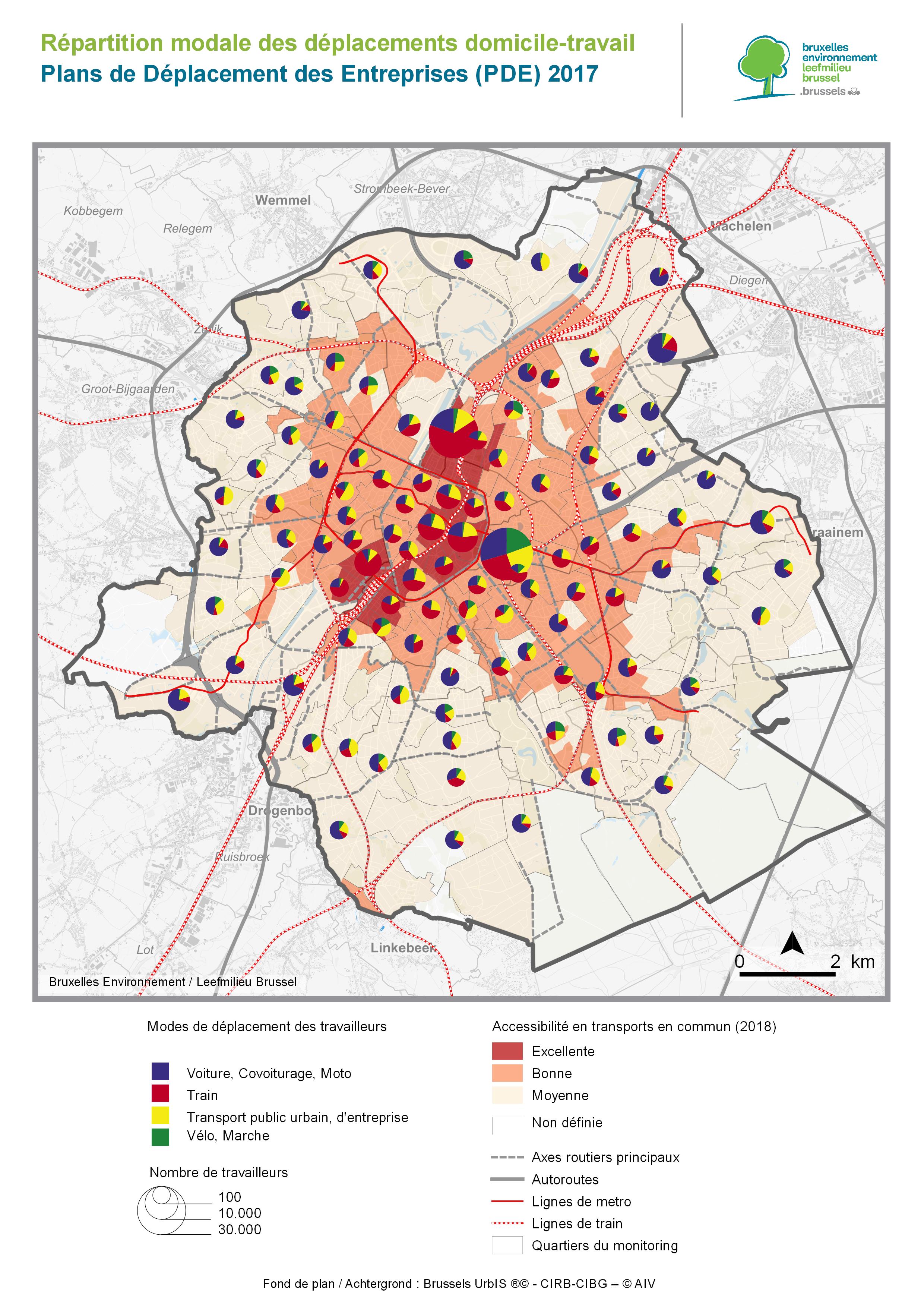
(Accédez à la carte interactive, mise à jour avec les données les plus récentes)
Les mesures des PDE
Le choix modal des travailleurs est également lié à d’autres facteurs, notamment les mesures prises par les entreprises en matière de mobilité. À titre d’exemple, la disponibilité d’un parking à destination est un élément déterminant du choix de mode de transport : si un parking est assuré, l’utilisation de la voiture est plus élevée, et inversement.
Le PDE doit présenter les mesures adoptées par les entreprises pour gérer la mobilité des travailleurs et des visiteurs. Tandis que certaines mesures sont obligatoires, d’autres sont facultatives. Elles se répartissent en quatre axes :
- la sensibilisation et l’information (par exemple, une rubrique mobilité sur le site internet, une formation vélo, etc.),
- les infrastructures et les services (par exemple, un parking vélo, des douches et vestiaires, une base de données de covoiturageSystème de transport qui consiste à partager l'utilisation d'une voiture particulière entre plusieurs personnes, principalement pour les trajets domicile-travail., du matériel et un service d’entretien vélo, etc.),
- les incitants financiers (par exemple, l’indemnité vélo ou covoiturage, le remboursement des abonnements aux transports en commun, etc.),
- le télétravailTravail effectué à distance avec l'utilisation de la télématique, lien entre le travailleur et l'entreprise..
L’éventail des mesures que les entreprises proposent à leurs travailleurs pour favoriser une mobilité plus durable s’est fortement élargi entre 2011 et 2017.
Tandis que certains éléments, tels que la localisation des entreprises ou le lieu de résidence des travailleurs, sont relativement fixes, d’autres aspects de la mobilité des entreprises ont évolué. Ceci se traduit notamment dans la baisse de la part modale de la voiture et la progression de celle du vélo, des évolutions qui signalent des changements d’habitude de déplacement parmi les travailleurs de la Région bruxelloise.
À télécharger
Fiche(s) de l’Etat de l’Environnement
- Mobilité et transports en Région bruxelloise
- BRUXELLES ENVIRONNEMENT, 2016. « Focus : Bilan des plans de déplacements des entreprises », Synthèse 2011-2012.(pages 109 et suivantes) (.pdf)
Fiches documentées
- 12. Défis et solutions pour une mobilité durable : les plans de déplacement d'entreprise 2017 (.pdf)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- BRUXELLES ENVIRONNEMENT, 2019. « Les plans de déplacement d’entreprise en Région de Bruxelles-Capitale. Bilan de la situation 2017 », 32 pp.(.pdf)
- BRUXELLES ENVIRONNEMENT, 2016 ; « Les plans de déplacements d’entreprise en Région de Bruxelles-Capitale Bilan de la situation 2014 ». 107 pp (.pdf)
Etude(s) et rapport(s)
Plan(s) et programme(s)
Liens utiles
Good food : Agriculture professionnelle en Région bruxelloise
Focus - Actualisation : septembre 2022
Depuis la mise en œuvre de la stratégie Good food : - le nombre d’entreprises d’agriculture urbaine a augmenté (de 6 à 42 entre 2015 et 2020) ; - tout comme les emplois qui y sont directement liés (de 63 équivalents temps plein à 80 entre 2018 et 2020). Ces 42 entreprises sont réparties sur environ 20 ha (5 ha en 2015) dont 12 sont alloués au maraîchage en pleine-terre. La majorité de la production est destinée au marché bruxellois. La Région bruxelloise compte par ailleurs environ 230 ha de terres agricoles bénéficiant de subsides de la Politique Agricole Commune européenne. Celles-ci sont principalement gérées par une trentaine d’entreprises agricoles. Leur production est essentiellement le fait d’agriculteur∙rice∙s « historiques » et surtout destinée à l’élevage. Les parcelles de maraîchage y sont encore très rares. Un peu plus de 6% de l’ensemble des terres régionales cultivées sont certifiées bio ou en cours de certification.
Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie
La stratégie Good food, adoptée en 2015, vise une transition du système alimentaire bruxellois vers un système plus durable. Elle inclut notamment un axe relatif à l’augmentation de la production alimentaire locale. Cet enjeu répond tant à des défis globaux (protection de la nature et de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). et lutte contre le dérèglement climatique) qu’à des défis locaux (sociaux, de santé, d’économie et d'emplois).
L'évaluation de cette stratégie, réalisée en 2020, a permis de mettre en évidence les progrès réalisés mais aussi des faiblesses et opportunités à prendre en compte dans la révision de ce programme. Par ailleurs, le contexte troublé (les changements climatiques, la crise sanitaire et, plus récemment, la guerre en Ukraine) a rappelé l’urgence de requalifier notre système alimentaire, et toute l’économie y afférente, vers un modèle plus durable et résilient. Il a aussi mis en avant la question de la sécurité alimentaire.

Un processus de co-construction, mené avec de nombreux acteurs et actrices représentant toute la chaîne alimentaire, a abouti à l’élaboration et à l’adoption, en 2022, de la stratégie Good Food 2 (2022-2030).
Celle-ci comporte maintenant 5 axes dont le premier vise à :
- Intensifier et soutenir une production agroécologique professionnelle à Bruxelles et en périphérie en :
- assurant la protection des terres (à potentiel) agricole(s) ;
- garantissant l’accès de ces terres aux agriculteur∙rice∙s ;
- soutenant les producteur∙rice∙s (accompagnement technique et commercial, soutien financier) ;
- intensifiant les échanges entre la Région et les villes et acteur∙rice∙s belges autour de la production primaire alimentaire.
- Développer et soutenir une production alimentaire citoyenne et mixte dans l’espace public, semi-public et privé pour contribuer à la fois à des fonctions écologiques (services écosystémiquesEnsemble des services rendus par les sols à l’environnement et de facto à notre société : fourniture d’eau potable, limitation des inondations, stockage du Carbone atmosphérique, support pour la faune et la flore...)), sociales, pédagogiques et, dans une certaine mesure, à l’accessibilité alimentaire des plus démunis.
Pour atteindre ces objectifs, la Région encourage et soutient le développement de projets d’agricultures urbaines dans ses différentes formes : agriculture professionnelle de pleine terre et hors sol, potagers et poulaillers collectifs, productions individuelles, etc.
Agriculture urbaine et périurbaine : de quoi parle-t-on ?
L'agriculture urbaine et périurbaine est un système de production agricole qui s'intègre dans les paysages (péri)-urbains et dont la production est destinée à la ville. C'est une agriculture multifonctionnelle qui s'adapte au contexte dans lequel elle se développe (dynamiques de quartiers, contraintes spatiales, qualités des terres, contraintes juridiques et urbanistiques...) et valorise des espaces et des dynamiques sociales. Les sites de production (terres agricoles mais aussi friches, toits, sous-sols, parkings, etc.), les supports de production (pleine terre, hors sol en hydro/ aquaponie ou sur résidus de consommation...), les types de production (maraichage, horticulture, élevage, aquaculture, agroforesterie, ), les acteur-rice-s (agriculteur-rice-s, promoteur-rice-s immobiliers, associations, citoyen-ne-s...) et les systèmes de distribution (vente sous forme de paniers, auto-cueillette, vente sur le champ, en magasin, ...) sont multiples et induisent le développement de nombreux modèles de production. Des formes « professionnelles » (à finalité essentiellement marchandes) coexistent avec des formes « non professionnelles » (sans vocation commerciale).
L'agriculture urbaine est multifonctionnelle : les acteurs et actrices de l'agriculture urbaine remplissent une multitude de fonctions dont certaines relèvent de l'intérêt général: production alimentaire, fonctions environnementales (dont l'intégration/maintien d'espaces verts et d’îlots de fraîcheur dans l'espace urbain, conservation/régénérationEn sylviculture, opération consistant à remplacer un peuplement mûr soit par voie naturelle, soit par voie artificielle. des écosystèmes et préservation de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). et des paysages), sociales (favorisation de la cohésion sociale, insertion socio-professionnelle), éducatives (sensibilisation du grand public aux multiples thématiques de l'alimentation durable, à la nature), contribution à l'attrait de la ville, etc.
Source : Stratégie Good food 2 2022-2030
Agriculture urbaine en Région bruxelloise

Ce focus fait un état des lieux de la production agricole professionnelle c’est-à-dire à vocation au moins partiellement économique. Il s’appuie sur plusieurs études et bilans concernant le développement de l’agriculture urbaine en Région bruxelloise (voir ci-dessous, partie « documents »). La question de la production à des fins de consommation privée (autoproduction ou agriculture urbaine non marchande) est abordée dans un autre focus consacré aux potagers collectifs et familiaux.
Bon à savoir
Selon la Stratégie Good food 2, l'agroécologie repose tout d'abord sur une série de principes et de pratiques qui améliorent la résilience et la durabilité des systèmes alimentaires et agricoles tout en préservant l'intégrité sociale. C'est aussi un mouvement de nature socio-politique et scientifique, qui concilie l'activité humaine et la préservation des écosystèmes naturels. Elle développe une approche multidimensionnelle de la gestion des ressources naturelles et humaines. C'est une alternative au modèle agricole dominant le marché, basé sur l'exploitation des éléments naturels et des êtres humains. Au sein d'un contexte urbain, l'agroécologie invite à repenser le rapport entre les citadin-e-s et leur propre contexte environnemental et social. Elle fédère les communautés et les quartiers autour de projets de proximité, pensés comme des espaces de convivialité et d'apprentissage.
En 2020, 230 ha de terres bruxelloises bénéficient de subsides dans le cadre de la politique agricole commune
En Région bruxelloise, l’agriculture urbaine professionnelle est pratiquée par différents acteurs : agriculteur∙rice∙s inscrit∙e∙s à la politique agricole commune ou non, petites et moyennes entreprises (PME), associations ou encore, coopératives.
Bon à savoir
La politique agricole commune (ou PAC) est une politique mise en place à l'échelle de l'Union européenne pour développer et soutenir les agricultures des États membres. Dans ce cadre, les agriculteur∙rice∙s peuvent bénéficier à certaines conditions d’aides directes au revenu.
En 2020, 230 ha de terres agricoles localisées en Région bruxelloise sont enregistrés dans le cadre de l’aide directe de la PAC. Ceci représente environ 1,4% de la superficie régionale. Les parcelles concernées sont fortement morcelées mais se concentrent essentiellement au nord-ouest de la Région et, en particulier, à Neerpede.
La moitié de ces 230 ha est localisée en zone agricole et 65 ha en zones vertes et zone verte à haute valeur biologiqueValeur reconnue d'un site coté sur base d'une série de critères tels que : la présence d'éléments hydrologiques peu perturbés (sources), la diversité et la rareté des espèces locales de plantes et d'animaux, la présence d'espèces rares, la maturité des végétations (site irremplaçable sauf à très long terme, ex. une forêt séculaire), etc. telles que définies au niveau du plan régional d’affectation du sol (PRASLe Plan régional d'Affectation des Sols est l'un des outils majeurs de la politique d'aménagement du territoire régional. Il comprend des prescriptions générales pour l'affectation des sols, des cartes délimitant des zones d'affectation et des prescriptions particulières par zone (notamment pour la protection des espaces verts). Il constitue en outre la référence légale pour l'octroi des permis d'urbanisme, de primes à la rénovation, etc. Il transcrit par ailleurs les objectifs opérationnels du PRD en carte.).
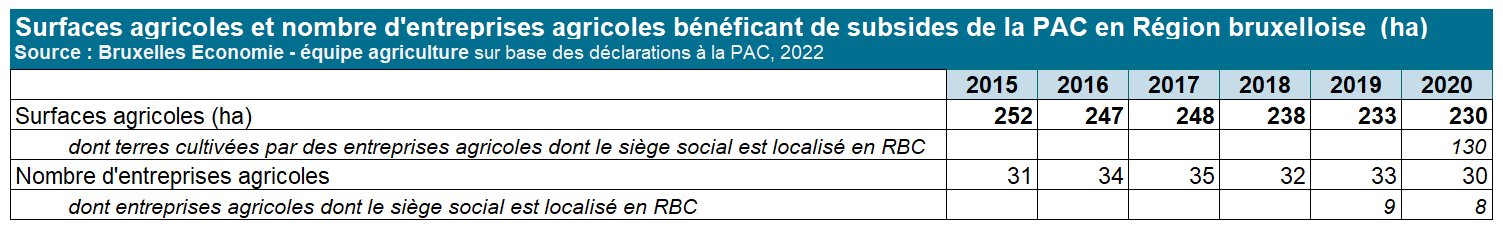
Ces terres sont gérées par une trentaine d’entreprises agricoles (le nombre exact d’équivalents temps plein liés à ces entreprises n’est pas connu), dont 8 pour lesquelles le siège social est localisé en Région bruxelloise (une 9eme déclare 0,5 ha pour un terrain non cultivé comportant un bâtiment agricole).
On observe ces dernières années une réduction des superficies déclarées à la PAC (ce qui ne signifie néanmoins pas que ces terres ne sont plus exploitées). Cette évolution s’explique en partie par des décès ou départs à la retraite d‘agriculteur∙rice∙s historiques. Le devenir des terres qu’ils ou elles exploitaient n’est cependant pas toujours connu avec précision. Certaines d’entre elles sont reprises par d’autres agriculteurs. Par ailleurs, des terres auparavant déclarées à la PAC par des agriculteur∙rice∙s émergent∙e∙s ne le sont plus mais continuent néanmoins d’être exploitées.
Bon à savoir
Deux profils de professionnel-le-s agricoles coexistent en Région bruxelloise :
- D’une part, des agriculteur∙rice∙s « historiques » : il s’agit d’agriculteurs et agricultrices issu∙e∙s du monde agricole et souvent relativement âgé∙e∙s. En Région bruxelloise, ils et elles travaillent généralement sur des terrains de plusieurs hectares déclarés à la PAC.
- D’autre part, des « agriculteur∙rice∙s émergeant(e)s » : ils et elles sont le plus souvent non issu∙e∙s du milieu agricole (d’où leur autre dénomination : « NIMAculteur∙rice∙s »). En Région bruxelloise, ils et elles travaillent généralement sur des plus petites surfaces que les agriculteurs et agricultrices historiques, en pleine terre ou en hors sol et sont généralement en lien direct avec les consommateur∙rice∙s.
La majeure partie de ces terres sont cultivées par des agriculteur∙rice∙s historiques travaillant dans différents secteurs (voir tableau ci-dessous). En 2020, 9 ha déclarés à la PAC sont par ailleurs exploités par des agriculteur∙rice∙s émergent∙e∙s : 4,7 ha pour de l’élevage ovin, 3,3 ha pour l’espace test agricole s’inscrivant dans le cadre du projet BoerenBruxselPaysans (environ 1,5 ha cultivés, le reste étant constitué des bâtiments agricoles) et 1 ha pour du maraîchage. En 2017, 9 ha étaient aussi déclarés à la PAC par 2 agriculteur∙rice∙s émergent∙e∙s.
Le tableau ci-dessous détaille les superficies déclarées à la PAC par type de culture :

Les prairies permanentes consacrées au pâturage (dont équin) sont largement majoritaires (145 ha en 2017 sur base de données du Laboratoire d’agroécologie – ULB) et les grandes cultures (plantes fourragères, céréales et pommes de terre) occupent environ 80 ha. A l’opposé, les surfaces de maraîchage (y compris fleurs, herbes médicinales, etc.) déclarées auprès de la PAC ne couvrent que 2,5 ha. Contrairement aux projets d’agriculture urbaine, l’agriculture historique présente en Région bruxelloise n’est pas, ou que très peu, destinée aux consommateur∙rice∙s bruxellois∙e∙s.
En 2017, la superficie cultivée au niveau de la périphérie bruxelloise (soit 19 communes attenantes ou très proches de la limite régionale) était de 12 257 ha. Le maraîchage n’y occupait que 5%, le reste des cultures étant largement dominé par les céréales, prairies, maïs fourrager et pommes de terre.
Aucune des cultures déclarées à la PAC n’est certifiée bio mais certaines d’entre elles sont en cours de conversion.
Depuis le lancement de la stratégie, les projets d’agriculture urbaine se sont fortement multipliés, ils couvrent de l’ordre de 20 ha en 2020
Parallèlement à l’agriculture historique, il existe de nombreux projets d’agriculture urbaine en Région bruxelloise : maraîchage pleine terre, culture de champignons, élevage d’insectes, aquaponie, hydroponie, etc. Les porteurs de ces projets ne sont pas enregistrés à la PAC.
Une étude a été réalisée début 2018 et actualisée en 2020 afin d’évaluer la production agricole urbaine primaire professionnelle en Région bruxelloise ainsi que son évolution entre le lancement de la Stratégie Good Food fin 2015 et 2020. Les principaux résultats montrent qu’entre 2015 et 2020, le nombre de projets d’agriculture urbaine est passé de 16 à 42 (32 en 2018). Ces projets emploient 80 équivalents temps plein (62 ETP en 2018) et leur superficie non déclarée à la PAC représente environ 20 ha (environ 6 ha cultivés par des NIMAculteurs et non déclarés à la PAC en 2017-2018). La comparaison entre les chiffres 2018 et 2020 doit néanmoins se faire avec prudence étant donné que les méthodes de récolte de données diffèrent. Une forte tendance à la hausse est cependant bien observée. Notons que les agriculteurs émergents qui ont des parcelles déclarées à la PAC ont aussi des parcelles non déclarées
Ces projets d’agriculture urbaine sont en grande partie localisés en dehors des zones agricoles délimitées dans le PRASLe Plan régional d'Affectation des Sols est l'un des outils majeurs de la politique d'aménagement du territoire régional. Il comprend des prescriptions générales pour l'affectation des sols, des cartes délimitant des zones d'affectation et des prescriptions particulières par zone (notamment pour la protection des espaces verts). Il constitue en outre la référence légale pour l'octroi des permis d'urbanisme, de primes à la rénovation, etc. Il transcrit par ailleurs les objectifs opérationnels du PRD en carte., généralement dans des zones protégées (zones vertes, zones de parcs, patrimoine culturel, Natura 2000) (voir carte). Les prescriptions du PRAS ne sont pas claires par rapport à la possibilité de mener des activités agricoles dans ces zones.
Répartition des projets d’agriculture urbaine selon leur typologie (2018 et 2020)
Source : Bruxelles économie – équipe agriculture
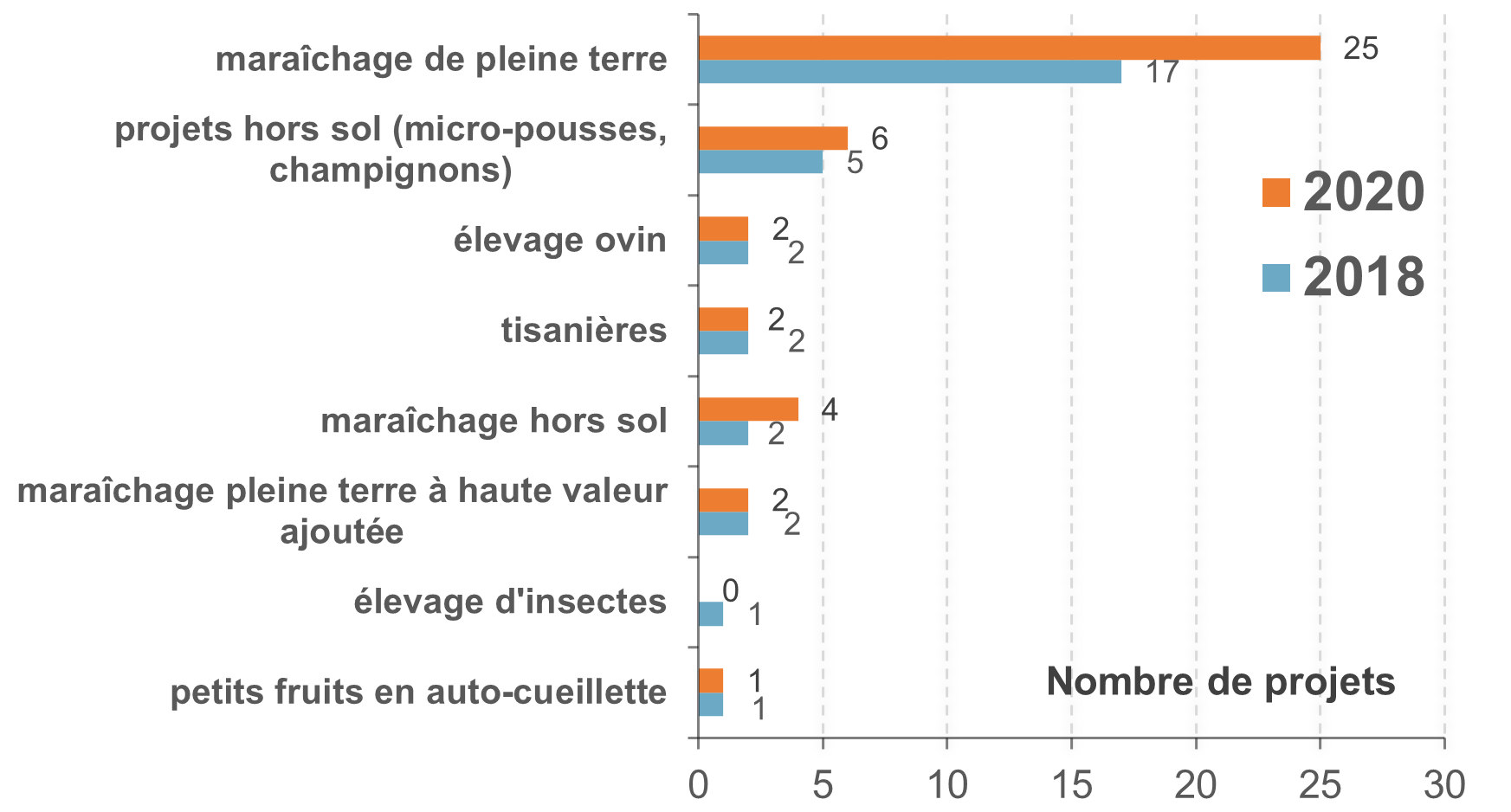
En termes de superficie, environ :
- 12 ha sont dédiés au maraîchage en pleine terre (dont 0,4 ha de tisanières, plantes aromatiques et médicinales) ;
- 1 ha à la production de petits fruits ;
- 3 ha à l'élevage ovin (prés-vergers) ;
- 0,6 ha à la production hors sol.
Sur base de l’estimation faite en 2018 (Laboratoire d’agroécologie – ULB), on peut estimer que la production en fruits et légumes par l’agriculture urbaine bruxelloise est de l’ordre du dixième de pourcents (0,1 à 0,3 %) de la demande bruxelloise (Evaluation de la stratégie Good food 2.0, annexe I). La plupart des projets bruxellois d’agriculture urbaine sont multifonctionnels, produisant aussi des services dans les domaines de l’éducation, de la santé, du lien social, de la culture, du patrimoine et de l’environnement.
Bon à savoir
Le maraîchage est une forme d’agriculture particulièrement intéressante en milieu urbain : cycles de production courts, production de produits périssables nutritionnellement intéressants qui peuvent être commercialisés en filières courtes, diversité des produits et pratiques agricoles, support à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., fonction sociale et pédagogique forte, absence ou faible mécanisation agricole, forte intensité en main d’œuvre avec, en corollaire, la création d’emplois…
Une quinzaine de ces entreprises agricoles sont labellisées bio (dont 3 producteurs hors sol) et 9,62 ha de terres sont certifiées bio (6,27 ha sont en cours de conversion vers le bio).
Des actions pour soutenir l’agriculture professionnelle bruxelloise
Pour encourager et soutenir ce développement de l’agriculture urbaine, la stratégie Good food a travaillé à améliorer l’accès des producteurs aux principaux facteurs nécessaires à la pérennité de leur activité, à savoir :
- Accès aux lieux de production
L’accès à long terme à des lieux de production adaptés constitue le premier obstacle au développement de projets d’agriculture urbaine. Les facteurs sont multiples : rareté des terres disponibles, manque de transparence, pollutions des sols, pression immobilière due entre autres à l’essor démographique, coût des terrains, précarité des baux, cadre juridique et règlementaire inadapté, etc.
Bon à savoir
Selon une étude réalisée par Terre-en-vue en 2016-2017 et basée à la fois sur une approche cartographique et sur une enquête auprès des communes afin de tenir compte de la réalité du terrain, le potentiel de terres agricoles non encore cultivées serait d’environ 161 ha. Vu le contexte urbain et la croissance démographique forte que connaît la Région, ce potentiel se trouve cependant en compétition avec d’autres enjeux territoriaux. Rappelons qu’il existe aussi un potentiel de développement de l’agriculture urbaine au niveau des toitures plates (voir fiche documentée consacrée aux potagers urbains). Par ailleurs, un peu plus de la moitié des 227 ha inscrites comme zones agricoles au PRASLe Plan régional d'Affectation des Sols est l'un des outils majeurs de la politique d'aménagement du territoire régional. Il comprend des prescriptions générales pour l'affectation des sols, des cartes délimitant des zones d'affectation et des prescriptions particulières par zone (notamment pour la protection des espaces verts). Il constitue en outre la référence légale pour l'octroi des permis d'urbanisme, de primes à la rénovation, etc. Il transcrit par ailleurs les objectifs opérationnels du PRD en carte. n’est pas affecté à des activités agricoles.
Un plan d’action juridique et urbanistique en faveur des agricultures urbaines durables en Région bruxelloise a été finalisé en mai 2020. Il propose des orientations pour la modification d’outils juridiques et urbanistiques influençant la place, la préservation et le développement de l’agriculture urbaine.
Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie Good food 2015-2020, près de 9 ha ont été mobilisés pour l’agriculture urbaine.
Pour en savoir plus
Entre 2017 et 2020, l’identification des terrains potentiellement utilisables pour l’agriculture urbaine les plus intéressants (lien vers l’étude), l’analyse de ces opportunités foncières et de nombreuses prises de contacts avec les propriétaires ont permis de mobiliser des terres pour l’agriculture urbaine à Bruxelles (acquisition par la Région bruxelloise, développement de projets d’agriculture urbaine sur des terrains régionaux gérés par Bruxelles Environnement, acquisition ou location de terrains par l’ASB Terre-en-vue subventionnée par la Région et le projet Feder BoerenBruxselPaysan pour trouver des terres en Région de Bruxelles-Capitale et en périphérie permettant d’y installer durablement des projets professionnels agroécologiques et en assurer le suivi). En outre près de 22 ha ont été mobilisés en périphérie bruxelloise.
Des réflexions ont aussi été entamées en 2021 sur le développement d’une politique foncière agricole bruxelloise.
- Accès aux capitaux
78 projets d’agriculture urbaine professionnelle ont été subsidiés via 5 appels à projets annuels (2016-2020). Une aide à la création de projets d’entreprises agricoles a été mise à disposition des porteur∙euse∙s de projets en agriculture urbaine début 2019. Des réflexions sont aussi en cours pour développer d’autres outils financiers (accessibilité aux aides européennes, aides structurelles, etc.). Durant la crise sanitaire, des primes COVID ont été octroyées à des agriculteur∙rice∙s ayant subi des pertes de revenus.
- Accès aux marchés
Good Food soutient financièrement le Réseau des GASAP lequel se fournit directement auprès de producteurs locaux, y compris bruxellois. Des réflexions autour de la mise en place de hubs logistiques permettant d’améliorer la distribution, en Région bruxelloise, de la production agricole urbaine et périurbaine sont en cours.
- Accès aux savoirs, savoir-faire et compétences
Le service « Facilitateur Agriculture(s) urbaine(s) », opérationnel depuis mars 2018, stimule la création ou le développement de projets en agriculture urbaine qu’ils soient ou non professionnels. Pour ce faire, il met notamment à disposition une plateforme Web d’informations et un service d’experts pluridisciplinaires. Il s’adresse notamment à des projets de création ou de développement d’entreprises, à des propriétaires et promoteurs immobiliers ou encore, à des organismes publics et des collectivités.
D’autres actions sont entreprises via BoerenBruxselPaysans, projet pilote qui a été financé majoritairement par le Fonds européen de développement régional (FEDER) durant la période 2015-2020 (2023 pour certains investissements). Implanté à la limite du territoire périurbain, principalement à Anderlecht (Neerpede et Vogelzang), ce projet vise notamment à faciliter et augmenter la production et la transformation alimentaire locale selon des modes de production écologiques. Il permet à de nouveaux et nouvelles agriculteurs et agricultrices ayant répondu à un appel à candidature de lancer leur projet grâce à un accompagnement individuel (formations, soutiens méthodologiques et techniques) et à une mise à disposition de terrains (Espace Test Agricole), d’infrastructures et d’outils pendant 3 saisons maximum. Il contribue également au développement de circuits courts de transformation et de vente, ou encore, d’actions de sensibilisation et de mise en réseau. Entre 2016 et 2020, 15 agriculteur∙rice∙s ont pu tester leur activité sur l’espace test du projet. Depuis 2020, le focus est principalement mis sur les actions visant à poursuivre les activités permettant au nombre de nouveaux producteurs de croître. Citons enfin la mise en place d’une fédération bruxelloise des professionnel∙le∙s de l’agriculture urbaine (FEDEAU).
À télécharger
Fiche documentée
- 1. Les potagers urbains (.pdf)
- 2. Good food : agriculture professionnelle en Région bruxelloise (.pdf)
Fiche de l’Etat de l’Environnement
Autres publications de Bruxelles Environnement
- BRUXELLES ENVIRONNEMENT & BRUXELLES ECONOMIE ET EMPLOI 2021. « Stratégie Good food « Vers un système alimentaire durable en Région de Bruxelles-Capitale » - Evaluation finale, synthèse des réalisations et performances de la stratégie 2016-2020 », 84 pages (.pdf)
- « Vers un système alimentaire plus durable : Les apports de/à la Région de Bruxelles-Capitale du projet URBACT II réseau thématique - Alimentation », 2015 (.pdf)
- Info-fiche « Alimentation et environnement - Perceptions, connaissances et comportements des Bruxellois en matière d'alimentation durable : Sondages et analyses », 2015 (.pdf)
Etudes et rapports
- BOUTSEN R., MAUGHAN N., VISSER M. 2018. « Evaluation de la production agricole primaire professionnelle en Région de Bruxelles Capitale », étude réalisée par ULB-Laboratoire d’agroécologie, pour le compte de Bruxelles Economie et Emploi, 50 pp.
- BRAT, ECO-INNOVATION, BGI 2013. « Evaluation du potentiel maraîcher en Région de Bruxelles-Capitale (phase I) - Identification des références d’agriculture urbaine pertinentes au regard du contexte bruxellois», étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 70 pp. (.pdf)
- BRAT, ECO-INNOVATION, BGI 2013. « Evaluation du potentiel maraîcher en Région de Bruxelles-Capitale (phase II) - Inventaire des sites d’agriculture urbaine existants en Région bruxelloise », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 46 pp. (.pdf)
- BRAT, ECO-INNOVATION, BGI 2013. « Evaluation du potentiel maraîcher en Région de Bruxelles-Capitale (phase III) », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 23 pp. (.pdf)
- COMASE 2021. « Etude de la performance de la stratégie Good Food 2016-2020 - Rapport final », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 83 pp (.pdf)
- DEDICATED RESEARCH 2011. « Les maraîchages urbains, écologiques: freins, leviers à la réalisation et état des lieux - phase quantitative », enquête téléphonique réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 61 pp. (.pdf)
- DEDICATED RESEARCH 2011. « Les maraîchages urbains, écologiques: freins, leviers à la réalisation et état des lieux - phase qualitative », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 69 pp. (.ppt)
- DE LESTRANGE R., FIERENS C., ANNICCHIARICO G., NYSSENS T., GERARD A., BOURGOIS C. 2021. « AGROPOLIS - D’un projet pilote à un réseau nourricier métropolitain », 153 pages. (.pdf)
- DE ZUTTERE C., LECOCQ B. , DEMANET M. 2020. « Plan d’action 2020 Agricultures urbaines : modifications législatives - Pour une évolution du cadre juridique et urbanistique en faveur des agricultures urbaines durables en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Economie Emploi - cellule agriculture, 69 pp. (.pdf)
- IPSOS PUBLIC AFFAIRS 2014. « Baromètre environnemental de la Région de Bruxelles-Capitale - résultats 2014 », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 112 pp. (.pdf)
- GREENLOOP 2013. « Etude sur la viabilité des business modèles en agriculture urbaine dans les pays du Nord », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement , 72 pp. (.pdf)
- GREENLOOP 2013. « L'incidence des pollutions urbaines sur les productions alimentaires en ville», étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement , 35 pp. (.pdf)
- LATERAL THINKING FACTORY 2013. « Indoor farming en RBC », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 77 pp. (en anglais uniquement) (.pdf)
- LAUWERS L., VAN KERCKHOVE Y. & DUMORTIER M. 2022. "Agro-ecological farming in (peri)urban protected areas: the agro-ecological farmers’ perspective on synergies and conflicts between nature and agriculture", Reports of the Research Institute for Nature and Forest, étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 104 pp. (en anglais uniquement) (.pdf)
- LEFEBVRE A., TSURUKAWA N., HAISSAM JIJAKLI, DUMARTIN P., PEETERS S., HANIQUE P., GOISSE G., LAMAL V. 2018.« Etude urbanistique et juridique pour le développement de l’agriculture urbaine en Région bruxelloise », étude réalisée par Gembloux Agro-Bio Tech (ULg), Agora-urba.eu, Pascal Hanique sprl, Avocats associés, 131 pp
- SONECOM 2018. « Réalisation d'un sondage d'évaluation à mi-parcours de la stratégie auprès de la population en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 61 pp. (.pdf)
- SONECOM 2016,. « Réalisation d'un sondage Etat initial sur les comportements des Bruxellois en matière d'alimentation durable dans le cadre de la stratégie d'alimentation durable », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 54 pp (.pdf)
- SONECOM 2013. « Baromètre de comportements de la population en matière d’environnement et d’énergie en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 57 pp. (.pdf)
- SONECOM 2015. « Sondage sur le comportement des ménages en matière d’achat et d’utilisation de pesticides dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans les zones de captage », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 79 pp. (.pdf)
- TERRE EN VUE 2017. « Cartographie des terres agricoles et des terres potentiellement utilisables pour l’agriculture en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Economie et Emploi, 11 pp.
- VERDONCK M., TAYMANS M., CHAPELLE G., DARTEVELLE G., ZAOUI C. 2012, révision en 2014. « Système d’alimentation durable - Potentiel d’emplois en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée par le Centre d’études régionales bruxelloises (FUSL) et GREENLOOP pour le compte de Bruxelles Environnement, 88 pp. + annexes. (.pdf)
Plan et programme
Liens utiles
Potagers collectifs et familiaux, arbres fruitiers partagés
Focus – Actualisation : novembre 2023
En 2018, la Région de Bruxelles-Capitale comptait 392 sites potagers soit 30% de plus qu’en 2013. Cette évolution s’est néanmoins accompagnée d’une réduction de 4% de la superficie totale de ces sites.
En mai 2023, 419 parcelles potagères sont mises à disposition des Bruxellois.e.s dans 14 espaces verts gérés par Bruxelles Environnement. C’est un peu plus du double qu’en 2013.
La création de potagers est également encouragée via de nombreux appels à projets s’adressant à différents publics. Depuis quelques années, des initiatives visant à développer la présence d’arbres fruitiers dans l’espace public et dans des espaces collectifs se multiplient également.
Les potagers urbains : des espaces verts aux fonctions multiples
A Bruxelles comme dans de nombreuses autres villes, on observe un regain d’intérêt pour les pratiques de cultures alimentaires. Celles-ci peuvent prendre différentes formes : culture maraîchère en pleine terre ou hors sol, arbres fruitiers, petits élevages, apiculture, aquaculture, fermes pédagogiques, cultures souterraines de champignons, etc. Elles sont encouragées dans le cadre de différents programmes d’action régionaux visant la transition vers des systèmes alimentaires plus durables, l’amélioration du cadre de vie, le développement d’espaces verts multifonctionnels ou encore, la création d’emplois.
Ce focus se concentre essentiellement sur les potagers familiaux ou collectifs non professionnels destinés avant tout à la production à des fins de consommation personnelle ou « autoproduction » (le volet agriculture professionnelle fait l’objet d’un autre focus, voir « Good Food : Agriculture professionnelle en Région bruxelloise »).
Ces pratiques maraîchères poursuivent des objectifs multiples, certains étant plus ou moins prioritaires selon les acteurs : production alimentaire mais aussi objectifs récréatifs (contact avec la nature, détente, activité physique), sociaux (espaces de rencontre et d’apprentissage collectifs de nouveaux comportements, réponse à un besoin d’appartenance, appui à des projets thérapeutiques ou de réinsertion professionnelle, etc.) ou encore, éducatifs (principes d’agriculture biologique, cycles des saisons, espèces locales, etc.). D’un point de vue environnemental, les potagers constituent également des espaces verts apportant un support à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., participant à l’amélioration du paysage urbain ou encore, permettant l’infiltration des eaux pluviales. La pratique du maraîchage en milieu urbain, dans des espaces interstitiels parfois très petits, permet aussi de créer et de maintenir des espaces ouverts au cœur des quartiers. Tous ces bénéfices montrent combien le développement de cette pratique peut fortement contribuer à améliorer le cadre de vie des citadins et participer à accroître la résilience des villes.
Vers un retour des arbres et arbustes fruitiers dans l’espace public
Les bienfaits apportés par la présence d’arbres en ville sont bien connus : embellissement du paysage urbain, rafraichissement de la ville (ombrage, évapotranspirationL’eau de pluie est retenue au niveau du sol puis s’évapore vers l’atmosphère. La présence de plantes amplifie/augmente fortement ce phénomène.), support à la biodiversité, réduction locale des concentrations de certains polluants atmosphériques, stockage de CO2, contribution à l’infiltration des eaux pluviales, fragrances…
Parmi les espèces d’arbres à envisager pour les plantations dans les espaces publics (parcs, rues, micro-forêt urbaine, etc.) et privés (jardins, façades), les fruitiers comestibles constituent une option particulièrement intéressante. Outre les bénéfices évoqués ci-dessus, les fruitiers présentent en effet des avantages complémentaires dont :
- vecteur d’implication citoyenne, de partage (savoirs, idées, ressources ,etc.) et de création de liens sociaux et avec la terre, notamment lors de la conception des projets et de la plantation et de l’entretien des arbres ;
- source d’habitats et de nourriture, notamment pour les oiseaux et pollinisateurs (floraison abondante) ;
- vecteur pédagogique et éducatif (sensibilisation à l’alimentation durable, reconnexion avec les cycles saisonniers, apprentissage des mécanismes de pollinisation, de techniques horticoles, ) ;
- potentiellement, offre de ressources alimentaires de proximité.
Avec une faible emprise au sol, les fruitiers ont un impact important à la fois sur le cadre de vie, sur l’écosystèmeC'est l'ensemble des êtres vivants (faune et flore) et des éléments non vivants (eau, air, matières solides), aux nombreuses interactions, d'un milieu naturel (forêt, champ, etc.). L'écosystème se caractérise essentiellement par des relations d'ordre bio-physico-chimique. urbain et sur les liens sociaux. Notons que les différents règlements en vigueur concernant les espaces verts n’autorisent pas la cueillette.
Si la fonction ornementale des arbres dans la ville est aujourd’hui prédominante, on assiste depuis quelques années à un mouvement de retour des arbres et arbustes fruitiers dans l’espace urbain. Ceux-ci peuvent investir différents lieux : parcs, alignements d’arbres ou arbres isolés, haies, vergers, potagers, micro-forêts jardinées, jardins, façades, etc.
Près de 9 Bruxellois.e.s sur 10 souhaitent davantage d’espaces dédiés à l’agriculture urbaine et aux potagers
En mai 2022, un sondage visant à collecter des informations sur les comportements, usages, compréhension et ressentis des Bruxellois.e.s par rapport à la « nature » a été effectué à la demande de Bruxelles Environnement (AQrate, 2022). Il en ressort les enseignements suivants concernant la production alimentaire en Région bruxelloise :
- 75% des sondés estiment que la nature en ville est une source de nourriture ;
- 88% des sondés considèrent qu’il faut développer plus d’espace dédiés à l’agriculture urbaine et aux potagers ;
- 85% des sondés soutiennent l’idée de planter davantage d’arbres fruitiers dans les espaces verts, ce pourcentage s’élève à 74% pour les plantations dans les rues et les places publiques ;
- 76% des sondés estiment que les arbres fruitiers favorisent les échanges et les contacts sociaux ;
- Respectivement 74%, 70% et 70% des sondés estiment que les fruits provoquent des glissades ou des salissures, attirent les guêpes, les mouches et les rats et n’osent pas consommer les fruits qui poussent en rue (pollution).
Ces résultats attestent d’un réel intérêt des Bruxellois-e-s pour le développement de l’agriculture, des potagers et fruitiers dans leur ville. Concernant les fruitiers, une part importante des sondés y voit cependant aussi une source de désagréments.
30% de sites potagers en plus entre 2013 et 2018 … mais une surface totale qui diminue de 4%
En 2013, Bruxelles Environnement a réalisé un inventaire des potagers collectifs et familiaux et de leurs caractéristiques. Cet inventaire a été reconduit en 2018, en utilisant une méthodologie pratiquement identique. Il n’a pas été réactualisé depuis.
Les potagers inventoriés sont les sites potagers susceptibles d’accueillir des jardiniers et les potagers ouverts au public, qu’ils soient officiels (potagers communaux, régionaux, sur terrains privés …) ou officieux (terrains squattés). Les projets professionnels d’agricultures urbaines, les potagers scolaires ou de démonstration ainsi que les potagers privés non accessibles depuis l’espace public ou se trouvant sur une parcelle bâtie ne font pas partie de l’inventaire.
Le tableau ci-dessous établit une comparaison de l’offre en potagers en 2013 et 2018. Des corrections ont été apportées aux données de l’inventaire de 2013 afin de rectifier quelques erreurs qui ont été identifiées et d’assurer une totale cohérence des deux inventaires en ce qui concerne les potagers pris en compte.
En 2018, la superficie brute de potagers collectifs était d’environ 79 ha.
Bon à savoir
En 1959, selon le recensement agricole réalisé par l’Institut national de Statistiques (aujourd’hui Statbel), 309 ha de terres étaient consacrés à l’économie de subsistance et d’autonomie alimentaire dans le territoire qui correspond aujourd’hui à la Région (Zitouni et al., 2018). Dans certaines communes, 5% du territoire était occupé par cette agriculture de subsistance. D’après cette même source, ces chiffres sont probablement sous-estimés et peu comparables à ceux obtenus par l’inventaire de Bruxelles Environnement.
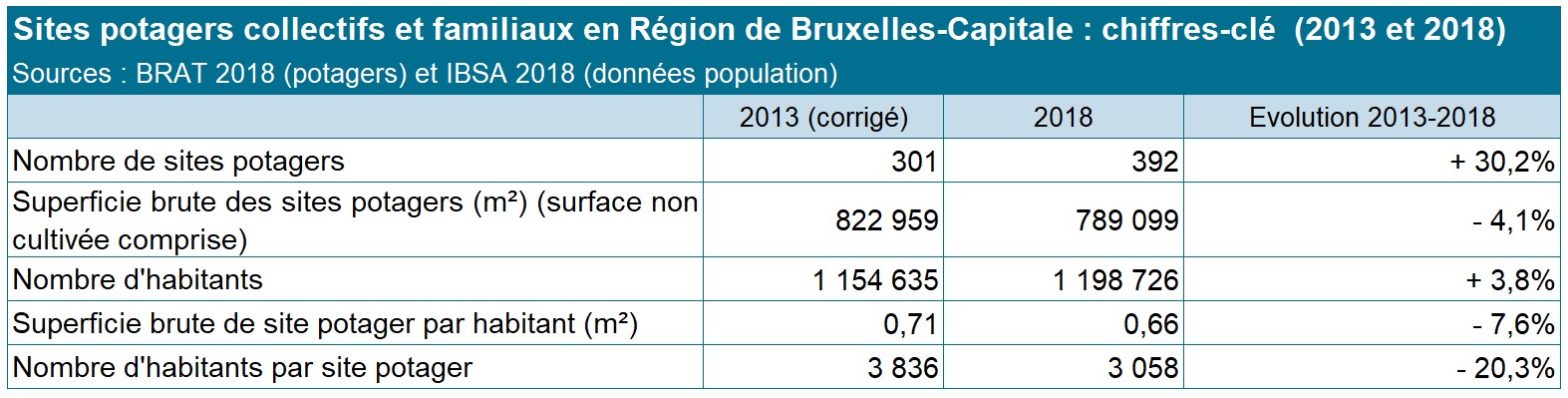
Si la superficie totale des potagers a diminué par rapport à 2013 (-4%), on constate en revanche que leur nombre a sensiblement augmenté (+30%). L’analyse des données montre que cette évolution est à mettre en relation avec une diminution du nombre de sites potagers de grande taille (plus de 5000 m2) accompagnée d’une forte augmentation des sites potagers de taille réduite (inférieurs à 500 m2 voire à 100 m2). La hausse du nombre de potagers a permis de décharger la pression démographique sur les potagers existants (- 20% d’habitants pour un site potager).
La comparaison des données inventoriées montre également qu’en l’espace de 5 ans :
- 129 nouveaux sites potagers ont été créés (il s’agit essentiellement de petits potagers qui ont contribué à améliorer l’offre dans les zones densément bâties);
- 38 sites potagers ont disparu;
- 3 sites potagers sont apparus et ont disparu;
- 13 sites potagers ont vu leur taille augmenter;
- 13 sites potagers ont vu leur taille diminuer.
On constate donc une dynamique rapide de création et disparition des potagers (à ce sujet, voir aussi Zitouni et al. 2018). L’inventaire a aussi permis d’identifier 26 potagers potentiellement menacés, le plus souvent en raison de projets de construction.
Plus du tiers de la superficie totale des sites de potagers accessibles au public se trouve en zones vertes ou zones agricoles et bénéficie donc d’une certaine protection.
Une offre en potagers très variable selon les communes et les quartiers
Le graphique ci-dessous montre, pour chaque commune bruxelloise, la superficie totale de potagers collectifs et familiaux (2018) ainsi que la superficie de site potager par habitant (2018).
¾ des communes disposent d’une superficie de potagers collectifs <1m2/habitant.e (2018)
Source : Bruxelles Environnement sur base de BRAT 2018
En moyenne, chaque Bruxellois.e a un accès théorique à 0,66 m2 de potager (sur base de la superficie totale du site potager, en ce compris les éventuelles parties non cultivées, et hors jardins privés et écoles). On observe de fortes disparités entre communes : alors que les habitants de Bruxelles (cf. quartiers périphériques tels que Haren et Neder-Over-Hembeek), Evere, Jette, Uccle et Watermael-Boitsfort disposent en moyenne de plus de 1 m2/hab., ceux des communes d’Etterbeek, Saint-Josse et Saint-Gilles disposent de moins de 0,15 m2/hab. Ces communes figurent également parmi celles où la part de ménages ayant accès à un jardin privé est la plus faible.
La carte ci-dessous permet de visualiser de manière plus fine la répartition des sites potagers dans le tissu urbain. Chaque potager est représenté par un cercle d’un rayon de 300 mètres à partir de son centre, cette distance à vol d’oiseau correspondant grosso modo à 5-10 minutes de marche. Cette représentation permet, en première approche, d’identifier des zones de carence concernant l’accès des Bruxellois.e.s à un potager de proximité.
De nombreux et nombreuses Bruxellois.e.s n’ont pas accès à un potager collectif dans leur quartier
Source : Bruxelles Environnement sur base de BRAT 2018
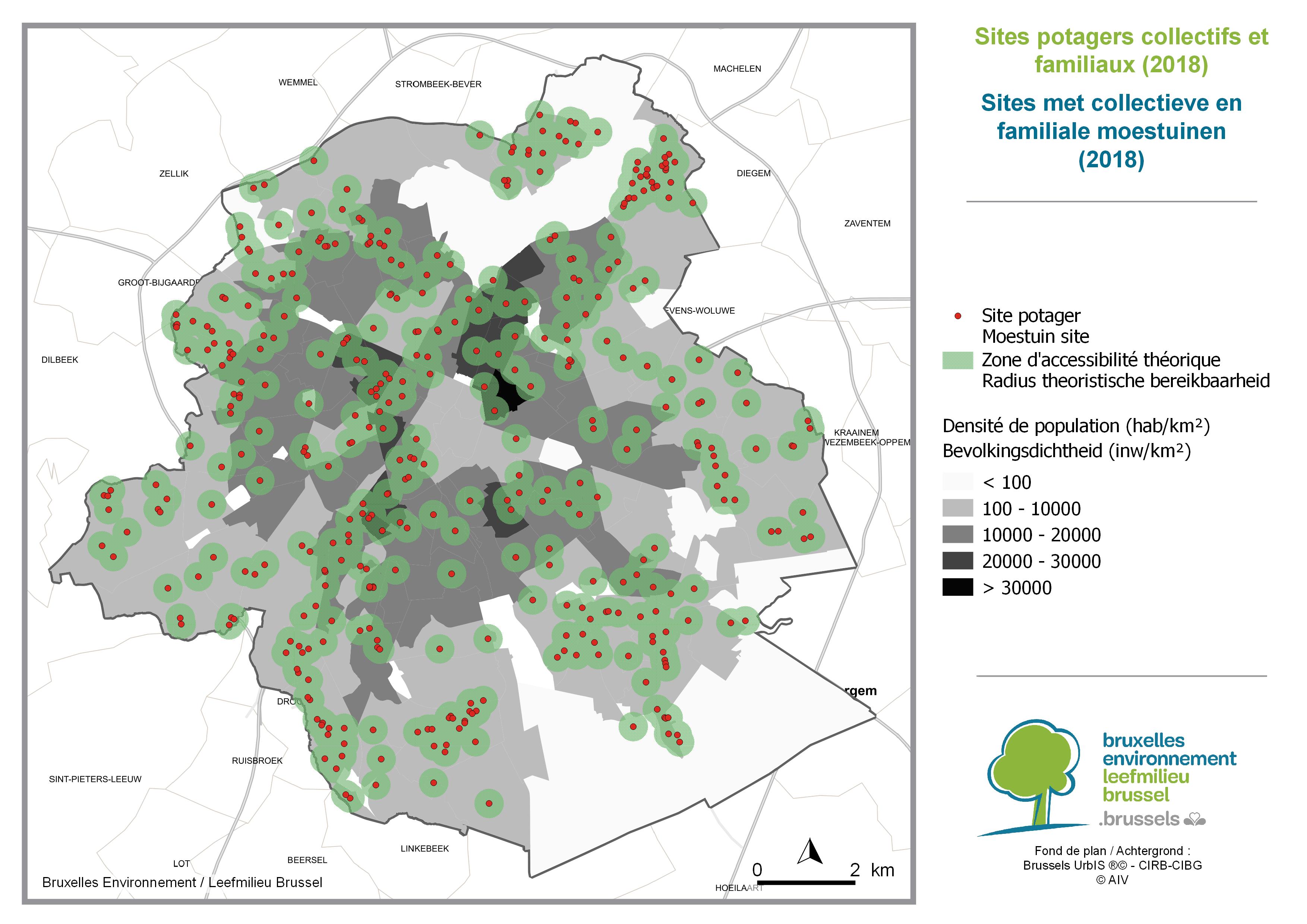
Malgré un renforcement global du nombre de potagers, il existe toujours des disparités spatiales marquées: de fortes concentrations locales alternent avec des zones non équipées. Si celles-ci s’observent également dans certaines zones moins denses, les zones déficitaires du centre combinent souvent une offre réduite en potagers mais aussi en espaces verts et en jardins privés ainsi que des fortes densités de populations et des faibles revenus moyens par habitant. L’offre en sites potagers de pleine terre et de grande taille est surtout présente dans les zones les moins denses.
1 ménage bruxellois sur 3 cultive des fruits et/ou des légumes mais souvent en très petites quantités
A l’échelle individuelle, 49% des Bruxellois.e.s déclarent cultiver, personnellement ou du fait d’un autre membre du ménage, des plantes aromatiques, fruits et/ou légumes (sondage Good Food, AQrate 2023). Ce pourcentage est de 33% si l’on considère uniquement la production de fruits et légumes. Ces chiffres reflètent des réalités très variables allant de la culture en pots de quelques fruits, légumes et/ou plantes aromatiques à l’exploitation d’un véritable potager.
Environ 4 « producteurs et productrices citoyen.n.e.s » sur 10 cultivent leurs aromates, fruits et/ou légumes dans un jardin
Source : Bruxelles Environnement sur base d’un sondage AQrate 2023
Cette production se fait essentiellement sur des balcons, terrasses, cours ou toits (cité par 51% des « producteurs et productrices citoyen.n.e.s ») et/ou dans des jardins (cité par 42%). Respectivement 13% et 11% des « producteurs et productrices citoyen.n.e.s » ayant répondu au sondage le font dans un potager collectif et/ou dans une parcelle individuelle d’un potager collectif. Notons que pour 6% des « producteurs et productrices citoyen.n.e.s » cette production se fait en dehors de la Région.
La moitié des « producteurs et productrices citoyen.n.e.s » ont une production de légumes très limitée
Source : Bruxelles Environnement sur base d’un sondage AQrate 2023
Près de 2/3 des « producteurs et productrices citoyenn.e.s » ont une production de fruits très limitée
Source : Bruxelles Environnement sur base d’un sondage AQrate 2023
Pour plus de la moitié des répondants, les quantités de légumes et fruits produites ne permettent d’agrémenter que quelques repas.
De plus en plus de parcelles potagères aménagées dans les espaces verts régionaux
La superficie de potagers aménagés dans les espaces régionaux gérés par Bruxelles Environnement s’élève à 3,4 ha en comptabilisant uniquement la superficie nette (c’est-à-dire la superficie cultivable) et à 5,3 ha en tenant également compte des superficies brutes (c’est-à-dire en incluant les chemins, les haies, les pelouses, les tables, etc.). Au total, en 2022, 418 parcelles sont mises à disposition des Bruxellois au niveau de 14 sites régionaux.
Entre 2013 et 2018, la superficie et le nombre de parcelles potagères mises à disposition des Bruxellois.e.s ont respectivement augmenté de 61% et 81%. Ensuite, de 2019 à 2022, le nombre et la superficie des sites potagers collectifs aménagés par Bruxelles Environnement dans les espaces verts régionaux est resté constant. En revanche, le nombre de parcelles aménagées dans les sites s’est accru progressivement, passant de 373 à 418 (+12%). Cette évolution s’inscrit dans le cadre des actions entreprises par la Région pour répondre à la demande grandissante des Bruxellois.e.s de disposer d’un potager. Celle-ci est particulièrement marquée depuis la crise sanitaire du COVID (le nombre d’inscriptions sur la liste d’attente est passé d’environ 300 en 2019 à environ 1400 fin 2021).
Parmi les actions mises en œuvre par Bruxelles Environnement figurent la subdivision des grandes parcelles lorsque celles-ci peuvent accueillir plusieurs cultivateurs ainsi que l’identification et la réattribution rapide des « parcelles dormantes ».
La carte interactive des potagers collectifs et familiaux gérés par Bruxelles Environnement est disponible en ligne. Elle permet de constater que l’offre régionale de potagers est actuellement limitée à 6 communes et que la majeure partie des sites sont localisés en seconde couronne.
Plusieurs (ré)aménagements de potagers sont en projet à Anderlecht et à Uccle ce qui permettra d’augmenter le nombre de parcelles disponibles.
3,4 ha de superficies potagères sont mis à disposition des Bruxellois.e.s dans les espaces verts gérés par Bruxelles Environnement (2022)
Source : Bruxelles Environnement 2023
Lire le texte de transcription
En 1991 seules 15 parcelles potagères (825 m2) étaient aménagées dans les espace verts gérés par Bruxelles Environnement. Elles étaient au nombre de 154 (16.407 m2) en 2001, 191 (21.106 m2) en 2011 et 418 (34.076 m2) en 2022.
418 parcelles potagères sont mises à disposition des Bruxellois dans les espaces verts gérés par Bruxelles Environnement (2022)
Source : Bruxelles Environnement 2023
La réduction de l’offre en potagers observée sur le graphique entre 2003 et 2007 est liée à la découverte de problèmes de pollution des sols au niveau de 2 sites. Ceci a conduit à fermer les potagers concernés jusqu’à ce que leur traitement les rende à nouveau aptes à la culture.
Notons que les objectifs quantitatifs fixés dans la première stratégie Good Food pour 2020 concernant l’accroissement des surfaces de potagers gérés par Bruxelles Environnement et le maintien voire l’accroissement des surfaces de potagers collectifs et familiaux n’ont pas été atteints.
Des actions régionales pour soutenir la pratique du maraîchage
Bruxelles Environnement mène depuis sa création une politique de développement de potagers et ce, via divers outils. Cette politique a été confirmée et renforcée ces dernières années, notamment avec l’adoption de la stratégie Good Food fin 2015. Celle-ci vise à favoriser une transition du système alimentaire bruxellois vers plus de durabilité. L’un de ses axes a pour objectif d’intensifier et soutenir la production agroécologique à Bruxelles et en périphérie en supportant à la fois la production professionnelle et la production citoyenne.
La politique de développement de potagers urbains et de sensibilisation à la production alimentaire citoyenne s’appuie sur plusieurs lignes d’action qui peuvent se résumer comme suit :
- Préserver et augmenter les espaces de production citoyenne gérés par les autorités publiques
Bruxelles Environnement gère actuellement 14 sites potagers. Les potagers y sont gérés dans le respect de l’environnement (via la signature de conventions d’occupation avec les bénéficiaires de parcelles) et en veillant à apporter une dimension sociale et pédagogique aux projets. Un effort particulier a été fourni pour aménager de nouveaux espaces potagers (nouveaux sites ou extension des sites existants) et améliorer les sites existants (plantations de petits fruitiers et plantes aromatiques, accès à l’eau, coffres de rangement, composts collectifs, etc.). L’amélioration de l’offre passe également par une meilleure gestion des sites existants (réaffectation des parcelles abandonnées, vérification du respect des conventions d’occupation, division des trop grandes parcelles, etc.).
Un autre axe vise à soutenir les pouvoirs publics (communes et CPAS) pour préserver et créer des espaces de production dans les espaces verts locaux et dans l’espace (semi)public. Il s’appuie en particulier sur les actions Good Food mises en œuvre dans le cadre de l’appel à projets Action climat. Sur la période 2019-2023, 19 projets de production ont ainsi été soutenus au niveau des communes (3 en 2019, 3 en 2020, 5 en 2021, 5 en 2022 et 3 en 2023).
- Mobiliser les producteurs et productrices (potentiel.l.e.s) et offrir des soutiens pour le développement de projets potagers collectifs par des citoyen.n.e.s
Cette ligne d’action revêt diverses formes :
- information et sensibilisation (information technique et pratique, développement et diffusion de différents outils, visibilisation de projets de production citoyenne, etc.) ;
- soutien et développement d’un réseau de guides potagers (anciennement dénommés maîtres-maraîchers) pour accompagner les producteurs et productrices citoyens (186 bénévoles en 2022) ;
- mise en réseau des projets de potagers citoyens ;
- distribution de kits de graines, etc.
Elle s’appuie également sur l’incitation et l’accompagnement des projets de production collectifs, notamment via l’appel à projets Inspirons le quartier. Sur la période 2019-2023, 48 projets de production alimentaire citoyenne (potagers, poulaillers, vergers, etc.) ont été soutenus (14 en 2019-2020, 13 en 2021, 9 en 2022 et 12 en 2023).
En moyenne chaque année environ une dizaine de nouveaux potagers collectifs se développent via l’appel à projets Inspirons le Quartier. Les écoles sont également très dynamiques dans la mise en place de sites de production. L’ensemble de ces potagers ne perdure cependant pas toujours (reprise des terrains par leur propriétaire, désinvestissement des citoyens, etc.).
Signalons aussi la mise en place d’un service « Facilitateur Agriculture urbaine ». Si celui-ci vise avant tout à soutenir l’agriculture urbaine professionnelle, il peut également aider à la mise en place de projets de production citoyenne tels que, par exemple, l’intégration d’espaces potagers dans un projet immobilier ou dans un projet de revitalisation d’un quartier.
- Développer des projets de production Good Food incluant les publics précaires en collaboration avec des relais locaux
En 2023, Bruxelles Environnement et la Société de Logement Régional Bruxellois (SLRB) ont retenu trois sites pilotes pour la mise en place de projets d'agriculture citoyenne. Cette sélection s’est opérée via un appel à manifestation d'intérêt à destination des SISP (Sociétés Immobilières de Service Public) et des projets de cohésion sociale. Les 3 projets pilotes ont démarré en mars 2023 et bénéficient d’un accompagnement (aspects techniques et participatifs) de Bruxelles Environnement. Des projets de production aux abords des logements sociaux se développent aussi via les appels à projets Plan climat et Inspirons le quartier (voir ci-dessus).
- Assurer une diversification des productions avec une plus-value, dont la promotion des fruitiers
La Région souhaite développer la production fruitière dans les espaces privés et publics. Et ce, en s’appuyant notamment sur les résultats et modèles recommandés par un projet de recherche en voie de finalisation (projet ARBRES, voir encadré ci-dessous). Une formation pilote de « coach fruitiers », soutenue par Bruxelles Environnement, a par ailleurs été organisée en 2023. Ces coachs accompagneront les citoyen·ne·s ainsi que des propriétaires publics et privés pour la plantation et la gestion des fruitiers.
Bon à savoir
Le projet ARBRES 2021-2024 (Arboriculture Régionale Bruxelloise pour une Résilience Écologique et Solidaire) est un projet de recherche-action participative financé par Innoviris (organisme public régional qui finance et soutient la recherche et l’innovation). Son objectif est de déterminer les conditions socio-écologiques d'implantation et de gestion de l'arbre fruitier en Région bruxelloise en tenant notamment compte des problématiques de pollution des sols et de dérèglements climatiques. Le projet vise également à examiner comment le fruitier peut participer à la résilience du système alimentaire bruxellois, de manière équitable et solidaire. Il s’appuie entre autres sur les résultats d’expérimentations in situ réalisées en collaboration avec des administrations publiques et des associations.
Parallèlement au projet ARBRES, 3 pépinières citoyennes ont vu le jour à Bruxelles (Uccle en 2019, Forest et Ganshoren en 2022). Ces projets participatifs visent à remettre des arbres et arbustes fruitiers dans les espaces publics et communs bruxellois et à créer des espaces de formation à la gestion des fruitiers.
À télécharger
Fiche documentée
- Représentations sociales des Bruxellois.e.s vis-à-vis de leur environnement naturel et des espaces verts bruxellois 2022 (.pdf)
- Les potagers urbains 2018 (.pdf)
- Good food : agriculture professionnelle en Région bruxelloise 2019 (.pdf)
Fiche de l’Etat de l’Environnement
- Focus : Good food : agriculture professionnelle en Région bruxelloise 2022
- Les espaces verts gérés par Bruxelles Environnement 2023
Autres publications de Bruxelles Environnement
- « Evaluation finale de la stratégie Good food – synthèse des réalisations et performances de la stratégie 2016-2020 », 2021 (document réalisé en collaboration avec Bruxelles Economie Emploi)
- Carte « Potagers de Bruxelles-Environnement »
Etudes et rapports
- AQRATE 2023. « Baseline Stratégie Good food 2 », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 138 pp. (.pdf)
- AQRATE 2022. « Baromètre Nature 2022 », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 111 pp. (.pdf)
- BRAT, ECO-INNOVATION, BGI 2013. « Evaluation du potentiel maraîcher en Région de Bruxelles-Capitale (phase I) – Identification des références d’agriculture urbaine pertinentes au regard du contexte bruxellois », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 70 pp. (.pdf)
- BRAT, ECO-INNOVATION, BGI 2013. « Evaluation du potentiel maraîcher en Région de Bruxelles-Capitale (phase II) – Inventaire des sites d’agriculture urbaine existants en Région bruxelloise », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 46 pp. (.pdf)
- BRAT, ECO-INNOVATION, BGI 2013. « Evaluation du potentiel maraîcher en Région de Bruxelles-Capitale (phase III) », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 23 pp. (.pdf)
- CHARPENTIER, A., DE MUYNCK, S., LACROIX, P., MAUQUOY, C., PIETERS, C., ET TAHON, N. 2024. « ARBRES – L’arbre fruitier comme levier de résilience du système alimentaire bruxellois », Rapport de recherche Innoviris Co-Create (2021-2024), 56 pp. (.pdf)
- DEDICATED RESEARCH 2011. « Les maraîchages urbains, écologiques: freins, leviers à la réalisation et état des lieux – phase quantitative », enquête téléphonique réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 61 pp. (.pdf)
- DEDICATED RESEARCH 2011. « Les maraîchages urbains, écologiques: freins, leviers à la réalisation et état des lieux – phase qualitative », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 61 pp. (.ppt)
- GREENLOOP 2013. « Etude sur la viabilité des business modèles en agriculture urbaine dans les pays du Nord », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement , 72 pp. (.pdf)
- LATERAL THINKING FACTORY 2013. « Indoor farming en RBC », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 77 pp. (en anglais uniquement) (.pdf)
- SONECOM 2015. « Sondage sur le comportement des ménages en matière d’achat et d’utilisation de pesticides dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans les zones de captage », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 79 pp. (.pdf)
- SONECOM 2018. « Réalisation d'un sondage d'évaluation à mi-parcours de la stratégie auprès de la population en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 54 pp. (.pdf)
- TERRE EN VUE 2017. « Cartographie des terres agricoles et des terres potentiellement utilisables pour l’agriculture en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Economie et Emploi, 11 pp.
- VERDONCK M., TAYMANS M., CHAPELLE G., DARTEVELLE G., ZAOUI C. 2012, révision en 2014. « Système d’alimentation durable – Potentiel d’emplois en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée par le Centre d’études régionales bruxelloises (FUSL) et GREENLOOP pour le compte de Bruxelles Environnement, 88 pp. + annexes. (.pdf)
- ZITOUNI B., CAHN L., DELIGNE C., PONS-ROTBARDT N., PRIGNOT N. et. al. 2018. « Terres des villes: enquêtes potagères de Bruxelles aux premières saisons du 21e siècle », éditions de l'éclat : Paris, 320 pages (.pdf)
Plan et programme
La stratégie "Good food" en milieu scolaire
Focus - Actualisation : janvier 2018
La stratégie « Good food » adoptée fin 2015 par la Région bruxelloise vise à assurer une transition vers un système d’alimentation plus durable. Elle répond tant à des enjeux environnementaux et climatiques qu’à des enjeux de santé publique, socio-économiques (y compris en terme de création d’emplois) et sociétaux. Les établissements scolaires constituent un des leviers majeur pour accompagner cette transition. Les actions qui y sont menées permettent en effet de sensibiliser les jeunes générations et de lutter contre un gaspillage alimentaire important. De nombreuses actions de la stratégie visent dès lors la mobilisation des acteurs scolaires et des crèches via le renforcement de l’offre pédagogique et le soutien à l’amélioration des pratiques de gestion liées à l’alimentation durable, aux potagers et aux cantines « Good food ». Depuis son lancement, la stratégie « Good food » s’est notamment traduite par :
- La labellisation « Good food » de 2 crèches, 2 écoles et 1 université (établissements qui au total servent de l’ordre de 3.370 repas chaque jour) et l’accompagnement dans le processus de labellisation de 8 crèches, 2 écoles et 1 haute école (totalisant environ 1.240 repas/jour) (situation 2017) ;
- La mise en place de 58 projets potagers scolaires à l’issue de l’année académique 2016-2017 et l’accompagnement (en cours) de 24 projets potagers scolaires qui devraient aboutir à la création de potagers à la fin de l’année scolaire 2017-2018 ;
- La réalisation de 20 autres projets en lien avec l’alimentation durable portant entre autres sur l’alimentation végétarienne et le gaspillage alimentaire (années académiques 2016-2017 et 2017-2018) ;
- Une centaine d’animations en alimentation durable dans les classes et de formations d’encadrants scolaires.
L’alimentation, un enjeu environnemental et sociétal majeur
Les pratiques majoritaires actuelles de production, transformation, conditionnement, distribution et consommation d’aliments participent largement à l’épuisement et à la pollution des ressources, aux émissions de gaz à effet de serreGaz qui absorbe une partie des rayons du soleil et les restitue sous la forme de rayonnements, lesquels rencontrent d'autres molécules de gaz et reproduisent ainsi le processus, entraînant l’effet de serre, qui engendre une augmentation de chaleur. Les principaux gaz à effet de serre dont l’origine est essentiellement liée à des activités humaines sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’ozone troposphérique (O3). ainsi qu’à l’érosion de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). (voir REE 2007-2010, Focus Impact de l’alimentation sur l’environnement ). Ainsi par exemple, selon l’AEE [2017], la quantité d’énergie nécessaire pour cultiver, transformer, emballer et transporter la nourriture jusqu’aux consommateurs européens correspond à environ 26% de la consommation finale d’énergie dans l’Union européenne.
Outre ces enjeux environnementaux et climatiques, l’alimentation est également au cœur de défis :
- sanitaires : risques liés à l’utilisation de pesticides (agriculteurs et riverains) ou à la consommation de certains aliments (contaminations accidentelles, résidus de pesticides ou antibiotiques, etc.), mauvaises habitudes alimentaires (entre autres, régimes alimentaires trop caloriques et déséquilibrés), malnutrition et sous-nutrition, etc. ;
- socio-économiques : coût de l’alimentation difficile à assumer pour les ménages les plus pauvres, situation économique précaire pour de nombreux acteurs du système alimentaire (agriculteurs mais aussi, par exemple, magasins de vente au détail), diminution sensible de l’emploi dans le secteur agricole, surproduction et gaspillage, etc. ;
- éthiques : concurrence des cultures d’exportation avec des productions locales, rémunération insuffisante de certains acteurs du système alimentaire (agriculteurs en particulier), conditions d’élevage et d’abattage du bétail, surconsommation de viande (production fortement consommatrice de terres et polluante), gaspillage alimentaire, etc. ;
- culturels et sociétaux : perte de paysages et de traditions agricoles, uniformisation des produits alimentaires et des modes de consommation, perte de liens entre les producteurs et consommateurs, etc.
La stratégie Good food
La stratégie Good food « Vers un système d’alimentation durable en Région de Bruxelles-Capitale » a été adoptée par le gouvernement bruxellois en décembre 2015 pour la période 2016-2020. Elle vise à répondre de manière coordonnée aux enjeux de santé, qualité et impacts environnementaux liés à l’alimentation ainsi que de développement de l’économie locale et de l’emploi. Au-delà de ces enjeux, l’essor de l’agriculture urbaine sous toutes ses formes (fermes urbaines, potagers individuels ou collectifs, vergers, etc.) est également susceptible d’avoir des impacts positifs sur la biodiversité locale, la gestion des eaux pluviales, la qualité de vie et la santé des citadins (bienfaits physiques et psychologiques liés aux activités de production agricole, lieux de convivialité, de création de liens sociaux et d’apprentissages collectifs, rafraîchissement de l’air en période estivale, maintien d’espaces verts et verdurisationActe volontaire visant à réintroduire de la végétation dans des zones qui en sont dépourvues. du paysage, accès à une nourriture de qualité, etc.) ou encore, l’éducation à l’environnement et à l’alimentation durable. Cette stratégie affiche une double ambition : il s’agit d’une part de « mieux produire », c’est-à-dire de cultiver et transformer localement des aliments sains et respectueux de l’environnement, et d’autre part, de « bien manger » c’est-à-dire de rendre accessible à tous une alimentation savoureuse et équilibrée, composée d’un maximum de produits locaux.
Elle s’appuie sur 7 axes stratégiques, à savoir :
- augmenter la production alimentaire locale et durable (tant celle destinée à la commercialisation que celle destinée à l’autoconsommation) ;
- accompagner la relocalisation et la transition d'une offre durable pour tous ;
- accompagner la transition de la demande pour tous ;
- développer une culture alimentaire « Good Food » durable et désirable ;
- réduire le gaspillage alimentaire ;
- penser et favoriser les systèmes alimentaires de demain ;
- assurer la gouvernance de la mise en œuvre de la stratégie.
Ces différents axes se déclinent en une quinzaine d’actions telles que la promotion de l’autoproduction durable, l’accélération de la transition des cantines et restaurants, l’accompagnement des citoyens et des familles ou encore, la valorisationToute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. des invendus alimentaires.
Les objectifs prioritaires de la stratégie sont de :
- développer la production alimentaire locale (Bruxelles et sa périphérie) en encourageant l’innovation, pour atteindre une autonomie de 30% en fruits et légumes à l’horizon de 2035 ;
- sensibiliser et impliquer des citoyens dès le plus jeune âge ;
- réduire le gaspillage alimentaire de 30% d’ici à 2020 ;
- développer les actions en tenant compte des spécificités sociales et multiculturelles de la Région.
Les établissements scolaires, un levier de la stratégie « Good food »
La sensibilisation et l’implication des jeunes générations s’avèrent indispensables pour accompagner cette transition. Avec une population scolaire de près de 340.000 élèves tous niveaux confondus, (année académique 2013-2014) et 652 établissements de niveau fondamental et secondaire (année académique 2014-2015) [IBSA 2017], les écoles et universités constituent à cet égard des acteurs incontournables tant au niveau pédagogique qu’au niveau de la gestion des cantines scolaires. En matière de cantines destinées aux plus jeunes, les cantines des crèches constituent également une cible. La Région comptait à cet égard environ 536 crèches en 2016 [estimation BE – département Consommation durableUtilisation de services et de produits qui répondent à des besoins essentiels et contribuent à améliorer la qualité de la vie, tout en réduisant au minimum les quantités de ressources naturelles et de matières toxiques utilisées, ainsi que les quantités de déchets de polluants tout au long du cycle de vie du service ou du produit, de sorte que les besoins des générations futures puissent être satisfaits., sur base de différentes sources]. De nombreuses actions de la stratégie visent dès lors la mobilisation des acteurs scolaires et des crèches via le renforcement de l’offre pédagogique et du soutien relatifs à l’alimentation durable, aux potagers et aux cantines « Good food ».
Les cantines « Good food » en milieu scolaire
Les cantines scolaires et les crèches constituent un levier important de transition du système alimentaire bruxellois vers plus de durabilité. Les actions qui y sont menées permettent en effet de sensibiliser les jeunes générations et représentent des quantités importantes comme l’illustrent les chiffres suivants :
- De l’ordre de 50% des enfants et jeunes scolarisés (incluant les crèches) en Région bruxelloise fréquentent la cantine de leur école [e. a. IPSOS 2014 : 47% et SONECOM 2013 : 46%]. Cette fréquentation diminue avec l’âge des enfants: 85% à la crèche, 65% en maternelle, 56% en primaire, 33% en secondaire et 25% en supérieur [IPSOS 2014] ;
- 74% des écoles fondamentales et secondaires proposent des repas chauds et 61% présentent, à des fréquences variables (le plus souvent une fois par semaine), un repas végétarien [SONECOM 2016] ;
- Environ 12 millions de repas sont servis chaque année dans les cantines des écoles et crèches bruxelloises [Food in Mind 2012];
- Le gaspillage alimentaire dans les écoles maternelles et primaires a été évalué à 6,4 kg/élève/an en moyenne, avec de grandes variations selon les établissements [RDC Environnement 2004]. Par ailleurs, des audits menés dans le cadre du projet européen Green Cook (2010-2012) dans 5 écoles ont évalué ce gaspillage à 8 kg/élève/an, avec également des résultats très contrastés d’une école à l’autre. Ce projet a par ailleurs mis en évidence un potentiel important de réduction des pertes. En particulier, un projet de réorganisation d’une cantine et des repas mené en collaboration avec la société de catering a permis de faire passer le gaspillage de 40% à 20% (nourriture non servie et retour d’assiettes).
La stratégie Good food a fixé des objectifs quantitatifs relatifs aux cantines à atteindre en 2020 :
- Proposition d’au moins un menu végétarien par semaine dans 50% des cantines scolaires ;
- Engagement de 10% des cantines dans une démarche « Good food » ;
- Réduction de 40% du gaspillage alimentaire des cantines publiques ;
- Mise en place d'au moins une action « Good food » par 100% des cantines publiques ;
- Imposition, au contractant, d'un ou plusieurs critères de durabilité par 100% des cantines publiques qui externalisent la gestion de leur cantine (veggieSont considérés comme veggie : les plats qui ne contiennent ni viande (poulet compris) ni poisson et qui comprennent au minimum 1 protéine végétale et 3 légumes différents., produits de saison, mesures contre le gaspillage...).
Un ensemble d’outils ont été développés pour accompagner les gestionnaires de cantines, notamment des écoles et crèches, dans l’amélioration de la durabilité des repas qu’ils proposent (gestion des stocks, valorisation des déchets, composition des menus, lutte contre le gaspillage, etc.). Il s’agit entre autres de formations théoriques et pratiques à la carte, de mise à disposition d’un helpdesk gratuit ainsi que d’outils (guides, modèle de cahier spécial des charges avec des clauses de durabilité, supports d’évaluation, brochures, affiches, vidéos, etc.). Entre le lancement du programme « Cantines durables » en 2008 et fin 2015, 12 crèches et 17 écoles ont bénéficié de ce dispositif.
Depuis 2016, le programme a été rebaptisé « Good food » et prend la forme d’un accompagnement dans une démarche de labellisation. Ce processus de labellisation, mis en place en 2016, permet à la fois de récompenser les efforts de cantines menant des actions « Good food » et de donner une visibilité au concept auprès du public. Depuis le lancement du processus, 2 crèches, 2 écoles et 1 université ont été labellisées (situation 2017). Ces cantines servent au total chaque jour environ 3.370 repas. En 2017, 8 crèches, 2 écoles et 1 haute école (totalisant environ 1.240 repas/jour) bénéficient d’un accompagnement pour obtenir le label.
L’offre pédagogique destinée aux écoles en lien avec l’alimentation durable
L’offre pédagogique de Bruxelles Environnement en matière d’alimentation durable à destination des écoles s’est développée à partir de 2009 et connaît depuis un vif succès. Elle est :
- soit intégrée à une offre transversale multi-thèmes qui se fait par différents biais : associations actives dans le domaine de l’éducation relative à l’environnement, service « facilitateur Ecoles » qui accompagne les écoles dans leur gestion environnementale (déchets, énergie, eau, etc.), mise en réseau des écoles actives en matière d’environnement (Bubble), accompagnement des écoles qui développent une démarche durable et souhaitent obtenir le label international « Eco-school » ou encore, outils pédagogiques transversaux (empreinte écologiqueMesure de la pression exercée par l'homme sur son environnement. Cet outil évalue la surface productive nécessaire à une population pour répondre à sa consommation de ressources et à ses besoins en absorption de déchets. L'empreinte écologique est exprimée en hectares. par ex.) ;
- soit spécifique à la thématique : cycles d’animation « alimentation durable », encadrement d’écoles ayant répondu à un appel à projet « alimentation durable » (projet élaboré par l’école ou, depuis l’année scolaire 2017-2018, projet « clés en main » autour de l’alimentation végétarienne, du gaspillage alimentaire ou des coins potagers), formations destinées aux enseignants (2 modules « alimentation durable » depuis 2014) ou encore, outils pédagogiques centrés sur l’alimentation durable (dossiers ou malles pédagogiques, info-fiches, recettes, jeux, affiches, projections de films ou pièces de théâtre),
La stratégie « Good food » s’est fixé comme objectif que, d’ici à 2020, 10% des élèves bruxellois bénéficient d’une activité pédagogique en lien avec l’alimentation durable chaque année.
Au cours de la période 2011-2015 (soit 5 années scolaires), 70 projets en lien avec l’alimentation durable ou les potagers ont été développés dans des écoles via des appels à projet. La majeure partie d’entre eux concernait des projets potagers. Des subsides ont également permis de financer 15 projets potagers (Jardin des couleurs).
Avec le lancement de la stratégie « Good food », l’offre pédagogique en alimentation durable a été renforcée pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018. Au cours de ces 2 années, les activités suivantes ont ainsi été réalisées :
- 58 potagers ont été mis en place à l’issue de l’année scolaire 2016-2017 (appel à projet) et 24 projets clés en main « coin potagers » étaient en cours en 2017-2018 ;
- 9 projets alimentation durable autres que potagers (appels à projet libre) ;
- 11 projets « clés en main » (sur l’alimentation végétarienne ou le gaspillage) ;
- 99 animations en alimentation durable dans des classes ;
- des formations en alimentation durable ou potagers destinés aux encadrants scolaires ayant rassemblé au total 90 participants en 2016-2017.
Le potager scolaire, un outil pédagogique au service d’apprentissages multiples
Dans le cadre de la stratégie « Good food », un accent important est mis sur les projets de potagers scolaires qui sont considérés comme une porte d’entrée de sensibilisation à l’alimentation durable. Outre le thème de l’alimentation durable (culture respectueuse de l’environnement et de la santé, qualité de l’alimentation, pyramide alimentaire, relations Nord-Sud, etc.), les potagers scolaires offrent également la possibilité d’aborder de nombreuses autres matières ou sujets en lien avec les programmes scolaires (botanique, écologie, géométrie, géographie, etc.). L’aménagement et l’entretien du potager permettent en outre aux enfants ou jeunes de pratiquer collectivement une activité physique et manuelle à l’extérieur, de se reconnecter avec la nature, de tisser des liens et collaborer, etc.
Un inventaire des potagers scolaires a été réalisé début 2016 auprès des établissements scolaires de la Région bruxelloise, haute-écoles et universités comprises [Sonecom 2016]. Les données collectées auprès des 281 établissements ayant répondu ont notamment permis d’établir, sur base d’extrapolations, que :
- Environ 37% des établissements scolaires entretiennent un potager (en bac ou de pleine terre) ou un verger, ce qui conduit à une estimation de 268 écoles (dont près de trois quart sont des écoles fondamentales) ;
- Environ 80% de ces potagers ont été créés après 2010 ;
- Parmi les établissements scolaires n’entretenant pas de potagers ou de vergers, environ un quart en ont déjà entretenu par le passé et moins de 30% envisagent un tel projet ;
- Les raisons invoquées pour l’absence de projet de potagers sont tout d’abord le manque de place, viennent ensuite le manque de temps ou de personnel.
La stratégie « Good food » s’est fixé comme objectif quantitatif que, d’ici 2020, 10 nouveaux potagers scolaires bénéficient d’un accompagnement chaque année. Le suivi des potagers soutenus les années précédentes doit par ailleurs se poursuivre en veillant à ce que le projet soit réellement intégré dans les activités de l’école.
Comme explicité ci-dessus, depuis 2011, les appels à projets « alimentation durable » ou des subsides ont permis à plusieurs dizaines d’écoles de mettre sur pied des projets potagers. Dans le cadre de la stratégie Good food et pour répondre aux demandes très importantes des écoles, l’offre de soutien aux potagers scolaires a été revue et élargie à partir de l’année scolaire 2016-2017. Elle comprend actuellement :
- des formations d’initiation au maraîchage ainsi que des formations thématiques (sur les sols par ex.) (80 participants en 2016-2017, 68 pour le premier trimestre 2017-2018);
- l’accompagnement de projets potagers (voir données ci-dessus);
- un soutien financier des projets ;
- une newsletter sur les travaux à faire dans les potagers.
De nombreux documents relatifs à la création, gestion et exploitation pédagogique des potagers sont également disponibles sur le site web de Bruxelles Environnement.
Programme « fruits, légumes et produits laitiers à l’école »
Le programme « Fruits, légumes et produits laitiers à l’école », cofinancé par la Région et l’Union européenne (programme « School Scheme »), s’inscrit dans le cadre de la stratégie Good food. Il s’adresse aux écoles bruxelloises fondamentales et de l'enseignement secondaire spécialisé ainsi qu’aux fournisseurs de fruits et légumes frais ou de produits laitiers naturels. Il consiste en des aides pour la distribution gratuite de fruits, légumes, lait et produits laitiers aux élèves des écoles participant à ce programme ainsi que pour la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement (informations sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments entre autres).
Pour l’année académique 2016-2017, 167 écoles (comptabilisant un total d’environ 34.628 élèves) ont bénéficié de ce programme ce qui constitue une nette progression par rapport aux années précédentes (87 écoles inscrites pour environ 11.436 élèves en 2013-2014).
À télécharger
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Info-fiche « Alimentation durable dans les collectivités - Programme « cantines durables » », 2015 (.pdf)
- Info-fiche « Alimentation et environnement - Perceptions, connaissances et comportements des Bruxellois en matière d'alimentation durable : Sondages et analyses », 2015 (.pdf)
- Info-fiche « Alimentation et environnement - Les futurs enseignants et l'alimentation durable : Haute Ecole Francisco Ferrer”, 2015 (.pdf)
- Info-fiche « Alimentation et environnement - L'alimentation durable se raconte/ : Cap Famille ASBL – Service Ecole des devoirs », 2014 (.pdf)
- Info-fiche « Alimentation durable dans les collectivités - Vrije Universiteit Brussel», 2013 (.pdf)
- Info-fiche « Alimentation durable dans les collectivités - Ecole Decroly », 2013 (.pdf)
- Info-fiche « Alimentation durable dans les collectivités - International school of Brussel», 2013 (.pdf)
- Info-fiche « Alimentation durable dans les collectivités - Ecoles communales de Watermael Boitsfort et TCO Service », 2013 (.pdf)
- Info-fiche « Alimentation durable dans les collectivités - Crèche communale Prince Baudouin», 2013 (.pdf)
- Info-fiche « Alimentation et environnement - Un potager dans la cour de l'école : Écoles maternelle n° 2 de Schaerbeek & Arc-en-ciel », 2013 (.pdf)
- Info-fiche « Alimentation et environnement - Mini-Entreprise durable à l'école : Groupe One», 2013 (.pdf)
- Info-fiche « Alimentation et environnement - Les petits écoliers durables : Écoles Saint-Augustin & Tamaris», 2013 (.pdf)
Etudes et rapports
- AGENCE EUROPEENNE DE L’ENVIRONNEMENT 2017. “Food in a green light – A systems approach to sustainable food », 60 pp., Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg (.pdf) (anglais uniquement)
- FOOD IN MIND 2012. « Verdeling van aantal kantines en maaltijden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het beheer ervan”, étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement
- IPSOS PUBLIC AFFAIRS 2014. « Baromètre environnemental de la Région de Bruxelles-Capitale – résultats 2014 », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 112 pp. (.pdf)
- RDC Environnement 2004. « Analyse de la poubelle des écoles primaires et maternelles en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement.
- SONECOM 2016. « Inventaire des potagers scolaires en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 21 pp. (pdf)
- SONECOM 2013. « Baromètre de comportements de la population en matière d’environnement et d’énergie en Région de Bruxelles-Capitale – Résultats 2012 », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 57 pp. (.pdf)
Plan et programme
- BRUXELLES ENVIRONNEMENT & BRUXELLES ECONOMIE ET EMPLOI « Stratégie Good Food « Vers un système alimentaire durable en Région de Bruxelles-Capitale » : De la fourche à la fourchette », 2015 (.pdf)
Liens utiles
Impact de l'alimentation sur l'environnement
Focus - Actualisation : décembre 2011
Contexte
L’alimentation se trouve au cœur de défis environnementaux, sociétaux, économiques, culturels, de santé publique, de relations Nord-Sud et de patrimoine. L’accord de gouvernement 2009-2014 de la Région de Bruxelles-Capitale souligne que "le Gouvernement visera à faire de Bruxelles un exemple en matière d'alimentation durable. […] Pour y arriver il développera un plan stratégique visant à développer l'alimentation durable et l'agriculture urbaine durable à Bruxelles". Le défi consiste à stimuler une alimentation durable pour atteindre les objectifs en terme de santé publique, de bien-être et de qualité environnementale.
Impact environnemental de nos habitudes de consommation alimentaire
L’impact environnemental de nos habitudes de consommation alimentaire est principalement d’ordre indirect et ce tout au long de la durée de vie de nos produits alimentaires :
La production de nos aliments nécessite une importante consommation d’eau, de matières premières (pour la production d’engrais et pesticides notamment) et d’énergie (pour le chauffage des serres, le travail de la terre, la production d’engrais et pesticides,…). Nos modes de production alimentaire entrainent également dans de nombreux cas une érosion des terres, de la déforestation, une perte de biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). liée à d’importantes surfaces de monocultures, une surproduction de lisiers (impactant la qualité des eaux souterraines) et de méthane (contribuant au changement climatiqueDésigne de lentes variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l'air, résultant d'activités humaines, menacent de modifier sensiblement les climats, dans le sens d'un réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants : élévation du niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones, etc.), déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d'eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales, etc.), une baisse importante des populations de poissons liée à la surpêche de certaines espèces. La production alimentaire primaire est réduite en Région de Bruxelles-Capitale.
En 2010, la Région comptait 268 ha de surfaces agricoles (65% de champs et 35% de prairies) [Statbel, 2011]. Un recensement effectué en 2004 révèle que la Région Bruxelloise compte 23,16 ha de jardins potagers sur terrains publics, soit 1122 parcelles [Bingen, 2004]. Actuellement Bruxelles-Environnement gère 190 parcelles dans 8 potagers, soit une superficie totale de 2ha, représentant 0,1% des espaces verts gérés par la Région. Ces parcelles sont mises à disposition de ménages bruxellois au moyen de contrats. Une dizaine d’écoles ont également aménagé un potager. Par ailleurs, une enquête téléphonique réalisée en juillet 2011 révèle que 85% des Bruxellois ont accès à un jardin ou une terrasse et que 19% des Bruxellois réalisent du maraîchage urbain (dans un jardin, sur un balcon, sur une toiture plate, …) et ce sans utiliser de pesticides ou d’engrais chimiques (dans presque tous les cas).
Environ 80% de l’alimentation consommée fait l’objet d’une transformation par l’industrie agroalimentaire, qui est le troisième secteur industriel en Belgique. Cette transformation et le conditionnement des aliments sont également responsables de nombreux impacts environnementaux, en fonction du type de transformation, du moyen de conservation, de l’emballage, … La Région de Bruxelles-Capitale compte environ 600 entreprises agroalimentaires, dont la majorité sont des PME’s ou des petits ateliers.
Le transport de nos aliments est également responsable d’une importante part de leur impact sur l’environnement. En effet, nos aliments doivent être transportés du lieu de production, vers le lieu de transformation ou de conditionnement, ensuite vers le lieu de distribution et enfin vers le lieu de consommation. L’impact du transport des aliments est fonction de la distance, du mode de transport et du taux de remplissage.
La distribution des produits alimentaires implique également une consommation d’énergie liée à l’éclairage, à la réfrigération, au chauffage etc. À Bruxelles, en 2007, les produits alimentaires sont principalement distribués par le secteur de la grande et moyenne distribution qui représente 92% du marché alimentaire [Nielsen, 2008].
Enfin, la consommation sensu stricto du produit impacte également notre environnement, en fonction du mode et du temps de cuisson, de la conservation de l’aliment (réfrigérateur, congélateur), du gaspillage alimentaire, du tri des déchets, ...
Quantification de cet impact
Différentes études se sont attachées à quantifier les impacts de notre consommation alimentaire, en prenant en compte les impacts liés à l’ensemble du cycle de vie de nos aliments (production, transformation et conditionnement, transport, distribution, consommation, élimination en tant que déchet). L’étude européenne EIPRO [DG JCR, 2006] a quantifié l’impact environnemental des produits dans l’UE des 25, et ce en prenant en compte l’ensemble de leur cycle de vie, et selon les différents domaines fonctionnels de consommation (définition COICOP de l’ONU). Selon cette étude, l’alimentation et les boissons sont responsables pour 20 à 30% des différents impacts environnementaux liés à la consommation dans l’UE des 25. Si l’on considère l’eutrophisationApport excessif d'éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème., notre consommation alimentaire (y compris boissons) est responsable de 60% des phénomènes d’eutrophisation rencontrés. Le détail de ces résultats est présenté dans la Figure ci-dessous.
Contribution des différents domaines fonctionnels de consommation aux différents impacts environnementaux observés dans l’UE des 25.
Source : Environmental Impact of Product (EIPRO) : Analysis of the life cycle environmental impacts related to the final consumption of the EU-25, European Commission (DG JRC), 2006.
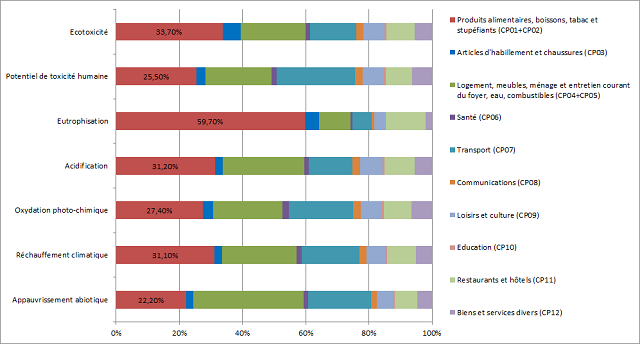
Par ailleurs, en 2004, Bruxelles-Environnement a fait réaliser une étude visant à quantifier "l’empreinte écologiqueMesure de la pression exercée par l'homme sur son environnement. Cet outil évalue la surface productive nécessaire à une population pour répondre à sa consommation de ressources et à ses besoins en absorption de déchets. L'empreinte écologique est exprimée en hectares. des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale". Selon cette étude, en 2001, l’empreinte alimentaire moyenne d’un Bruxellois s’élevait à 23% de son empreinte totale.
Aspects sociaux et économiques de l'alimentation durable
Notons toutefois que l’alimentation durable ne limite pas le champ d’étude aux impacts environnementaux, mais intègre également des aspects sociaux et économiques. La Région de Bruxelles-Capitale n’a pas établi de définition propre pour l’alimentation durable, mais il est fait référence à la définition proposée par le RABAD (Réseau Bruxellois pour l’Alimentation Durable). Selon le RABAD l’alimentation durable intègre les dimensions suivantes :
- L'accès à une alimentation de qualité pour tous, au niveau planétaire, c’est à dire à une alimentation diversifiée, saine et équilibrée qui répond aux besoins vitaux et contribue au bien-être et à la santé.
- Le droit à la souveraineté alimentaire, c’est-à-dire le droit des Etats à définir leurs propres politiques et stratégies de production alimentaire durable, et de consommation, sans dumping vis-à-vis des pays tiers.
- Des impacts environnementaux réduits tout au long du cycle de vie, du champ à la fourchette et réduction de l’empreinte écologique des modes alimentaires; les méthodes de production doivent permettre une conservation optimale de la fertilité des sols et de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., veiller au respect et bien-être des animaux d’élevage et ne pas avoir recours aux organismes génétiquement modifiés.
- La consommation de produits locaux et de saison.
- Le respect des droits sociaux et humains tout au long des chaînes de production et de distribution.
- Le commerce équitable et un juste prix pour le producteur, au Nord comme au Sud.
- La transparence des pratiques, la visibilité et la traçabilité, l'information des consommateurs.
- Le maintien et le développement d'entreprises paysannes et artisanales locales, de circuits courts et le développement de relations de confiance entre producteurs et consommateurs.
- La diffusion et l'échange des cultures culinaires, la transmission des savoirs traditionnels et la promotion de la créativité, la découverte des goûts et des saveurs.
- La création de liens sociaux et conviviaux par la nourriture.
Afin d’entrainer une conversion progressive de l’ensemble du système alimentaire bruxellois, différentes actions sont mises en œuvre par la Région de Bruxelles-Capitale :
- des projets sont mis en place (comme le projet "Cantines Durables", qui a pour but d’accompagner les cantines collectives (écoles, maisons de repos, entreprises, administrations, etc. ) qui veulent effectuer la transition vers une alimentation durable ; le projet Greencook, cofinancé par le fonds INTERREG IVB, 2010-2013, a pour objet de limiter le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne alimentaire ; les projets de mise en place de potagers collectifs via les appels à projets "Potagers collectifs", "Quartiers Durables", "Quartiers Verts" et également via les "contrats de Quartiers Durables"; ou l'appel à projets "alimentation durable", lancé mi-2011 auprès d’acteurs variés de terrain) ;
- des initiatives sont soutenues (comme la campagne Jeudi ''VeggieSont considérés comme veggie : les plats qui ne contiennent ni viande (poulet compris) ni poisson et qui comprennent au minimum 1 protéine végétale et 3 légumes différents.'' ou l’action "Goûter Bruxelles", qui est organisé par Karikol, l’association Slow Food de Bruxelles).
- de nombreuses campagnes de sensibilisation sont menées à l’attention du grand public.
- des associations actives dans le domaine sont soutenues voire subsidiées (comme le Rabad (Réseau des acteurs bruxellois pour une alimentation durable), le réseau des GASAP (Groupe d’Achat Solidaire de l’Agriculture Paysanne) bruxellois).
Collecte de données sur la biodiversité bruxelloise par les citoyens ("crowdsourcing")
Indicateur - Actualisation : mai 2021
Les initiatives de « crowdsourcing » visant à susciter la collecte de données environnementales par les citoyens sont de plus en plus nombreuses. Les objectifs poursuivis sont scientifiques mais également pédagogiques, cet aspect étant plus ou moins développé selon les projets.
Le site web www.bru.observations.be est un portail qui permet à toute personne, naturaliste confirmé ou amateur, d’enregistrer ses observations d’espèces animales, végétales et mycologiques en Région bruxelloise. En avril 2021, la base de données totalisait plus de 1.100.000 d’observations portant sur 6.341 espèces.
Observations.be : une interface belge, ouverte à tous, de partage et gestion de données d’observations naturalistes
L’information et la sensibilisation des citoyens à la nature constituent des éléments importants d’une politique de développement urbain durable. Cette sensibilisation est en effet susceptible d’avoir de nombreuses retombées positives notamment en termes de respect des espaces verts et de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., d’intérêt plus général pour les questions environnementales, d’éducation au monde du vivant - en particulier au niveau des enfants - ou encore, d’implication active dans des projets environnementaux. En outre, le contact avec la nature entraîne d’importants bienfaits physiques et psychiques. Les activités d’observation d’espèces effectuées par les naturalistes professionnels ou amateurs constituent l’une des facettes de cet intérêt pour la nature. Outre les bénéfices précités, elles participent directement à l’amélioration des connaissances sur la biodiversité locale.
Les sites Internet www.waarnemingen.be et sa version francophone www.observations.be ont été développés en 2008 à l’initiative de Natuurpunt, de Stichting Natuurinformatie et de Aves-Natagora. Il s’agit de portails où chacun peut encoder ses propres observations. A la demande de Bruxelles Environnement, une version bruxelloise du site a été développée en néerlandais et français (www.bru.waarnemingen.be et www.bru.observations.be). Les sites francophones et néerlandophones partagent la même base de données, ce qui signifie que les observations encodées dans un système sont visibles et partagées par l'autre. De même, les observations encodées dans la base de données bruxelloise sont partagées avec les sites nationaux. Ces sites sont alimentés par des observations effectuées tant par des groupes de travail et experts que de manière ponctuelle par des naturalistes amateurs ou confirmés. Une procédure de validation des observations est par ailleurs assurée.
En 2020, 774 personnes encodent régulièrement des observations naturalistes se rapportant à la Région bruxelloise dans observations.be
Les indicateurs repris dans les graphes ci-dessous présentent, sur une base annuelle, le nombre de personnes qui encodent régulièrement sur ces sites des observations floristiques ou faunistiques localisées en Région bruxelloise et ce, pour différents groupes taxonomiques. Seules les personnes ayant observé plus de 5 espèces différentes par an (10 pour les oiseaux) au sein d’un même groupe taxonomique ou plus de 100 espèces différentes, tous groupes taxonomiques confondus, sont comptabilisées.
En l’espace de 13 ans, le nombre de personnes ayant encodé régulièrement des observations a été multiplié par 13, passant de 59 en 2008 à 774 en 2020 (notons que ce chiffre inclut un nombre indéterminé de doubles comptages relatifs aux observateurs actifs pour plusieurs groupes taxonomiques). Après une légère stagnation en 2014-2016, le nombre d’observateurs a à nouveau sensiblement progressé entre 2017 et 2020. Compte tenu de la taille de la population bruxelloise, le nombre d’observateurs encodant leurs observations dans la base de données s’avère toutefois limité et une marge de progression subsiste certainement, en particulier pour certains groupes (mammifères, reptiles et amphibiens, etc.).
Les oiseaux constituent le groupe taxonomique bénéficiant du plus grand nombre d’observateurs, soit 244 personnes en 2020
Sans surprise, les oiseaux constituent le groupe taxonomique le plus populaire en termes d’observations comme en attestent les graphes ci-dessous. En 2020, 244 personnes ont encodé plus de 10 observations d’oiseaux se rapportant au territoire bruxellois et ce chiffre tend à progresser d’années en années.
Pour les insectes et autres arthropodes, l’engouement varie selon les groupes taxonomiques. Les papillons et hymènoptères sont les groupes connaissant actuellement le plus de succès. Des groupes tels que les sauterelles, criquets et grillons (orthoptères), généralement plus difficiles à observer et dont l’identification taxonomique requiert souvent le recours à une littérature spécialisée, ne font l’objet d’observations que par un nombre très restreint de naturalistes.
Les naturalistes sont aussi peu nombreux à encoder des observations concernant les groupes taxonomiques vertébrés autres que les oiseaux (mammifères, poissons, amphibiens et reptiles). Il s’agit pourtant de groupes bien connus du grand public. Leur mode de vie généralement caché ou nocturne explique probablement, au moins en partie, le nombre limité d’observations. L’augmentation du nombre d’observateurs de reptiles et amphibiens à partir de 2017 est vraisemblablement liée au projet de mise à jour de l’atlas des amphibiens et reptiles de la Région bruxelloise (inventaire de terrain couvrant la période 2017-2019). Remarquons qu’en ce qui concerne les poissons aucun observateur n’a jusqu’à présent encodé plus de 5 observations par an.
De manière générale, le nombre d’observateurs de plantes augmente au fil des ans et s’est fortement accru en 2020. Ceci est également constaté pour les champignons. Par contre les mousses et lichens sont suivis par peu d’observateurs.
Evolution annuelle du nombre d’observateurs réguliers par groupes taxonomiques (2008-2020)
Source : www.bru.observations.be
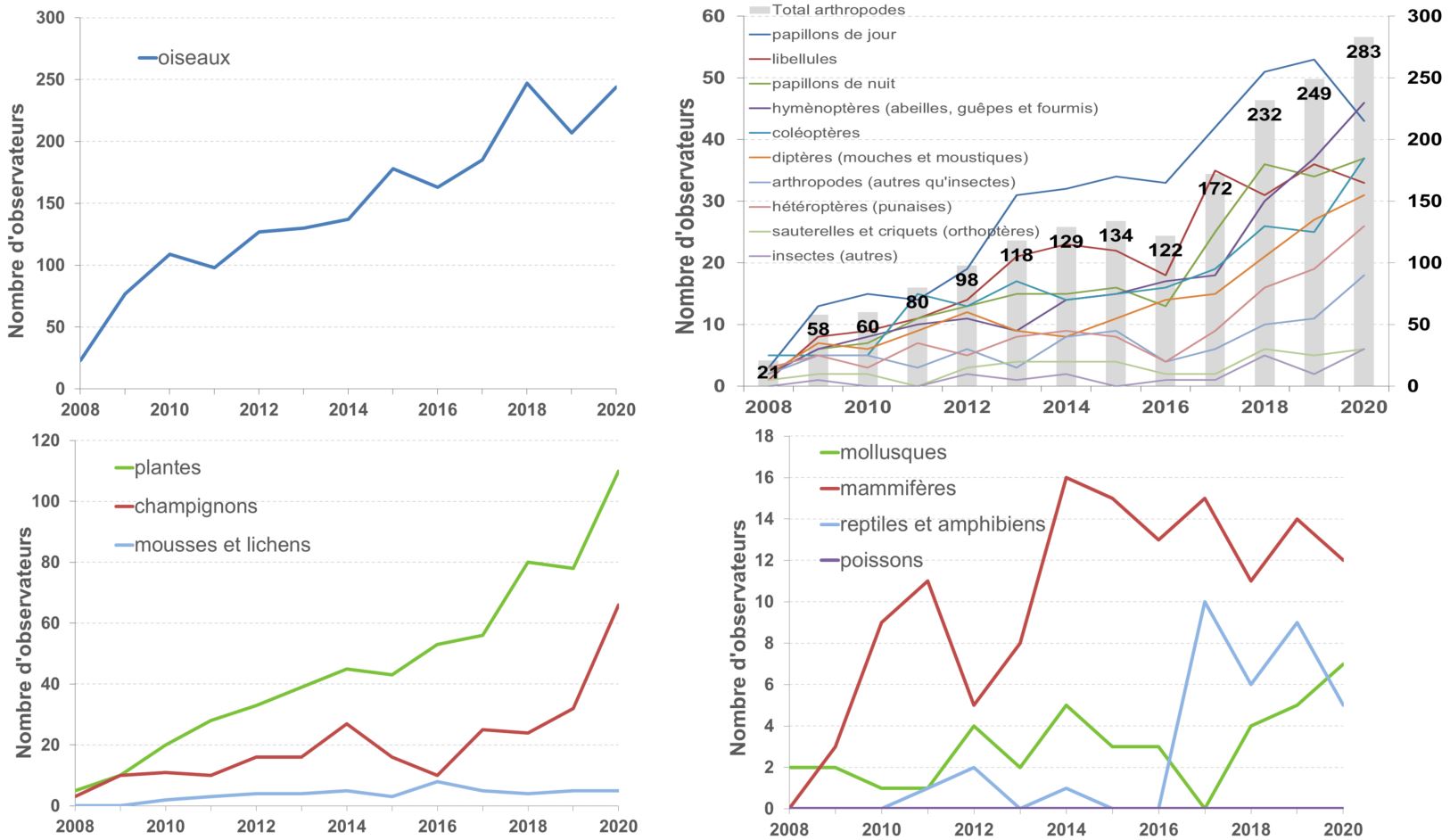
6.341 espèces observées en Région bruxelloise sont inventoriées dans observations.be en 2021
Entre la création du site en 2008 et avril 2021, plus de 1.100.000 d’observations se rapportant à 6.341 espèces différentes ont été encodées dans www.bru.observations.be, y compris un certain nombre d’observations antérieures à 2008. 82,5% de ces observations se rapportent aux oiseaux et plantes .
Répartition du nombre d’observations entre les différents groupes taxonomiques (avril 2021)
Source : www.bru.observations.be, site consulté le 28 avril 2021
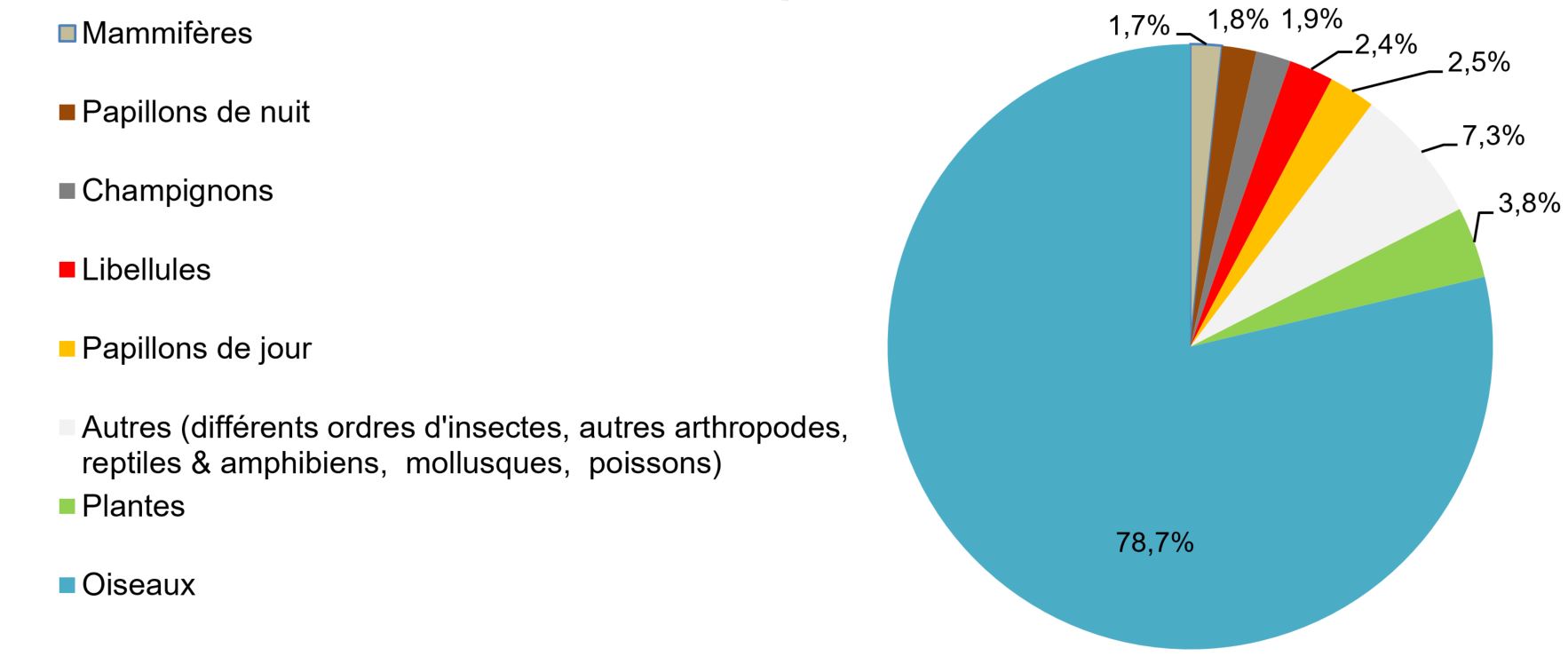
Le graphique ci-dessous reprend le nombre d’espèces observées par groupe taxonomique. Les groupes les plus représentés en terme de nombre d’espèces sont les champignons, plantes et certains ordres d’insectes tels que les lépidoptères (papillons de nuit et papillons de jour), les coléoptères (scarabées, coccinelles, carabes entre autres), les diptères (mouches et moustiques) ou encore, les hyménoptères (abeilles, guêpes et fourmis).
Répartition des espèces observées par groupes taxonomiques, espèces exotiques comprises (avril 2021)
Source : www.bru.observations.be, site consulté le 28 avril 2021
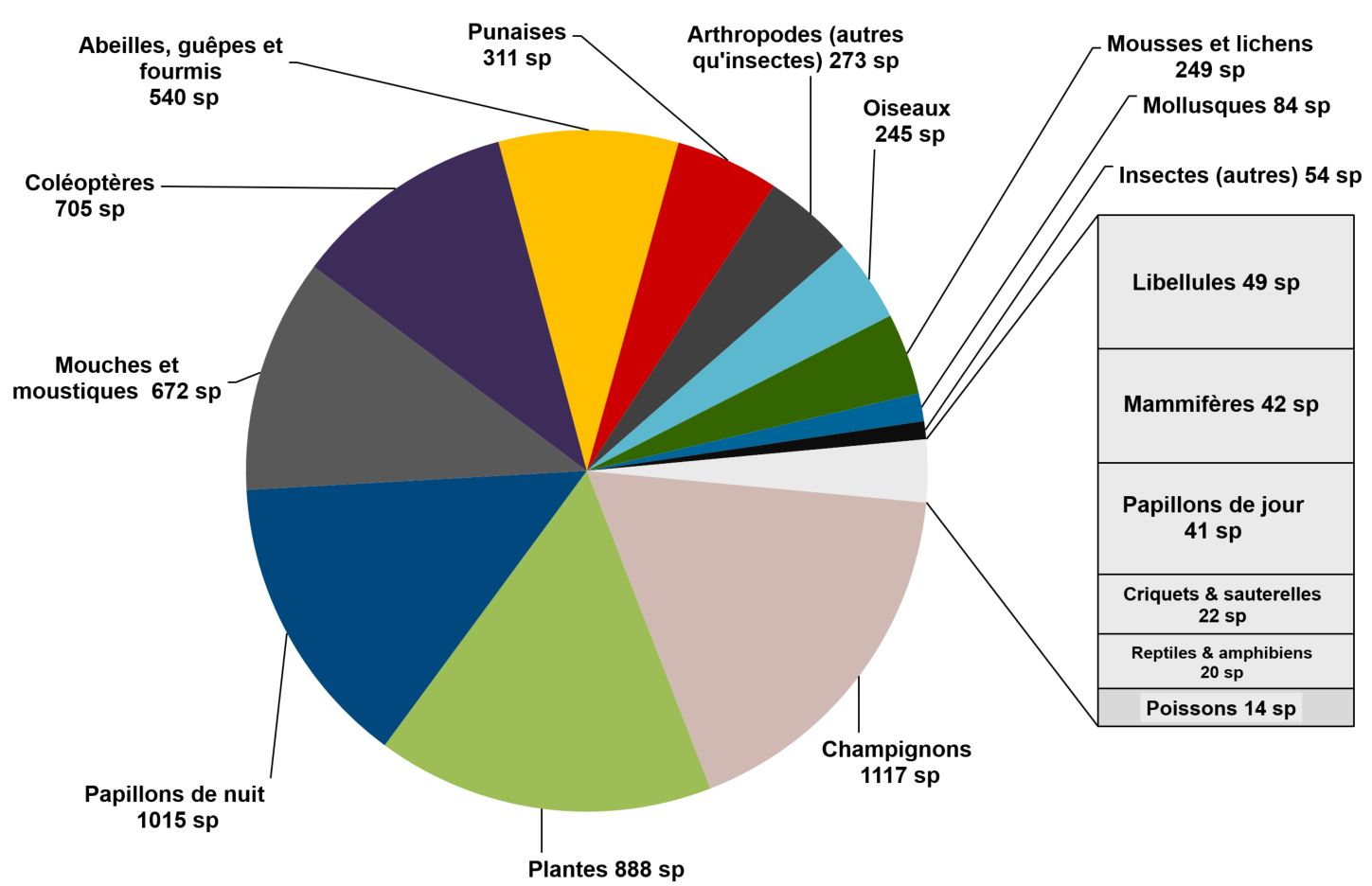
Ces chiffres reflètent, dans une certaine mesure, la diversité d’espèces au sein de chaque groupe. Ils sont néanmoins aussi influencés par les efforts d’inventorisation ainsi que par la plus ou moins grande facilité d’observation et d’identification des espèces qui diffèrent selon les groupes taxonomiques.
Le graphe suivant compare le nombre d’espèces observées par groupe taxonomique en Région bruxelloise, d’une part, et pour l’ensemble de la Belgique, d’autre part. Les poissons sont le groupe où la proportion d’espèces observées en Région bruxelloise par rapport à l’ensemble de la Belgique est la plus faible (8%). A contrario, cette proportion est élevée pour certains groupes tels que les reptiles et amphibiens (77%), les libellules (70%), les plantes (61%), les oiseaux et mammifères (51% chacun) ou encore, les criquets et sauterelles (44%).
Nombre d’espèces (y compris exotiques) observées par groupes taxonomiques en Région bruxelloise et dans l’ensemble de la Belgique (mai 2021)
Source : www.bru.observations.be, site consulté le 3 mai 2021
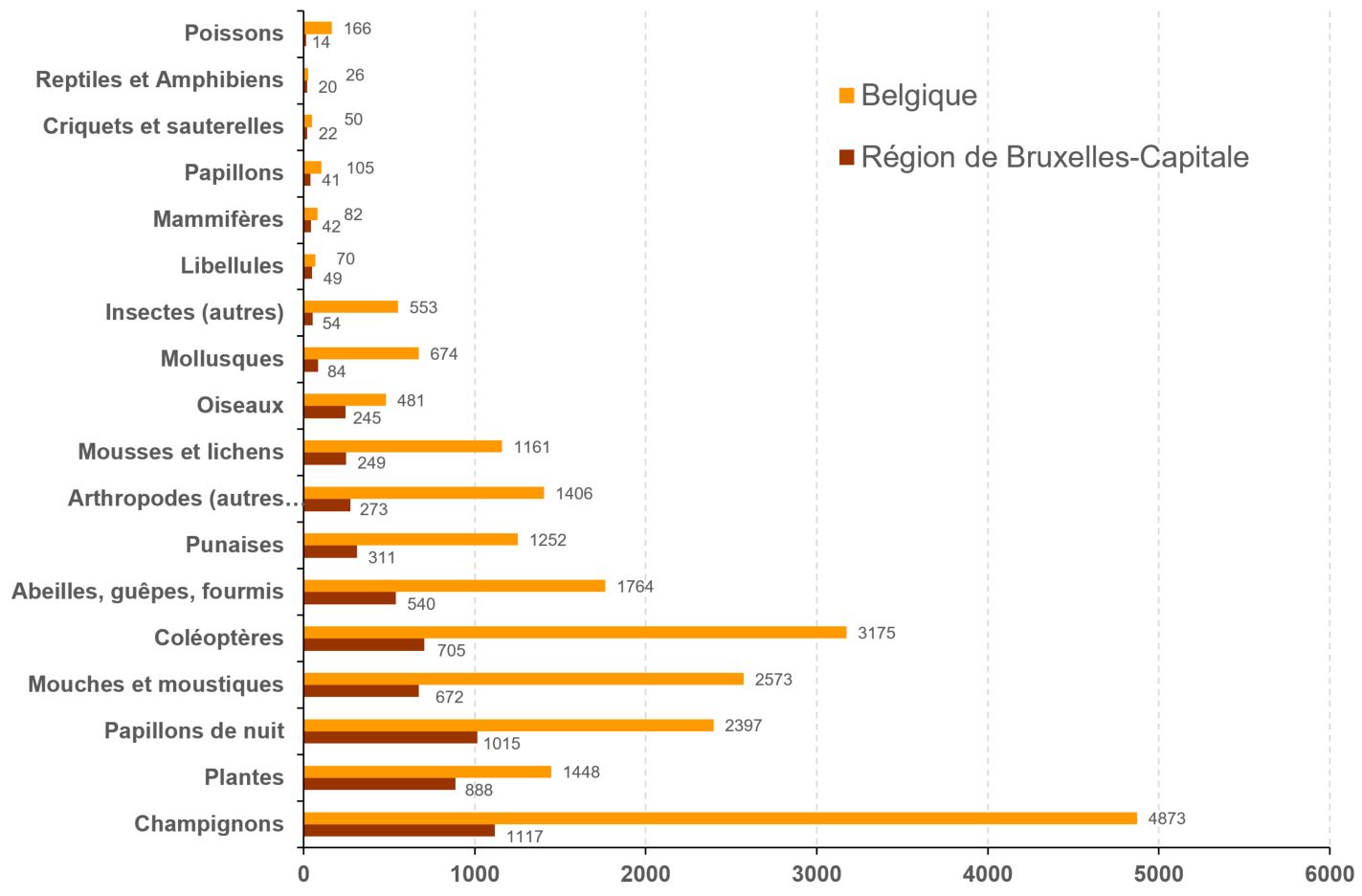
Malgré les biais inhérents à ces données, ces résultats illustrent le fait qu’en dépit de sa superficie limitée et de son caractère fortement urbain, la Région bruxelloise présente une diversité floristique et faunistique appréciable.
À télécharger
Fiches méthodologiques
Tableaux reprenant les données
- Nombre d’observateurs réguliers par groupes taxonomiques et par an (site web www.bru.observations.be, Région de Bruxelles-Capitale) [xls]
- Nombre d'observations encodées dans le site www.bru.observations.be par groupes taxonomiques (Région de Bruxelles-Capitale) [xls]
- Nombre d'espèces encodées dans le site www.bru.observations.be par groupes taxonomiques (Région de Bruxelles-Capitale) [xls]
- Nombre d'espèces encodées dans le site www.bru.observations.be par groupes taxonomiques (Région de Bruxelles-Capitale et Belgique) [xls]
Fiches documentées
Fiche de l’Etat de l’Environnement
Autre publication de Bruxelles Environnement
Plan et programme
Recherche et synthèse de connaissances : Perception du cadre de vie
Focus - Actualisation : décembre 2011
Contexte
L’enquête socio-économique réalisée en 2001 par l’INS (devenue depuis la DGSIE) contenait des questions se rapportant au jugement de l’environnement immédiat du logement et des équipements offerts dans le quartier. Celles-ci étaient reprises dans au sein de la partie "logement" du questionnaire, soumise à tous les chefs de ménage inscrits au registre national comme étant domiciliés en Région bruxelloise.
Les thématiques concernées sont notamment l’aspect esthétique des constructions, la propreté, la qualité de l'air (pollution atmosphérique), la tranquillité (pollution sonore), les trottoirs, les pistes cyclables, les routes, la présence d'espaces verts, l’offre de transports publics et les facilités commerciales.
Evaluation de la répartition spatiale de la perception du cadre de vie
L’analyse de la répartition spatiale (à l’échelle des secteurs statistiques) des réponses données a montré trois patrons :
- Une opposition entre la ville dense (et anciennement urbanisée) de première couronne et la ville moins dense (plus verdurisée et souvent plus récente) de seconde couronne ;
- Une répartition liée aux infrastructures effectivement disponibles ;
- Une répartition liée à des spécificités locales, qui traduisent parfois l'effet de politiques territoriales différentes (communales par exemple).
La combinaison des différents indicateurs obtenus permet d'élaborer une typologie des secteurs statistiques de la Région (réalisée à l'aide d'une analyse multivariée des indices de satisfaction), en fonction de la perception du cadre physique d’une part et de l'équipement d’autre part.
Neuf types d’appréciations peuvent ainsi être identifiés, correspondant plus à une matrice de situation qu'à un gradient univoque : depuis un jugement négatif du cadre physique et des équipements (en orange clair sur la carte) jusqu’à une bonne perception de ces deux caractéristiques (en vert foncé sur la carte).
Répartition spatiale de la perception de l'environnement et des équipements du quartier en Région de Bruxelles-Capitale
Source : DGSIE (ex-INS), Enquête socio-économique de 2001
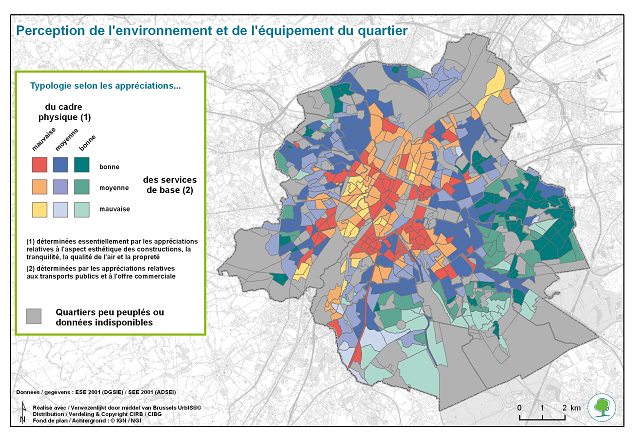
(Accédez à la carte interactive)
Analyse du jugement de la qualité globale de l'environnement et des services du quartier
L’analyse de la répartition spatiale de l’indice obtenu montre une situation assez contrastée du jugement des quartiers par leurs habitants. Il existe ainsi en Région bruxelloise des quartiers bien perçus tant sur le plan du cadre physique qu'en terme de services (dans l’est de la Région), tout comme des quartiers unanimement moins appréciés (dans l’ouest de la 1e couronne).
Cependant, dans bien des cas, la situation est plus complexe, l'une ou l'autre composante du quartier étant dominante dans le jugement. Ainsi, par exemple, le sud d'Uccle est bien perçu pour son cadre physique agréable, mais décrié pour le manque de services. Le centre-ville et les anciens faubourgs du 19ème siècle sont très appréciés pour leur commerce et leur accessibilité par les transports en commun, mais le cadre physique n'y est pas très bien perçu. Par de nombreux aspects, les quartiers intermédiaires (entre la première et la seconde couronne) et de nombreux anciens noyaux villageois semblent constituer un compromis intéressant vis-à-vis du jugement de la qualité globale de l'environnement et des services du quartier.
Notons toutefois que, du fait du poids des facteurs d'ordre foncier et financier (qui se traduisent dans les structures socio-spatiales de la ville), cette typologie ne permet pas de se prononcer quant à la contribution de la perception du cadre de vie dans les choix résidentiels.
À télécharger
Fiche(s) méthodologique(s)
Fiche(s) documentée(s)
- 13. Perception du cadre de vie par les habitants en Région de Bruxelles-Capitale (.pdf)
- 01. Perception des nuisances acoustiques en Région de Bruxelles-Capitale (.pdf)
Etude(s)
Le maillage jeux
Focus - Actualisation : mai 2022
Selon une étude réalisée par Bruxelles Environnement, la Région bruxelloise comptait, en 2011, de l’ordre de 299 plaines de jeux et de 142 infrastructures de type terrains multisport ou skateparks. Ces aires de jeux sont inégalement réparties dans le tissu urbain et sont très hétérogènes notamment en termes de taille, de qualité et de classes d’âge visées. En s’appuyant notamment sur un état des lieux - tant quantitatif que qualitatif - des aires de jeux ludiques et sportives ainsi que sur des données prospectives, une stratégie « Maillage jeux » a été élaborée par Bruxelles Environnement. Elle vise à offrir à tous les Bruxellois des espaces ludiques en quantité suffisante, répartis sur l’ensemble du territoire et de qualité élevée. Cette stratégie a été explicitée et diffusée dans deux publications destinées à servir d’outil de référence pour l’aménagement d’aires de jeux et d’espaces dédiés à la « glisse urbaine » en Région bruxelloise. Depuis 2009, une trentaine d’aires de jeux et de sport ont été rénovées ou créées par Bruxelles Environnement en s’inspirant des principes et recommandations guidant cette stratégie. Des projets visant à développer des offres ludiques alternatives dans les quartiers denses ont par ailleurs également été réalisés.
L’enjeu du jeu dans la ville
La disponibilité en espaces verts et espaces récréatifs de qualité constitue un ingrédient essentiel de la qualité de vie en ville. Les espaces de jeux, en particulier, participent au développement psychomoteur, physique et social des enfants et des adolescents voire des adultes.
Au cours des dernières décennies, de nombreuses friches et terrains vagues – offrant des terrains d’aventure et de jeux informels - ont été progressivement bâtis sous la pression de l’urbanisation ; selon le rapport sur l’état de la nature 2012, environ 20 à 25% des friches ont été bâties entre 1998 et 2008. Par ailleurs, la forte demande de logements liée à la croissance de la population et à la réduction de la taille des ménages s’est traduite par une augmentation conséquente du nombre de logements de type « immeubles à appartements » (+ 55% entre 1995 et 2021) et par une division de nombreuses maisons unifamiliales réduisant ainsi la part de la population ayant accès à un jardin privé. Dans un contexte général de croissance démographique (avec rajeunissement de la population) et de densification du tissu urbain, assurer une offre ludique à la fois quantitative et qualitative au niveau des espaces publics devient dès lors un enjeu essentiel en termes de planification et d’aménagement urbains.
Bruxelles Environnement gère par ailleurs de 115 aires de jeux et de sport intégrées dans ses espaces verts dont certaines, amorties, doivent être rénovées. C’est dans ce contexte qu’une réflexion plus globale sur le contour à donner aux aires ludiques et sportives de demain a été initiée il y a une dizaine d'année.
Offre et demande en matière d’aires ludiques et sportives
En 2009, alors que de nombreuses plaines de jeux arrivaient à amortissement, Bruxelles Environnement a mené une première évaluation des aires de jeux et de sport de la Région bruxelloise. Un inventaire des aires ludiques et sportives formelles (y compris celles gérées par les communes) a été réalisé sur base d’un questionnaire portant notamment sur la localisation et les équipements présents.
Ces informations ont été encodées dans une base de données géoréférencée ce qui a permis d’analyser la répartition spatiale des aires ludiques dans le tissu urbain mais aussi de les croiser, à l’échelle des quartiers, avec des variables démographiques et socio-économiques (taille et densité de la population, répartition par âge, revenus, superficie moyenne des logements par habitant, etc.).
Cette étude a permis de recenser 321 aires ludiques et sportives (y compris 21 terrains de pétanque et tables de ping-pong) dont 115 gérées par Bruxelles Environnement. Ces aires de jeux sont néanmoins très hétérogènes tant en termes de taille, que de qualité et de classes d’âge visées ce qui rendait indispensable le recours à une analyse qualitative complémentaire. Elles sont également inégalement réparties dans le tissu urbain avec, tant au centre qu’en périphérie, de fortes concentrations locales ou, au contraire, des zones non équipées. Globalement, les aires ludiques en seconde couronne proposent surtout des jeux destinés aux enfants alors que dans les parties plus centrales de la ville, les aires sont plutôt orientées vers un public d’enfants et d’adolescents en offrant sur un même site des jeux et du sport.
De nombreux autres constats ont été mis en avant dont, notamment, une prise en compte insuffisante de certains publics (pré-adolescents et adolescents dont en particulier les jeunes filles, enfants porteurs d’un handicap moteur, familles avec enfants de différentes tranches d’âges, très jeunes enfants), les possibilités d’utilisation souvent trop univoques des jeux et la faible inventivité dans la conception des espaces, l’importance des espaces de jeux informels, le manque d’entretien, de surveillance et d’équipements auxiliaires (WC, eau potable, tables de pique-nique, etc.). Plus généralement, l’étude a montré qu’il n’existait pas de véritable politique régionale en matière de développement d’aires ludiques et sportives.
Dans l’optique d’élaborer une stratégie de maillage jeux et d’identifier les zones d’intervention prioritaire, cet état des lieux a été complété par une approche qualitative détaillée réalisée en 2011-2012. L’approche qualitative s’est appuyée sur la visite de l’ensemble des aires de jeux et de sport répertoriées lors de la première phase et leur caractérisation sur base d’une grille d’analyse portant sur 6 thématiques : généralités (rayonnement théorique de l’aire, heures d’ouverture, proximité d’écoles ou de musées, etc.), accessibilité, jeux et activités sportives à disposition, ludicité et attrait, confort des accompagnants, propreté, entretien et sécurité). Sur base de différents critères de qualité une cotation globale a été établie pour chaque aire étudiée. La qualité des plaines de jeux a été considérée comme bonne, moyenne ou mauvaise selon que sa cote était > 7/10, comprise entre 5 et 7/10 ou < 5/10.
Cette seconde phase de l’étude a notamment mis en évidence les constats suivants :
- la cote moyenne pour la qualité de l’ensemble de l’offre ludo-sportive au niveau régional est de 6,5/10 pour les aires de jeux et de 6/10 pour les terrains de sport ou skateparks ;
- il existe 299 plaines de jeux (soit en moyenne environ une plaine de jeux pour 435 enfants en âge de fréquenter l’enseignement maternel et primaire) et 142 infrastructures de type terrains multisport ou skateparks (soit en moyenne environ un espace de jeux pour adolescent pour 528 jeunes en âge de fréquenter l’enseignement secondaire) ;
- 65% des plaines de jeux ont un rayonnement à l’échelle locale (rue ou quartier), 33% à l’échelle communale et moins de 2% à l’échelle supra communale.
Répartition spatiale (2009) et qualité (2011) des aires de jeux
Source : Bruxelles Environnement, BRAT et L’Escaut 2015
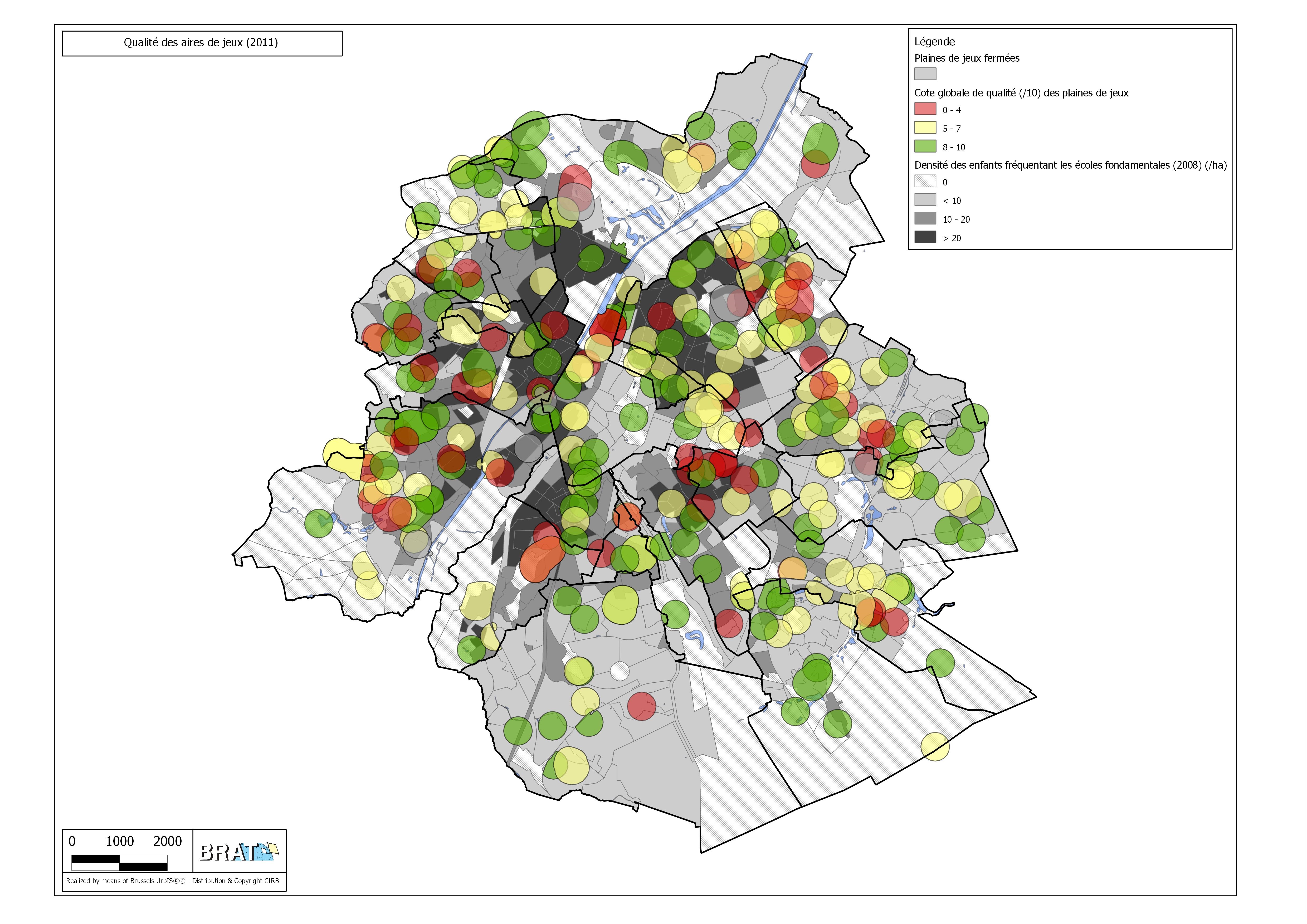
Chaque plaine de jeux est représentée par un cercle correspondant à un rayon de 300 mètres à partir du centre de l’aire ou de l’entrée du parc. Cette distance de 300 mètres à vol d’oiseau correspond à environ 10 minutes de marche avec des enfants soit à une zone d’accessibilité théorique. Ces zones ont été tronquées lorsqu’elles coupent des barrières urbaines infranchissables (autoroutes, canal, plan d’eau, zones impénétrables, lignes de métro aérien et de chemin de fer). Si un point de passage permet de traverser cet obstacle, une zone au-delà de ce point a été recalculée afin d’atteindre les 300 mètres de distance à vol d’oiseau. Dans le cas d’une aire de jeux située dans un parc compris entre 1,5 et 4 hectares, la zone d’accessibilité a été calculée à partir des limites du parc.
Cette carte met en évidence les parties du territoire situées dans une zone d’accessibilité théorique d’une plaine de jeux et permet donc, en première approche, d’identifier des zones de carence concernant l’accès des enfants à une plaine de jeux de proximité. Elle fournit également des informations sur la qualité des plaines de jeux ainsi que sur la densité d’enfants par quartier (IBSA).
Répartition spatiale (2009) et qualité (2011) des terrains multisport ou skateparks
Source : Bruxelles Environnement, BRAT et L’Escaut 2015
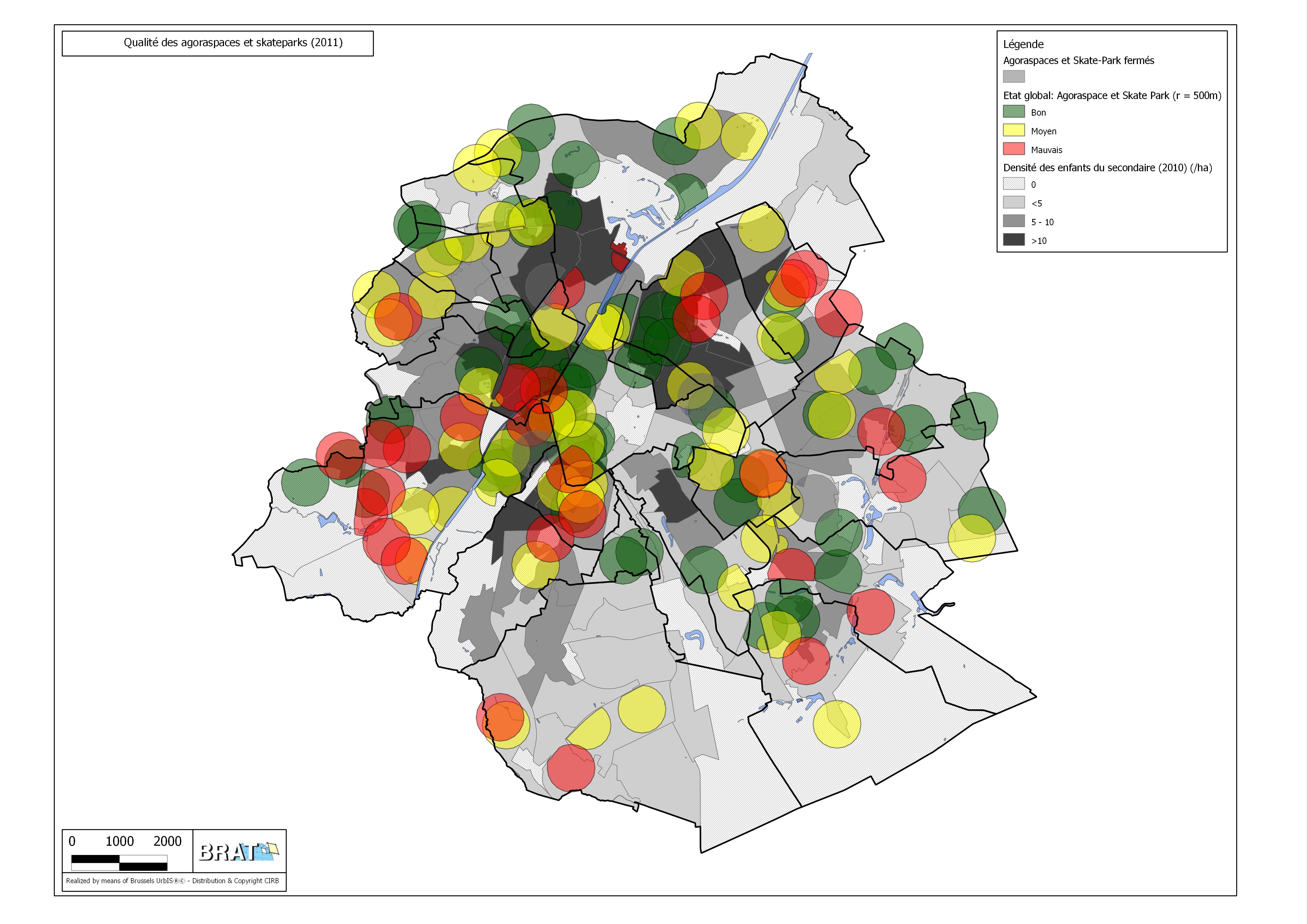
Une approche similaire a été menée pour les infrastructures destinées aux adolescents en considérant une zone d’accessibilité théorique de 500 mètres à vol d’oiseau.
Vers un maillage jeux à Bruxelles
Suite à ces travaux et réflexions, une stratégie de mise en place d’un véritable « maillage jeux » a été élaborée par Bruxelles Environnement. Celle-ci, ainsi que ses modalités pratiques de mise en œuvre, ont fait l’objet de deux publications : « Le jeu dans la ville – Pour un maillage jeux à Bruxelles » et « SK8BXL – Le skate dans la ville », cette dernière étant consacrée spécifiquement au développement de lieux dédiés au skate et autres disciplines de glisse urbaine. Ces publications visent à servir d’outil de référence pour les maîtres d’ouvrage, concepteurs, administrations et tout autre acteur impliqué dans l’aménagement de l’espace public.
Le maillage jeux y est défini comme « une stratégie visant à offrir des espaces ouverts ludiques en quantité suffisante, répartis sur l’ensemble du territoire et de qualité élevée à tous les habitants de la Région ». Cette stratégie a été traduite en objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre à l’horizon 2020 à savoir :
- assurer, au niveau de tous les quartiers bruxellois, la présence d’une plaine de jeux pour 500 enfants et d’une infrastructure adaptée aux adolescents pour 500 adolescents ;
- assurer la présence d’une plaine de jeux et d’un espace ludo-sportif pour adolescent respectivement à moins de 300 mètres et 500 mètres à vol d’oiseau de toutes les zones habitées ;
- atteindre une cote moyenne de 8/10 en ce qui concerne la qualité de l’ensemble de l’offre ludo-sportive en Région bruxelloise.
Au-delà de ces objectifs cette stratégie s’appuie sur une série de grands principes et lignes directrices tels que par exemple :
- agir prioritairement sur les zones de carence en infrastructures ludiques (en tenant compte de l’offre tant quantitative que qualitative, des projections démographiques par quartier, de la présence d’infrastructures telles qu’écoles, bibliothèques et ludothèques, musées venant renforcer la demande, etc.) ;
- articuler le maillage jeux autour de 4 niveaux de rayonnement (rue, quartier, commune et région) en développant les collaborations et synergies nécessaires entre les divers acteurs (BE, communes, contrats de quartier, institutions communautaires, etc.) ;
- créer des pôles récréatifs d’ampleur régionale (prévus dans le projet de plan régional de développement ou PRDD) ;
- diversifier l’offre et les types d’aires de jeux (en prenant en compte les besoins des catégories d’usagers pour lesquelles l’offre est faible) et augmenter leur inventivité et originalité ;
- stimuler la création d’espaces de jeux informels et intégrer la dimension ludique dans la conception des espaces publics ;
- privilégier la participation des enfants et futurs usagers lors de l’aménagement d’aires de jeux et plus largement d’espaces publics ;
- intégrer les objectifs du maillage jeux au cœur des nouveaux projets de logements.
Le projet de PRDD identifie les équipements sportifs et récréatifs parmi les besoins prioritaires en termes de services et équipements dont il convient d’améliorer l’offre. Le maillage jeux y est par ailleurs explicitement mentionné et présenté, avec les maillages socio-récréatif, bleu et écologique, comme l’un des maillages stratégiques du maillage vertProgramme fondé sur la protection et la création des espaces verts et l'établissement de liens physiques entre eux, qui vise, outre la préservation du patrimoine naturel et l'accroissement de la biodiversité, à rééquilibrer les disparités régionales au niveau de la verdurisation et de la répartition des espaces verts publics, à améliorer les qualités paysagères et à promouvoir la mobilité douce. (voir focus sur le sujet).
Plusieurs mesures concrètes ont déjà été prises pour la mise en application de la politique de développement d’un maillage jeux. Depuis 2009, de nombreuses aires de jeux ont été rénovées ou créées par Bruxelles Environnement en intégrant les recommandations issues de la réflexion sur le maillage jeux. Elles sont localisées au niveau des sites suivants : parc Georges-Henri, parc Bonnevie, Porte de Hal, parc Roi Baudouin (phases 1, 2 et 3), Rouge-Cloître, pavillon chinois, promenade du chemin de fer (station et Willame), bois du Wilder (parcours santé), parc Seny, ligne 28-Dubrucq, Scheutbos (partie basse). De nouveaux projets sont également en cours ou planifiés.
En 2022, Bruxelles Environnement gérait 115 aires de jeux et de sport.
Des projets visant à développer des offres ludiques alternatives - notamment au niveau des quartiers denses - ont également été menés et se sont concrétisés par la réalisation d’une structure mobile suscitant l’imaginaire (la grotte du Yéti) et de luges sur roulettes pour animations de rues ou de parcs (le Mur infernal).
Développement d’un axe sport
Une vaste étude prospective a été lancée par Bruxelles Environnement en 2018 afin d’évaluer l’offre existante en infrastructures sportives et la confronter aux besoins réels. Cette étude a permis d’aboutir à une stratégie sport, autant opérationnelle que stratégique, visant à favoriser l’accueil des pratiques sportives spontanées par des interventions légères et relativement rapides qui s’intègrent au mieux dans le paysage et respectent la valeur écologique des sites. L’objectif est aussi de renforcer la cohésion et l’intégration sociale au sein des espaces verts, renforcer le conditionnement physique et améliorer la santé, encourager les loisirs actifs et développer des pôles sportifs. Cette stratégie est mise en œuvre depuis 2019 et a déjà permis de réaliser une série d’aménagements sportifs polyvalents et de qualité, d’impulser une dynamique sportive à travers des interventions légères de type marquage, bornage, fresque et enfin de diversifier l’offre sportive afin de toucher tous les publics (femmes, enfants, public adolescent…) dans les espaces verts.
Pour plus d’informations sur la stratégie sport et les actions réalisées dans le cadre de celle-ci, consultez le focus Sport et espaces verts en Région bruxelloise.
À télécharger
Fiche(s) documentée(s)
Fiche(s) de l’Etat de l’Environnement
- Focus : Sport et espaces verts en Région bruxelloise
- L’évolution démographique en Région bruxelloise (mai 2022)
- L’occupation du sol en Région bruxelloise (février 2022)
- Focus : Le maillage vert (décembre 2015)
- Focus : Recherche et synthèse de connaissances : perception du cadre de vie (édition 2007-2010)
- Espaces verts : accessibilité au public (édition 2007-2008) (.pdf)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- BRUXELLES ENVIRONNEMENT, BRAT et L’ESCAUT 2015. « Le jeu dans la ville - Pour un maillage jeux à Bruxelles », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 122 pp. (.pdf)
- BRUXELLES ENVIRONNEMENT, BRAT et BRUSK 2015. « SK8BXL - Le skate dans la ville», étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 63 pp. (.pdf)
Etude(s) et rapport(s)
- BRAT 2009. « Inventaire des espaces verts et espaces récréatifs accessibles au public en Région de Bruxelles-Capitale», étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 40 pp. + annexes (.pdf)
- BRAT et RUIMTECEL 2009. « Etude pour un redéploiement des aires ludiques et sportives en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 49 pp. (.pdf)
- VAN DE VOORDE T., CANTERS F. ET CHEUNG-WAI CHAN J. 2010. « Mapping update and analysis of the evolution of non-built (green) spaces in the Brussels Capital Region - Part I & II», cartography and GIS Research Group - department of geography (VUB), Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 35 pp. (.pdf) (uniquement en anglais)
Sport et espaces verts en Région bruxelloise
Focus – actualisation : juillet 2021
L’offre en infrastructures dédiées à la pratique sportive dans l’espace public est actuellement peu diversifiée: plus de 80% de l’offre relève de terrains de foot et/ou basket et de pistes de pétanque. Les sports pratiqués dans les espaces verts sont dès lors peu variés et orientés essentiellement vers certains groupes cibles : hommes (environ 80% des pratiquants), jeunes et jeunes adultes. La question de la promotion du sport dans l’espace public pour les adolescentes, les femmes, les personnes plus âgées, les personnes porteuses d’un handicap et parfois aussi les enfants, constitue un enjeu de taille. L’offre est également spatialement contrastée : une étude a estimé à environ 43% les quartiers bruxellois présentant des niveaux de carence élevés en infrastructures sportives.
Une étude pour répondre à la demande croissante d’espaces dédiés au sport dans les espaces verts
La disponibilité en espaces verts et espaces récréatifs représente un élément essentiel de la qualité de vie et de la santé des citadins. Elle influence aussi directement l’attractivité résidentielle. L’augmentation de la population bruxelloise ainsi que la densification qui l’accompagne se traduisent notamment par une demande croissante pour le développement de pratiques sportives dans les espaces verts publics régionaux. Celui-ci doit toutefois s’intégrer dans l’espace urbain et cohabiter avec les autres fonctions des espaces verts (accueil de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., zone de calme, valeur patrimoniale et paysagère, etc.). Parmi la centaine d’espaces verts gérés par Bruxelles Environnement, une cinquantaine d’infrastructures de jeu et/ou de sport (certaines étant combinées) sont actuellement présentes.
C’est dans ce contexte qu’une étude visant à développer une vision et une stratégie globales pour le (re)déploiement du sport dans les espaces verts de la Région bruxelloise a été réalisée en 2017-2018.
Celle-ci a comporté 3 phases :
- Mise en contexte et état des lieux :
- Inventaire et cartographie de l’offre en infrastructures de sports disponibles dans l’espace public ainsi que par type de terrain ;
- Inventaire et cartographie des sites permettant une pratique sportive sans pour autant qu’un aménagement spécifique ne soit prévu (pelouses, chemins, parcs et bois, pièces d’eau, etc.) ;
- Identification de zones de carence non couvertes par certains éléments relatifs à l’offre (en considérant une zone d’accessibilité de 500 mètres de rayon).
- Identification de la demande potentielle et des usages (d’un point de vue quantitatif et qualitatif) et confrontation à l’offre (analyse par sport et par type d’espaces verts ou de quartiers) ;
- Recommandations.
Cette étude a permis à Bruxelles Environnement de structurer son approche et de définir un cadre d’intervention à moyen et long terme pour le développement du sport dans les espaces publics régionaux.
La pratique sportive dans les espaces publics répond à des enjeux sociaux et de santé publique
L’activité physique régulière a de nombreux effets bénéfiques sur la santé physique et psychologique ainsi que sur le développement psychomoteur de ceux qui la pratiquent. Outre les rencontres qu’elle favorise, la pratique d’activités physiques et/ou sportives est également susceptible d’impacter favorablement la socialisation des individus : dépassement des différences (classe sociale, origine, genre, âges, etc.), sentiment d'appartenance à un groupe et cohésion, acquisition de compétences sociales (communication, interaction, capacité d’écouter et de se faire écouter, etc.), gestion des règles et conflits, etc.
Certains quartiers bruxellois connaissent des phénomènes d’exclusion se traduisant notamment par des taux de chômage, d’échecs scolaires ou de précarité plus élevés. Le développement de la pratique du sport dans ces quartiers peut contribuer, avec de nombreux autres outils, à favoriser une dynamique sociale et une appropriation positives de l’espace public.
La possibilité de pratiquer des activités physiques dans l’espace public offre des avantages supplémentaires tels que la gratuité, l’aspect pratique ou encore, la convivialité. Les infrastructures sportives aménagées dans les espaces publics peuvent également s’avérer très utiles pour les associations (maisons de jeunes, mouvements de jeunesse, etc.) et les écoles qui ne disposent pas toujours de ces équipements.
Mais son développement doit aussi faire l’objet d’une réflexion transversale
Les pratiques de certaines de ces activités peuvent être à l’origine de nuisances, que ce soit pour l’espace lui-même, pour les autres utilisateurs de l’espace, pour les voisins ou pour l’environnement. Différents types de nuisances sont identifiées : dégradations de l’espace, nuisances sonores, conflits potentiels (entre usagers, avec le voisinage, etc.), perturbation de la flore et de la faune, compactage du sol…
Au-delà de la question des nuisances, se posent aussi les questions du partage des espaces publics, de la gestion et de l’entretien des infrastructures sportives et des espaces utilisés par les sportifs ainsi que de l’encadrement visant à assurer la bonne cohabitation des usagers de l’espace.
Le développement de pratiques sportives dans un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. doit dès lors veiller à trouver un équilibre entre les différentes fonctions du site et tenir compte de sa capacité d’accueil ainsi que des impacts potentiels de l’intervention en termes d’aménagements à réaliser et d’activités récréatives engendrées. Il doit aussi s’insérer dans une approche socio-urbanistique tenant compte des caractéristiques et enjeux du quartier. Par ailleurs, la pratique sportive en espace public relève davantage du loisir sportif que de la pratique intensive d’un sport et, de ce fait, les infrastructures proposées ne doivent pas se substituer à l’offre « normalisée » (salles de sport par exemple) mais plutôt assurer un rôle complémentaire.
Une approche par sport : l’exemple du basket
Une cinquantaine de sports praticables dans l’espace public ont été considérés dans le cadre de cette étude, y compris des sports ne nécessitant pas d’équipements et infrastructures spécifiques (thai-chi, parkour, conditionnement physique, etc.). Les sports non pris en compte incluent les sports essentiellement indoor nécessitant des infrastructures particulières, ceux dont la pratique présente un risque élevé et implique un encadrement ainsi que les sports considérés avant tout comme un loisir (kuistax par exemple). A titre d’exemple, les données collectées pour la pratique du basket sont reprises ci-dessous.
Un éclairage quantitatif …
Un total de 133 terrains de basketball est implanté en Région de Bruxelles-Capitale. Toutes les communes de la Région comprennent de tels terrains, à l’exception de Forest. Parmi ces terrains, 70 sont aménagés spécifiquement et uniquement pour la pratique du basket.
Concernant l’adaptation de l’offre à la demande, le seuil indicatif retenu pour ce sport est de 2.500 habitants/terrain de basket (ratio établi sur base de différentes études). Ce ratio doit être comparé à celui calculé pour l’ensemble de la Région qui est de 8.932 habitants/équipement. Ce calcul a par ailleurs été appliqué aux 145 quartiers délimités sur l’ensemble de la Région (Monitoring des quartiers) ce qui a permis de déterminer en première approche l’importance des carences en terrains de basket par quartier en définissant 3 niveaux de priorité (forte, moindre, aucune). Cette approche a été ensuite affinée en excluant les quartiers peu ou pas habités et en faisant passer d’une priorité supérieure à une priorité inférieure les quartiers peu denses (< 5.000 habitants/km2) ainsi que les quartiers couverts sur au moins 50% de leur superficie par la zone d’accessibilité de terrains de basket situés au sein de quartiers adjacents.
Compte tenu du nombre important de quartiers de priorité moindre obtenu pour le football et le basket, il a été décidé d’ajouter un niveau de catégorisation supplémentaire pour ces quartiers : une priorité supérieure a été accordée aux quartiers où l’on dénombrait plus de 1.000 jeunes (12-24 ans) par terrain.
Sur base de cette approche quantitative on observe globalement une bonne répartition géographique théorique, malgré quelques carences :
- À l’ouest de Molenbeek-Saint-Jean et au nord d’Ixelles, au sein de quartiers ayant des densités de population importantes ;
- À proximité du quartier Georges Henri, à densité intermédiaire ;
- À Forest et Uccle, au sein de quartiers ayant une densité moindre.
D’autres critères pourraient encore être considérés selon les orientations prises par les instances compétentes : proximité d’écoles, potentiel d’intervention (zones en mutation à l’échelle régionale), etc.
…mais un éclairage aussi qualitatif
Parallèlement à cette approche quantitative, les auteurs de l’étude ont procédé à une approche plus qualitative. Celle-ci s’est basée sur :
- la rencontre d’une série d’acteurs clé du monde sportif, du monde éducatif et dédié à la jeunesse ainsi que de Bruxelles Environnement (gestionnaires et gardiens de parcs) ;
- des observations de terrain effectuées sur une dizaine de sites sélectionnés pour assurer une représentativité des différents types de cas présents en Région bruxelloise en terme d’offre et de profils de quartiers notamment.
Ce travail a permis d’identifier les besoins non rencontrés ou mal rencontrés, les usages faits des équipements existants au sein de différents types de sites ou encore, les attentes des acteurs.
Pour le basket, les principaux enseignements apportés par l’approche qualitative peuvent se résumer comme suit :
- sur les terrains combinés (ex. agoraspace), le basket sera plus souvent pratiqué sur des espaces polyvalents de plus grande taille où les paniers ne coïncident pas avec les goals, à défaut la pratique du football l’emporte quasi systématiquement sur le basketball ;
- le sol et les paniers des agoraspace ne sont pas bien adaptés à la pratique du basket et induisent des risques d’accidents ;
- les usagers pratiquant du basket dans les espaces publics ont moins d’intérêt pour le basket conventionnel que pour le streetbasket pratiqué en plus petit groupe (3X3) sur un seul panier ;
- il existe une demande pour des paniers plus bas, adaptés aux enfants ;
- les infrastructures de basketball sont rapidement dégradées (filets, anneaux) ;
- le rebond des balles induit des nuisances sonores (en fonction du type de revêtements) ;
- les acteurs scolaires et du secteur sportif souhaitent des équipements correspondant aux normes ;
- le basket constitue un outil potentiel pour des éducateurs de la jeunesse et une source de motivation importante pour certains jeunes qui y voient un vecteur d’ascenseur social.
Sur base des analyses quantitatives et qualitatives ainsi que des caractéristiques inhérentes au basket, une synthèse AFOM (Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces) a été élaborée.
L’analyse qualitative amène à nuancer l’approche quantitative. Ainsi, si on ne tient pas compte des aménagements de types agoraspace où la pratique du basket est, dans les faits, quasi inexistante, on constate que la couverture spatiale est bien moins étendue, avec de plus vastes zones de carence, notamment dans des quartiers où la densité de jeunes est importante.
Analyse de l’offre et de la demande d’infrastructures dédiées au basket : approche quantitative
Source : BRAT-PEPS 2017
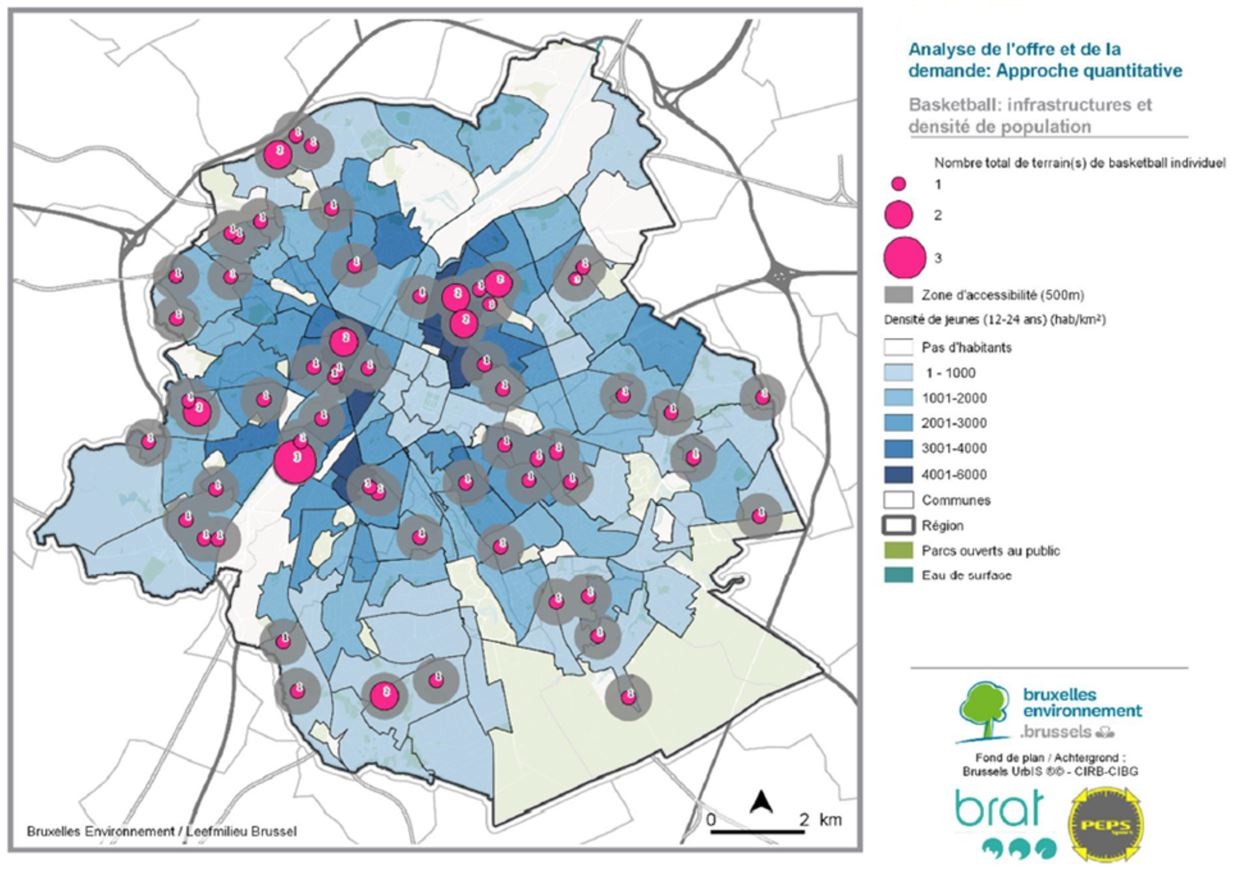
En terme d’équipements, l’analyse effectuée permet aussi d’émettre certaines recommandations, à savoir notamment :
- privilégier un maillage plus important d’anneaux isolés - hors du champ de jeu des terrains de football - à une concentration de terrains classiques, plus consommateurs d’espace ;
- prévoir des équipements plus résistants que les équipements actuels et dont certains répondent aux normes officielles et d’autres répondent aux besoins des enfants ;
- choisir des revêtements permettant de limiter le bruit et d’amortir les chocs lors d’accidents ;
- privilégier les demi-terrains permettant la pratique du street basket (3x3), une pratique sportive très en vogue.
Une approche transversale par type d’espaces verts ou par quartiers
Il s’agit ici de dépasser l’analyse par pratique sportive et d’appréhender la question du développement des infrastructures sportives dans l’espace public d’un point de vue plus global et en tenant compte des caractéristiques des espaces verts et du contexte urbain environnant.
Cette analyse s’appuie essentiellement sur les observations de terrain, croisées à des apports théoriques issus de multiples workshops. Elle a permis d’analyser pour les différents parcs étudiés l’offre et la demande et, dans un second temps, de proposer une typologie des parcs au regard des pratiques sportives observées. Les auteurs de l’étude ont ainsi distingué les « parcs nature », les « parcs de sports » (nombreuses infrastructures sportives, pratiques variées, utilisation intense), les « parcs sports intégrés » (peu d’équipements sportifs mais pratique sportive présente principalement sur les pelouses et les chemins) et les « parcs multisports cloisonnés » (infrastructures sportives installées à l’écart des autres zones du parc).
Le foot et le jogging concentrent 60% des activités sportives observées dans les parcs étudiés
Les visites de terrain ont montré que 7 sports et activités physiques concentrent 90% des activités observées : foot, jogging, street workout (gymnastique/musculation/parkour) et fitness, basket, sport de glisse, pétanque. Ces considérations relatives à l’usage sont néanmoins biaisées puisqu’une offre faible ou inexistante réduit inévitablement l’usage. Le jogging est pratiqué dans tous les parcs d’une taille suffisante.
Nombre de fois où une des 7 activités sportives majoritairement inventoriée a été observée et % répartition hommes/femmes (118 visites – 14 parcs)
Source : BRAT-PEPS 2017
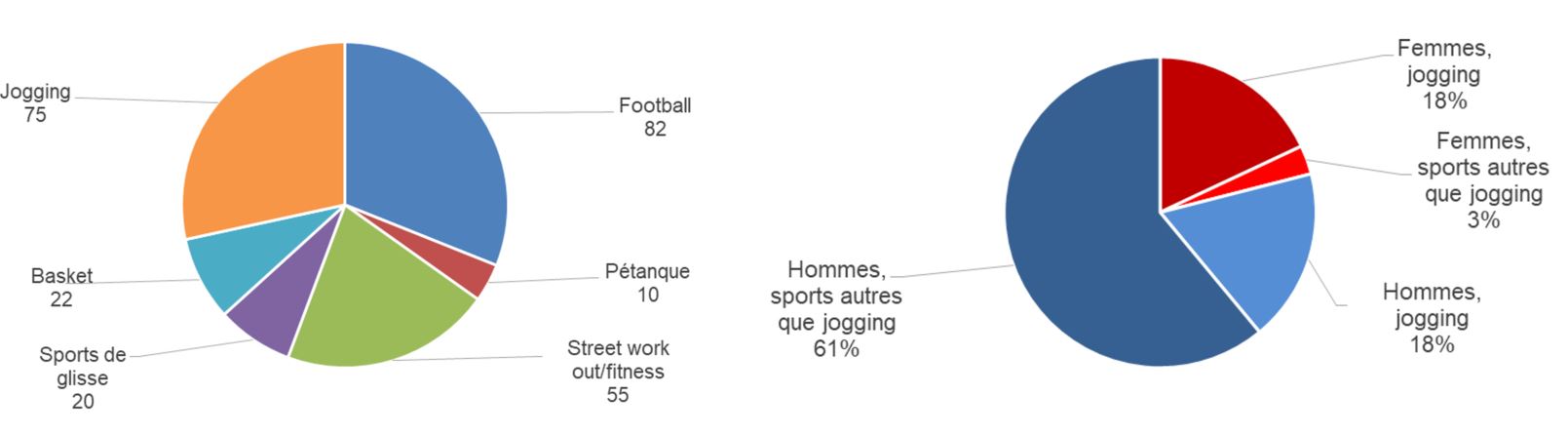
D’autres activités telles que frisbee, badminton ou encore volley, ont été observées de manière plus ponctuelle.
Près de 80% des pratiquants sportifs observés sont des hommes
Lors des visites, près de 3500 personnes pratiquant des activités sportives ont été observées. Parmi
celles-ci, 79% étaient des hommes. Au niveau des tranches d’âge estimées, on observe une majorité d’adultes (60%) et une plus faible part d’adolescents (25%) et d’enfants (15%). Le jogging est de loin le principal sport pratiqué par les femmes (87% des observations) et le seul sport pour lequel une quasi parité homme - femme a été observée.
Une analyse a également été réalisée pour examiner si le type de quartier (tissu urbain et composante socio-démographique) influençait les pratiques sportives. Il en ressort que celles-ci sont surtout liées à la présence et aux caractéristiques de l’offre au sein d’un parc (concentration de plusieurs infrastructures, taille des pelouses…).
62 quartiers présentent des niveaux de carence élevés en infrastructures sportives
Au regard du constat précédant, il paraît intéressant de caractériser les quartiers non pas d’un point de vue socio-urbanistique mais bien au regard de leurs carences cumulées dans les principales infrastructures identifiées (terrain de foot, basket, pétanque, tennis de table et fitness et assimilés).
Pour chaque quartier, les éventuelles carences pour différentes infrastructures ont été sommées en considérant une pondération fonction de l’importance de la carence : 2 points (priorité forte), 1 point (priorité moindre), 0 point (pas d’intervention prioritaire).
Les quartiers peuvent ainsi être présentés suivant un niveau de carence global. Cet exercice permet de mettre en avant les quartiers les plus déficitaires, toutes infrastructures confondues. On observe ainsi plusieurs zones critiques, souvent situées aux limites communales, voire étendues sur plusieurs communes adjacentes.
Analyse de l’offre et de la demande d’infrastructures sportives : synthèse des carences
Source : BRAT-PEPS 2017
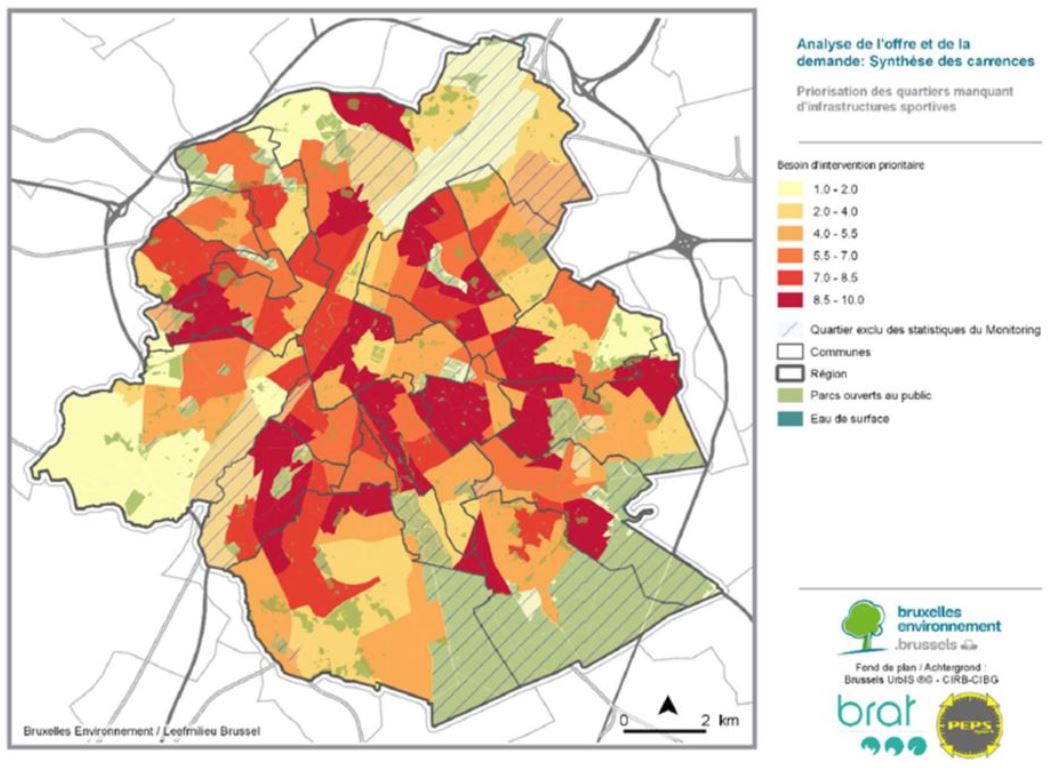
Les niveaux de carences les plus élevés (score de 7 à 10) sont atteints par 62 des quartiers, soit 43%. L’offre sportive est également peu diversifiée : plus de 80% de l’offre relève de pistes de pétanque ou terrains de foot et/ou basket. Les conséquences sont multiples : peu de diversité des pratiques et orientation de l’offre vers certains groupes cibles de pratiquants au détriment d’autres groupes cibles, parfois oubliés (femmes, personnes âgées, personnes porteuses d’un handicap et parfois enfants).
Les priorités concernant le développement de l’offre peuvent tenir compte d’autres critères complémentaires à ceux de l’offre et de la demande tels que la densité de jeunes, l’urgence des interventions (vétusté des équipements…), la proximité d’espaces verts ou de pôles de développement prioritaire tels que délimités dans le plan régional de développement durableMode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Il s'agit donc d une démarche qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement, et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine.. Ces pôles sont en effet voués à évoluer grandement au cours des prochaines années, concentrant une hausse potentielle du nombre de logements et de la population et donc de nouveaux besoins mais également de potentielles mutations en termes d’espaces publics et d’équipements.
Une stratégie sport adaptée aux besoins, aux opportunités et aux réalités des espaces verts régionaux et de leurs usagers
Sur base de cette étude, le service « Maillage jeux et sports » de Bruxelles Environnement a élaboré un document stratégique pour cadrer le développement des pratiques sportives dans les espaces verts régionaux. Ce travail a été fait en co-construction avec les différents départements concernés ainsi qu’avec la cellule sport de Perspective brussels.
Ce développement s’articule autour de 4 axes principaux, à savoir :
- le renforcement de la cohésion et de l’intégration sociale ;
- le renforcement du conditionnement physique et l’amélioration de la santé des Bruxellois ;
- l’encouragement des « loisirs actifs » ;
- le développement des « pôles sportifs » de rayonnement local ou régional.
Le choix des axes à développer doit se faire en fonction du contexte local, tant sociodémographique qu’environnemental.
Au niveau quantitatif, la stratégie sport vise à équiper la Région de manière équilibrée en tenant compte des zones de carences, du profil socio-démographique des différents quartiers (avec une priorité pour les quartiers défavorisés densément peuplés) et en veillant à atteindre davantage certains groupes cibles (adolescentes, personnes âgées, personnes à mobilité réduite, etc.). Des dynamiques sportives adaptées aux besoins des usagers et aux différentes typologies des espaces verts seront encouragées via l’organisation de micro-évènements sportifs, de séances d’initiation, d’animation et des interventions légères (marquage au sol par exemple).
Au niveau qualitatif, 5 objectifs ont été fixés :
- Diversification de l’offre, des pratiques et des pratiquants ;
- Adoption de modes d’intervention adaptés à l’axe visé prioritairement (par exemple, pour la finalité sportive sociale, s’appuyer sur une approche participative avec le tissu associatif et valoriser l’action des gardiens animateurs) ;
- Amélioration de l’intégration paysagère des aménagements/infrastructures sportives ;
- Offre d’un meilleur encadrement, accueil des pratiques sportives ;
- Promotion du développement de sports ne nécessitant pas d’infrastructures lourdes.
Concernant le premier objectif, l’étude a mis en évidence la surreprésentation des pratiquants jeunes ou jeunes adultes et de sexe masculin. La question de la promotion du sport dans l’espace public pour les femmes ou les personnes plus âgées constitue donc un enjeu de taille. De la même manière, l’accueil des personnes qui présentent un déficit mental ou physique nécessite l’installation d’aménagements sportifs adaptés ainsi que des interventions en termes d’accessibilité à ces installations et de communication.
Une offre régionale qui s’accroît

D’un point de vue opérationnel, le service « Maillage jeux et sport » réalise de nombreux projets d’aménagement ou de réaménagement visant à favoriser la pratique sportive dans les espaces régionaux, qu’ils soient gérés par Bruxelles Environnement ou en cours d’acquisition.
Plusieurs projets ont été ou sont en cours de réalisation en 2019-2021, par exemple :
- Terrain multi-sport, engins fitness et mur d’escalade au parc Bonnevie ;
- Plaine de jeu et de sport au jardin Botanique ;
- Marquage au sol d’une zone de sprint et nouveau terrain de street basket sur le parc de la Ligne 28, aménagement d’un spot de parkour sous le Pont Demeer ;
- Plaines de jeu et infrastructures de sport, spot pour la pratique du slackline au Rouge-Cloître ;
- Terrains de sport et de jeux de glisse au Parc Georges Henri ;
- Jeux et sport (street basket et spot de parkour) au Parc de la Senne.
Plusieurs autres projets devraient être menés ou entamés dans le courant de l’actuelle législature (par exemple, plaine de jeu et infrastructures de sport au Parc de la Rosée). Le déploiement du maillage ludo-sportif sur le territoire bruxellois passe aussi par des partenariats et interactions avec les différents acteurs concernés tels que les communes, le monde sportif et associatif, Perspective brussels ou encore, la société du logement de la Région bruxelloise (SLRB) en charge de promouvoir le logement social.
Au-delà de Bruxelles Environnement, la Région bruxelloise vise à promouvoir la pratique du sport et à la rendre accessible au plus grand nombre. Dans ce cadre, Perspective brussels développe actuellement une vision stratégique du développement des infrastructures sportives en Région de Bruxelles-Capitale. Pour ce faire, un cadastre du sport bruxellois présentant toutes les infrastructures sportives (indoor et outdoor) est en cours de réalisation. Une stratégie régionale visant à promouvoir la pratique du running est également en cours d’élaboration.
La Région met aussi en œuvre une politique active de soutien aux communes pour le développement d’infrastructures sportives via deux appels à projets. L’un d’entre eux concerne les « infrastructures sportives de proximité » c’est-à-dire localisées à proximité des lieux d’habitation et offrant un accès libre. Celles-ci doivent notamment contribuer à renforcer la cohésion sociale en permettant à tous les habitants d’un quartier de se détendre, de se divertir et de rencontrer d’autres personnes.
Au-delà des infrastructures, le service « Maillage jeux et sport » de Bruxelles Environnement développe des programmations sportives cherchant notamment à élargir et diversifier l’offre sportive dans les parcs afin de mieux répondre aux besoins de tous les publics. Ces initiatives visent également à promouvoir et accompagner certains aménagements récemment réalisés. Dans ce cadre, des initiations à de nouvelles pratiques sportives sont organisées à destination du public en collaboration avec les gardiens de parcs et des opérateurs externes. Ainsi, durant l’été 2018, un travail de sensibilisation et de promotion du sport a été mené auprès des gardiens et du public à travers une série de démonstrations sportives innovantes. En 2021, le projet ‘sport dans les parcs’ met en avant le slackline, le parkour ainsi que le roller dans 6 espaces verts, Ces trois pratiques sportives se caractérisent entre autres par le recours à des équipements assez légers et susceptibles d’une bonne intégration paysagère. En plus de ces activités, un pumptrack (parcours en boucle fermée, constitué de bosses et de virages) installé dans un parc doit permettre d’expérimenter la pratique du BMX, de la trottinette, du skate et du roller.
À télécharger
Fiches de l’Etat de l’Environnement
Autres publications de Bruxelles Environnement
- BRUXELLES ENVIRONNEMENT, BRAT et L’ESCAUT 2015. « Le jeu dans la ville - Pour un maillage jeux à Bruxelles », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 122 pp. (.pdf)
- BRUXELLES ENVIRONNEMENT, BRAT et BRUSK 2015. « SK8BXL - Le skate dans la ville », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 63 pp. (.pdf)
Etude(s) et rapport(s)
- BRAT-PEPS 2017. « Développement d'une stratégie globale de redéploiement du sport dans les espaces verts en Région de Bruxelles Capitale - Phase 1 : Etude », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, rapport final, 68 pp. (.pdf)
- BRAT-PEPS 2017. « Développement d'une stratégie globale de redéploiement du sport dans les espaces verts en Région de Bruxelles Capitale - Phase 2 : Analyse de l’offre et la demande », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, rapport final, 102 pp. (.pdf)
- BRAT-PEPS 2017. « Développement d'une stratégie globale de redéploiement du sport dans les espaces verts en Région de Bruxelles Capitale - Phase 3 : Recommandations », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, rapport final, 78 pp. (.pdf)
- BRAT-PEPS 2019. « Développement d'une stratégie globale de redéploiement du sport dans les espaces verts en Région de Bruxelles Capitale - Synthèse des recommandations de l’étude », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, rapport final, 5 pp. (.pdf)
- BRAT 2009. « Inventaire des espaces verts et espaces récréatifs accessibles au public en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 40 pp. + annexes (.pdf)
- BRAT 2009. « Etude pour un redéploiement des aires ludiques et sportives en Région de Bruxelles-Capitale : Rapport final », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 51 pp. (.pdf)
- PERSPECTIVE BRUSSELS 2020. « Be running : vers un réseau récréatif de toutes les ‘vitesses piétonnes’ », note de synthèse, 30 pp. (.pdf)
Liens utiles
Métabolisme urbain, bilan des flux de matières et d'énergie
Focus - Actualisation : décembre 2015
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe Ressources et Déchets de l’Alliance Emploi-Environnement, Bruxelles Environnement a réalisé une étude visant à quantifier les flux de matières, d’eau et d’énergie qui entrent en Région bruxelloise, qui y sont consommés, transformés ou stockés et qui en sortent. Le bilan métabolique réalisé dans ce cadre a notamment montré qu’en raison de son caractère urbain et de la prédominance du secteur tertiaire, la Région bruxelloise est caractérisée par une économie fortement linéaire et dépendante de l’extérieur. L’étude a également mis en évidence l’importance quantitative de certains flux dont, en particulier, ceux liés aux secteurs de la construction, de l’agriculture et de l’alimentation ou encore, aux combustibles et produits pétroliers.
Transition des villes vers une économie plus circulaire
Les villes constituent d’importantes consommatrices d’énergie et de matières qui y sont soit stockées pendant des périodes plus ou moins longues soit en ressortent sous forme de produits exportés ou, le plus souvent, sous forme de déchets, d’émissions dans l’air et dans l’eau et de chaleur.
Une analogie est couramment faite entre le mode de fonctionnement des villes ou régions et celui des écosystèmes. Cependant, s’il présente des analogies avec les écosystèmes naturels, ce mode de fonctionnement s’en distingue néanmoins de manière fondamentale notamment au niveau des caractéristiques des flux :
- prépondérance des flux anthropiques (combustibles et électricité, eau de distribution, produits alimentaires, biens manufacturés, déchets et émissions polluantes…) relativement aux flux naturels (énergie solaire, cycles de l’eau, de l’azote, du phosphore, du carbone et de l’oxygène avec entre autres la photosynthèse…) ;
- circulation généralement linéaire des flux (peu de recircularisation des flux par réutilisation ou recyclageToute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage. Ces opérations impliquent une modification structurelle (physique ou chimique) de la matière. Le recyclage peut impliquer différentes actions de prétraitement comme, par exemple, le démantèlement. dans la ville ou via des synergies entre entreprises) ;
- très forte dépendance des villes relativement aux flux provenant de l’extérieur du système du fait notamment de cette circulation très linéaire des flux et de la forte densité de population et d’activités économiques.
Ce mode de fonctionnement des villes a un impact environnemental important tant en « amont » de la ville, suite à l’importation massive de ressources prélevées en dehors des territoires urbains, que dans la ville et en « aval », suite aux différents rejets qui engendrent des pollutions de l’air, des eaux et des sols.
Pour ces territoires, la transition d’une économie très gourmande en ressources et majoritairement linéaire (« extraire-fabriquer-consommer-jeter ») vers une économie plus sobre et plus circulaire (« réduire-réutiliser-recycler ») constitue un enjeu majeur et ce, non seulement d’un point de vue environnemental mais aussi d’un point de vue économique (utilisation réduite de ressources, diminution de la dépendance vis-à-vis des territoires extérieurs, innovation technologique et amélioration de la compétitivité) et social (création d’emplois locaux peu délocalisables, diminution des pressions environnementales).
Au niveau bruxellois, cette transition d’une économie linéaire vers une économie circulaireL'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur. créatrice d’emplois constitue un objectif clairement affiché de la politique régionale, repris notamment au niveau de l’accord de majorité 2014-2019 et de la stratégie 2025 pour Bruxelles.
Bilan des flux de matières et d’énergie en Région de Bruxelles-Capitale
De manière générale, un bilan de métabolisme territorial (ou de métabolisme urbain lorsque cet exercice est appliqué à l’échelle d’une ville) consiste en une quantification des flux de matières et d’énergie qui entrent dans un territoire, qui y sont consommés, transformés et stockés et qui en sortent. Les flux étudiés, l’échelle d’approche, les éventuelles analyses réalisées (par ex. sur les consommateurs et producteurs des différents flux) ou encore, les méthodes de quantification et leur précision varient cependant considérablement d’un bilan à l’autre en fonction notamment des objectifs poursuivis ainsi que des moyens et données disponibles.
L’étude du métabolisme bruxellois est une des composantes fondatrices du Programme Régional d’Economie Circulaire (voir focus sur l’Alliance Emploi Environnement) pour soutenir le développement d’un programme d’écologie industrielle. L’écologie industrielle vise à développer, à l’échelle du système industriel, un mode d’organisation caractérisé par un usage optimal des ressources et un fort taux de recyclage de la matière et de l’énergie notamment en développant des synergies entre entreprises (réutilisation locale de résidus de production, mutualisation de certains services et équipements). Cette approche fait entre autres appel à l’analyse des flux de matières, d’eau et d’énergie afin d’identifier les rejets et déchets des entreprises - ou, par extension, de l’économie - qui pourraient être réinjectés dans l’économie locale.
C’est dans ce cadre que Bruxelles Environnement a réalisé, en 2014 et à partir de données essentiellement relatives à l'année 2011, l’étude du métabolisme urbain de la Région bruxelloise. De par son caractère fortement transversal, ce projet a impliqué de nombreux partenaires tant au niveau de Bruxelles Environnement (implication de nombreux départements) qu’au niveau des prestataires externes (consortium de plusieurs centres universitaires et bureaux d’étude).
Le bilan global des principaux flux d’énergie, d’eau et de matière est illustré dans la figure reprise ci-dessous. On y distingue les flux entrants, internes et sortants ainsi que le stock de matériaux présents en Région bruxelloise.
Les flux entrants en Région bruxelloise pris en compte dans le bilan global sont :
- les flux internationaux et interrégionaux importés (en ce compris une partie du trafic de transitTrafic constitué par des véhicules de passage, dont la destination finale est plus éloignée. qui ne peut être distinguée des importations) : énergie (gaz naturel, électricité, produits pétroliers, biocarburants et bois, charbon), matières (minéraux, combustibles, agriculture et alimentation, métallurgie, autres catégories telles que vêtements, électroménagers, mobilier, journaux et livres, etc.) et eau de distribution ;
- des flux naturels entrants d’eau (précipitations, cours d’eau et canal);
- des flux anthropiques qui entrent dans le territoire mais n’y sont pas valorisés économiquement (eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. produites en Région flamande qui sont traitées par les stations d’épuration bruxelloises).
Il est important de signaler que, du fait de l’insuffisance de données, les importations de matières ont été estimées sur base de nombreuses hypothèses et approximations et comportent de ce fait une large marge d’imprécision. Par ailleurs, notons également que le bilan repris ci-dessous comporte un double comptage puisqu’il comptabilise à la fois les flux entrants d’énergie consommée en Région bruxelloise sous forme de GWh (gaz, électricité mais aussi combustibles liquides ou solides) ainsi que les flux entrants de matières, incluant des combustibles en partie destinés à la consommation bruxelloise, sous forme de ktonnes.
Les flux sortants de la Région bruxelloise prennent en compte :
- des flux internationaux et interrégionaux exportés (en ce compris une partie du trafic de transit qui ne peut être distinguée des exportations) : matières (idem ci-dessus)
- des flux sortants générés par les activités humaines à savoir les flux de déchets (déchets non traités par l’incinérateur et mâchefers et cendres volantes provenant de l’incinérateur), les flux d’eaux usées (effluents des stations d’épuration qui quittent la Région bruxelloise via la Senne) ainsi que les flux de gaz à effet de serreGaz qui absorbe une partie des rayons du soleil et les restitue sous la forme de rayonnements, lesquels rencontrent d'autres molécules de gaz et reproduisent ainsi le processus, entraînant l’effet de serre, qui engendre une augmentation de chaleur. Les principaux gaz à effet de serre dont l’origine est essentiellement liée à des activités humaines sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’ozone troposphérique (O3). (GES);
- les flux d’eaux sortants (évaporation et évapotranspirationL’eau de pluie est retenue au niveau du sol puis s’évapore vers l’atmosphère. La présence de plantes amplifie/augmente fortement ce phénomène., cours d’eau et canal) ainsi que des flux gazeux.
Notons que les flux correspondant aux rejets de polluants atmosphériques autres que les GES ainsi qu’aux rejets de polluants dans l’eau ont été traités dans le cadre de ce projet mais n’ont pas été intégrés dans le schéma global (la quantification de ces flux, réalisée par Bruxelles Environnement sur base de modélisations, est cependant disponible, cf. divers indicateurs d’émissions de polluants atmosphériques et focus sur les émissions de polluants dans les eaux de surface). Par ailleurs, les flux gazeux naturels (liés principalement à la photosynthèse) ainsi que la consommation d’oxygène associée aux processus de combustion n’ont pas été considérés dans ce bilan.
Les flux internes correspondent aux flux qui sont produits et traités en Région bruxelloise, à savoir:
- la production primaire d’énergie (essentiellement via la production d’électricité de la centrale électrique couplée à l’incinérateur) soit 1150 GWh (ou 1150 milliards de Wh);
- les captages d’eau (VIVAQUA entre autres) soit un peu plus de 2 millions de m3 d’eau ;
- les quantités d’eaux usées traitées au niveau des 2 stations d’épuration régionales soit 130 millions de m3 d’eau;
- les flux de déchets traités par l’incinérateur soit 448 kt (ou 448 milliers de tonnes);
- les flux de matériaux (soit 500 kt) qui s’additionnent au stock de matériaux déjà présents en Région bruxelloise.
La production de biomasseEnsemble des végétaux et des animaux, ainsi que des déchets organiques qui leur sont associés. La biomasse végétale provient de la photosynthèse et constitue une source d'énergie renouvelable. à des fins de consommation (production de bois et maraîchère) est également considérée en tant que flux interne. Elle n’est cependant pas intégrée dans les schémas des bilans globaux et de matière.
Le stock matériel (184 921 kt) comptabilisé dans ce bilan correspond à une évaluation, relativement sommaire, de la masse des éléments suivants :
- matériaux de construction composant les bâtiments résidentiels, les bureaux et les commerces (certains types de bâtiments tels que les écoles ou bâtiments industriels n’ont pas été prise en compte) ;
- véhicules (parcs de véhicules privés immatriculés en RBC et parc de la STIB) ;
- réseaux de distribution d’eau et d’égouttage, réseau électrique, rails du réseau tram/métro/train, réseau routier ;
- petits et grands électroménagers possédés par les ménages bruxellois.
Métabolisme urbain de la Région de Bruxelles-Capitale, 2011 (2012 pour certaines données sur les déchets non municipaux)
Source : ICEDD-ECORES-BATIR pour le compte et avec la contribution de Bruxelles Environnement 2014
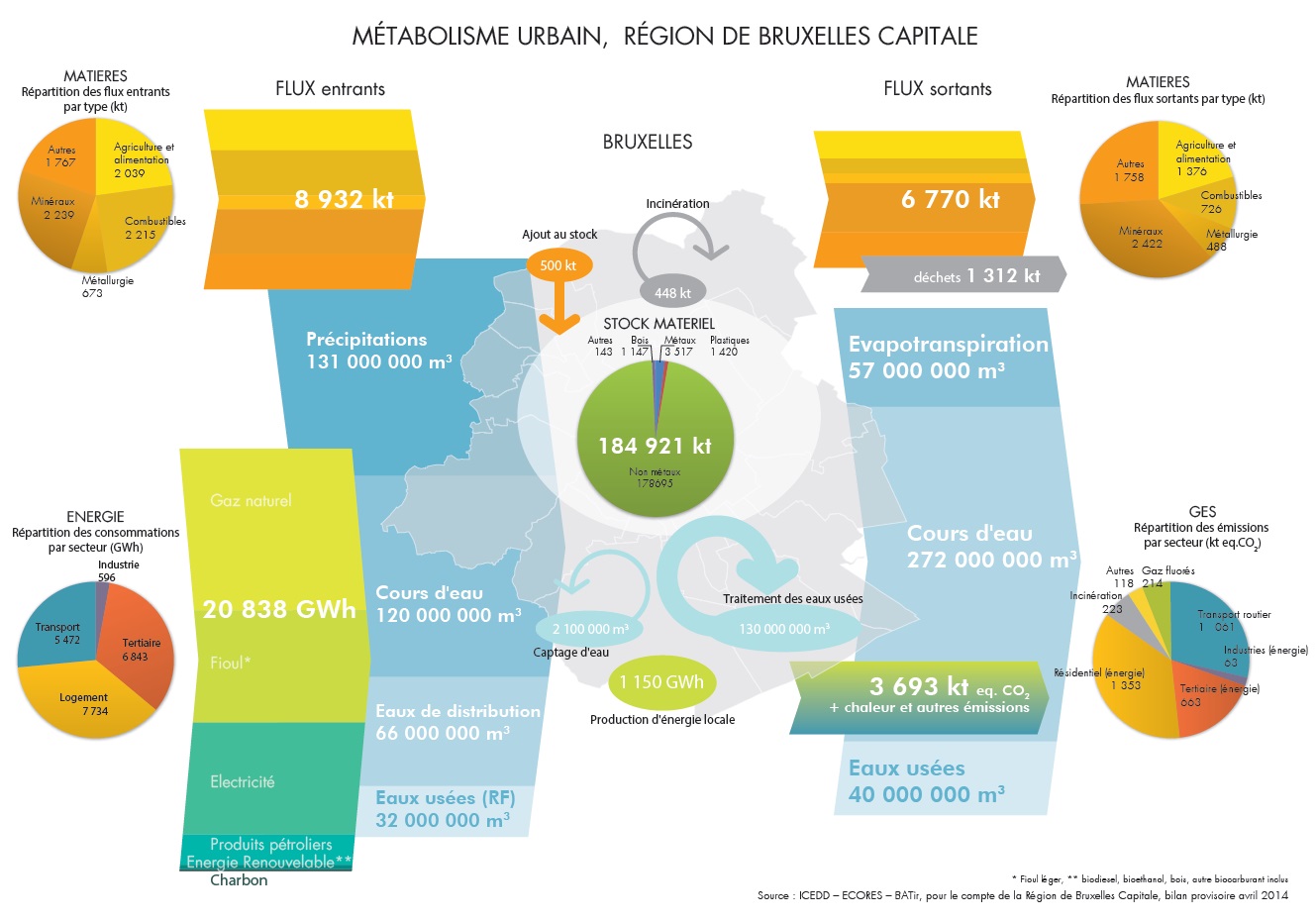
L’élaboration de ce bilan repose sur de multiples sources de données ainsi que, pour certains flux, sur de nombreuses hypothèses et estimations. Il en résulte que la précision des données présentées dans ce bilan est très variable selon les flux et que certaines quantifications doivent être considérées avant tout comme des ordres de grandeur.
Les principales sources de données utilisées sont :
- pour l’énergie : bilan énergétique régional ;
- pour les émissions de gaz à effet de serreGaz qui absorbe une partie des rayons du soleil et les restitue sous la forme de rayonnements, lesquels rencontrent d'autres molécules de gaz et reproduisent ainsi le processus, entraînant l’effet de serre, qui engendre une augmentation de chaleur. Les principaux gaz à effet de serre dont l’origine est essentiellement liée à des activités humaines sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’ozone troposphérique (O3). : inventaire des émissions (Bruxelles Environnement) ;
- pour les flux entrants et sortants de matière : importations et exportations extranationales (Banque nationale de Belgique), transport de marchandises chargées et déchargées en RBC par voie routière (SPF Mobilité et transports), fluviale et maritime (Port de Bruxelles), ferroviaire (SNCB) ;
- pour les déchets : déchets municipaux (Bruxelles Propreté, opérateurs de l’économie sociale, communes et étude IGEAT-ULB effectuée pour le compte de Bruxelles Environnement pour les parcs à conteneurs), déchets non municipaux (étude Recydata effectuée pour le compte de Bruxelles Environnement, Bruxelles Energie, Recupel, étude sur les déchets de construction et démolition du CERAA et ROTOR effectuée pour le compte de Bruxelles Environnement, Recytyre, Febelauto, Valorfrit, Port de Bruxelles, SBGE, VIVAQUA, Bruxelles Environnement) ;
- pour le stock matériel : bâtiments (estimation de BATir-ULB sur base de données du cadastre, de Bruxelles Développement urbain-Observatoire des bureaux, de la SPF Economie - DG Statistiques et Informations économiques), petits et gros électroménagers des ménages (DGSIE, Récupel), véhicules (DGSIE, STIB et études sur la composition matérielle de divers types de véhicules), réseaux (HYDROBRU, Sibelga, STIB, SNCB, base de données URBIS, fiches et ouvrages techniques) ;
- pour l’eau : cours d’eau et canal (Flowbru, Bruxelles Environnement, ULB-unité Traitement des eaux et pollutions), précipitations (IRM), eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. (Bruxelles Environnement, SBGE), eau de distribution et captages (VIVAQUA, HYDROBRU, Bruxelles Environnement), ruissellement, infiltration et évapotranspirationL’eau de pluie est retenue au niveau du sol puis s’évapore vers l’atmosphère. La présence de plantes amplifie/augmente fortement ce phénomène. (ULB-unité Traitement des eaux et pollutions)
Principaux enseignements
Le territoire bruxellois, fortement urbanisé et densément peuplé (par ses habitants mais aussi par ses « travailleurs navetteurs », étudiants, touristes, participants à des congrès, etc.), à l’économie essentiellement tertiaire et de taille limitée, est marqué par une forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur concernant les ressources qu’il consomme.
Le bilan ci-dessus montre que, plus de 96% de l’eau de distribution consommée à Bruxelles est importée de la Région wallonne. Il est également intéressant de constater que l’apport d’eau par les précipitations équivaut à deux fois les volumes d’eau de distribution importés. Or une part importante de ces eaux pluviales abouti dans le réseau d’égouttage sans avoir été préalablement utilisée (la récupération d’eau de pluie n’a toutefois pas été quantifiée dans le cadre de cette étude faute de données suffisantes). En ce qui concerne l’énergie, seuls environ 5% de la consommation énergétique bruxelloise provient d’une production effectuée en Région bruxelloise. Il s’agit essentiellement de la production d’électricité par la centrale électrique couplée à l’incinérateur de déchets ménagers mais d’autres sources interviennent également (biogazLe biogaz est le gaz produit par la fermentation de matières organiques animales ou végétales. produit par la digestion des boues d’épuration, énergie solaire et géothermique, etc.) (voir indicateur « Production d'énergies renouvelables »).
Le bilan a permis d’estimer, de manière très approximative, à près de 9000 kt la quantité de matière (pour rappel, cette catégorie regroupe par ex. les minéraux et produits de la métallurgie, les produits agricoles et alimentaires, les vêtements, l’électroménager, le mobilier, les journaux et livres, etc.) et de combustibles entrant en Région bruxelloise en 2011. Ces flux entrants concernent majoritairement des minéraux et matériaux de construction (25%), des combustibles (25%) et des produits agricoles et alimentaires (23%). Rapporté au nombre d’habitants et sans tenir compte des combustibles, cela équivaut à un flux annuel entrant de matière de 7981 kg/habitant (produits issus de l’agriculture et de l’alimentation, matériaux de construction, produits chimiques et métallurgiques, machines et équipements, textiles, papier et publications, etc.). Seule une faible partie de ce flux est cependant destinée à la consommation finale des ménages bruxellois. La majeure partie de ce flux est utilisée par les activités économiques bruxelloises y compris en tant que consommation intermédiaire pour les entreprises manufacturières. Par ailleurs, rappelons que les données disponibles n’ont pas toujours permis de distinguer le trafic de marchandises réellement destiné à l’économie bruxelloise et à la consommation des habitants du trafic de transitTrafic constitué par des véhicules de passage, dont la destination finale est plus éloignée.. Remarquons également que ce bilan ne prend pas en compte les flux indirects (ou flux cachés) c‘est-à-dire l’ensemble des ressources non intégrées dans le produit final importé mais dont l’utilisation ou l’extraction ont été nécessaires à la fabrication et au transport de ce produit.
En ce qui concerne les déchets, le bilan a évalué à 448 kt le flux de déchets ménagers et assimilés (c’est-à-dire de déchets de type ménagers produits par les habitants mais aussi par les commerçants, bureaux, entreprises, écoles, etc.) incinérés par Bruxelles Energie en 2011 et à 1312 kt le flux de déchets sortis de la Région bruxelloise. De l’ordre de 46% (en poids) de ce flux sortant seraient composé de déchets de construction et de démolition. Les autres flux quantitativement importants sont les boues des stations d’épuration et les boues de balayage (+/-11%), les papiers-cartons (+/-8%) ainsi que les métaux (+/-7%) et déchets d’incinération (+/-7%). Par ailleurs, précisons que les flux sortants sont en partie composés de déchets triés, regroupés ou démantelés en Région bruxelloise qui sont ensuite revendus pour être recyclés ou réutilisés (papiers/cartons, plastiques, verres, acier, métaux, compostProcessus naturel de transformation de la matière organique sous l’action d’organismes vivants, dans des conditions contrôlées, en humus et nutriments pour le sol et ses habitants., textiles, etc.). À cet égard, les données disponibles n’ont pas toujours permis de distinguer dans le flux sortant une éventuelle recircularisation, en tant que ressource, de certains déchets au sein de la Région bruxelloise même.
La caractérisation quantitative et qualitative du stock matériel constitue une question essentielle dans le cadre de l’élaboration de stratégies d’économie circulaireL'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur. puisqu’elle permet d’anticiper les déchets qui seront produits dans le futur et dont pourront être extraits des composants ou matériaux revalorisables (concept d’« urban mining »). Une évaluation sommaire de ce stock a été réalisée dans le cadre de la présente étude. Il en ressort qu’en première approximation le stock matériel comportant les structures des bâtiments (inventaire non exhaustif), l’équipement électroménager des ménages, le parc de véhicules (publics et privés) ou les réseaux d’infrastructure représente 185 millions de tonnes (soit 165 tonnes par habitant). S’il apparaît quantitativement considérable, ce gisement de futurs « déchets-ressources » est cependant constitué de matériaux dont les impacts environnementaux et l’intérêt économique, en terme de récupération, sont très variables. Dans le cadre de cette étude, seuls les principaux flux ont été estimés mais il convient de garder à l’esprit qu’un potentiel important en terme d’économie circulaire est également associé à la recircularisation de micro-flux (par ex: des métaux spécifiques tels que les terres rares).
À télécharger
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Approvisionnement et consommation d'eau de distribution (édition 2011-2014)
- Focus: Etat quantitatif des eaux souterraines (édition 2011-2014)
- Consommation énergétique totale et par secteur (édition 2011-2014)
- Production d'énergies renouvelables (édition 2011-2014)
- Emissions de gaz à effet de serre (édition 2011-2014)
- Emissions de substances acidifiantes (NOx, SOx, NH3) (édition 2011-2014)
- Emissions de précurseurs d'ozone (NOx, COV, CO et CH4) (édition 2011-2014)
- Emissions de particules fines (PM10 primaires ) (édition 2011-2014)
- Tonnage des déchets ménagers et assimilés collectés en porte-à-porte (édition 2011-2014)
- Focus : Part et gestion des déchets préparés en vue du réemploi et du recyclage (édition 2011-2014)
- Focus : Monitoring des principaux flux de déchets professionnels (édition 2011-2014)
- Focus : économie des ressources et prévention via l’économie sociale (édition 2011-2012)
- Focus : production et gestion des boues et sédiments (édition 2007-2010)
- Pressions environnementales des activités, chapitre acteurs économiques (édition 2007-2008) (.pdf)
- L’empreinte écologique, chapitre politique et gouvernance environnementale (édition 2003-2006) (.pdf)
Etudes et rapports
- ECOLIFE 2003. « L'empreinte écologique des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale : Rapport synthétique », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 30 pp.
- ECOLIFE 2004. « De ecologische voetafdruk van de bewoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Technisch rapport », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 77 pp. + annexes. (en néerlandais uniquement)
- ECORES, ICEDD, BATir (ULB) 2015. « Métabolisme de la Région de Bruxelles-Capitale : identification des flux, acteurs et activités économiques sur le territoire et pistes de réflexion pour l’optimisation des ressources », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 289 pp. + annexes.
- RDC ENVIRONMENT 2008. « Etude préparatoire pour l'évaluation de l'empreinte écologique des activités localisées en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 232 pp. + annexes.
- KAMPELMAN R. 2016. « Mesurer l'économie circulaire à l'échelle territoriale : Une analyse systémique de la gestion des matières organiques à Bruxelles », In « Observatoire français des conjonctures économiques », 24 pp.
Plan et programme
Quels ont été les effets du premier confinement COVID-19 sur l'environnement ?
Focus - Actualisation : février 2022
Différentes mesures ont été prises dans le monde pour réduire la propagation du virus lié au COVID-19, notamment un confinement strict en Belgique entre mars et mai 2020. La réduction significative des activités qui en a découlé a eu des conséquences sur notre environnement et sur notre qualité de vie. Certaines ont été sensibles, comme la réduction du trafic et l'amélioration de la qualité de l'air et de l'environnement sonore. D'autres sont plus contrastées ou indirectes. Découvrez-en plus …
La pandémie de COVID-19
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 qui s’est déclarée partout dans le monde dès la fin 2019 / début 2020, différentes mesures ont été prises pour réduire la propagation du virus. En Europe, de nombreuses régions se sont donc vues strictement confinées. Ainsi, à Bruxelles, le premier confinement des mois de mars et avril 2020 a donné lieu à une réduction significative des activités, via un ralentissement sensible de l’économie et une limitation des déplacements et des activités notamment.
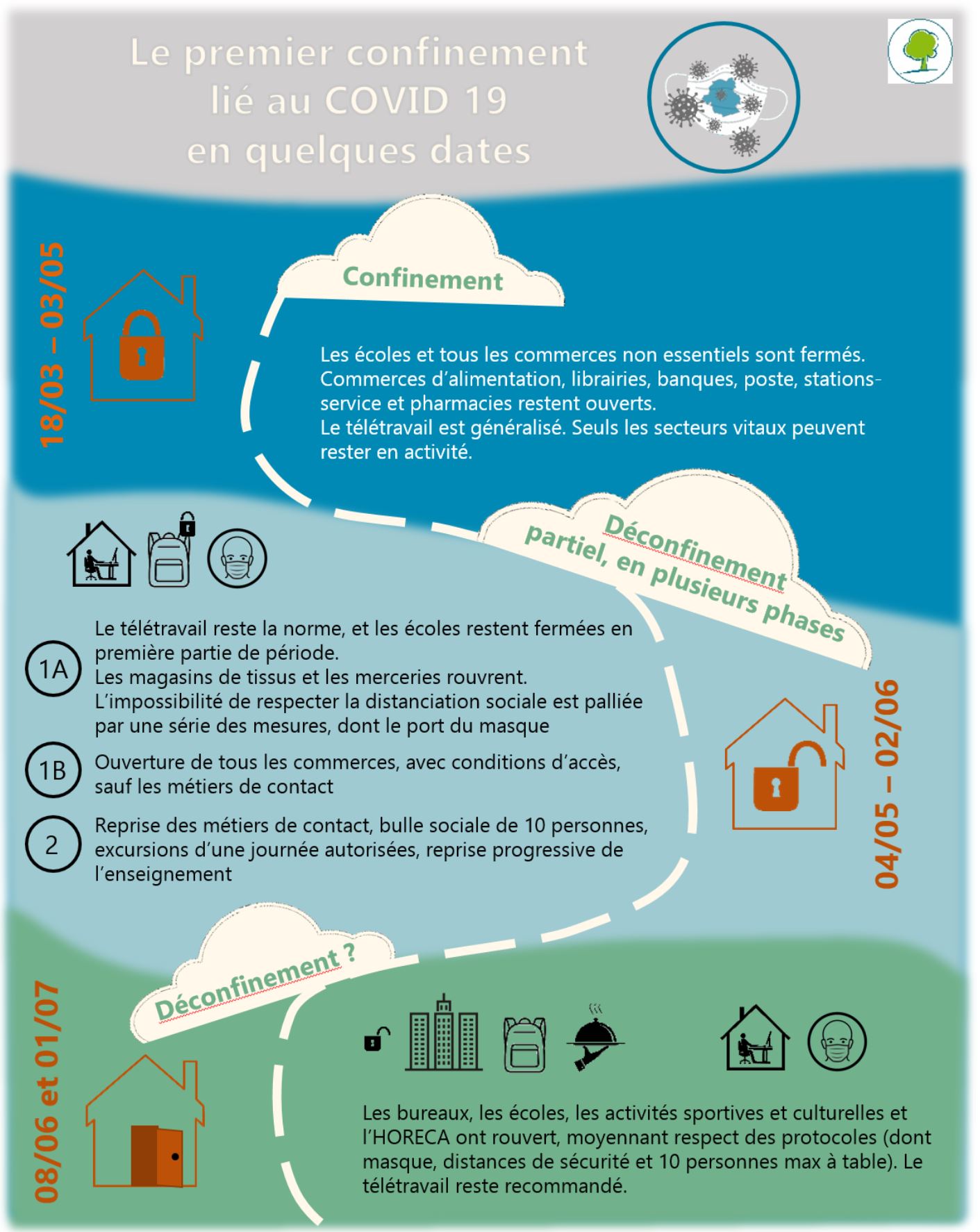
La période de confinement total, vu l'impact qu'elle a eue sur les activités, a permis de préciser le lien entre ces activités humaines et l'environnement.
Ces effets ont été plus limités dès début mai 2020, étant donné la reprise progressive des activités.
Une réduction importante du trafic routier

Selon les données récoltées dans le cadre de la LEZ, une réduction importante du nombre de véhicules en circulation a été observée durant le confinement total, qui concerne toutes les catégories de véhicules.
Bon à savoir
Une réduction de 62% du nombre de véhicules en circulation a été observée durant une semaine « confinement total » (tous véhicules confondus), par rapport à une semaine « normale ».
Si l'on tient compte du type de véhicule :
- La réduction est la plus forte pour les voitures particulières (M1, -64%), en particulier les voitures particulières professionnelles (càd les voitures immatriculées au nom d’une personne morale, ce qui comprend les voitures de leasing et les voitures des professionnels d’une entreprise (indépendants,…) ; -70%).
- Le nombre de (mini-)bus en circulation a diminué de 59%.
- La réduction du nombre de camionnettes et de poids lourds uniques en circulation est également importante mais plus faible que pour les autres catégories : -47% pour les camionnettes et -38% pour les poids lourds. Cela peut s’expliquer par la diminution de certaines activités mais l’augmentation d’autres activités, notamment dans le domaine du e-commerce ou l’approvisionnement des supermarchés.
- La diminution est plus importante pour les navetteurs que pour les déplacements des Bruxellois : le nombre de véhicules immatriculés en RBC a baissé de 56% alors que le nombre de véhicules immatriculés en Flandre et Wallonie à réduit d’environ deux tiers.
Ces observations sont cohérentes avec les données du Centre de mobilité de Bruxelles Mobilité en lien avec les comptages effectués dans 8 tunnels de la RBC : une diminution du trafic routier entre 50% et 75% a été observée pendant la semaine du 23-27 mars 2020, par rapport à des journées « normales » comparables du mois de mars 2019.
Les données des comptages dans les tunnels permettent également d’observer un phénomène d’ordre géographique, à savoir que la diminution du trafic a été moins importante dans les tunnels du centre :
- La diminution se situe entre 50% et 60% dans les tunnels au centre (tunnels sur la petite ceinture, soit les tunnels Rogier, Botanique, Louise et Porte de Hal)
- Alors que dans que dans les tunnels des radiales (tunnels Stéphanie, Belliard, Reyers) et de la moyenne ceinture (tunnel Montgomery), la diminution est de l’ordre de 70% à 75%.
Ces données reflètent sans doute la réduction du nombre de trajets de navetteurs, qui est plus importante que celle des trajets effectués par les véhicules immatriculés en RBC.
Cette réduction du trafic automobile a été perçue par 92% des Bruxellois interrogés lors d'un sondage réalisé dans le contexte de cette crise sanitaire, en septembre 2020. Et les effets induits ressentis seraient selon eux importants :
- 52% estimaient que globalement, la ville était plus agréable,
- 56% considéraient que les déplacements ont été plus fluides,
- 59% considéraient que la qualité de l’air était meilleure,
- 71% estimaient qu’il y avait moins de bruit en ville durant la période de confinement.
Ce ressenti par rapport à la qualité de l'air et au bruit est-il confirmé par les mesures ?
Une amélioration significative de la qualité de l’air

L’analyse de l'impact du confinement sur la qualité de l’air s’est focalisée sur les oxydes d’azote (NO et NO2) pour lesquels le transport routier est le principal émetteur en Région bruxelloise. Le NO2 est en outre le polluant le plus critique en RBC en termes de respect de valeur limiteValeur à respecter afin d'éviter des effets indésirables sur la santé ou l'environnement. Une valeur limite reprise dans une réglementation devient une norme. européenne. Et, même s’il n’est pas réglementé, le NO est un polluant intéressant dans le sens où il reste localisé près de ses sources d’émission, ce qui permet de mieux évaluer l’efficacité des mesures locales de réduction d’émissions.
L’analyse des données recueillies pendant la période du 19 mars au 3 mai 2020 a permis d’aboutir aux conclusions suivantes :
Bon à savoir
Une amélioration de la qualité de l’air très significative a été observée dans les sites habituellement fortement exposés aux émissions du trafic : en moyenne, les concentrations de NO ont diminué de 75 %, et les concentrations de NO2 de 50 %.
Concentrations moyennes de dioxyde d’azote (NO2) par station.
Remarque : Les concentrations ont été mesurées pendant les jours ouvrés, pendant les périodes de référence (mars à juin 2019) et pendant les périodes de confinement et de déconfinement (19 mars au 19 juin 2020).
L'ampleur de l'influence des émissions directes du trafic sur les concentrations mesurées par la station est précisée entre parenthèses.
Source : Laboratoire Qualité de l’Air, Bruxelles Environnement, 2020.
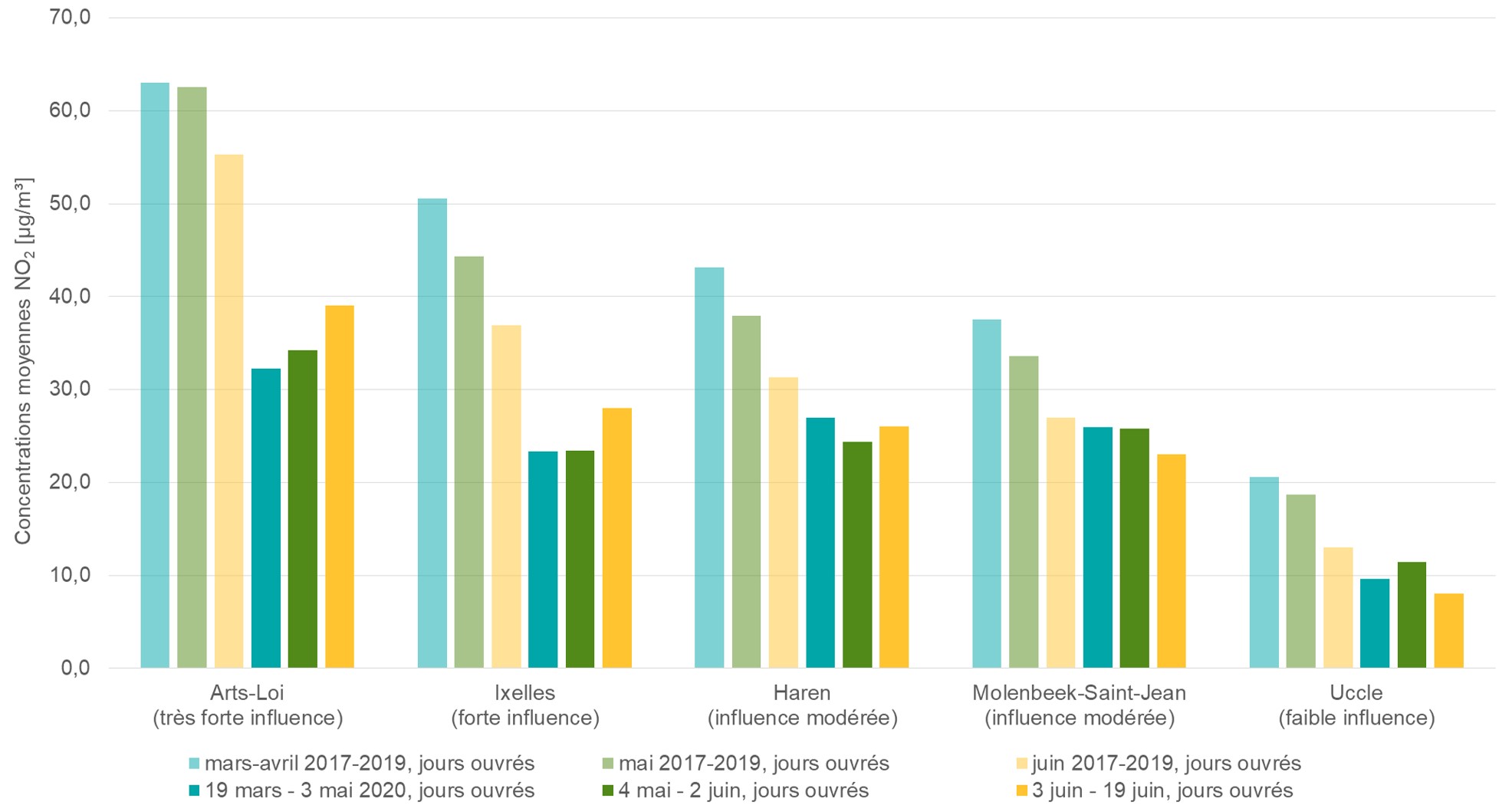
Dans les sites moins exposés aux émissions directes du trafic, l’amélioration de la qualité de l’air a logiquement été moins spectaculaire, mais néanmoins significative avec une réduction de 30 à 40 % sur les concentrations de NO et NO2.
Les valeurs relevées dans les sites de fond urbains (comme Uccle) font état d’une réduction d’environ 50 % sur les concentrations de NO2, alors que les concentrations de NO ne diminuent que de 35 %. Le NO2 étant un polluant susceptible d’être transporté sur de grandes distances (au contraire du NO), ces valeurs démontrent que la pollution importée en Région bruxelloise a également diminué significativement : il s’agit plus que probablement d’un effet lié aux mesures de confinement prises en Belgique et dans les pays limitrophes.
Si les réductions constatées pour le black carbon sont dans la même ligne que celles pour les oxydes d’azote, il n’en est pas de même pour les particules fines. Au cours de la période de confinement du 18 mars au 3 mai 2020, les niveaux de PM10 et de PM2.5 étaient comparables la valeur normale pour un mois de mars ou avril. Ceci s’explique par la multiplicité des sources qui contribuent à la présence des particules fines dans l’air ambiant. Le trafic routier est l’une de ces sources, mais pas la plus importante en Région bruxelloise…
Pour en savoir plus sur l'effet du confinement sur la qualité de l'air ou sur la concentration en dioxyde d'azote et en particules fines dans l'air (PM 10 et PM 2,5), suivez le lien !
Des nuisances sonores réduites

Le ralentissement de l’économie et des activités sociales observé durant le premier confinement a amené une réduction généralisée des nuisances sonores. Sur le terrain, le réseau de sonomètres permanents de Bruxelles Environnement a mesuré les effets de cette situation particulière.
En ce qui concerne le bruit du trafic routier, une baisse générale des niveaux sonores s’observe à partir du 16 mars 2020, date à laquelle les écoles ont été fermées et le télétravailTravail effectué à distance avec l'utilisation de la télématique, lien entre le travailleur et l'entreprise. recommandé. Cette baisse s’est accentuée avec les mesures de confinement en application à partir du mercredi 18 mars 2020 à midi.
Evolution du niveau de bruit de fond mesuré aux stations situées à proximité d'axes routiers, durant la journée (7h-23h)
Source : Département bruit, Bruxelles Environnement, 2020.
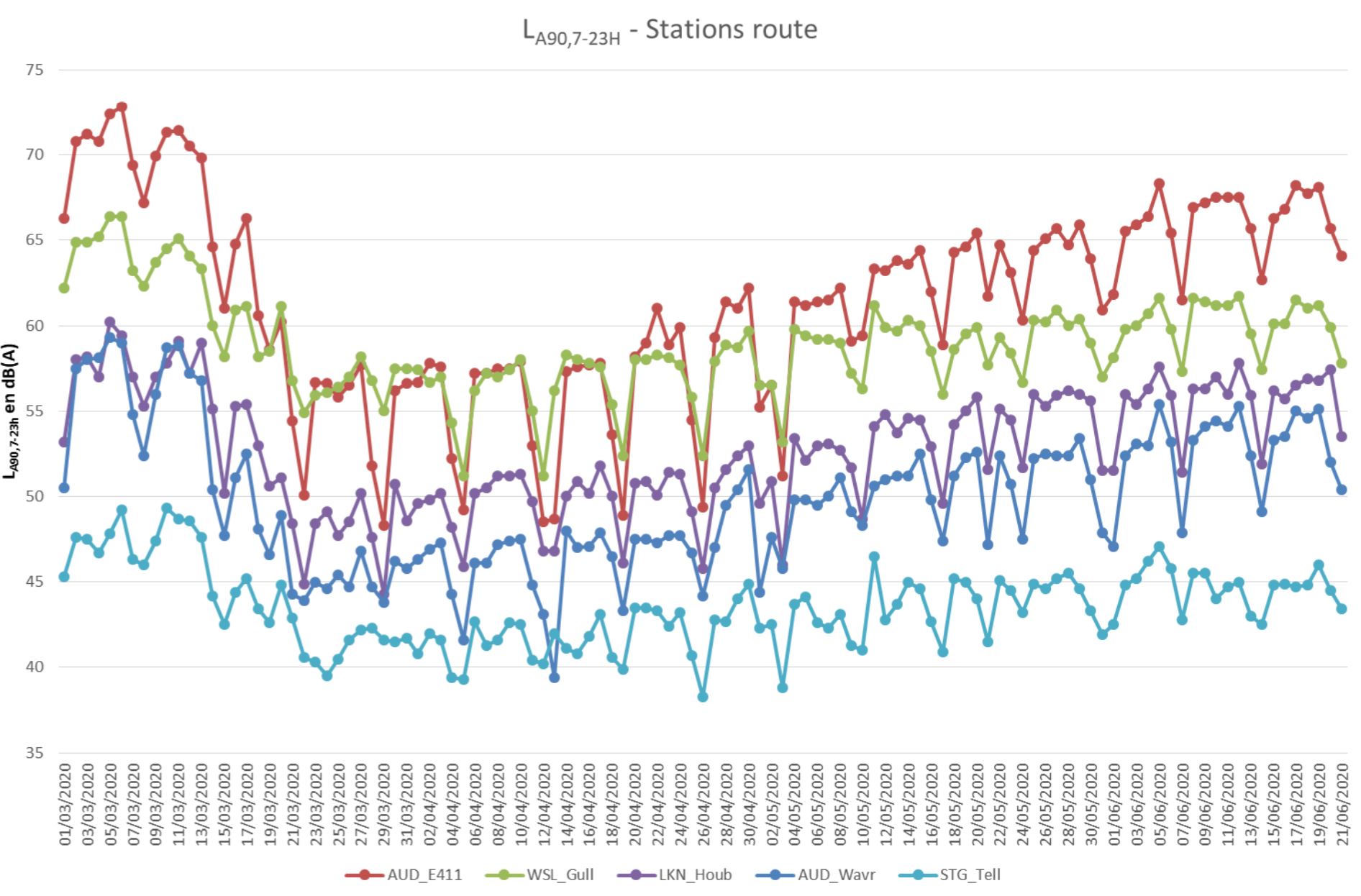
Bon à savoir
Durant la journée, la diminution observée varie entre 1 et 22 dB(A) suivant le jour et la station de mesure.
Ces diminutions s’approchent des écarts observés lors des dimanches sans voitures .
Les diminutions les plus importantes s’observent aux stations situées à proximités des autoroutes (station d'Auderghem, située le long de l’axe autoroutier E411 et station de Woluwe-Saint-Lambert, située à proximité de la E40) et aux stations situées le long de voiries importantes (chaussée de Wavre à Auderghem, avenue Houba de Strooper à Laeken).
En ce qui concerne le bruit du trafic aérien, une baisse des niveaux sonores le jour (07h-23h) s’observe à partir de la mi-mars, essentiellement du fait de la réduction du trafic aérien (d'approximativement 20.000 mouvements mensuels durant les mois d'avril et mai 2019 à moins de 3.000 mouvements en avril et mai 2020). Les diminutions les plus importantes étaient de l’ordre de 10 dB(A), et ont été observées à la station située à Woluwe-Saint-Lambert, impactée par les avions décollant de la piste 25R et empruntant les routes dites «du virage vers l’Est».
Enfin pour le bruit du trafic ferroviaire, étant donné l’organisation d’un service alternatif des trains desservant l’ensemble du réseau avec une offre adaptée entre le lundi 23 mars et le dimanche 3 mai 2020, le trafic ferroviaire a été réduit mais de nombreux trains circulaient toujours. Une baisse des niveaux sonores a également été constatée, variable selon la configuration des stations.
Une consommation d'énergie, et donc des émissions de gaz à effet de serre également impactées
 L'analyse de l’impact du confinement sur les consommations énergétiques, et donc sur les émissions de gaz à effet de serreGaz qui absorbe une partie des rayons du soleil et les restitue sous la forme de rayonnements, lesquels rencontrent d'autres molécules de gaz et reproduisent ainsi le processus, entraînant l’effet de serre, qui engendre une augmentation de chaleur. Les principaux gaz à effet de serre dont l’origine est essentiellement liée à des activités humaines sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’ozone troposphérique (O3). (GES) s’est focalisée sur :
L'analyse de l’impact du confinement sur les consommations énergétiques, et donc sur les émissions de gaz à effet de serreGaz qui absorbe une partie des rayons du soleil et les restitue sous la forme de rayonnements, lesquels rencontrent d'autres molécules de gaz et reproduisent ainsi le processus, entraînant l’effet de serre, qui engendre une augmentation de chaleur. Les principaux gaz à effet de serre dont l’origine est essentiellement liée à des activités humaines sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’ozone troposphérique (O3). (GES) s’est focalisée sur :
- la consommation de gaz naturel, dont plus de 90% est liée à Bruxelles aux bâtiments (logements et secteur tertiaire) ;
- le transport routier.
 Pour ce qui est des consommations de gaz naturel, l’impact du confinement a été évalué en comparant 2 périodes : avant le confinement et durant la période de confinement strict (du 14 au 31 mars 2020).
Pour ce qui est des consommations de gaz naturel, l’impact du confinement a été évalué en comparant 2 périodes : avant le confinement et durant la période de confinement strict (du 14 au 31 mars 2020).
Les résultats montrent une diminution des émissions directes moyennes de GES liées à la consommation de gaz naturel de l’ordre de 20% pendant la période de confinement. Cette diminution semble plus forte pendant les jours ouvrables, comparativement à la diminution estimée pendant les weekends. Si l'on tient compte des différences en besoins en chauffage (estimés sur base des degrés jours), cette diminution de consommation de gaz naturel aurait été plus importante d’environ 4%, étant donné que les températures ont été un peu plus froides durant le confinement par rapport à la période de référence. En tenant compte de ce paramètre, la diminution serait proche de 25%.
Pour ce qui est des émissions du transport routier, la réduction du trafic (décrite plus haut) est à l'origine d'une réduction des émissions de CO2:
Bon à savoir
Le confinement a entraîné une réduction estimée à 50% des émissions de CO2 du transport routier, lors de la 4e semaine de mars par rapport à une semaine de référence hors confinement. La réduction des émissions sur l’ensemble de la période de confinement (jusqu'à fin mai) est estimée à d’un peu plus de 10% pour l'ensemble des véhicules en circulation.
Les espaces verts (dont la Forêt de Soignes) mis sous pression, avec un effet sur la biodiversité en demi-teinte du coup…
 Les courtes sorties en extérieur étant autorisées durant le confinement, la plupart des espaces verts, parcs et forêts de la Région bruxelloise sont restés ouverts. Les plaines de jeux étaient néanmoins rendues inaccessibles pour des raisons sanitaires.
Les courtes sorties en extérieur étant autorisées durant le confinement, la plupart des espaces verts, parcs et forêts de la Région bruxelloise sont restés ouverts. Les plaines de jeux étaient néanmoins rendues inaccessibles pour des raisons sanitaires.
La crise sanitaire aura ainsi notamment eu pour effet d’encourager près de 4 Bruxellois sur 10 à découvrir les espaces verts à proximité du domicile, selon un sondage réalisé en novembre 2020 (Baromètre des comportements 2020, Bruxelles Environnement).
Etant donné les conditions météo printanières, ceci a mené à une augmentation (parfois très) importante de la fréquentation des espaces verts et parcs, en particulier dans les zones centrales de Bruxelles, où la densité de population est plus importante mais l'offre en espaces verts plus réduite.
Répartition des espaces verts accessibles au public
Source : Bruxelles Environnement
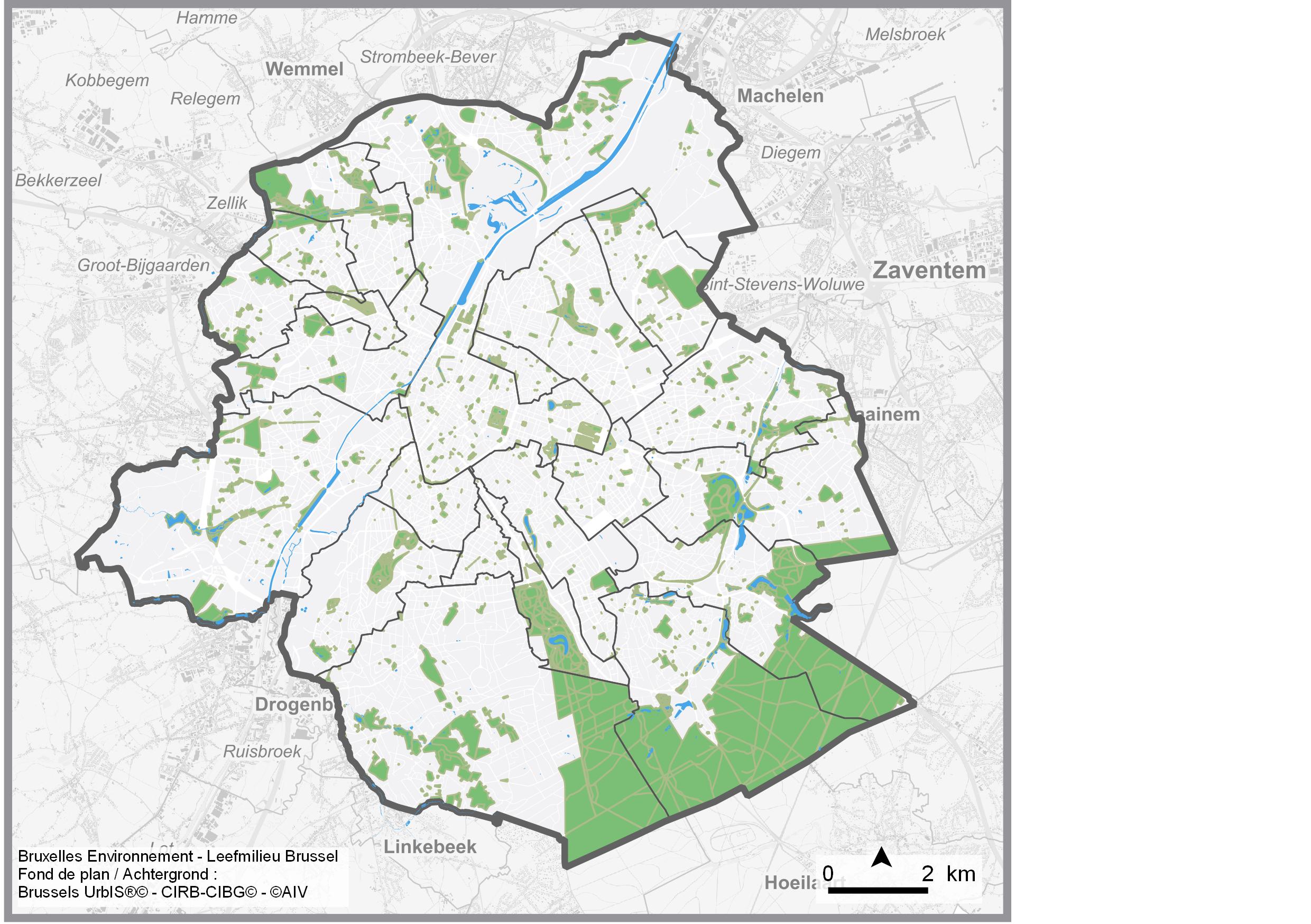
Le constat fait en Forêt de Soignes est similaire. Et le niveau atteint certains jours, principalement en fin d'après-midi, a été inédit.
Ceci a bien sûr compliqué le respect des mesures de distanciation sociale recommandées, mais aussi mené à des pressions accrues sur les espaces naturels (par exemple en Forêt de Soignes) avec des dommages apportés notamment :
- aux sols (via leur compaction),
- à la flore printanière,
- à la reproduction des animaux (notamment les oiseaux nichant au sol),
- à la faune liée aux étangs (dans lesquels de nombreux chiens se sont baignés).
Sur le plan positif par contre, étant donné l'interruption des activités (dont le trafic) et la réduction du niveau sonore, des animaux et de la végétation sont apparus spontanément dans des endroits où ils sont habituellement absents.
Ainsi, globalement, l'impact sur la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). ne peut certainement pas être qualifié sans ambiguïté de positif ou de négatif.

Quelques adaptations des habitudes alimentaires
Les habitudes alimentaires ont été influencées par la période de confinement, notamment en lien avec une augmentation de la propension des Bruxellois à cuisiner eux-mêmes des plats à la maison (comportement adopté lors du confinement par 53% des personnes sondées sur le sujet en septembre 2020).
D'une façon générale, lors du premier confinement, des difficultés ont été rencontrées au niveau des de l'approvisionnement ou de la disparition de débouchés pour le secteur alimentaire. Le rôle central de la logistique pour le fonctionnement de ce secteur a en outre été révélé.
Ces aspects ont notamment eu pour conséquence directe pour les consommateurs des ruptures de stocks. Une augmentation du prix de certaines denrées alimentaires non transformées a également été observée en 2020 (selon le Rapport annuel 2020 de l’Observatoire des prix). L'accès pour tous (tous les âges et toutes les conditions sociales) à certaines alternatives, tant sur le plan technologique (vente en ligne) que financier est également un point d'attention. Les difficultés rencontrées par une tranche de la population, notamment en termes d'accessibilité à des produits de qualité (frais), et la nette augmentation des demandes à l’aide alimentaire en sont des exemples.
Néanmoins, en termes de comportements d'achats, les enquêtes et observations réalisées ont pu montrer :
- Des achats massifs et de création de réserves de produits de base en début de confinement : céréales transformées (dont pâtes, riz, farine), légumineuses, …
- Une augmentation de l'achat de produits frais, comme les fruits et légumes, la viande, les œufs, notamment en lien avec une augmentation du nombre de personnes qui ont fait leur pain et des pâtisseries eux-mêmes, et préparé leurs repas.
- Une augmentation de l'achat de produits plus durables / Fair trade (selon un sondage de Fairtrade Belgium)
- Une augmentation des achats en ligne, ce qui n'a pas été sans poser des problèmes logistiques. Selon une étude réalisée par le RABAD auprès d’acteurs bruxellois du secteur de l’alimentation durable, les acteurs qui ont misé leur stratégie sur l’e-commerce s’en sortent en effet mieux.
- La mise en place de réseaux d'entraides et de collaboration (notamment relevés dans l'étude du RABAD)
- Une réorientation des consommateurs vers les circuits courts/les commerces de proximité : globalement, la hausse des achats en circuits-courts a été estimée entre 10 et 30%. La demande auprès de certains producteurs aurait cependant doublé, voire triplé (selon l'Apaq-W, news de début avril 2020).
Mais les supermarchés sont quand même souvent restés la norme voire privilégiés par certains pour centraliser les achats. A noter que les consommateurs se seraient également davantage tournés vers les enseignes favorisant les produits locaux ou régionaux.
Relevons que si 45% des bruxellois ayant changé leurs habitudes d’achats et/ou de consommation de produits alimentaires lors du confinement pensent maintenir ces changements à l’avenir (selon le sondage réalisé en septembre 2020), la question de la durabilité de ces tendances est néanmoins soulevée et devra être évaluée par la suite.
Bref, des défis pour l'avenir !
Les conditions rencontrées lors du premier confinement ont permis de mieux estimer certains aspects de l'impact de notre mode de vie sur notre environnement, tout comme sur notre qualité de vie. Différents enjeux ont également émergé, comme l'importance des secteurs dits 'vitaux', le rôle de la nature en ville, la dépendance aux sources externes, le potentiel des filières courtes ou alternatives, …
Cette crise, vu sa durée, sera probablement également à l'origine de changements plus durables (pratiques de télétravailTravail effectué à distance avec l'utilisation de la télématique, lien entre le travailleur et l'entreprise., habitudes alimentaires et/ou d'achat, …). Le fait que la relance (notamment économique) ne se fasse pas aux dépens de l'environnement et du climat mais serve plutôt de tremplin à autre fonctionnement de notre société constituera probablement l'un des enjeux majeurs pour la suite.
Dans ce cadre, relevons qu'une part importante des Bruxellois sondés en septembre 2020 s'est montrée ouverte à différents changements de ses habitudes, tels que l'adoption de comportements susceptibles d'améliorer la qualité de l'air comme se déplacer à pied (ce que 53% des sondés se disent prêts à pratiquer), pratiquer davantage de télétravail (40%) ou se déplacer en vélo ou à trottinette (40%).
À télécharger
Fiche(s) de l'Etat de l'Environnement
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Evaluation de l’impact des mesures prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19 sur la qualité de l’air en Région de Bruxelles-Capitale - Rapport du 26 juin 2020 (.pdf)
- BRUIT & COVID-19 : Etat de la situation durant la crise sanitaire et le confinement (01/07/2020) (.pdf)
Etudes et rapports
- Dedicated Research, septembre 2020. "Etude sur les opinions et les comportements des Bruxellois pour la résilience de leur ville dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 ". Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. Rapport final. 51 pp. (.pdf)
Végétaliser pour refroidir les espaces urbains : des solutions fondées sur la nature
Focus – Actualisation : septembre 2021
La végétation agit sur les températures ressenties via deux mécanismes : l’évapotranspirationL’eau de pluie est retenue au niveau du sol puis s’évapore vers l’atmosphère. La présence de plantes amplifie/augmente fortement ce phénomène. des plantes et du sol et la formation d’ombre. Des espaces végétalisés bien fournis en eau et capables de la stocker peuvent contribuer à réduire significativement la température de l’air. Plus le réseau d’espaces verts sera dense et les superficies étendues, plus l’impact du refroidissement sera important et perceptible à grande échelle. L’étude de scénarios de végétalisation appliqués à 4 zones critiques de la Région bruxelloise a permis d’estimer que la mise en œuvre de mesures de végétalisation de grande ampleur permettrait, durant les jours de grande chaleur, de réduire les valeurs de stress thermique en dessous du seuil où des problèmes de santé publique commencent à apparaître. Découvrez comment…
Des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes en ville
En ville, les températures de l’air, des surfaces et du sol sont presque toujours plus importantes que dans les zones rurales environnantes. Ce phénomène est connu sous le nom d’« îlot de chaleur urbain »). Il peut être observé tout au long de l'année mais constitue principalement un problème le soir et la nuit pendant les mois d'été.
Une étude a mis en évidence que les températures de l’air sont plus élevées de 3°C en moyenne au centre de la Région bruxelloise qu'à ses alentours ruraux en été. Lorsque certaines conditions spécifiques sont réunies, la température de l’air pendant la nuit peut être jusqu’à 8-9°C plus élevée dans le centre-ville urbanisé que dans la campagne périphérique. Il y a en outre en moyenne 3 fois plus d’épisodes de fortes chaleurs dans le centre de Bruxelles qu'en zone rurale (voir focus « Cartographie des îlots de fraicheur à Bruxelles » ).
Suite aux changements climatiques, ces vagues de chaleur sont amenées à être de plus en plus fréquentes. Alors que le climat actuel en Belgique présente en moyenne moins d’une demi-journée de vague de chaleur par an, des modélisations (basées sur le scénario le moins bon) réalisées dans le cadre du projet Cordex.be prévoient que ce phénomène se produise plus de 20 jours par an pour la période 2070-2100, avec des augmentations encore plus fortes en milieu urbain, comme à Anvers, Liège ou Bruxelles (voir fiche documentée « Evolution future du climat en Belgique et en RBC et conséquences et risques associés » et focus « Evolution future du climat en RBC et adaptations possibles ») .
Déjà à l’heure actuelle, les vagues de chaleur représentent une cause très importante de problèmes de santé au sein de la population. Selon l’Institut national de santé publique (Sciensano), les 3 vagues de chaleur enregistrées durant l’été 2019 en Belgique ont chacune coïncidé avec une surmortalité de la population, particulièrement à Bruxelles en ce qui concerne les 2 premières (respectivement 4% entre le 21 juin et le 2 juillet et jusqu’à près de 35% pour la période du 19 au 27 juillet 2019). Bien qu’il existe encore une certaine incertitude quant aux causes exactes de cette surmortalité, Sciensano insiste sur la nécessité de se protéger contre les effets des fortes chaleurs pour limiter les risques, particulièrement au vu de l’évolution potentielle du nombre de vagues de chaleur. L’adaptation des villes pour faire face aux épisodes de chaleurs estivales constitue un enjeu de taille pour le bien-être et la santé des citadins.
Une étude pour mieux comprendre l’impact de la végétalisation des espaces urbains sur le confort thermique des citadins
Parmi les mesures d’adaptation préconisées pour réduire l’impact de la chaleur en milieu urbain figure le développement d’espaces verts et de la végétation. Plusieurs plans bruxellois, dont le plan régional de développement durableMode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Il s'agit donc d une démarche qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement, et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine. (PRDD), le plan Air-Climat-Energie, le plan de gestion de l’eau ou encore le plan Nature, comportent ainsi des mesures visant à accroître la présence de végétation dans la ville afin de bénéficier des différents « services écosystémiquesEnsemble des services rendus par les sols à l’environnement et de facto à notre société : fourniture d’eau potable, limitation des inondations, stockage du Carbone atmosphérique, support pour la faune et la flore...) » apportés par cette dernière. Ces bénéfices incluent l’amélioration de la qualité de l’espace public, le support à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., la régulation du cycle de l’eau et du climat, la modération des conditions météorologiques extrêmes, l’assainissementTraitement de la pollution affectant un site (sol, eau) afin de le remettre dans son état initial ou du moins atteindre des valeurs fixées légalement. de l’air, le captage du dioxyde de carbone, l’amélioration de la qualité du sol, ou encore, la création de zones calmes et de confort, notamment au niveau des espaces publics. Les mécanismes à la base de certains de ces impacts sont néanmoins complexes et leurs effets réels, en milieu urbain, généralement peu connus.
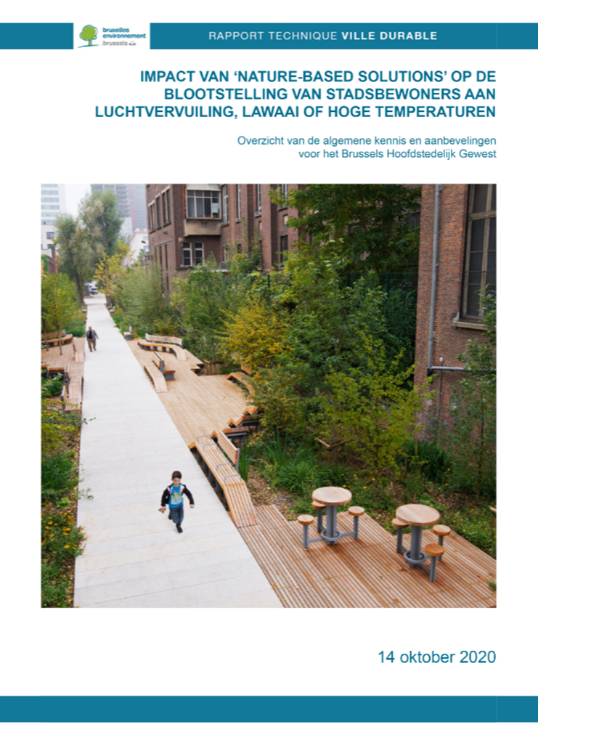 C’est dans ce cadre qu’une étude visant à synthétiser les connaissances scientifiques concernant l’impact de la végétation urbaine sur l’exposition des citadins aux polluants atmosphériques, au bruit et aux fortes chaleurs a été effectuée en 2020 à la demande de Bruxelles Environnement.
C’est dans ce cadre qu’une étude visant à synthétiser les connaissances scientifiques concernant l’impact de la végétation urbaine sur l’exposition des citadins aux polluants atmosphériques, au bruit et aux fortes chaleurs a été effectuée en 2020 à la demande de Bruxelles Environnement.
Le but de cette étude est d’objectiver le potentiel de la végétation pour réduire, localement- et en milieu extérieur, des problèmes de qualité de l’air, de bruit ou de chaleur ressentie et de disposer de recommandations générales concernant la mise en œuvre de ces solutions, qualifiées de solutions fondées sur la nature (ou nature-based solutions), au niveau bruxellois.
Ce focus traite du lien entre végétation et confort thermique des usagers des espaces publics en périodes de fortes chaleurs. Son contenu sur fonde en grande partie sur les résultats de l’étude précitée (VITO et WITTEVEEN+BOS 2020). L’impact de la végétalisation des espaces publics sur l’exposition au bruit et à la pollution atmosphérique fait l’objet de deux autres focus.
Bon à savoir
La température de l’air ne donne pas une image complète de la température ressentie. Celle-ci dépend en effet également de l’exposition au rayonnement solaire, de l’humidité de l’air et du vent.
L'indice de température au thermomètre-globe mouillé, de son nom originel « wet-bulb globe temperature » (WBGT), est un indice composite qui prend en compte les effets de ces différents paramètres sur l’homme. Il constitue un standard international pour quantifier le confort thermique utilisé par exemple en hygiène du travail ou par les militaires pour déterminer les niveaux d’exposition à des températures élevées. Une cartographie des îlots de fraîcheur a été établie sur base d’une simulation des valeurs de l'indice WBGT, reflet du stress thermique, sur l’ensemble du territoire bruxellois (voir focus sur le sujet).
L’ombrage des arbres et l’évapotranspiration de la végétation, des sols et des points d’eau contribuent à améliorer le confort thermique des citadins
Comment les arbres rafraîchissent la ville
Source : Bruxelles Environnement (adapté de VITO et WITTEVEEN+BOS 2020)
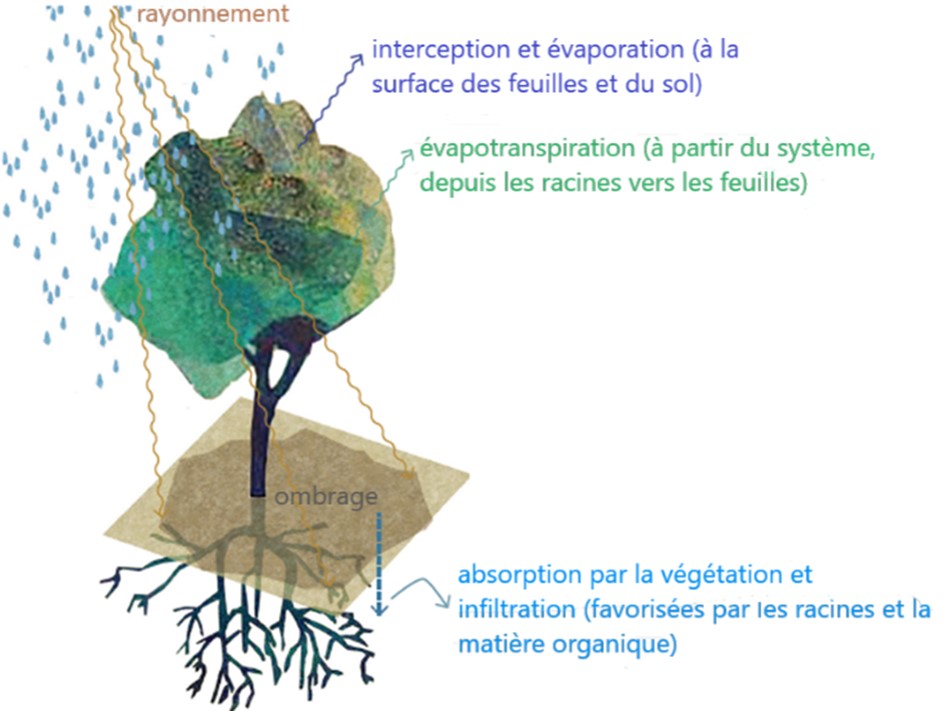
La végétation urbaine agit sur les températures ressenties via deux mécanismes:
- la limitation du rayonnement solaire incident par la formation d’ombre (absorption et, dans une moindre mesure, réflexion des rayons solaires par la végétation)
- l’évapotranspirationL’eau de pluie est retenue au niveau du sol puis s’évapore vers l’atmosphère. La présence de plantes amplifie/augmente fortement ce phénomène.
L’évapotranspiration regroupe deux phénomènes distincts :
- l’évaporation de l’eau interceptée par les feuilles et branches mais aussi celle de l’eau emmagasinée dans les sols et les points d’eau
- la transpiration des plantes : chez les végétaux, la transpiration est un processus continu causé par l’évaporation d’eau, prélevée par les racines, au niveau des feuilles (principalement via de minuscules orifices appelés stomates) et qui permet à celles-ci de maintenir à leur surface une température acceptable ainsi que la circulation de la sève
L’évaporation de l’eau liquide en vapeur nécessite de l’énergie (chaleur) qui est prise dans l’air ou au végétal ce qui se traduit par un rafraîchissement de l’air.
Une zone végétalisée bien fournie naturellement en eau et capable de l’emmagasiner est apte à répondre efficacement aux problèmes de stress thermique par une diminution de la température de l’air (via l’évapotranspiration) mais surtout par la création d’ombre. L’importance du rayonnement solaire est en effet un facteur important déterminant le confort thermique. Aux moments les plus chauds de la journée, l'ombrage des arbres revêt une importance cruciale.
Au-delà de l’espace végétalisé lui-même, l’espace de pleine terre auquel il peut être associé contribue également à optimiser les bénéfices apportés par la végétation, notamment via l’évaporation des eaux pluviales infiltrées.
Le rafraîchissement apporté par la végétation dépend de nombreux facteurs parmi lesquels les caractéristiques des végétaux et des sols (capacité de stockage de l’eau et mode de gestion des eaux pluviales), la taille et densité des espaces verts, l’implantation dans l’espace urbain (distance par rapport aux zones à rafraîchir, localisation par rapport aux écoulements de l’air et au soleil) ou encore, les conditions météorologiques locales.
La formation d’ombre et l’évapotranspiration sont surtout le fait des arbres relativement aux plantes herbacées et aux arbustes. Par temps sec et chaud, un grand arbre peut évaporer et transpirer des centaines de litres de vapeur d’eau par jour.
Un air sensiblement plus frais dans les parcs urbains en été mais un effet essentiellement local
Les mesures indiquent que les espaces verts sont toujours plus frais que les autres lieux urbains et que l’importance du refroidissement augmente avec la taille de l’espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières.. Cet effet reste cependant localisé et n'a pas ou peu d'impact sur les températures des zones voisines.
Une campagne de mesure réalisée par le VITO à Anvers durant l'été 2013 a montré que le Parc de la ville (stadspark) était clairement l'endroit le plus frais du centre-ville. Par une chaude soirée d'été, la température de l'air y était inférieure de 3°C à celle du tissu urbain situé à proximité. De même, lors d’une journée chaude, la température de surface dans le parc était inférieure de 15°C à celle de l'environnement urbain. Sur l'ensemble de l'été, le parc de la ville était plus frais de 1°C le soir et la nuit et 0,5°C plus frais pendant la journée. Ces résultats sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus dans le cadre de recherches scientifiques similaires menées dans d’autres villes.
La combinaison d’arbres d’alignements, de façades végétalisées et de toitures vertes peut réduire localement la température de l’air d’une rue jusqu’à 2°C
À un niveau plus local, Gromke et al. (2015) ont étudié l'effet de rangées d'arbres, de façades végétalisées et de toitures vertes sur la température de l'air dans une rue canyon en utilisant des simulations. Il en ressort que, par une journée chaude, ce sont les arbres d’alignement qui refroidissent la rue le plus efficacement à savoir jusqu'à un maximum de 1,5°C localement.
La verdurisationActe volontaire visant à réintroduire de la végétation dans des zones qui en sont dépourvues. des façades et les toitures vertes induisent un refroidissement de l’air limité de maximum 0,5°C. Dans le cas d'une combinaison de ces mesures, le refroidissement en termes de distribution spatiale et d'intensité ressemble globalement à une superposition linéaire des refroidissements occasionnés par les mesures de végétalisation appliquées seules, avec une réduction de température moyenne de 0,5 °C et maximale de 2,0 °C. Ces effets ne se produisent qu'à proximité de la verdure installée, soit à quelques mètres. Lorsqu’il n’est pas possible ou souhaitable de planter des arbres d’alignement de part et d’autre de la voirie, mieux vaut privilégier si possible une implantation côté nord de la rue (dans une rue orientée est-ouest) car les bâtiments du côté sud fournissent déjà de l’ombre au niveau de la rue aux heures les plus chaudes de la journée.
Seul un réseau dense et étendu d’espaces verts et d’espaces végétalisés peut contribuer à une baisse significative de la température de l’air à l’échelle de la ville
Pour améliorer le confort thermique des usagers des espaces urbains, il est nécessaire de multiplier, dans l’ensemble de la ville, des petits espaces verts – si possible ombragés - et de les connecter entre eux au maximum. Plus le réseau d’espaces verts sera dense et plus les superficies d’espaces verts seront étendues, plus l’impact du refroidissement sera significatif et pourra se faire sentir à grande échelle.
La localisation des espaces verts joue également un rôle important. Des espaces verts aménagés au vent de la ville permettent au vent de répartir l’air frais dans la ville. Certains axes verdurisés peuvent jouer le rôle « de couloirs climatiques » en connectant la ville avec des zones périphériques plus fraîches.
La présence d’eau contribue aussi à rafraîchir l’air mais joue peu sur le confort thermique si elle n’est pas accompagnée d’ombrage
La présence d'eau peut également être utilisée pour rendre le climat des villes plus agréable. Plus l'eau s'évapore facilement, plus l'effet de refroidissement sera important. A cet égard, les fontaines et les brumisateurs s’avèrent plus efficaces que de l’eau stagnante (mais soulèvent la question de la consommation d’eau potable et d’énergie). Par exemple, dans le cas d’une fontaine à jet à Tokyo, une réduction de 1 à 2°C de la température de la zone localisée sous le vent a été constatée (Kimoto et al. 1998). Au niveau des espaces publics, les dispositifs de cheminements d’eau peuvent avoir un effet rafraîchissant sous réserve qu’ils soient correctement conçus et dimensionnés, en particulier en évitant les eaux peu profondes et stagnantes. A défaut, la chaleur absorbée par l’eau en journée sera lentement libérée dans l'environnement durant la nuit ce qui peut conduire à renforcer localement l’effet d’îlot de chaleur.
Des dispositifs de cheminement d’eau bien dimensionnés peuvent contribuer à rafraîchir l’air
Source : VITO et WITTEVEEN+BOS 2020
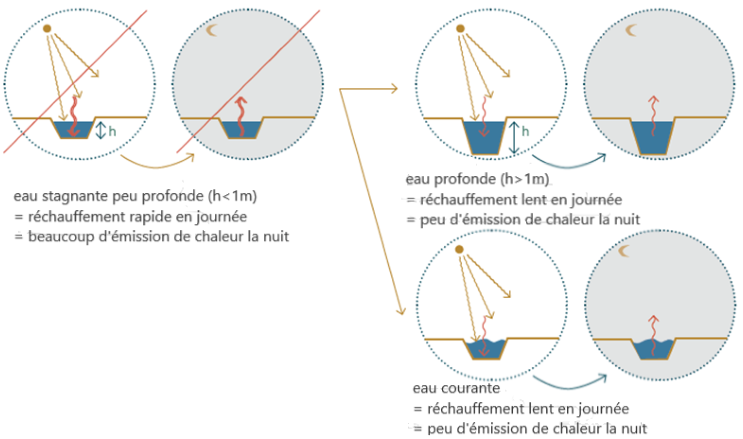
A proximité immédiate des surfaces d'eau, la température de l'air est nettement plus fraîche l'après-midi mais, en raison du rayonnement solaire incident et de l'humidité de l’air plus élevée, les valeurs de l’indice de confort thermique WBGT ne sont pas vraiment inférieures. L’idéal est donc de combiner la présence d’eau avec l’effet d’ombrage de la végétation.
Végétaliser la ville, oui … mais pas n’importe comment
Lors d’un projet de végétalisation de l’espace public, le choix des essences doit tenir compte de nombreux facteurs en lien avec les besoins et contraintes liées aux différentes espèces ainsi qu’avec les bénéfices environnementaux et socio-économiques (ou services écosystémiquesEnsemble des services rendus par les sols à l’environnement et de facto à notre société : fourniture d’eau potable, limitation des inondations, stockage du Carbone atmosphérique, support pour la faune et la flore...)) rendus par celles-ci.
Du côté des services écosystémiques, il importe de prendre en considération des éléments tels que la contribution à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). (avec notamment la question des espèces indigènes et exotiques), la qualité de l’ombrage, le potentiel de rafraîchissement, la capacité de réduire localement la pollution de l’air et/ou les nuisances sonores (voir focus « Végétaliser pour réduire l’exposition locale à la pollution de l’air : des solutions basées sur la nature » et « Végétaliser pour réduire localement l’exposition au bruit : des solutions fondées sur la nature »), la capacité de protéger du vent, l’intérêt paysager ou patrimonial, la production de fruits comestibles ou encore, le stockage de dioxyde de carbone.
Les contraintes et besoins à analyser sont notamment les risques allergiques liés à certains pollens, les racines potentiellement intrusives dans les réseaux souterrains ou susceptibles de déformer les revêtements de surface, les dimensions de l’arbre à l’âge adulte, la rapidité de croissance et la longévité de l’arbre, l’adaptation au climat local actuel mais aussi aux évolutions climatiques attendues (résistance au stress hydriqueLe stress hydrique est une situation critique qui surgit lorsque les ressources en eau disponibles sont inférieures à la demande en eau. et thermique en particulier), les besoins en eau et sol, les risques de chute de branches ou de fruits, le dépôt de miellats, les exigences en terme de gestion, la sensibilité aux maladies et espèces nuisibles, aux polluants, aux sels de déneigement, etc.
Ces nombreux facteurs doivent être modulés en fonction du contexte urbain et des usages attendus du lieu d’implantation.
Les choix en termes de végétation peuvent impliquer des enjeux contradictoires. Par exemple, les végétaux les plus résistants à la sécheresse ont souvent une surface foliaire réduite et une physiologie limitant leur transpiration avec comme conséquence un impact rafraîchissant moindre. Le choix et la combinaison des plantations doivent donc faire l’objet d’une réflexion spécifique à chaque projet.
De manière générale, les espèces feuillues sont préférables aux conifères car en perdant leurs feuilles en hiver, elles entravent moins la ventilation de l’air et l’obstruction à la dilution des polluants et permettent au soleil de chauffer la rue et les bâtiments adjacents.
Un enjeu essentiel est de concilier préservation des ressources en eau et végétalisation massive des villes
Avec le réchauffement climatique, on assiste de plus en plus à la nécessité d’arroser certaines plantations en période estivale, y compris sous nos latitudes, alors que les ressources en eau sont parfois mises sous pression. Par ailleurs, comme explicité précédemment, l’effet rafraichissant de la végétation repose sur l’évapotranspirationL’eau de pluie est retenue au niveau du sol puis s’évapore vers l’atmosphère. La présence de plantes amplifie/augmente fortement ce phénomène., qui nécessite la présence d’eau dans le sol, ainsi que sur la formation d’ombrage, liée à la densité du feuillage elle-même liée en partie à l’absence de stress hydrique.
Outre le choix des essences et le recours éventuel à des méthodes d’irrigation économes en eau, la réponse à l’enjeu de l’approvisionnement des plantations en eau s’inscrit dans celui, plus vaste, de la gestion de l’eau dans la ville avec notamment les projets de désimperméabilisation des sols, de mise en valeur de l’eau dans l’espace urbain, de récupération et gestion des eaux de pluie là où elles tombent ou, tout simplement, de gestion intégrée des eaux pluviales.
De manière générale, pour éviter ou limiter le stress hydrique des arbres et autres plantations, il faut veiller à ne pas empêcher l’eau de ruissellement d’atteindre les espaces végétalisés. Cela passe par la désimperméabilisation de certaines zones de voiries - en particulier, de parking - ou encore, par l’utilisation de revêtements semi-perméables. Une attention particulière doit toutefois être accordée à la qualité des eaux de ruissellement infiltrées et aux risques de pollution des nappes (hydrocarburesCe sont des composés organiques liquides constitués de carbone et d’hydrogène dérivés du pétrole. Le mazout, l’essence et d’autres types d’huiles minérales en font partie. Ces huiles ont la particularité d’avoir une faible densité. Lorsqu’elles s’infiltrent dans le sol, elles peuvent atteindre l’eau souterraine et y former une couche flottante., métaux lourdsNom générique d'un groupe de métaux de densité relativement élevée, tels que le plomb, le mercure, le zinc et le cadmium. Ces métaux sont présents naturellement dans l'environnement et sont même nécessaires à certains processus naturels. Ils sont toutefois nocifs en concentrations élevées. Les principales sources de métaux lourds sont l'industrie non ferreuse, la combustion de combustibles fossiles, l'incinération de déchets et le trafic., etc.). Pour éviter une contamination potentielle, il peut s’avérer nécessaire de mettre en place des systèmes de phytoépuration, voire des solutions permettant uniquement l’évapotranspiration des eaux sans infiltration.
Il peut aussi être recommandé d’adapter, en termes de volume et de porosité, les fosses de plantation des arbres de manière à améliorer le stockage des eaux de ruissellement. Lorsque l’espace dans le sol est limité (présence de constructions ou d’impétrants), une alternative moins invasive dans le sol est d’implanter des fosses d’eau pluviale au pied des arbres où les eaux sont acheminées par ruissellement. Cette eau sert ensuite à l’alimentation des arbres et sera évacuée par évapotranspiration et infiltration dans le sol. Des systèmes d’alimentation des arbres par drainage des surfaces environnantes peuvent aussi être mis en œuvre (pour plus d’information voir infofiche sur les arbres de pluie ).
Pour les cas étudiés en Région bruxelloise, l’application de solutions fondées sur la nature de grande ampleur pourrait réduire localement de 0,5 à 2,5°C (indice WBGT) la température de l’air
Afin d’estimer, en première approche, le potentiel théorique de solutions fondées sur la nature pour réduire localement l’exposition des usagers de l’espace public à la pollution de l’air et aux nuisances sonores ainsi qu’aux chaleurs excessives, 4 zones bruxelloises représentatives de différentes configurations spatiales ont été étudiées.
Pour chacun de ces cas, un scénario minimaliste (mesures de végétalisation compatibles avec une conservation des infrastructures de mobilité existantes) ainsi qu’un scénario maximaliste (mesures de végétalisation impliquant une emprise spatiale significative) ont été étudiés.
Principales solutions fondées sur le nature envisagées pour améliorer localement le confort thermique des usagers de l’espace public
Source : VITO et WITTEVEEN+BOS 2020
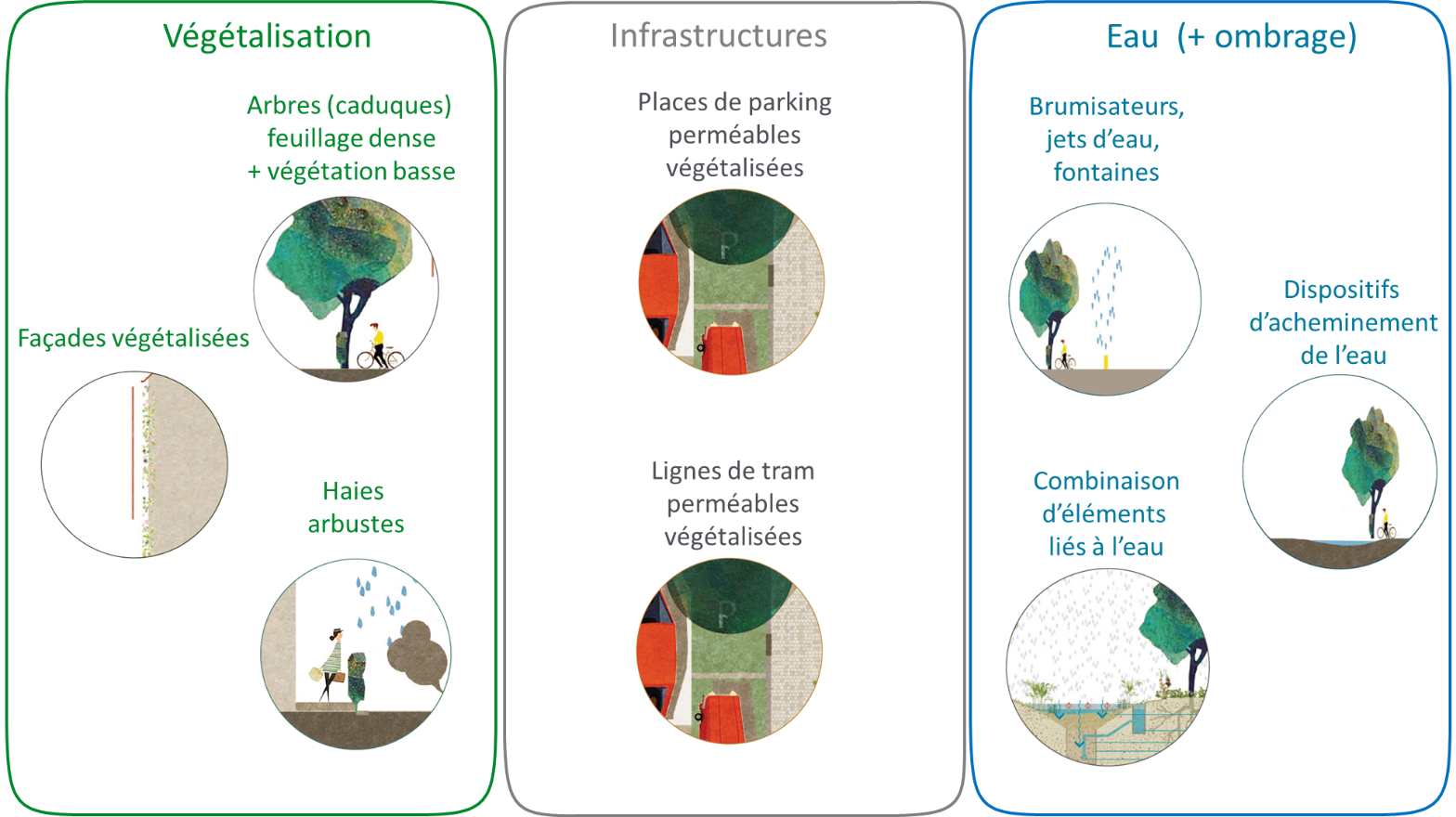
Il en ressort que, pour les cas étudiés, le recours à une végétalisation importante de l’espace public permettrait une réduction locale de l'indice de température au thermomètre-globe mouillé comprise entre 0,5 à 2,5°C (indice WBGT). Cette baisse suffit généralement pour permettre aux valeurs de stress thermique mesurées par temps chaud de descendre en dessous du seuil où les problèmes de santé deviennent apparents.
Comme explicité ci-dessus, chaque projet de végétalisation doit faire l’objet d’un examen spécifique afin d’optimiser l’effet rafraîchissant tout en tenant compte des autres bénéfices écosystémiques attendus et des contraintes du site.
À télécharger
Fiche(s) documentée(s)
Thématique climat
- 03. La Région de Bruxelles-Capitale face aux changements climatiques, 2021 (.pdf)
- 06. Évolution future du climat en Belgique et en Région de Bruxelles-Capitale et conséquences et risques associés, 2021 (.pdf)
Thématique sol
Thématique eau
Fiche(s) de l'Etat de l'Environnement
- Focus : Les vulnérabilités de la RBC face aux changements climatiques, 2021
- Focus : Cartographie des îlots de fraîcheur à Bruxelles, 2020
- Focus : Évolution future du climat en Région de Bruxelles-Capitale et adaptations possibles, 2021
- Focus : Végétaliser pour réduire localement l’exposition au bruit : des solutions fondées sur la nature, 2021
- Focus : Végétaliser pour réduire localement l’exposition à la pollution de l’air : des solutions fondées sur la nature, 2021
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Infofiche, Les arbres de pluie, 2014 (.pdf)
- Infofiche, Favoriser la mise en place de dispositifs alternatifs pour la gestion des eaux pluviales, 2021 (.pdf)
- Eaux de pluie, un atout pour l’espace public, 2014 (.pdf)
- Memento NAT - Développement de la nature, be sustainable.brussels, 2021(.pdf)
Etudes et rapports
- ADEME 2018. « Aménager avec la nature en ville - Des idées préconçues à la caractérisation des effets environnementaux, sanitaires et économiques », 100 pp. (.pdf)
- GROMKE, C., BLOCKEN, B., JANSSEN, W., MEREMA, B., VAN HOOFF, T., & TIMMERMANS, H. 2015. "CFD analysis of transpirational cooling by vegetation: Case study for specific meteorological conditions during a heat wave in Arnhem, Netherlands" in "Building and Environment", 83, 11-26.
- MATHILDE PASCAL M., KARINE LAAIDI K., BEAUDEAU P. 2019. "Intérêt des espaces verts et ombragés dans la prévention des impacts sanitaires de la chaleur et de la pollution de l’air en zones urbaines » in "Santé publique" 2019/HS1 (S1), p.197-205.
- UNALAB 2019."Nature Based Solutions - Technical Handbook (part II)", 114 pp. (.pdf)
- VITO et WITTEVEEN+BOS (LAUWAET D., VRANCKX S., DENS S., HAWER T.) 2020. « Impact van nature-based solutions op de blootstelling van stadsbewoners aan luchtvervuiling, lawaai of hoge temperaturen - Overzicht van de algemene kennis en aanbevelingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, rapport final, 98 pp.(.pdf) (en néerlandais uniquement, résumé en français)
Plans et programmes
Liens utiles
Végétaliser pour réduire localement l’exposition à la pollution de l’air : des solutions basées sur la nature
Focus - Actualisation : octobre 2021
Selon diverses études, la présence de végétation pourrait réduire, en moyenne, la contribution des émissions locales aux concentrations de polluants de 15 à 20 %. Pour la Région bruxelloise, l’étude de scénarios de végétalisation appliqués à 4 zones critiques en terme de pollution de l’air, a permis d’estimer un impact sur les concentrations locales de dioxydes d’azote (NO2) de 5 à 10% lors de la mise en œuvre de mesures de grande ampleur. Cet effet est principalement dû à l'influence de la végétation sur les flux d'air (effet aérodynamique) et, dans une moindre mesure, à l'effet filtrant. Dans un contexte urbain, les mesures de végétalisation à elles seules ne permettent généralement pas de réduire la pollution de l’air de manière significative, le principal levier restant la réduction des émissions de polluants à la source.
Une étude pour mieux comprendre l’impact de la végétalisation des espaces urbains sur l’exposition des citadins à la pollution de l’air
Il existe aujourd’hui une conscience croissante de la nécessité et de l’urgence de végétaliser les villes. Outre le fait qu’elle constitue un élément important de la qualité de vie des citadins, la nature en ville remplit en effet de nombreuses autres fonctions notamment en matière de régulation des écosystèmes.
Plusieurs plans bruxellois comportent des mesures visant à accroître la présence de végétation dans l’espace urbain afin de bénéficier de divers services (ou bénéfices) écosystémiques (voir focus « Végétaliser pour refroidir les espaces urbains »). Parmi les services attendus figure l’assainissementTraitement de la pollution affectant un site (sol, eau) afin de le remettre dans son état initial ou du moins atteindre des valeurs fixées légalement. de l’air qui est évoqué par les plans Nature et Air-Climat-Energie (2016 et 2023) ainsi que par le plan régional de développement durableMode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Il s'agit donc d une démarche qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement, et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine. (2018).
Les mécanismes à la base de l’impact de la végétation sur la qualité de l’air sont néanmoins complexes et leurs effets réels, en milieu urbain, généralement peu connus.
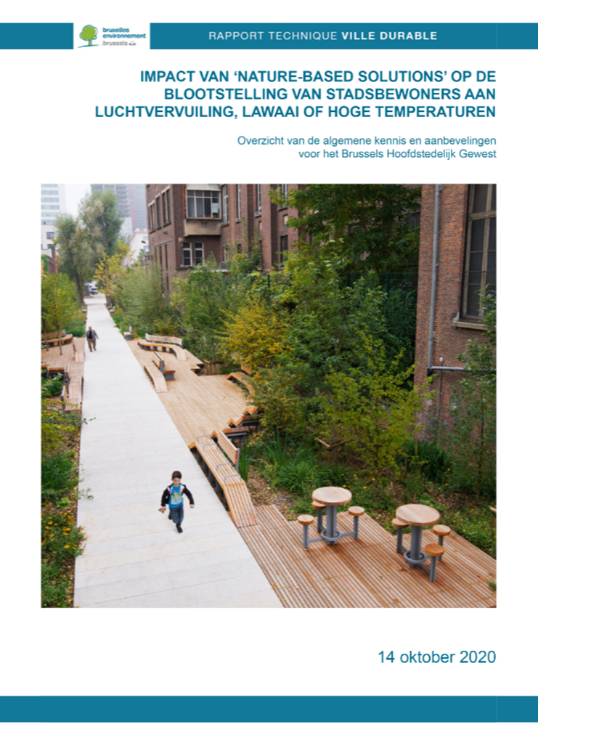 C’est dans ce cadre qu’une étude visant à synthétiser les connaissances scientifiques concernant l’impact de la végétation urbaine sur l’exposition des citadins aux polluants atmosphériques, au bruit et aux fortes chaleurs a été effectuée en 2020 à la demande de Bruxelles Environnement.
C’est dans ce cadre qu’une étude visant à synthétiser les connaissances scientifiques concernant l’impact de la végétation urbaine sur l’exposition des citadins aux polluants atmosphériques, au bruit et aux fortes chaleurs a été effectuée en 2020 à la demande de Bruxelles Environnement.
Le but de cette étude est d’objectiver le potentiel de la végétation pour réduire, localement- et en milieu extérieur, des problèmes de qualité de l’air, de bruit ou de chaleur ressentie et de disposer de recommandations générales concernant la mise en œuvre de ces solutions, qualifiées de solutions fondées sur la nature (ou nature-based solutions), au niveau bruxellois.
Solutions fondées sur la nature (ou nature-based solutions)
Les solutions fondées sur la nature (SFN) ou nature-based solutions (NBS) sont définies par la Commission européenne comme des solutions inspirées par la nature et reposant sur cette dernière, qui sont rentables, qui offrent des avantages à la fois environnementaux, sociaux et économiques et qui favorisent la résilience. De telles solutions apportent aux paysages (…) des caractéristiques et des processus naturels plus nombreux et diversifiés, grâce à des interventions systémiques adaptées aux conditions locales et efficaces en termes d’utilisation des ressources. La Commission souligne en outre que les solutions fondées sur la nature doivent s’avérer bénéfiques pour la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). et contribuer à la fourniture d’une série de services écosystémiquesEnsemble des services rendus par les sols à l’environnement et de facto à notre société : fourniture d’eau potable, limitation des inondations, stockage du Carbone atmosphérique, support pour la faune et la flore...).
Ce focus explicite la façon dont la présence de végétation peut influencer localement la qualité de l’air. Son contenu se fonde en grande partie sur les résultats de l’étude précitée (VITO et WITTEVEEN+BOS 2020). L’impact de la végétalisation des espaces publics sur l’exposition au bruit et à l’exposition aux fortes chaleurs fait l’objet de deux autres focus.
Un effet filtrant et absorbant de la végétation sur la pollution de l’air
La végétation participe à la purification de l’air via trois mécanismes distincts :
La déposition des polluants particulaires sur les feuilles et les branches
Parmi les polluants atmosphériques les plus néfastes pour la santé figurent les particules fines en suspension dans l'air. Celles-ci entrent en contact avec des feuilles et des branches, s'y déposent et sont ensuite emportées au sol par la pluie ou la chute des feuilles, voire remises en suspension par le vent.
L’importance de ce dépôt croît avec la surface des feuilles et des branches des végétaux.
L’adsorption de polluants lipophiles dans les cires de la cuticule des feuilles
Les polluants tels que les polychlorobiphényles (PCB) et les dioxines (polluants organiques persistants) ont la propriété d'être solubles dans un corps gras. La cuticule, couche de cire présente à la surface des feuilles, est donc en mesure de les fixer (ou adsorber). A cet égard, les feuilles munies d'une cuticule épaisse comme les épines des conifères sont plus efficaces.
Notons que de par leurs propriétés physicochimiques, les sols peuvent également piéger les polluants présents en solution. Par ailleurs, les polluants dissous dans l’eau du sol peuvent être absorbés par les racines des plantes.
La pénétration de polluants par les stomates
Les stomates, minuscules ouvertures à la surface des feuilles, assurent les échanges gazeux entre la plante et l’air ambiant. Ces échanges de dioxyde de carbone (CO2), d’oxygène (O2) et de vapeur d’eau (H2O) (essentiellement) sont nécessaires aux processus de photosynthèse, de respiration et de transpiration des végétaux. Via ces stomates, les feuilles peuvent également absorber, par diffusion, des polluants de petites tailles tels que l'ozone (O3), les oxydes d'azote (NO et NO2), les oxydes de soufre (SO et SO2), des composés organiques volatils (COV) ou encore, le monoxyde de carbone (CO).
L’importance de l’absorption par les stomates est un phénomène complexe lié à de nombreux facteurs dont :
- Les caractéristiques physiologiques de la plante : densité de stomates, mécanismes de régulation en cas de sécheresse, etc. ;
- Les stimuli de l’environnement : sécheresse, lumière, concentration en dioxyde de carbone, etc.
La contribution de la végétation au filtrage et à l’absorption des polluants dépend notamment du type de végétation, de l’espèce et des polluants
De manière générale, les arbres sont les végétaux les plus efficaces à cet égard, suivis respectivement par les arbustes et les plantes herbacées.
Les conifères sont généralement plus efficaces en ce qui concerne la filtration des particules polluantes (plus grande surface d’interaction) et l’adsorption de composés organiques volatils. Ils sont également efficaces toute l’année puisqu’ils ne perdent pas leurs feuilles en hiver, à quelques exceptions près.
Durant la saison de végétation, les arbres à feuilles caduques obtiennent quant à eux de meilleurs résultats que les conifères pour l’absorption de polluants gazeux (NO2 et O3 notamment). Pour les feuillus, le dépôt est lié à l’importance de la surface foliaire mais aussi aux caractéristiques des feuilles : en particulier, les feuilles rugueuses, poilues et collantes sont bien adaptées pour capturer les particules de particules fines.
Bon à savoir
L'impact de l’effet filtrant de la végétation sur de très courtes distances est estimé se situer entre 1% et quelques pour cent des concentrations présentes en ce qui concerne les particules (Litschke & Kuttler, 2008).
Plus on s'éloigne de la végétation, plus l'impact diminue et ce, de manière exponentielle (Baldauf et al, 2008 ; Lefebvre & Vranckx, 2013).
Mais c’est surtout en déviant l’air pollué qu’un écran végétal peut réduire localement la pollution…
En créant un obstacle, la végétation - et en particulier les arbres - a une influence locale importante sur l'écoulement de l'air (vitesse, direction, turbulence). Lorsque la végétation se situe entre les sources d’émissions polluantes et le récepteur, l’écran végétal dévie l’air pollué vers des couches d’air plus élevées où il se dilue.
Diverses études de cas ont permis aux auteurs de l’étude d’estimer que la présence de végétation peut réduire en moyenne la contribution des émissions locales aux concentrations de polluants de 15 à 20 %. Cet effet est principalement dû à l'influence de la végétation sur le flux d'air (effet aérodynamique) et, dans une moindre mesure, à l'effet de filtrage décrit précédemment. Il est d’autant plus important que la végétation est située à proximité immédiate de la source de pollution et est limité spatialement.
Présence d’une haie entre le trafic routier et les piétons : effet sur les concentrations locales de polluants

… mais un dôme végétal peut aussi augmenter la pollution en piégeant les polluants émis par le trafic
Présence d’arbres dans une rue canyon : effet sur les concentrations locales de polluants
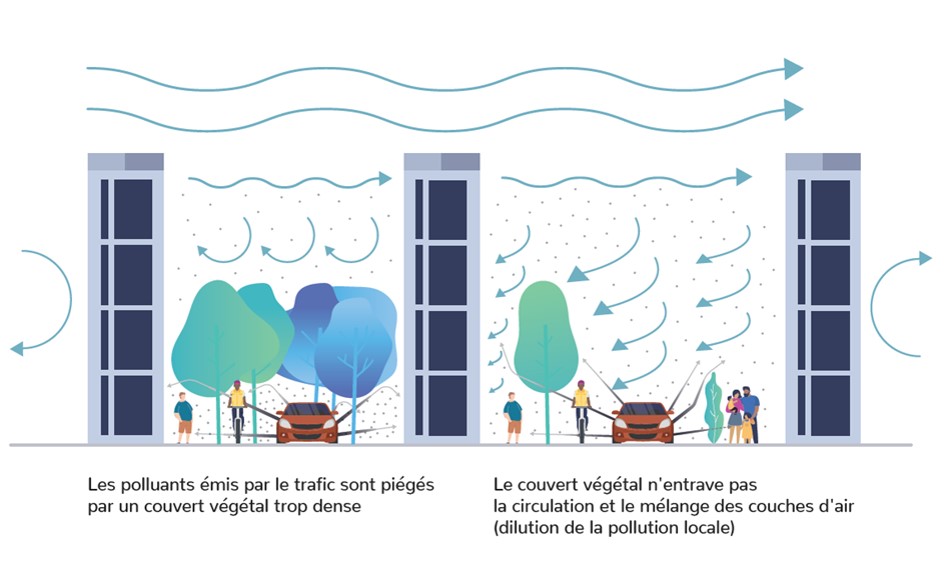
C’est surtout dans les rues canyons à forte circulation que des alignements d’arbres au feuillage dense sont susceptibles d’entraver la circulation de l’air et de provoquer localement une augmentation des concentrations de polluants.
Les rues canyons
Une rue canyon est une rue dont les bâtiments se succèdent de manière (quasi) ininterrompue et qui sont étroites et/ou dont les bâtiments sont élevés.
Selon l’étude précitée, cette augmentation de la contamination s'élève généralement à 15 % en moyenne, avec des variations fonction de la configuration de la rue canyon et de la direction du vent. L’implantation des arbres doit permettre d’éviter que la canopée ne bloque la pollution au sol par exemple, en laissant un espacement entre les couronnes d’arbres ou en implantant qu’une rangée d’arbres plutôt que deux pour éviter la formation d’un dôme végétal bloquant les polluants émis par le trafic.
Dans la mesure où les façades sous le vent concentrent davantage les polluants (voir focus sur La cartographie du black carbon en Région bruxelloise), il faut particulièrement veiller à ce que l’air puisse circuler de ce côté de la voirie. L’aménagement doit aussi privilégier la plantation d’arbres à feuilles caduques afin d’assurer une meilleure ventilation ainsi qu’un meilleur ensoleillement au sol en hiver. Dans les rues canyons, les murs végétalisés peuvent aussi contribuer à réduire la pollution de l’air.
Le cas particulier de l’ozone
L'ozone est un oxydant puissant qui peut causer de graves problèmes sanitaires s'il est présent en quantité anormalement élevée à proximité du sol (ozone troposphériquePrésent en basse altitude dans la troposphère, l'ozone se forme par liaison chimique en présence de rayons solaires. Il peut causer de graves problèmes au niveau des yeux, du nez et des voies respiratoires chez les humains et chez les animaux. Il peut altérer les cultures et les forêts, et dégrader de nombreux matériaux.). Il a aussi un effet toxique sur la végétation, tant au niveau des cellules des feuilles (dégâts foliaires sous forme de taches ou nécroses) que sur la croissance elle-même ou la productivité des cultures.
Le lien entre végétation et pollution par l’ozone (O3) s’avère particulièrement complexe dans la mesure où les plantes contribuent à la fois à augmenter et à réduire les quantités d’ozone présentes à leur proximité. Différents mécanismes, dont l’intensité varie en fonction de nombreux facteurs (ensoleillement et températures entre autres), entrent en jeu :
- Absorption directe d’ozone (O3) via les stomates ;
- Absorption de dioxyde d’azote (NO2) via les stomates : la réduction des concentrations en NO2 de l’air ambiant se traduit par une diminution de la formation d’ozone (voir fiche documentée sur l’ozone) ;
- Réduction de la température de l’air en période de forte chaleur liée à la présence de végétation (voir focus sur l’impact de la végétation sur le refroidissement des espaces urbains) entraînant également une diminution de la formation d’ozone (idem) ;
- Emission de composés organiques volatiles (COV) par les plantes via les stomates : l’augmentation des concentrations en COV de l’air ambiant se traduit par une augmentation de la formation d’ozone en présence de niveaux élevés de NOX (idem).
Lors de fortes chaleurs, les plantes émettent en effet des COV, tels que par exemple les terpènes, qui sont des gaz intervenant dans la formation de l’ozone ainsi que de certaines particules fines sous certaines conditions. C’est pourquoi, il peut être souhaitable d’éviter de planter certaines essences particulièrement émettrices de COV en trop grandes quantités pour ne pas augmenter les niveaux d’ozone en période estivale. Notons que ces terpènes ne sont pas intrinsèquement polluants : c’est suite à la présence de niveaux élevés de NOX, polluants émis par les processus industriels et les transports, que ces COV très réactifs entraînent des réactions chimiques se traduisant par la formation d’ozone.
Bon à savoir
Certaines espèces végétales telles que les bouleaux et noisetiers émettent des pollens à fort potentiel allergisant, responsables de nuisances sanitaires saisonnières chez les personnes sensibles et allergiques.
De nombreux facteurs à prendre en compte pour améliorer localement la qualité de l’air via la végétalisation des espaces publics
Il ressort de ce qui précède que lors de la plantation d’arbres dans l’espace urbain, il importe de prendre en considération de nombreux facteurs afin d’optimaliser les effets positifs des arbres sur la qualité de l’air et d’en limiter les impacts négatifs.
Concernant le choix des essences, rappelons que toutes les espèces d’arbres n’ont pas un impact équivalent sur la filtration et l’absorption de divers polluants et que certaines essences émettent davantage de COV ou sont allergènes. De manière générale, il convient de privilégier un mélange de différentes essences afin de capter un large spectre de polluants.
Outre le choix des essences, la façon dont sont plantés les arbres ainsi que leur structure constituent aussi des éléments importants :
- Comme explicité ci-dessus, dans une rue type canyon, les arbres ne doivent pas entraver la circulation de l’air et être plantés de préférence du côté au vent ;
- Un écran végétal dense situé entre les sources d’émissions polluantes et les usagers de l’espace public peut dévier une partie significative des flux d’air pollué vers des couches d’air plus élevées et réduire ainsi l’exposition des citadins aux polluants locaux ;
- L’effet filtrant nécessite un contact entre les polluants et les feuilles. Au niveau d’une voirie, la couronne des arbres doit donc ne pas être trop dense pour laisser circuler l’air à travers le feuillage ;
- Si les rangées d’arbres le long des rues filtrent l’air, elles peuvent aussi être à l’origine d’un effet aérodynamique qui réduit la vitesse du vent (effet « tunnel de verdure »), ce qui peut augmenter localement les concentrations de polluants provenant des gaz d’échappement. Cet effet peut être en partie évité en privilégiant une plantation au feuillage pas trop dense ;
- Pour avoir un effet d’écran effectif à différentes hauteurs, il convient de combiner plantations d’arbres, d’arbustes et de plantes herbacées ;
- Lorsque c’est possible, il est plus efficace de privilégier la plantation des arbres en rangées perpendiculaires à la direction dans laquelle arrive l’air pollué ;
- En l’absence de feuilles (période hivernale entre autres), les arbres à branchage dense interceptent davantage de particules que les arbres peu fournis en branches ;
- A proximité de lieux concentrant plus de personnes sensibles (écoles, hôpitaux, maisons de repos, etc.), il est particulièrement intéressant de planter massivement des arbres et arbustes tout en évitant la concentration d’arbres à fort potentiel allergisant ou émettant beaucoup de COV ;
- A nombre de plantations égales, celles-ci seront d’autant plus bénéfiques qu’elles se feront dans des zones fortement habitées/fréquentées.
A titre illustratif, quelques exemples sont fournis ci-dessous pour une rue bordée de maisons deux façades :
Exemples d’aménagements de l’espace urbain prenant en compte l’impact de la végétation sur l’exposition locale des citadins à la pollution de l’air
Source : VITO et WITTEVEEN+BOS 2020
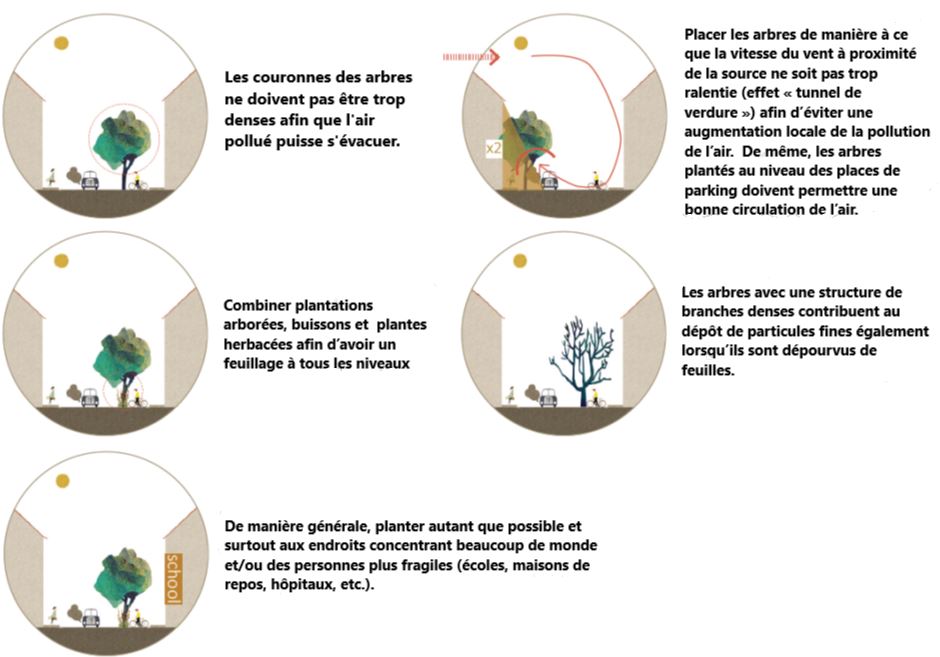
Pour les cas étudiés, l’application de solutions fondées sur la nature de grande ampleur pourrait réduire de 5 à 10% les concentrations locales de NO2
Afin d’estimer, en première approche, le potentiel théorique de solutions fondées sur la nature pour réduire localement l’exposition des usagers de l’espace public à la pollution de l’air et aux nuisances sonores ainsi qu’aux chaleurs excessives, 4 zones bruxelloises représentatives de différentes configurations spatiales ont été étudiées.
Pour chacun de ces cas, un scénario minimaliste (mesures de végétalisation compatibles avec une conservation des infrastructures de mobilité existantes) ainsi qu’un scénario maximaliste (mesures de végétalisation impliquant une emprise spatiale significative) ont été étudiés. Ces 2 scénarios ont également été comparés à un scénario de réduction de 50% du trafic motorisé (à infrastructures et végétalisation inchangées).
Principales solutions fondées sur la nature envisagées pour réduire localement l’exposition des usagers de l’espace public à la pollution de l’air
Source : VITO et WITTEVEEN+BOS 2020

Il en ressort que, pour les cas étudiés, les scénarios maximalistes permettraient une réduction de l’ordre de 5 à 10% des concentrations locales de NO2. Notons que la réduction de 10% est associée à une mesure combinant végétalisation et infrastructure « dure » (placement d’un écran végétalisé de 4 à 6 mètres de hauteur déviant l’air pollué en sortie d’un tunnel).
Néanmoins, bien que ces réductions soient significatives, cette étude concoure à montrer que les solutions fondées sur la nature sont généralement insuffisantes pour réduire significativement la pollution atmosphérique et sont toujours subordonnées à des mesures visant à réduire les émissions de polluants à la source, en particulier via une réduction significative du trafic motorisé.
En résumé
L’impact de la végétation sur la réduction de la pollution locale dépend de nombreux facteurs : nature des polluants, espèce et type de végétation, conditions météorologiques ou encore, implantation de la végétation par rapport à la source locale de pollution. La végétation peut aussi être source d’allergènes et de précurseurs de la formation d’ozone et d’aérosols polluants. Par ailleurs, dans des rues étroites où le trafic est important, le dôme des arbres peut freiner l’évacuation et la dilution des polluants et donc dégrader localement la qualité de l’air. Ces différents éléments doivent dès lors être pris en compte, parmi d’autres, lors de la conception de projets de végétalisation des espaces publics .
À télécharger
Fiche(s) documentée(s)
Thématique sol
Fiche(s) de l'Etat de l'Environnement
- Focus : Végétaliser pour réduire localement l’exposition au bruit : des solutions fondées sur la nature, 2021
- Focus : Végétaliser pour refroidir les espaces urbains : des solutions fondées sur la nature, 2021
Etudes et rapports
- ADEME 2018. « Aménager avec la nature en ville - Des idées préconçues à la caractérisation des effets environnementaux, sanitaires et économiques », 100 pp. (.pdf)
- BALDAUF R., THOMA E., KHLYSTOV A., ISAKOV V., BOWKER G., LONG T., & SNOW, R. 2008. "Impacts of noise barriers on near-road air quality », in Atmospheric Environment, 42(32), 7502-7507.
- LEFEBVRE W., & VRANCKX S. 2013. « Validation of the IFDM-model for use in urban applications" (Issue May).
- LITSCHKE, T., & KUTTLER, W. 2008. « On the reduction of urban particle concentration by vegetation - A review", in Meteorologische Zeitschrift, 17(3), 229-240.
- MATHILDE PASCAL M., KARINE LAAIDI K., BEAUDEAU P. 2019. "Intérêt des espaces verts et ombragés dans la prévention des impacts sanitaires de la chaleur et de la pollution de l’air en zones urbaines » in "Santé publique" 2019/HS1 (S1), p.197-205.
- UNALAB 2019."Nature Based Solutions - Technical Handbook (part II)", 114 pp. (.pdf)
- VITO et WITTEVEEN+BOS (LAUWAET D., VRANCKX S., DENS S., HAWER T.) 2020. « Impact van ‘nature-based solutions’ op de blootstelling van stadsbewoners aan luchtvervuiling, lawaai of hoge temperaturen - Overzicht van de algemene kennis en aanbevelingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, rapport final, 98 pp.(.pdf) (en néerlandais uniquement, résumé en français)
Plans et programmes
Végétaliser pour réduire localement l’exposition au bruit : des solutions fondées sur la nature
Focus – Actualisation : novembre 2021
La présence de végétation peut, sous certaines conditions, contribuer à atténuer les niveaux de bruit en déviant et en absorbant les ondes sonores. Les arbres et les haies sont les dispositifs végétaux les plus efficaces pour interagir avec les ondes sonores et ce, d’autant plus qu’ils forment une bande profonde et dense. D'autres solutions végétalisées peuvent néanmoins également y contribuer. Dans le cadre d’une étude de cas appliquée à 4 zones critiques de la Région bruxelloise, le gain acoustique maximal qui a pu être obtenu à l’échelle micro-locale à partir de solutions fondées sur la nature a été estimé à environ 5 décibels (dB(A)). Découvrez comment…
Une étude pour mieux comprendre l’impact de la végétalisation des espaces urbains sur l’exposition des citadins au bruit
La présence d’espaces verts et bleus constitue un élément important de la qualité de vie en milieu urbain. Outre une amélioration du cadre de vie, la nature en ville apporte de nombreux autres bénéfices ou « services écosystémiquesEnsemble des services rendus par les sols à l’environnement et de facto à notre société : fourniture d’eau potable, limitation des inondations, stockage du Carbone atmosphérique, support pour la faune et la flore...) » dont, entre autres, un support à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., la régulation du cycle de l’eau et du climat, la modération des conditions météorologiques extrêmes ou encore, une réduction locale de la pollution de l’air (voir focus « Végétaliser pour refroidir les espaces urbains» et «Végétaliser pour réduire localement l’exposition à la pollution de l’air» ).
Parmi les services écosystémiques attribués à la végétation urbaine figure la réduction du bruit ambiant, enjeu environnemental important en termes de santé publique des citadins. Le plan de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations (Quiet.Brussels), adopté en février 2019, comprend notamment des mesures visant à préserver, améliorer et créer des "zones de confort acoustique". Celles-ci correspondent à des zones dont au moins la moitié de la superficie a des niveaux sonores inférieurs à un seuil déterminé (Lden55dB(A)) et se localisent notamment au niveau des parcs et espaces verts. Le recours aux murs ou merlons (levées de terre) végétalisés figure parmi les actions préconisées. La création de zones calmes et de confort sur le territoire bruxellois, notamment au niveau des espaces publics, constitue aussi un objectif du plan régional de développement durableMode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Il s'agit donc d une démarche qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement, et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine. (Stratégie 6. Préserver et améliorer le patrimoine naturel régional, chapitre sur la limitation des nuisances environnementales).
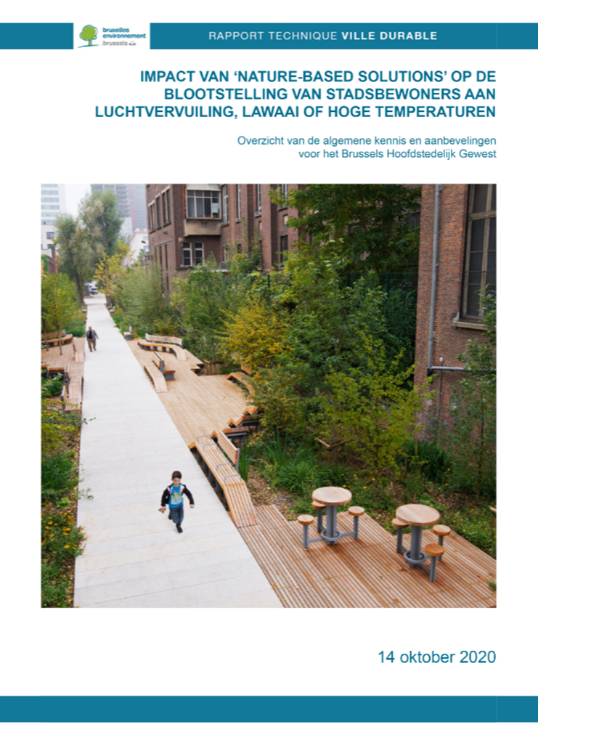 Une étude visant à synthétiser les connaissances scientifiques concernant l’impact de la végétation urbaine sur l’exposition des citadins aux polluants atmosphériques, au bruit et aux fortes chaleurs a été effectuée en 2020 à la demande de Bruxelles Environnement.
Une étude visant à synthétiser les connaissances scientifiques concernant l’impact de la végétation urbaine sur l’exposition des citadins aux polluants atmosphériques, au bruit et aux fortes chaleurs a été effectuée en 2020 à la demande de Bruxelles Environnement.
Le but de cette étude est d’objectiver le potentiel de la végétation pour réduire, localement et en milieu extérieur, des problèmes de qualité de l’air, de bruit ou de chaleur ressentie et de disposer de recommandations générales concernant la mise en œuvre de ces solutions, qualifiées de solutions fondées sur la nature (ou nature-based solutions), au niveau bruxellois.
Solutions fondées sur la nature (ou nature-based solutions)
Les solutions fondées sur la nature (SFN) ou nature-based solutions (NBS) sont définies par la Commission européenne comme des solutions inspirées par la nature et reposant sur cette dernière, qui sont rentables, qui offrent des avantages à la fois environnementaux, sociaux et économiques et qui favorisent la résilience. De telles solutions apportent aux paysages (…) des caractéristiques et des processus naturels plus nombreux et diversifiés, grâce à des interventions systémiques adaptées aux conditions locales et efficaces en termes d’utilisation des ressources. La Commission souligne en outre que les solutions fondées sur la nature doivent s’avérer bénéfiques pour la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). et contribuer à la fourniture d’une série de services écosystémiquesEnsemble des services rendus par les sols à l’environnement et de facto à notre société : fourniture d’eau potable, limitation des inondations, stockage du Carbone atmosphérique, support pour la faune et la flore...).
Ce focus traite du lien entre végétation et exposition des usagers des espaces publics aux nuisances sonores. Son contenu se fonde en grande partie sur les résultats de l’étude précitée (VITO et WITTEVEEN+BOS 2020). L’impact de la végétalisation des espaces publics sur l’exposition aux fortes chaleurs et à la pollution atmosphérique fait l’objet de deux autres focus.
Bon à savoir
La végétation peut contribuer à la réduction du bruit de deux manières :
- Déviation des ondes sonores (réflexion, diffraction)
- Absorption des ondes sonores
Par ailleurs, la présence de végétation peut aussi influencer de manière positive l’appréciation de l’ambiance sonore d’un lieu. Outre l’impact psychologique de la verdure, celle-ci peut s’accompagner de bruits de feuillages, de chants ou de cris d’oiseaux ou, encore de bruit d’eau perçus le plus souvent comme agréables.
L’influence du sol, de la couverture de sol et des surfaces d’eau
Un sol recouvert d’une végétation sera généralement plus poreux ce qui le rend acoustiquement plus absorbant. La présence de cette végétation entraîne également une plus grande interaction des ondes avec le sol de sorte qu'une plus grande partie du son sera absorbée.
Dans certaines configurations telles que des cours ou places urbaines, les surfaces au sol végétalisées permettent d’apporter une diminution de bruit de 2 à 4 dB(A) par rapport aux mêmes surfaces mais qui seraient revêtues de matériaux réfléchissants tels que des dalles ou de l’asphalte (ADEME 2017).
Bon à savoir
Une diminution du niveau sonore de 3 dB(A) correspond, pour comparaison et dans le cas du bruit routier, à l’impact d'une division par deux du trafic ou du doublement de la distance d’éloignement par rapport à la source sonore.
En milieu urbain, ces résultats sont également applicables aux voies de trams ainsi qu’aux voies ferrées.
Cet effet est cependant réduit, voire négatif, si le sol est humide (l’eau empêche la pénétration du son), notamment en cas d’arrosage. De même, en réfléchissant totalement les ondes sonores, les plans d’eau n’apportent pas d’amélioration acoustique.
Notons que la présence de fontaines, jets ou chutes d’eau peut générer un son permettant de masquer un bruit perçu comme désagréable (trafic par exemple) et, de ce fait, améliorer le confort acoustique perçu des usagers de l’espace.
L’influence des arbres
Troncs, branches, tiges et feuilles des arbres réfléchissent, diffractent et absorbent les ondes sonores. La réduction de bruit apportée par un ensemble d’arbres augmente avec la circonférence des troncs et la densité ainsi qu’avec la profondeur de la plantation (VITO et WITTEVEEN+BOS 2020). L’impact dépend aussi des essences (par ex. caractéristiques de l’écorce), de la hauteur des plantations et des caractéristiques du sol qui absorbe également les ondes sonores. Il est aussi fonction des conditions météorologiques locales (vent, température…), elles-mêmes influencées par la présence d’une bande boisée (Defrance et al. 2019).
Selon l’ADEME (2017), une plantation d’une longueur de l’ordre de 25 mètres le long d’une voirie et d’une profondeur de 75 mètres, avec des arbres de tronc d’environ 16 cm de diamètre et espacés d’un à deux mètres, serait susceptible d’apporter une atténuation supplémentaire du bruit d’environ 7 dB(A) par rapport à un terrain simplement enherbé. Ceci constitue une amélioration très perceptible. Des mesures effectuées par ailleurs (Defrance et al. 2019) montrent qu’un effet sur le bruit ne serait mesurable qu’à partir d’une bande de forêt profonde d’une vingtaine de mètres.
Atténuation du bruit avec la distance et la présence d’une bande boisée
Source : Bruxelles Environnement 2021
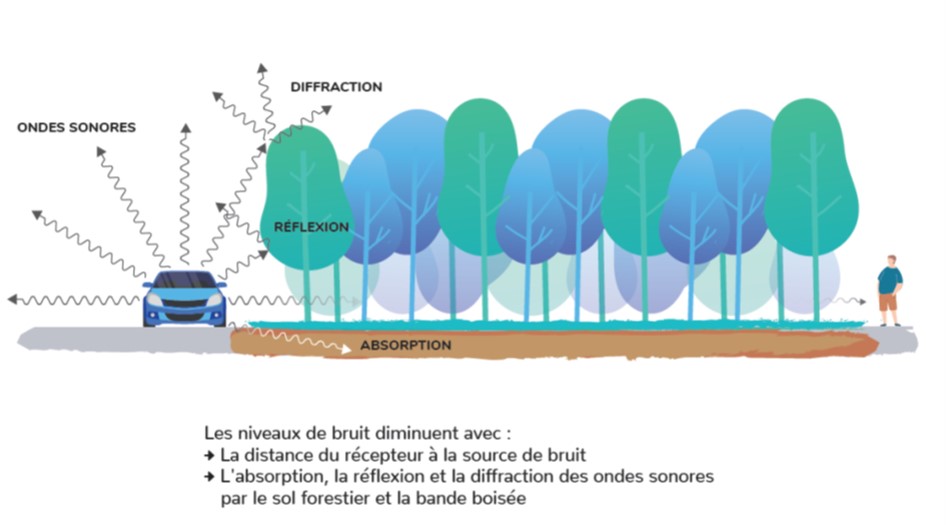
Pour que l’efficacité acoustique d’une bande boisée soit maximale durant toute l’année, il est préférable de planter des arbres à feuillage persistant. Ce type d’aménagement, nécessitant une emprise importante au sol, est cependant rarement applicable en milieu urbain dense.
Dans une rue arborée, l’effet diffère fortement selon la position de la personne exposée au bruit (« récepteur ») par rapport à la source sonore et à la configuration spatiale (présence d’éventuels obstacles, phénomènes de réverbération, etc.). Lorsque ce récepteur est situé sous le couvert des arbres, les nuisances sonores qu’il subit sont légèrement supérieures suite à la réflexion des bruits émis par le trafic sur les troncs et branchages. Au niveau des étages, l’impact peut s’avérer par contre positif lorsque la masse de la couronne des arbres permet de bloquer une partie du bruit. Cette configuration peut aussi avoir un léger effet positif pour les récepteurs situés dans des rues voisines.
L’influence des haies et arbustes
De manière générale, compte tenu de leur contenu en bois plus faible, les arbustes ont un effet limité sur la propagation du bruit routier comparativement à des arbres. Une haie continue, épaisse et dense, peut toutefois engendrer une légère diminution sonore (entre 1 et 3 dBA) pour l’usager situé derrière l’aménagement végétal (Defrance et al. 2019). Cette atténuation résulte cependant en partie de la présence de végétation herbacéeQui a la consistance souple et tendre de l'herbe (opposé à ligneux ou à scarieux). et de terre au pied des buissons.
L’influence des toitures et façades végétalisées
L’impact d’une toiture végétalisée est très variable selon les substrats accueillant les plantes qui, selon leur porosité, absorbent plus ou moins significativement les ondes sonores. Il dépend également de la forme du toit. Pour qu'une toiture verte soit utile, elle doit interagir avec une part significative des ondes sonores.
De ce fait, une toiture verte sera généralement plus utile dans une configuration type « rue canyon » que dans des rues avec des maisons 4 façades.
Les rues canyons
Une rue canyon est une rue dont les bâtiments se succèdent de manière (quasi) ininterrompue et qui sont étroites et/ou dont les bâtiments sont élevés.
Dans ce dernier cas, le bâtiment lui-même fait écran vis-à-vis des ondes sonores et le bruit se propage principalement autour du bâtiment. Dans une rue type canyon, en raison des nombreuses réflexions et diffraction des ondes sonores sur les façades et dans la partie haute des bâtiments, des niveaux relativement élevés seront encore perçus à l'arrière des maisons. Une toiture végétalisée pourra dans ce genre de contexte urbain et sous certaines conditions, en fonction notamment de la distance source-récepteur et des interactions ondes/toitures, atténuer le bruit en façade et à l’arrière des maisons. De même, en empêchant la réflexion du son entre les façades côté rue, les façades végétalisées peuvent s’avérer efficaces pour réduire significativement le bruit dans les rues canyons et à l’arrière des bâtiments. C’est surtout le cas si les végétaux sont en pleine terre ou installés sur un substratCouche de terre pour les plantes couvrant toute la façade. La mise en place de ce type de solutions sur des bâtiments existants peut cependant s’avérer compliquée et poser la question de l’approvisionnement en eau.
Exposition différenciée des façades au bruit de la circulation selon la direction du vent
Source : VITO et WITTEVEEN+BOS 2020 sur base de Depauw et al. 2018
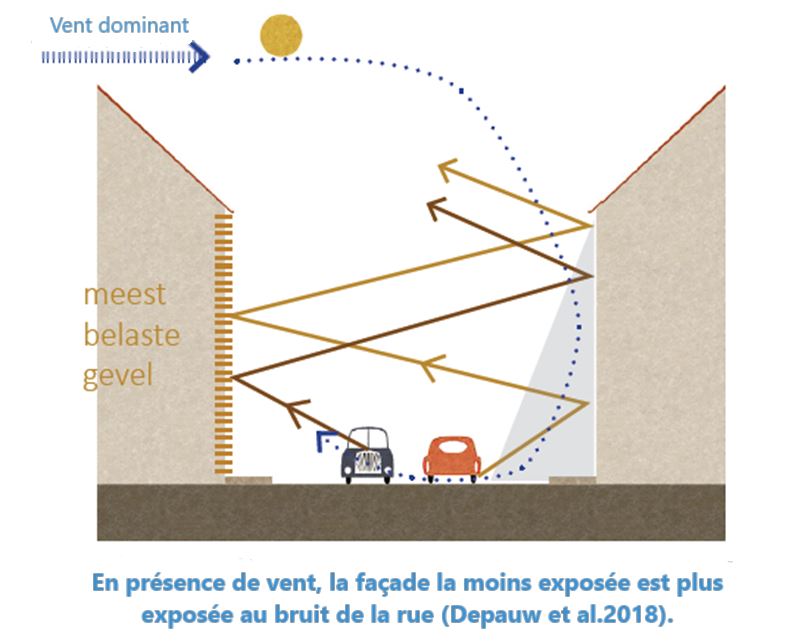
Dans une rue canyon, en raison des mécanismes physiques de déviation des ondes sonores par le vent, les façades sous le vent sont plus exposées aux bruits émis par le trafic. De manière générale, il est donc préférable d’installer des aménagements type écran acoustique végétalisé de ce côté de la voirie.
Les buttes de terre végétalisées sont efficaces pour absorber le bruit routier
Les merlons (ou buttes de terre) constituent des surfaces relativement absorbantes et ce, d’autant plus s’ils sont végétalisés, voire bordés d’arbres et d’arbustes (la hauteur de ceux-ci doit toutefois être inférieure à la partie haute du dispositif selon Defrance et al. 2019). Selon l’ADEME (2017), pour que ces buttes soient aussi efficaces qu’un écran acoustique, elles doivent en général être légèrement plus hautes. Elles nécessitent en outre une emprise au sol importante pour leur implantation.
L’application de solutions fondées sur la nature de grande ampleur pourrait réduire localement les niveaux de bruit de maximum 5 décibels pour les cas étudiés
Afin d’estimer, en première approche, le potentiel théorique de solutions fondées sur la nature pour réduire localement l’exposition des usagers de l’espace public à la pollution de l’air et aux nuisances sonores ainsi qu’aux chaleurs excessives, 4 zones bruxelloises représentatives de différentes configurations spatiales ont été étudiées.
Pour chacun de ces cas, un scénario minimaliste (mesures de végétalisation compatibles avec une conservation des infrastructures de mobilité existantes) ainsi qu’un scénario maximaliste (mesures de végétalisation impliquant une emprise spatiale significative et des modifications possibles des infrastructures routières) ont été étudiés.
Principales solutions fondées sur la nature envisagées pour réduire localement l’exposition des usagers de l’espace public aux nuisances sonores
Source : VITO et WITTEVEEN+BOS 2020
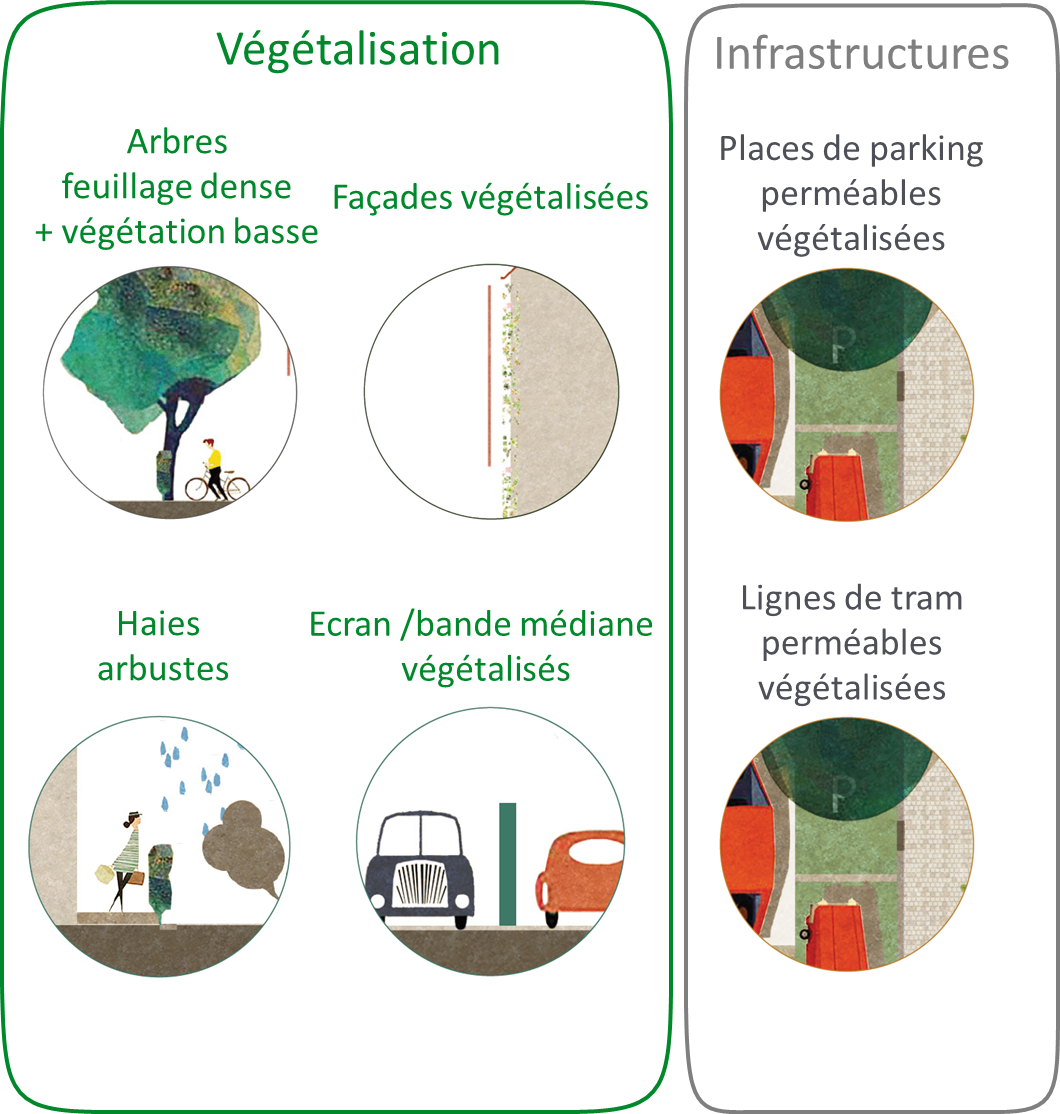
En ce qui concerne les 4 cas étudiés, le gain acoustique maximal qui a pu être obtenu à l’échelle micro-locale à partir de solutions fondées sur la nature a été estimé à environ 5 décibels A (sur base de l’indicateur Lden), avec néanmoins des variations importantes selon la position de l’usager dans l’espace public. Dans ce cas précis, la diminution locale maximale des niveaux de bruit résulte essentiellement de l’implantation d’un écran végétalisé autour de la bouche d’un tunnel accompagnée de la combinaison de végétation haute et basse et d’un accroissement de la distance entre les usagers de l’espace public et le trafic.
Indicateur Lden
Le Lden (Level day-evening-night) i décrit le niveau sonore équivalent moyen pondéré pendant 24h, observé sur une année complète avec la prise en compte d’une correction pénalisante de 5 dB(A) pour le soir (de 19h à 23h) et de 10 dB(A) pour la nuit (de 23h à 7h), les bruits générés pendant ces moments de la journée étant ressentis comme plus gênants.
A titre indicatif, une baisse des niveaux sonores de 5 dB correspond grosso modo à une réduction par trois d’un trafic dense dans une rue à 2 bandes. Même si les réductions peuvent être importantes, elles sont toutefois généralement insuffisantes pour diminuer les nuisances sonores en-dessous des valeurs-seuils à partir desquelles des problèmes de santé peuvent apparaître.
Dans la plupart des cas, pour obtenir un effet comparable à celui obtenu avec des mesures importantes de réduction du bruit à la source, le mieux est de combiner des mesures de végétalisation avec l’implantation d’infrastructures matérielles (par exemple, des murs antibruit végétalisés ou des bâtiments à fonction peu sensible - en termes de bruit - faisant écran aux ondes sonores).
En résumé
La présence de végétation peut, sous certaines conditions, contribuer à atténuer les niveaux de bruit en déviant et en absorbant les ondes sonores. Les effets sont cependant souvent d’ampleur limitée relativement à d’autres actions visant à réduire le bruit. Ils sont également très variables dans l’espace et dépendent de nombreux facteurs. Si l’impact de la végétation sur les niveaux de bruit mesurés est souvent réduit, la présence de nature a aussi un impact positif sur la perception de l’ambiance sonore du site.
Les arbres et les haies sont les dispositifs végétaux les plus efficaces pour interagir avec les ondes sonores et ce, d’autant plus qu’ils forment une bande large et dense en matériel ligneux (bois). En général, un effet maximal sera obtenu en combinant la présence de plantes herbacées, d’arbustes et d’arbres. Les ondes sonores sont aussi dispersées et absorbées par les sols naturels poreux qu’elles rencontrent. Les buttes de terres végétalisées ou la végétalisation de voies de tram peuvent constituer des solutions basées sur la nature efficaces pour réduire les nuisances sonores.
À télécharger
Fiche(s) documentée(s)
Thématique sol
Fiche(s) de l'Etat de l'Environnement
- Focus : Végétaliser pour réduire localement l’exposition à la pollution de l’air : des solutions fondées sur la nature, 2021
- Focus : Végétaliser pour refroidir les espaces urbains : des solutions fondées sur la nature, 2021
Etudes et rapports
- ADEME 2018. « Aménager avec la nature en ville - Des idées préconçues à la caractérisation des effets environnementaux, sanitaires et économiques », 100 pp. (.pdf)
- BRUXELLES ENVIRONNEMENT & BRUXELLES MOBIITE 2017. « Vademecum du bruit routier urbain - Les écrans antibruit et les revêtements de parois acoustiquement absorbants »
- DEFRANCE J., JEAN Ph., BARRIERE N. 2019. « Les arbres et les forêts peuvent-ils contribuer à l’amélioration de l’environnement sonore ? » in Santé publique, 2019/ HS S1, p. 187-195 (.pdf)
- UNALAB 2019."Nature Based Solutions - Technical Handbook (part II)", 114 pp. (.pdf)
- VITO et WITTEVEEN+BOS (LAUWAET D., VRANCKX S., DENS S., HAWER T.) 2020. « Impact van nature-based solutions op de blootstelling van stadsbewoners aan luchtvervuiling, lawaai of hoge temperaturen - Overzicht van de algemene kennis en aanbevelingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, rapport final, 98 pp.(.pdf) (en néerlandais uniquement, résumé en français)
Plans et programmes