Espaces verts et biodiversité : état des lieux
- Espaces verts
- Biodiversité
- État des lieux de l'environnement
- Étude
Sommaire
-
Les espaces verts gérés par Bruxelles Environnement
-
Espaces verts : accessibilité au public
-
Sites semi-naturels et espaces verts protégés
-
La carte d’évaluation biologique de la Région bruxelloise
-
La couverture végétale en Région bruxelloise
-
Fragmentation des habitats naturels
-
Le maillage vert
-
Surveillance des espèces
-
Evolution de l'avifaune
-
Etat local de conservation des espèces couvertes par les directives "Habitats" et "Oiseaux"
-
Le lucane cerf-volant, une espèce européenne protégée
-
Les Mammifères en Région bruxelloise
-
Evolution des populations de chauves-souris en Région bruxelloise
-
Les Amphibiens et Reptiles en Région bruxelloise
-
Les abeilles en Région bruxelloise
-
Libellules et demoiselles en Région bruxelloise
-
Biodiversité : les papillons de jour
-
Le chevreuil en Région bruxelloise
-
Champignons et lichens
-
Espèces exotiques envahissantes
-
Surveillance des habitats naturels en Région bruxelloise
-
Habitats naturels dans les espaces verts bruxellois
-
Etat sanitaire des hêtres et chênes en forêt de Soignes
-
Patrimoine forestier de la forêt de Soignes bruxelloise
-
Prélèvements de bois en forêt de Soignes bruxelloise
-
Changement climatique et croissance du hêtre en forêt de Soignes
-
Forêt de soignes et risques associés au changement climatique
-
Miellées, origine botanique et qualité du miel
-
Poursuivre la lecture
La nature en ville remplit de nombreuses fonctions écologiques : support à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., régulation du cycle hydrologique et du microclimat (infiltration des eaux pluviales, évaporation et évapo-transpiration), captage du dioxyde de carbone, filtration de certains polluants, … A l’échelle de la ville, ces fonctions contribuent notamment à la recharge des nappes phréatiques, à la limitation des inondations et de la pollution des cours d’eau (moindre surverse des déversoirs) ou encore, au rafraîchissement de l’air. Les espaces verts urbains remplissent également d’autres fonctions importantes notamment récréatives, sociales, paysagères, patrimoniales ou encore, urbanistiques. Une fonction de production peut également être plus ou moins développée (potagers, maraîchage, bois).
La préservation et le développement d’espaces verts en milieu urbain participent dès lors, dans une large mesure, à la qualité de vie et à la santé des citadins ainsi qu’à la résilience des villes notamment vis-à-vis des changements climatiques attendus.
Ces espaces sont cependant soumis à de nombreuses pressions et ne bénéficient pas toujours de protection ni de gestion adéquates.
Depuis une vingtaine d’années, les actions développées au niveau de l’aménagement ou de la rénovation des espaces verts régionaux s’inscrivent dans le cadre général du programme de maillage vertProgramme fondé sur la protection et la création des espaces verts et l'établissement de liens physiques entre eux, qui vise, outre la préservation du patrimoine naturel et l'accroissement de la biodiversité, à rééquilibrer les disparités régionales au niveau de la verdurisation et de la répartition des espaces verts publics, à améliorer les qualités paysagères et à promouvoir la mobilité douce., concept intégrateur combinant des objectifs socio-récréatifs, environnementaux et paysagers.
Face à la forte croissance démographique, l’un des enjeux majeurs de la Région est de préserver l’offre en espaces verts accessibles par habitant et d’améliorer leur répartition en aménageant prioritairement de nouveaux parcs dans les quartiers denses et peu verdurisés du pentagone et de la première couronne. La constitution de corridors verts reliant entre eux les espaces verts permet aussi d’accroître la présence de nature dans la ville et de renforcer la résilience des écosystèmes.
Outre l’extension, sous diverses formes, des espaces verts et leur protection, notamment via des outils juridiques, il importe également d’assurer une gestion de qualité permettant d’optimaliser la diversité des fonctions des espaces verts et de répondre tant que possible aux besoins des citadins. La flore, la faune et les habitats naturels font l’objet de programmes de surveillance et de suivi permettant de disposer de données indispensables à l’élaboration des politiques et mesures de gestion en matière de biodiversité.
Les espaces verts gérés par Bruxelles Environnement
Indicateur - Actualisation mars 2023
La division Espaces verts de Bruxelles Environnement est chargée de la gestion de 108 espaces verts couvrant une superficie de 502 ha (mars 2023). 1801 ha, constitués essentiellement de forêt, bois et réserves naturelles, sont par ailleurs gérés par la sous-division Forêt et Nature. Ces sites font chacun l’objet d’une gestion spécifique adaptée visant à maximiser leurs différentes fonctions. La Région s’attache également à améliorer l’offre quantitative en espaces verts, en particulier au niveau des quartiers denses, ainsi que leur connectivité.
Depuis janvier 2020, 8 espaces verts totalisant une superficie d’environ 17 ha (soit l’équivalent d’environ 24 terrains de football) ont été créés ou repris en gestion par la division Espaces verts.
Bruxelles Environnement, principal gestionnaire d’espaces verts publics
De l’ordre de 52% du territoire bruxellois est couvert par de la végétation (voir focus La couverture végétale en Région bruxelloise). Celle-ci est de nature très diverse : jardins et domaines privés, bois et forêt, parcs et jardins publics, terrains de sports et loisirs avec couverture végétale, espaces semi-naturels, friches, terrains agricoles, sites potagers, cimetières ou encore, espaces verts associés aux voiries (« dépendances vertes ») et lignes ferroviaires (arbres d’alignement, bermes et rond points engazonnés, accotements, talus, etc.).
Une part importante des espaces verts bruxellois est constituée d’espaces privés ou inaccessibles au public. Ils sont gérés par une grande variété d’acteurs (particuliers, propriétaires immobiliers, Infrabel, STIB, Donation royale, Régie des bâtiments, écoles et universités, maisons de retraite, hôpitaux, armée belge, fabriques d’église, …). A côté de ces espaces, les espaces verts accessibles au public jouent un rôle social fondamental en tant qu’espaces de détente, de jeux et de rencontre, participant de manière positive à la qualité de vie des Bruxellois.e.s.
Les espaces verts accessibles au public sont essentiellement gérés par des administrations et organismes d’intérêt public régionaux (Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité pour les espaces verts associées aux voiries régionales) ou par les communes (parc de Bruxelles, parc Josaphat, Bois de la Cambre par exemple, pour ne citer que les plus grands d’entre eux). Il existe toutefois des espaces verts, accessibles en tout ou en partie au public, gérés par des acteurs privés (par ex. espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. associé à l’ancien bâtiment d’Axa, à Watermael-Boitsfort). Certains sites sont gérés par des associations environnementales avec le soutien ponctuel de Bruxelles Environnement (Hof ter Musschen, site du Scheutbos, réserve naturelleZone constituée par un organisme public ou privé en vue de préserver un spécimen représentatif d'une communauté végétale et animale (biocénose) donnée, principalement dans un but d'ordre scientifique et éducatif. du Vogelzangbeek, domaine des Silex, etc.).
Le développement et la gestion d’espaces verts figurent parmi les missions de Bruxelles Environnement, principal gestionnaire public d’espaces verts au sein du territoire régional. Cette compétence est répartie entre la division Espaces verts (DEV) et la sous-division Forêt et Nature.
La sous-division Forêt et Nature gère la forêt de Soignes, les bois de Dieleghem et du Laerbeek (jusqu’il y a peu gérés par la DEV) et les bois périphériques associés situés à Uccle (bois de Verrewinkel, bois de la chapelle Hauwaert, bois du Buysdelle, bois de Percke, domaine de Latour de Frein) ainsi que les réserves naturelles et forestières (voir focus Sites semi-naturels et espaces verts protégés). Elle gère également quelques autres espaces importants en termes de biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., parfois en collaboration étroite avec des associations naturalistes ou des sociétés de logement. Les espaces verts gérés par la sous-division Forêt et Nature couvrent une superficie totale d’environ 1801 ha (en ne comptabilisant pas, dans la plupart des cas, les surfaces non gérées par la sous-division tels que les routes et bermes latérales des voiries traversant ou jouxtant ces surfaces ou les bâtiments).
La gestion (aménagement et entretien) de la promenade verteParcours paysager, destiné à la mobilité douce, reliant les espaces verts naturels et semi-naturels de seconde couronne. Elle permet de faire le tour complet de la Région sans quitter un itinéraire sécurisé et balisé. et d’espaces verts tels que parcs et jardins, squares, potagers collectifs régionaux, bois et autres espaces semi-naturels sont assurés par la division Espaces verts. Il s’agit d’espaces verts appartenant à la Région ou dont la gestion a été confiée à Bruxelles Environnement (via des conventions), notamment par des instances fédérales ou communales.
Le présent focus est consacré exclusivement aux espaces verts gérés par la division espaces verts. La gestion de la forêt de Soignes et des réserves naturelles et forestières est abordée dans d’autres focus (voir Sites semi-naturels et espaces verts protégés et Patrimoine forestier de la forêt de Soignes bruxelloise).
502 ha répartis au niveau d’une centaine d’espaces verts, de tailles et caractéristiques très variées, sont gérés par la division espaces verts
En mars 2023, la division Espaces verts gérait 108 espaces verts ou végétalisés de taille et de nature très variables. Ces espaces couvrent au total une superficie de 502 ha.
Exemples d’espaces verts gérés par Bruxelles Environnement (division Espaces verts)

Les plus grands espaces gérés par cette division sont : le parc de Woluwe (68 ha), le Kauwberg (36 ha), le parc Roi Baudouin (33 ha), le parc de Laeken (32 ha), le parc du Cinquantenaire (27 ha), le parc Duden (23 ha), le parc Bon Pasteur (15 ha) ainsi qu’une partie du site du Rouge-cloître (prairies, sites potagers, plaine de jeux…) (15 ha). Ces 8 parcs et bois, qui totalisent de l’ordre de 249 ha, représentent près de la moitié de la superficie des espaces gérés par la division Espaces verts. A l’inverse de ces grands parcs, Bruxelles Environnement gère également des petits espaces résiduels, davantage en lien avec des voiries, comme le Square Jean de Bologne (0,21 ha) et le Monument des Anglais (0,03 ha), ou avec des bâtiments, comme le Jardin du Conservatoire royal (0,05 ha).
Le tableau ci-dessous liste, par commune, les parcs et espaces verts gérés par la division Espaces verts et reprend leur superficie.
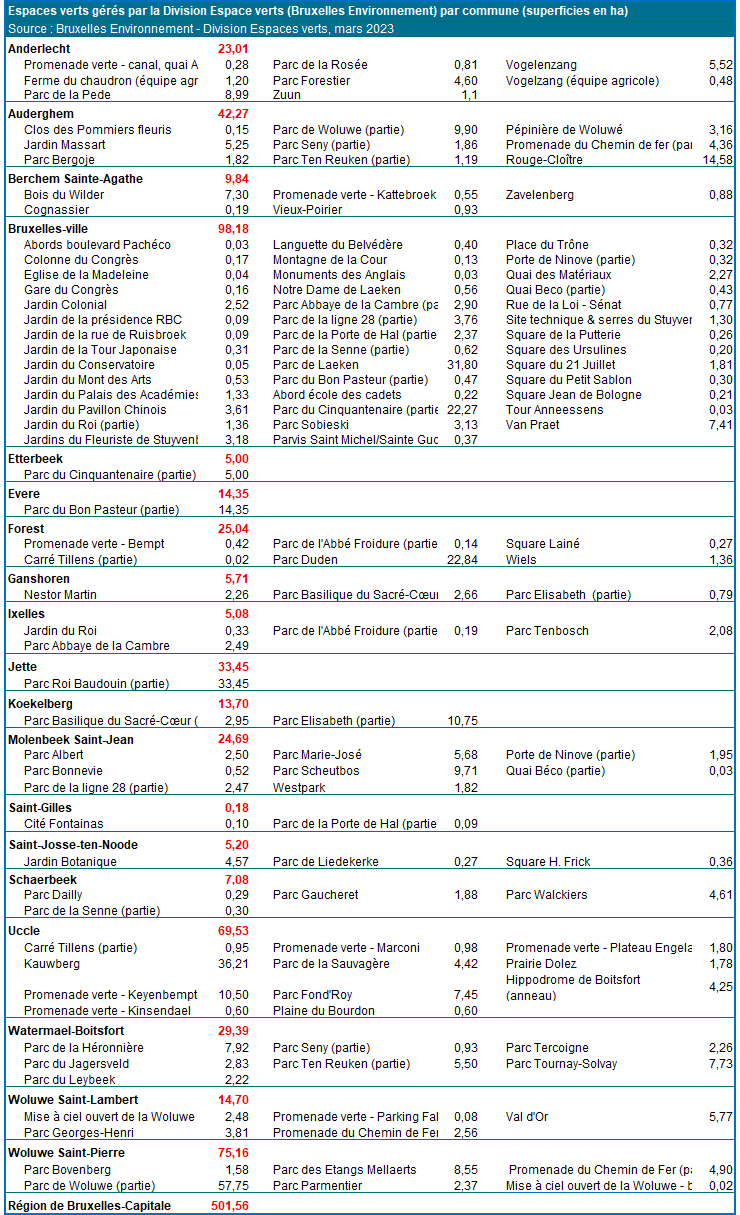
Lire le texte de transcription
Les superficies d’espaces verts gérées par la division Espaces verts de Bruxelles Environnement sont, par commune et pour l’ensemble de la Région :
Anderlecht ..............................23,01 ha
Auderghem ............................42,27 ha
Berchem Sainte-Agathe......... 9,84 ha
Bruxelles-ville .........................98,18 ha
Etterbeek .................................5,00 ha
Evere.......................................4,35 ha
Forest .....................................25,04 ha
Ganshoren .............................. 5,71 ha
Ixelle s......................................5,08 ha
Jette ........................................33,45 ha
Koekelberg.............................13,70 ha
Molenbeek Saint-Jean ...........24,69 ha
Saint-Gilles...............................0,18 ha
Saint-Josse-ten-Noode............5,20 ha
Schaerbeek..............................7,08 ha
Uccle........................................69,53 ha
Watermael-Boitsfort .................... 29,39 ha
Woluwe Saint-Lambert ................14,70 ha
Woluwe Saint-Pierre ....................75,16 ha
Région de Bruxelles-Capitale ... 501,56 ha
L’ensemble des espaces verts gérés par Bruxelles Environnement sont représentés dans la carte ci-jointe :
Carte des espaces verts gérés par Bruxelles Environnement
Source : Bruxelles Environnement, 2023
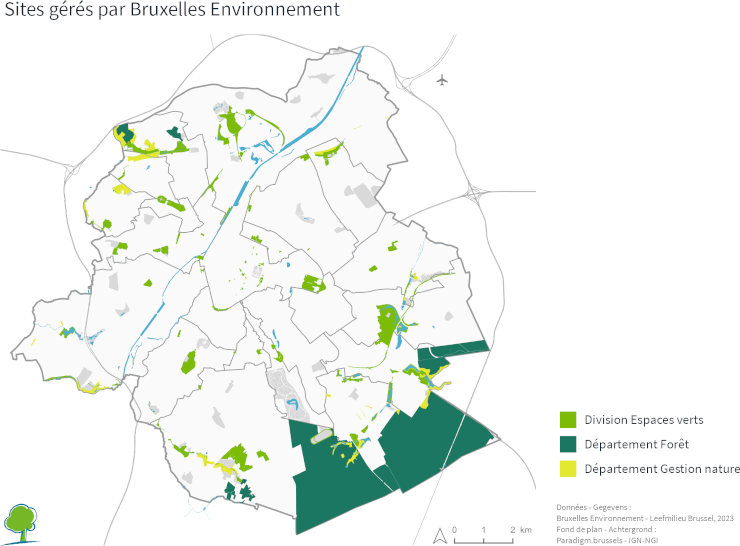
Ces données sont disponibles en ligne public via le portail cartographique Geodata de Bruxelles Environnement (carte Espaces verts en gestion par Bruxelles Environnement).
Bon à savoir
Depuis janvier 2020, 8 espaces verts supplémentaires, totalisant une superficie de près de 17 ha, sont gérés par la division Espaces verts. Ceux-ci correspondent soit à des espaces verts préexistants repris en gestion par Bruxelles Environnement (dont principalement l’anneau de l’hippodrome de Boitsfort, une petite partie du marais Wiels et l’espace attenant ainsi que le parc Walckiers), soit à des espaces verts nouvellement créés ou en cours de création (Pannenhuis, Westparc, Zuun). Deux de ces espaces ne sont pas encore ouverts au public.
L’estimation précise de l’évolution des superficies d’espaces verts gérées par la division Espaces verts au cours des décennies précédentes est sujette à caution compte tenu :
- de l’évolution technologique des outils de cartographie qui permettent actuellement des mesures de surface plus précises et une amélioration de la précision dans la délimitation des parcelles gérées ;
- des interprétations : par exemple, les superficies sont aujourd’hui calculées en excluant les superficies des bâtiments et certaines voiries présentes sur le site, ce qui n’a pas toujours été le cas.
La délimitation très précise des espaces verts gérés par Bruxelles Environnement est un processus encore en cours ce qui explique que les superficies de certains espaces verts ont été légèrement modifiées entre la première version du calcul de l’indicateur (janvier 2020) et les données actuellement présentées (mars 2023) sans que cela ne corresponde toujours à une réelle modification de superficie sur le terrain. A titre d’exemple, la révision (sur carte) de la délimitation de la surface du Rouge-Cloître gérée par la division Espaces verts s’est traduite par une réduction de superficie de près de 7 ha. Cette réduction correspond au fait que les étangs, qui sont gérés par la sous-division Forêt et Nature, ne sont maintenant plus comptabilisés dans les espaces verts gérés par la division Espaces verts.
Selon le Rapport sur l’état de l’environnement bruxellois 2003-2006, Bruxelles Environnement gérait environ 2177 ha d’espaces verts en 2003 (bois et forêt compris). En mars 2023, cette superficie s’élève à 2303 ha (espaces verts gérés par la division Espaces verts et espaces verts gérés par la sous-division Forêt et nature). Même si, rappelons-le, ces chiffres ne sont pas comparables entre eux, cette différence met néanmoins en évidence le fait que la superficie totale d’espaces verts gérés par Bruxelles Environnement a significativement augmenté au cours de ces 2 dernières décennies.
Une gestion écologique différenciée des espaces verts qui vise à optimaliser leurs fonctions sociales, écologiques, paysagères et urbanistiques
Les espaces verts urbains remplissent de multiples fonctions : détente et récréation, support à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., infiltration des eaux pluviales, embellissement du paysage, espaces de rencontre, connexion urbanistique (mobilité douceMobilité faisant appel aux modes de déplacement non motorisés, principalement le vélo et la marche.), culture et tourisme, éducation à la nature, etc. Les différentes fonctions sont plus ou moins développées au sein de ces espaces, selon leur taille, leur typologie (parc paysagerSouvent de grande superficie, ce parc remplit diverses fonctions récréatives et paysagères., parc historique ou horticole, espace récréatif, etc.), leur valeur biologique ou encore leur emplacement dans le tissu urbain (caractéristiques sociodémographiques du quartier, présence d’autres espaces verts à proximité, etc.).
Selon les contraintes des espaces verts gérés et aménagés, Bruxelles Environnement s’attache à répondre tant que possible aux besoins des citadins en maximisant et en faisant cohabiter au mieux les fonctions sociales, écologiques et urbanistiques de ces sites.
La gestion différenciée est une manière de relever ce défi. Celle-ci est de plus en plus pratiquée au niveau des espaces verts : il s’agit, par une appréciation fine des sites, de l’usage qui en est fait et des contraintes qui s’y rattachent, d’appliquer des modes de gestion spécifiquement adaptés aux différentes zones. A titre d’exemple, une pelouse peut être divisée en deux parties, la plus robuste dévolue à la récréation (jeux de ballon, ...) et la plus fragile, à la protection du biotopeAire géographique de dimensions variables, souvent très petites, offrant des conditions constantes ou cycliques aux espèces constituant la biocénose.. Cette technique permet d’accroître la gamme des fonctions d’un site et donc sa richesse. Bruxelles Environnement privilégie également souvent la participation des habitants et des utilisateurs de parcs et jardins tant lors de leur conception, de leur rénovation que tout au long de leur entretien.
Selon les caractéristiques des espaces verts et les modes de gestion qui y sont appliqués, l’entretien est réalisé soit en régie, par les jardiniers de Bruxelles Environnement (par exemple, pour des tâches requérant une expertise et un savoir-faire particulier au sein d’un parc historique), soit confié à des entreprises prestataires externes. Dans ce dernier cas, la qualité d’exécution est assurée via l’imposition de clauses techniques très précises au niveau des cahiers des charges et par un contrôle journalier des activités réalisées.
Les gardiens de parcs assurent un rôle d’accueil et de prévention
Des gardiens de parcs assurent une présence ou un passage dans les différents espaces verts. Au-delà d’une fonction d’accueil et de surveillance, leur rôle s’est enrichi progressivement de missions d’animation, voire de médiation, d’information et de sensibilisation du public aux valeurs portées par Bruxelles Environnement. Lorsque le contexte s’y prête, que des attentes particulières s’expriment, des gardiens peuvent assurer un rôle d’animateurs, en développant une approche spécifique davantage orientée sur le déploiement d’activités et d’interactions contribuant à favoriser la cohésion sociale entre usagers. En travaillant en étroite collaboration avec les associations de proximité, les gardiens animateurs répertorient les besoins et les souhaits des usagers et leur proposent des animations en adéquation avec ceux-ci.
Les arbres des parcs régionaux font l’objet d’un suivi phytosanitaire
Une équipe de la division Espaces verts est chargée du suivi sanitaire des arbres localisés dans les parcs gérés par Bruxelles Environnement. Ce suivi se traduit entre autres par une évaluation visuelle périodique (tous les 3 à 5 ans) de l’état de santé de près de 45.000 arbres répartis dans 55 parcs et sites semi-naturels. Chaque arbre dont la circonférence est supérieure à 40 cm à 1,5 m de hauteur est décrit en termes de localisation, d’espèce, de dimensions, d’environnement et d’état sanitaire (p.ex. blessures, présence d’insectes ou de maladies). Ces relevés permettent d’évaluer périodiquement les risques pour le public et les infrastructures et de programmer les interventions nécessaires (soins aux arbres, élagage, abattage, …) à court et moyen termes. Diverses expertises complémentaires peuvent être entreprises afin d’affiner le diagnostic.
Pour en savoir plus concernant les expertises complémentaires
Les expertises complémentaires réalisées sont notamment
- le test de traction : une simulation d’une charge de vent est exercée sur un arbre à l’aide d’un câble ce qui permet d’évaluer la résistance à la rupture et la résistance d’ancrage ;
- la tomographie : des ondes sonores sont induites dans une ou plusieurs sections du tronc et la vitesse de leur transmission, mesurée par des capteurs, permet d’évaluer l’état sanitaire du bois (dont la présence de cavités ou de pourritures) ;
- le résistographe : une fine mèche introduite dans un tronc permet de mesurer la résistance que celle-ci rencontre lors du percement du bois.
Extrait de la carte interactive des arbres localisés dans les parcs régionaux (essence, hauteur, circonférence du tronc et diamètre de la couronne)
Source : Bruxelles Environnement 2023 (portail Géodata)
Les données « Arbres » recueillies sont centralisées dans une base de données. Les données de localisation, d’espèces et de dimension des arbres sont accessibles au public via le portail cartographique Geodata de Bruxelles Environnement (carte Arbres dans les parcs régionaux).
De nouveaux espaces verts sont créés par Bruxelles Environnement
Si plus de la moitié de la superficie régionale correspond à des espaces végétalisés, il n’en reste pas moins que de nombreux quartiers connaissent un déficit en espaces verts publics. C’est particulièrement le cas dans des quartiers densément bâtis, notamment dans le pentagone et en première couronne ainsi que le long du canal (pour de plus amples informations sur les disparités en espaces verts, voir les focus sur l’accessibilité des espaces verts au public et sur la couverture végétale). Par ailleurs, on estime qu’environ deux tiers des Bruxellois n’ont pas accès à un jardin privatif (Dedicated 2020).
Lors de la crise sanitaire de la COVID19, la sur fréquentation de certains parcs a mis en évidence de façon criante le manque d’offre en espaces verts de certains quartiers et la nécessité pour les Bruxellois de disposer de zones de quiétude permettant la pratique d’activités sportives et de détente (voir Rapport d’activité 2020, Bruxelles Environnement). Cette forte augmentation de l’affluence dans les parcs reste toujours importante lors de la belle saison et nécessite un renforcement saisonnier des équipes de gardiens et une attention accrue de la part des jardiniers pour assurer l’entretien des espaces les plus fréquentés.
L’amélioration de l’offre en espaces verts de proximité, en particulier dans le pentagone et dans la première couronne, constitue l’un des principaux objectifs du plan régional Nature et a été confirmé dans le plan régional de développement durableMode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Il s'agit donc d une démarche qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement, et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine.. La constitution de corridors verts reliant entre eux les espaces verts permet aussi d’accroître la présence de nature dans la ville et de renforcer la résilience des écosystèmes (voir focus Maillage vert).
La partie nord du parc Ligne 28, réalisée grâce à une étroite collaboration entre Bruxelles Environnement et la Ville de Bruxelles et ouverte en avril 2021, figure parmi les réalisations majeures les plus récentes dans les quartiers centraux. Cette portion de parc linéaire était le chaînon manquant permettant de relier la place Bockstael (Laeken) à l’avenue du Port en passant par le site et parc de Tour et Taxis et d’autres espaces verts adjacents récemment créés. Cette jonction a permis la création d’un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. continu d’environ 13 ha. Ce parc est un bel exemple de multifonctionnalité puisqu’il combine support à la mobilité douceMobilité faisant appel aux modes de déplacement non motorisés, principalement le vélo et la marche., mise en valeur du patrimoine naturel (zone humide entre autres) et historique (ancienne voie ferroviaire désaffectée), préservation de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). (maintien d’espaces en fricheZone de terrain laissée à l'abandon et progressivement colonisée par la végétation spontanée.) ou encore, aires de jeux, de sport et de pique-nique.
Toujours en ville dense, sur la commune de Molenbeek, un parc temporaire et évolutif de près de 2 ha s’est également ouvert au public fin 2022 sur une partie de l’ancienne friche de la gare de l’ouest. L’aménagement définitif de ce parc est prévu pour 2026.
En périphérie, l’espace vert du Kattebroek (Berchem-Sainte-Agathe), attenant à la promenade verteParcours paysager, destiné à la mobilité douce, reliant les espaces verts naturels et semi-naturels de seconde couronne. Elle permet de faire le tour complet de la Région sans quitter un itinéraire sécurisé et balisé. et géré par la sous-division Forêt et Nature, a été réouvert au public en octobre 2022 après plusieurs dizaines d’années de fermeture.
Au cours de ces dernières années, on peut également citer la création des différentes phases du parc de la Senne et du parc de la Porte de Ninove dans des quartiers fortement urbanisés ou encore, l’aménagement de tronçons de la promenade verte et d’espaces verts liés (plateau Engeland, Zavelenberg, Marconi, prairie Dolez, Vogelzang…).
Outre la création d’espaces verts, de nombreux projets de restaurations - parfois très conséquents - sont mis en œuvre (plaines de jeux telles que récemment au Scheutbos, au Jardin Botanique ou encore au Rouge-Cloître, chemins, équipements, …) pour assurer la pérennité des espaces verts existants ou en améliorer la qualité.
La reprise en gestion d’espaces verts communaux par la division Espaces verts
Les communes ne disposant pas toujours des moyens humains et budgétaires nécessaires, une politique de reprise en gestion de parcs communaux par Bruxelles Environnement a été initiée depuis quelques années.
La Région s’est ainsi vu confier en 2017 la gestion de 4 parcs communaux (parcs de la Ligne 28, Marie-José, Albert et Forestier) et 4 autres parcs ont été repris en gestion en 2018 (Val d’Or, parcs Tercoigne, Sauvagère et Bon Pasteur). Deux tronçons de la promenade verte ont également fait l’objet d’une acquisition en 2018 (Canal et Nestor Martin). Plus récemment, la gestion de la totalité ou d’une partie des sites du Kauwberg, du Walckiers, de l’hippodrome de Boitsfort et du Wiels a aussi été confiée à Bruxelles Environnement.
Cette reprise en gestion de parcs par la Région permettra à terme d’améliorer la cohérence de leurs aménagements et de réaliser des économies d’échelle (achat de plants, matériel, paysagistes et personnel de terrain). Elle facilite par ailleurs la réalisation de projets d’envergure régionale tels que la promenade verte, les maillages vert et bleu, le maillage jeu ou le développement des activités sportives dans les parcs. Pour les espaces verts situés en zones sensibles, elle permet d’y développer un gardiennage adapté aux réalités sociales locales.
Une gestion qualitative et écologique pour l’ensemble des espaces verts bruxellois
Cette approche doit progressivement s’étendre à l’ensemble des espaces verts gérés par les communes et autres aménageurs et gestionnaires d’espaces verts.
Pour ce faire, divers outils sont mis en place : séminaires de formation, guides de bonne pratiques en gestion écologique et paysagère, production de fiches thématiques, possibilité de faire appel à un « facilitateur nature », appels à projets et subsides, mise à disposition d’un outil d’évaluation du potentiel de développement de la biodiversité d’un site pour les architectes et urbanistes, etc.
Des conventions de partenariats portant sur une gestion favorable à la biodiversité et à l’agriculture urbaine ont également été signées ou sont en cours de signature entre Bruxelles Environnement et des partenaires publics disposant d’espaces verts au sens large (Bruxelles Mobilité, SLRB, Citydev, Infrabel, Port de Bruxelles).
Depuis 2017, la division Espaces verts participe, en partenariat avec d’autres institutions, aux réflexions sur les grands enjeux urbanistiques de la Région. Au-delà de ces réflexions, ce partenariat débouche sur une prise en charge active des réalisations (aménagements de nouveaux espaces verts, établissement de liaisons et connexions vertes) ainsi qu’à terme, sur la reprise en gestion des nouveaux espaces verts en projet ou encore à créer.
La division Espace verts est également indirectement impliquée dans la gestion de moyens considérables affectés à l’aménagement ou à la requalification d’espaces verts bruxellois dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération Beliris qui, pour rappel, vise à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.
Développer une production alimentaire qualitative et respectueuse des ressources
La Région bruxelloise place l’alimentation comme pilier de sa politique de développement, pour sa fonction nourricière autant que culturelle, sociale et d’intérêt pour la santé. Comme la stratégie originale, la seconde stratégie Good Food adoptée en 2022 fixe des objectifs et des mesures pour que chaque Bruxellois ait accès à une alimentation saine et durable, produite localement.
La déclaration de politique régionale 2019-2024 a confirmé cette ambition et l’a étendue à l’élaboration d’une politique agroécologique à part entière (voir focus Good food sur les potagers collectifs et familiaux et sur l’agriculture urbaine professionnelle). Un service « Agriculture urbaine » a été récemment créé au sein de la division Espaces verts. Il a pour mission de faciliter la réalisation de projets d’agriculture urbaine, tant citoyens que professionnels, qui poursuivent des fonctions nourricières, environnementales, paysagères et sociales (notamment inclusion et pédagogie).
À télécharger
Fiche méthodologique
Tableaux reprenant les données
Fiches documentées
Thème « L’occupation des sols et les paysages bruxellois »
- n°14. Espaces semi-naturels et espaces verts bénéficiant d’un statut de protection (.pdf)
- n°6. Le Maillage Vert (.pdf)
- n°4. Aménagement et gestion d’espaces verts publics par l’IBGE de 1993 à 2001 (.pdf)
Thème « Alimentation durable et agriculture urbaine »
- n°1. Les potagers urbains (.pdf)
- n°2. Good food : Agriculture professionnelle en Région bruxelloise (.pdf)
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Sites semi-naturels et espaces verts protégés (2021)
- Focus : Good food : Agriculture professionnelle en Région bruxelloise (2020)
- Focus : Sport et espaces verts en Région bruxelloise (2021)
- Focus : Le maillage vert (édition 2015-2016)
- Focus : Le maillage jeux (édition 2015-2016)
- Focus : Espaces verts : accessibilité au public (mai 2022)
- Focus : Quels ont été les effets du premier confinement COVID-19 sur l'environnement ?
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Carte « Végétation 2021 – Répartition de la végétation haute et basse en septembre 2021 »
- Carte « Espaces verts accessibles au public »
- Carte « Appréciation de l’offre en espaces verts (2001) »
- Carte « Promenade verte »
- Carte « Potagers de Bruxelles environnement »
- Carte « Zones de carence en espaces verts ouverts au public »
- Carte « Fragmentation des espaces verts » (2008)
Etudes et rapports
- Etude pour un redéploiement des aires ludiques et sportives en Région de Bruxelles-Capitale (.pdf)
- Développement d'une stratégie globale de redéploiement du sport dans les espaces verts en Région de Bruxelles Capitale
Phase 1 (.pdf) - Phase 2 (.pdf) - Phase 3 (.pdf) - Développement d’une stratégie globale de redéploiement du sport dans les espaces verts bruxellois - Synthèse des recommandations de l’étude (.pdf)
- Dedicated 2020. “Etude sur les opinions et les comportements des Bruxellois pour la résilience de leur ville dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19” (.pdf)
Plans et programmes
- Plan régional nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale (.pdf)
- Stratégie Good Food « « Vers un système alimentaire plus durable en Région de Bruxelles-Capitale »
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre I - Etat des connaissances, 2019 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre II - Objectifs et mesures de gestion, 2019 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre III - Plans de gestion des réserves archéologiques, naturelles et forestières, 2019 (.pdf)
Espaces verts : accessibilité au public
Focus – Actualisation : décembre 2023
78% des Bruxellois disposent d’un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. public à proximité de chez eux. Ces espaces verts sont cependant de nature, de taille et de qualité très variables. Parmi les Bruxellois vivant dans des zones carencées en espaces verts, près de 158.000 habitent dans des quartiers peu végétalisés (moins de 30% de couverture végétale).
Pourquoi cartographier les espaces verts accessibles ?
La moitié de la surface du territoire régional est couverte par de la végétation. Celle-ci est de nature diverse : parcs, bois, forêts, friches, éléments végétalisés associés aux espaces publics et à la voirie (pelouses, arbres, parterres), champs, prairies, toitures végétalisées, jardins privatifs ou encore, grands domaines privés.
S'ils ont tous une importance capitale pour la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). et la résilience régionale, seuls les espaces verts accessibles pour le public jouent un rôle social important en termes de qualité de vie et de santé publique, notamment en tant qu'espaces de détente, de jeux et de rencontre. Ce rôle s’avère particulièrement important à l’échelle d’une ville telle que Bruxelles où environ 2/3 des habitants n’ont pas accès à un jardin privé (Dedicated 2020). Pour plus d’informations, voir fiche documentée consacrée à l’apport de la nature à la santé des Bruxellois et Bruxelloises.
L’objectif du Gouvernement, affirmé tant dans le premier plan Nature que dans le Plan Régional de Développement DurableMode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Il s'agit donc d une démarche qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement, et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine., est que chaque Bruxellois dispose d’un espace vert accessible et accueillant de plus de 1 hectare à moins de 400 m de son habitation ou de moins de 1 hectare à moins de 200 m.
Plus généralement, la politique régionale en matière d’espaces verts vise à augmenter la végétalisation de la ville, en particulier dans ses zones les plus denses en termes de bâti et de population.
Extrait de la carte des espaces verts publics sur fond de photographie aérienne (janvier 2024)
Source Geodata - Bruxelles Environnement (2024), disponible en ligne

La cartographie des espaces verts accessibles au public permet d’identifier les zones de la Région bruxelloise où l’on observe une offre insuffisante de ces espaces. Les zones de carences mettent en lumière les espaces où les aménagements d’espaces verts et les dynamiques de végétalisation sont prioritaires. L’information relative aux espaces verts accessibles au public est vouée à toucher des publics et utilisateurs très larges : instances régionales pour la gestion et le développement de stratégies territoriales à large échelle, communes pour la mise en œuvre de stratégies plus locales et variées, citoyens pour la connaissance de leurs territoires et leur qualité de vie, voire pour développer des projets locaux.
Depuis la création de Bruxelles Environnement, plusieurs cartes des espaces verts accessibles ont été réalisées
Un premier inventaire géoréférencé (cartographie informatisée) des espaces verts bruxellois a été réalisé en 1997 en soutien à l’élaboration du programme de Maillage vertProgramme fondé sur la protection et la création des espaces verts et l'établissement de liens physiques entre eux, qui vise, outre la préservation du patrimoine naturel et l'accroissement de la biodiversité, à rééquilibrer les disparités régionales au niveau de la verdurisation et de la répartition des espaces verts publics, à améliorer les qualités paysagères et à promouvoir la mobilité douce. (IGEAT-ULB 1997). La typologie utilisée ne permettait cependant pas de distinguer da façon exhaustive les espaces verts accessibles au public.
En 2009, une nouvelle étude étude visant à élaborer un inventaire géoréférencé des espaces verts et récréatifs accessibles au public a été menée (BRAT 2009). Jusqu’en 2020, cet inventaire n’a été mis à jour que partiellement, essentiellement pour les espaces verts gérés par Bruxelles Environnement.
En 2020, le BRAT, en association avec Nordend, a été chargé de mettre à jour, compléter et réorganiser l’inventaire et la base de données géoréférencées des espaces verts accessibles afin que celle-ci réponde aux besoins des différents utilisateurs. La mission inclut également l’élaboration d’une méthode reproductible permettant une mise à jour régulière de la base de données via les informations transmises par les gestionnaires des espaces verts. Cette base de données est actuellement mise à jour en continu.
Quels espaces verts sont cartographiés ?
La notion d’espaces verts accessibles au public ne fait pas l’objet d’une définition univoque et varie selon les objectifs poursuivis et le contexte des politiques urbaines. C’est pourquoi, la première phase du projet lancé en 2020 a été consacrée à définir les espaces verts à prendre en compte dans le cadre de cet inventaire, les différentes catégories ainsi que les critères à appliquer. L’élaboration de ce cadre s’est appuyée sur ce qui a été fait ailleurs ainsi que sur les résultats d’ateliers de réflexion et d’échanges réunissant divers acteurs communaux et régionaux appelés à utiliser la base de données.
L’approche s’est voulue la plus large possible afin de retenir l’ensemble des espaces accessibles au public et participant à la qualité de vie et au caractère vert de la Région, quelles que soient leur taille ou leur nature.
Au terme de ce processus, les critères suivants ont été retenus pour définir les espaces verts et les espaces végétalisés accessibles pris en compte:
- Végétalisation: > 10% de couverture végétale
< 30% de pleine terre ou autre revêtement naturel à espaces publics végétalisés
Il s’agit des places, placettes, élargissement de trottoirs… Ces espaces sont majoritairement minéralisés mais comportent des plantations assurant leur caractère « vert ». Ils offrent des fonctions d’accueil du public et, en tant qu’espace de respiration, assurent une fonction sociale et écologique importante à l’échelle des quartiers.
> 30% de pleine terre ou autre revêtement naturel à espaces verts
Exemple d’espaces retenus dans l’inventaire selon le degré de végétalisation
Source des illustrations : BRAT & Nordend 2021
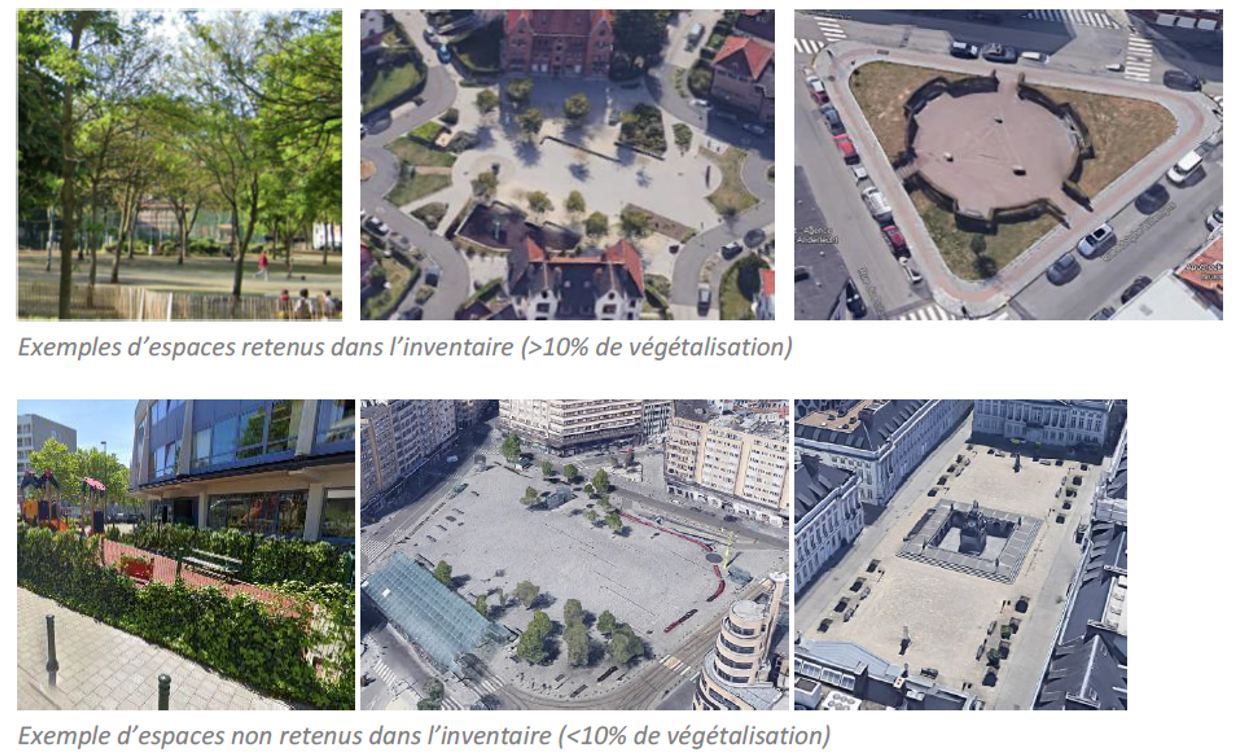
- Accessibilité :
De fait (pas nécessairement de droit)
À tous
Gratuité
Même si l’accessibilité est limitée dans le temps (par ex. ouverture 1 jour/mois)
Prise en compte des espaces aménagés temporairement
Exemple d’espaces retenus dans l’inventaire selon l’accessibilité
Source des illustrations: BRAT & Nordend 2021

- Fonctions de séjour et/ou loisir: l’espace doit être aménagé pour le séjour et l’accueil du public (bancs, jeux, chemin, etc.)
Exemple d’espaces avec fonction de séjour/loisir retenus dans l’inventaire
Source des illustrations: BRAT & Nordend 2021

- Taille: pas de taille minimale
Hormis les espaces « surfaciques », les cheminements non intégrés dans un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. public ont été également repris dans l’inventaire moyennant le respect de certaines conditions : accès public et gratuit, fonction de promenade, cadre verdoyant (public ou privé), interdit aux véhicules (excepté services techniques) et hors circulation routière.
Exemple de cheminements retenus dans l’inventaire
Source des illustrations: BRAT & Nordend 2021

Attention
En bref, les critères pris en compte pour inclure un espace dans l’inventaire des espaces verts et espaces végétalisés publics sont :
- Accessibilité de fait et gratuite (même si espace temporaire ou horaires d’ouverture)
- > 10% de couverture végétale
- Espace aménagé pour le séjour et l’accueil du public (bancs, jeux, chemins etc.)
Les catégories et sous-catégories retenues pour définir les différents espaces sont
- Espaces publics végétalisés (10-30% de pleine terre ou autre revêtement à caractère naturel)
- Espaces verts (> 30% de pleine terre ou autre revêtement type à caractère naturel)
- Parcs et squares (au sens large)
- Bois
- Cimetières
- Espaces verts associés à la voirie (bermes, ronds-points, etc.)
- Etangs et berges en milieu urbain (hors parcs et bois)
- Espaces verts non aménagés (friches, pelouses non aménagées)
- Espaces verts potentiels
- Projets d’espaces verts (donnée non exhaustive)
- Cheminements dans un cadre verdoyant
Cette délimitation de la notion d’espaces verts permet la prise en compte de nombreux petits espaces jouant un rôle important à l'échelle des quartiers (squares, placettes, « pocket parcs », etc.) comme lieux de socialisation, de rencontre ou de jeux. Elle exclut les espaces trop « minéraux » (les espaces repris comme espaces verts doivent avoir plus de 30% de pleine terre ou autre revêtement naturel).
Faute de disposer d’autres sources, la ou les natures du revêtement au sol (présence de pleine terre ou autre revêtement à caractère naturel versus revêtement à caractère artificiel) est estimée sur base de photographies aériennes ou de Google streetview en prenant en compte leur superficie respective par rapport à la surface totale de l’espace.
Différents champs de la base de données apportent de nombreuses informations complémentaires (dont superficie, % végétalisation, catégorie, modalités d’ouverture, propriétaire, gestionnaire, etc.). A des fins d’aide à la planification, un champs « Potentiel » a été inclus pour intégrer dans l’inventaire des espaces non repris sur base de la définition mais qui présentent un potentiel pour créer un nouvel espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. ou des espaces qui y sont repris mais qui ont un potentiel important d'amélioration au niveau de l'aménagement.
Exemple d’espaces à potentiel d’espace vert repris dans la base de données
Source des illustrations: BRAT & Nordend 2021
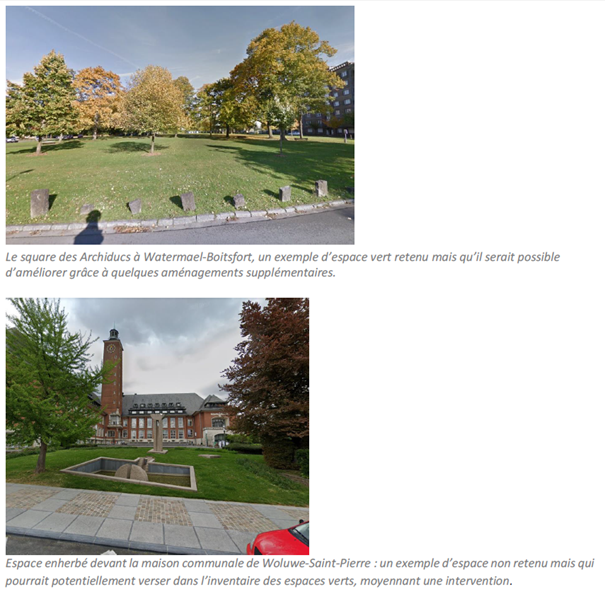
Chaque espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. ou espace public végétalisé a été délimité précisément sur base des cartes reprenant les voiries, le bâti, les parcelles cadastrales et sur base des photographies aériennes. Les voiries locales se trouvant au sein des espaces retenus y ont été intégrées. S’agissant d’une base de données géoréférencées, ces informations peuvent être croisées avec d’autres couches de données (par ex. réseau hydrographique, aire de jeux, affectation au plan régional d’affectation du sol ou PRASLe Plan régional d'Affectation des Sols est l'un des outils majeurs de la politique d'aménagement du territoire régional. Il comprend des prescriptions générales pour l'affectation des sols, des cartes délimitant des zones d'affectation et des prescriptions particulières par zone (notamment pour la protection des espaces verts). Il constitue en outre la référence légale pour l'octroi des permis d'urbanisme, de primes à la rénovation, etc. Il transcrit par ailleurs les objectifs opérationnels du PRD en carte., etc.)
La définition des espaces verts retenue pour la carte 2021 s’est construite en s’appuyant sur celle de 2008 pour éviter une trop grosse rupture. Dans un objectif d’acceptation plus large de la notion, au regard notamment des évolutions des pratiques et des besoins (développement des « pocket park, » des espaces temporaires…), des différences avec 2008 existent néanmoins. La construction de la base de données rend cependant possibles certaines comparaisons des données entre les 2 inventaires.
Comment l’information a-t-elle été collectée ?
Dans un premier temps, les espaces verts cartographiés lors de l’inventaire réalisé en 1998 ont été examinés à la lumière des définitions retenues en 2021. Cette analyse a été complétée par différentes sources d’information : photos aériennes (2019), exploitation d’autres bases de données régionales (arbres en voirie, PRAS, carte STAPAS des chemins destinés au trafic non motorisé, etc.), données fournies par les communes et Bruxelles environnement, prise en compte de projets urbanistiques, etc. Les cas complexes ont été discutés lors de réunions techniques.
La seconde phase de l’étude, démarrée en 2022, a porté notamment sur la validation de la base de données avec les gestionnaires ainsi que sur le développement d’une méthode permettant une mise à jour régulière, par Bruxelles Environnement, sur base de données communiquées par les gestionnaires via une interface numérique (voir formulaire interactif accompagnant la carte géodata).
En 2023, les espaces verts et espaces végétalisés accessibles au public couvrent 3.194 ha soit 19,7% du territoire régional
Les espaces verts et espaces publics végétalisés accessibles au public pris en compte dans l’inventaire couvrent 3.194 ha soit 19,7% du territoire régional.
Cette superficie correspond à grosso modo 39% de la couverture végétale (canopée comprise). En d’autres termes, de l’ordre de 60% de la couverture végétale correspond à des espaces verts non accessibles au public (jardins ou domaines privés, certains espaces associés aux voiries, talus de chemin de fer, complexes de logements, campus, etc.).
Près de 58% des superficies d’espaces verts et d’espaces végétalisés accessibles sont constitués par des bois (233 ha) et la forêt de Soignes (1608 ha). Les parcs et squares représentent 34%. Les espaces restants sont les cimetières (4,8%), les espaces non aménagés (1,2%), les espaces associés à la voirie (1,3%), les espaces dont la typologie n’a pas pu être attribuée (1%) et les étangs et berges hors parcs et bois (0,4%).
Les espaces verts accessibles et les espaces vegétalisés accessibles de moins de 1 ha sont respectivement au nombre de 834 et 87. Ils couvrent près de 178 ha et 12 ha.
58% des superficies d’espaces verts et d’espaces végétalisés accessibles sont constitués par des bois et la forêt de Soignes
Source: Bruxelles Environnement 2023
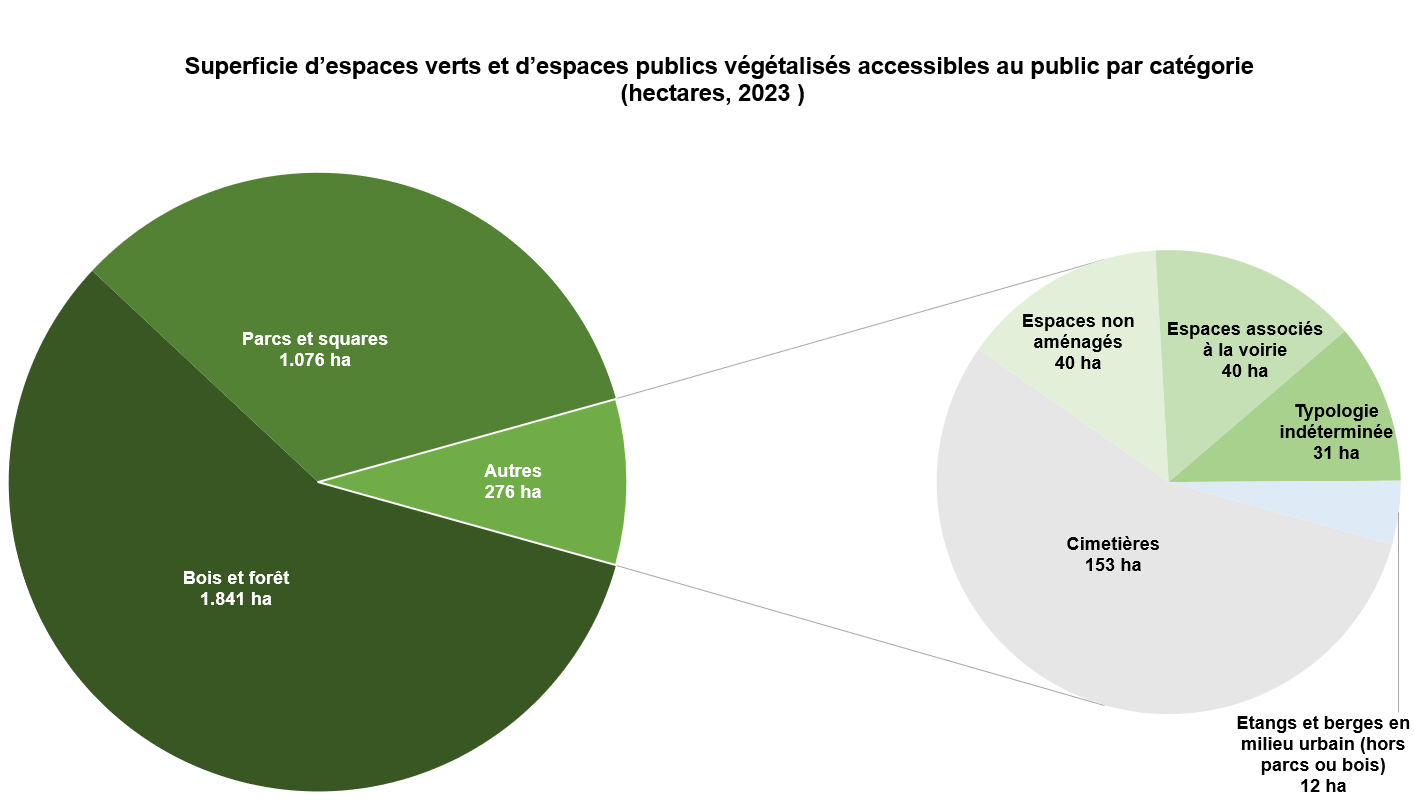
La carte des zones de carence en espaces verts accessibles
Cette carte répertorie les espaces verts accessibles de la Région bruxelloise et délimite les zones de la Région bruxelloise où l’on observe une carence de ces espaces.
Les espaces verts pris en compte pour l’établissement de cette carte et l’analyse des données sont les espaces accessibles de droit avec plus de 50% de couverture végétale et aménagés pour l’accueil du public. Les zones de carence ont été identifiées en se basant sur les objectifs d’accessibilité aux espaces verts définis dans le Plan nature et le PRDD: il s’agit de toutes les zones situées à plus de 200 m d’un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. d’une taille inférieure à 1 hectare et à plus de 400 m d’un espace vert d’une taille supérieure à 1 hectare. Les distances prises en compte correspondent à des cheminements réels (pas à vol d’oiseau) jusqu’aux entrées (ponctuelles ou diffuses) des espaces verts.
Le choix des espaces verts pris en compte répond au souci de pouvoir comparer les données de l’inventaire de 2009 avec celles du présent inventaire. Pour l’analyse, il a été considéré que les entrées des espaces verts correspondaient aux intersections entre les voiries et les limites des espaces verts.
Les Bruxellois vivant dans des zones carencées en espaces verts habitent majoritairement dans les quartiers les plus centraux
Source: Bruxelles Environnement 2023
La carte ci-dessous ne prend en compte que les espaces verts accessibles de plus de 1 ha. Les différentes couleurs correspondent au temps nécessaire pour parcourir à pied, en cheminement réel, la distance séparant le point considéré à l’espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. de plus de 1 ha le plus proche. Les Bruxellois habitant dans les zones reprises en orange et rouge sont localisés à plus de 400 mètres à pied d’un espace vert de plus de 1 ha.
Une part importante du territoire se trouve à plus de 400 mètres d’un espace vert accessible de plus de 1 ha (distance piétonne)
Source: Bruxelles Environnement 2023
Ces zones de carences mettent en lumière les espaces où les aménagements d’espaces verts et les dynamiques de végétalisation doivent être prioritairement envisagées. D’autres critères interviennent également, notamment l’importance quantitative de la population et le taux de couverture végétale dans les périmètres concernés.
En fonction des projets et de leurs objectifs, d’autres cartes peuvent être aisément produites sur base d’autres critères (par ex. taille des espaces verts, distances à parcourir, degré de végétalisation, etc.) et croisement de couches de données (par ex. % de jeunes de moins de 18 ans par quartier, revenus moyens, etc.).
22% des Bruxellois ne disposent pas d’un espace vert de proximité
En 2023, environ 78% des Bruxellois disposent d’un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. à proximité de chez eux (calculé selon la méthodologie exposée ci-dessus, les données sur les espaces verts datent de 2023, les données de population de 2021). Ces espaces verts peuvent être de taille, de nature et qualité variables et ne remplissent pas tous les mêmes fonctions (par exemple, un cimetière très végétalisé, s’il peut se prêter à la promenade, ne se prête pas aux jeux d’enfants).
Entre 2020 et 2023, le pourcentage estimé de Bruxellois vivant dans une zone de carence en espaces verts serait passé d’environ 26% à 22%. Cette évolution apparente positive est cependant à relativiser dans la mesure où, d’une part, elle est probablement partiellement liée à une inventorisation plus complète des espaces à intégrer dans la base de données (les données 2020 n’étaient pas encore validées) et que, par ailleurs, les données de population sont de 2021 et non pas de 2023 (la population bruxelloise s’est accrue d’environ 23.000 habitants entre 2020 et 2023).
Et 42% ne disposent pas d’un espace vert de plus de 1 ha à moins de 400 m à pied de chez eux
Si l’on ne prend en compte que les espaces verts de plus de 1 ha (soit environ la taille du terrain de football du Heysel x 1,4), le pourcentage de population pourvue en espaces verts accessibles n’est plus que de 58,2%. En d’autres termes, près de 42% des Bruxellois n’ont pas accès à un espace vert de plus de 1 ha à moins de 400 mètres de chez eux (distance piétonne). Et parmi ces derniers, la moitié (22% de la population totale) n’a en outre pas non plus accès à un espace vert de petite taille (inférieure à 1 ha) à moins de 200 mètres de son habitation.
Schaerbeek, Bruxelles-Ville, Ixelles, Molenbeek et Uccle, communes où le nombre absolu de citoyens habitant en zone de carence est le plus élevé
Source: Bruxelles Environnement 2023
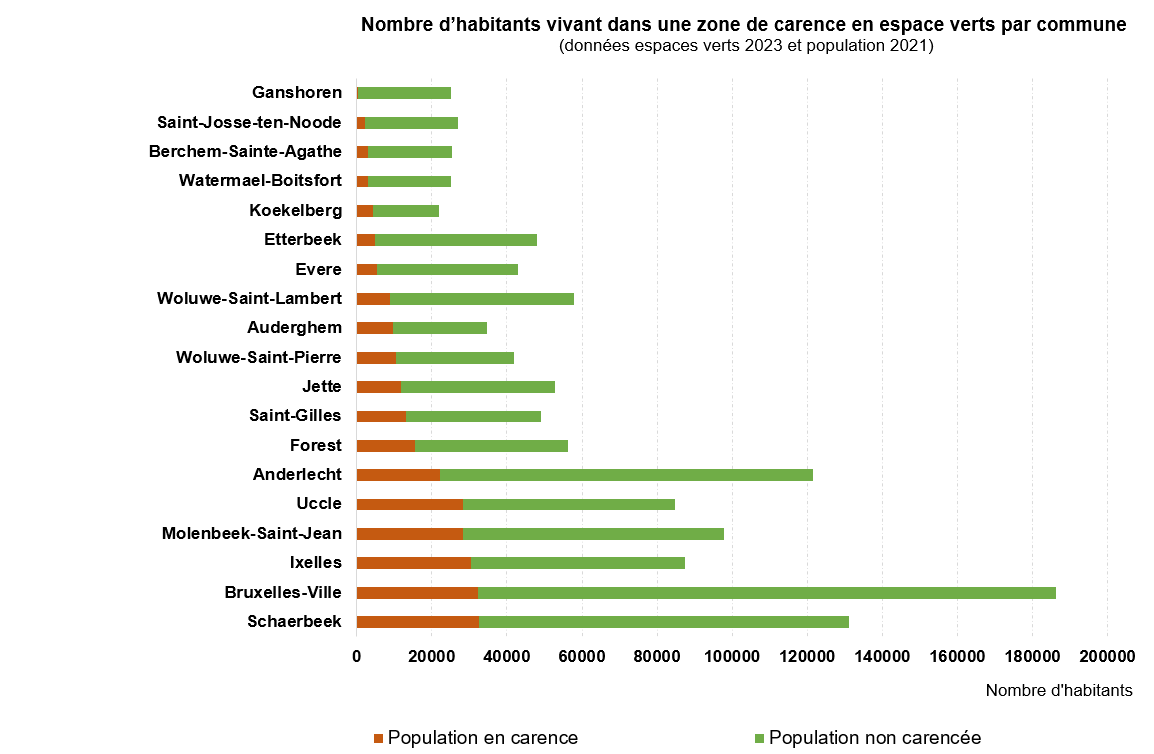
En termes de pourcentage de population, les communes les plus carencées sont, par ordre, Ixelles, Uccle, Molenbeek, Auderghem, Forest, Saint-Gilles, Woluwé-Saint-Lambert et Schaerbeek. Dans ces communes, entre un quart et un tiers de la population ne dispose pas d’un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. de proximité.
7 communes disposent de moins de 10 m2 d’espaces verts publics par habitant
L’offre en espaces verts s’apprécie également selon les superficies disponibles par habitant. Cet indicateur reflète la pression récréative qui s’exerce sur un espace vert et qui peut entraîner des dégradations (par ex. piétinement excessif des pelouses) ou des conflits d’usage. Le ressourcement qu’offre le contact avec la nature est également moindre dans un espace vert extrêmement fréquenté.
En moyenne, en 2023, 25 m² d’espaces verts accessibles sont disponibles par Bruxellois, avec à nouveau de fortes différences entre les quartiers et communes.
La disponibilité en espaces verts accessibles par habitant s’étage entre 1 m2 à Saint Gilles et 314 m2 à Watermael-Boitsfort (forêt comprise)
Source: Bruxelles Environnement 2023
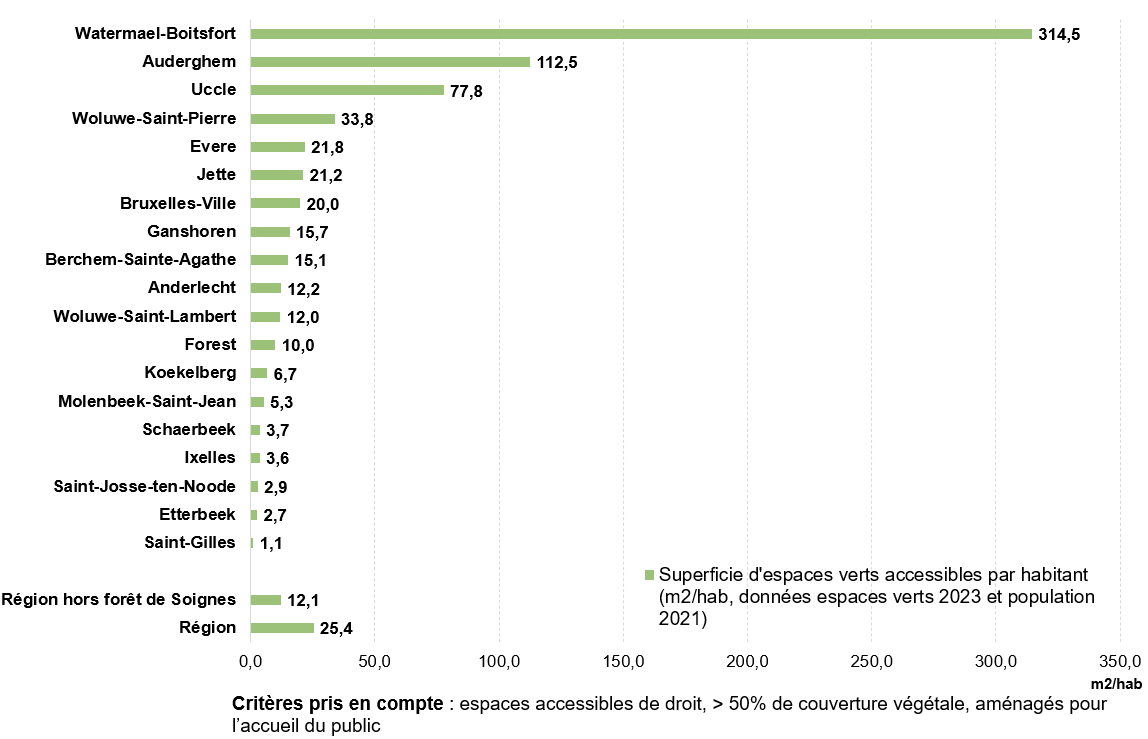
Les normes en matière de disponibilité en espaces verts accessibles par habitant disponibles dans la littérature sont extrêmement variables. La ville de Paris (département de Paris et 3 départements contigus) a fixé la quantité d’espaces verts à 10 m²/habitant en zone centrale et à 25 m²/habitant en zone périurbaine via une circulaire ministérielle datant de 1973 (Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile de France 2009). 7 communes bruxelloises disposent de moins de 10 m2 d’espaces verts publics par habitant à savoir, Saint-Gilles (1,1 habitant par m2 d’espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. disponible), Etterbeek, Saint-Josse, Ixelles, Schaerbeek, Molenbeek et Koekelberg. La commune de Forest atteint tout juste le seuil. Avec 12 m2/habitant, les communes de Woluwe-Saint-Lambert et Anderlecht sont également proches du seuil de 10 m2.
A l’opposé, les communes périphériques de Watermael-Boitsfort, Auderghem, Uccle et, dans une moindre mesure, Woluwe-Saint-Pierre, du fait notamment de la présence de la forêt de Soignes, disposent d’une disponibilité en espaces verts accessibles par habitant particulièrement élevée. Néanmoins, une part importante des habitants d’Uccle et d’Auderghem vivent dans des quartiers insuffisamment pourvus en espaces verts publics (voir graphe et tableau ci-dessous).
Des communes très vertes mais où une part importante de la population vit dans des zones de carences en espaces verts accessibles
Source: Bruxelles Environnement 2023
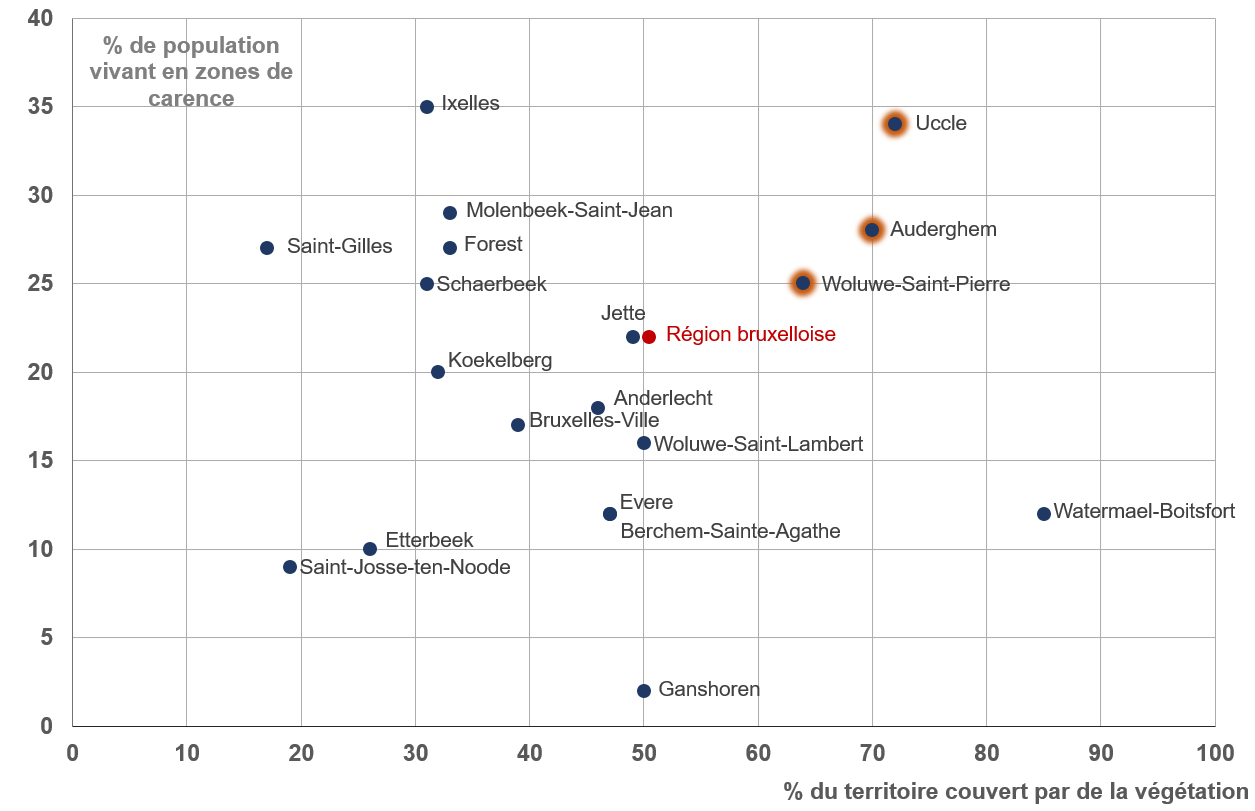
Ce graphique montre que même dans des communes très « vertes » (en termes de couverture végétale) telles que Uccle et Auderghem, respectivement plus d’un tiers et plus d’un quart de la population vit dans des quartiers carencés en espaces verts accessibles. Ceci s’explique par différents facteurs : beaucoup d’espaces verts ne font pas partie de l’espace public (jardins privés ou d’entreprises, cours d’écoles végétalisées, …) ou ne sont pas des espaces verts accessibles (végétation associée aux voiries, certains potagers collectifs, etc.). Par ailleurs, les espaces verts publics peuvent être répartis très inégalement sur le territoire.
Pour en savoir plus : tableau reprenant les données quantitatives sur les espaces verts accessibles et la couverture végétale par commune
13% des Bruxellois ne disposent pas d’un espace vert de proximité et vivent dans un quartier peu végétalisé (< 30%)
D’un point de vue urbanistique, l’analyse de l’offre quantitative en espaces verts est plus pertinente à l’échelle des quartiers. Les données de taux de végétalisation, espaces verts accessibles et population sont disponibles pour les 145 quartiers bruxellois (cf. définition IBSA-Monitoring des quartiers).
L’analyse des données à une échelle spatiale fine montre que 16.717 Bruxellois vivent dans des zones de carence en espaces verts publics dans un quartier où la couverture végétale est inférieure ou égale à 10%. Ce chiffre est de 157.853 habitants pour les quartiers où le taux de végétalisation est de moins de 30%.
Environ 160.000 Bruxellois vivent dans un quartier peu végétalisé (< 30%) et dans une zone de carence en espaces verts publics
Source: Bruxelles Environnement 2023
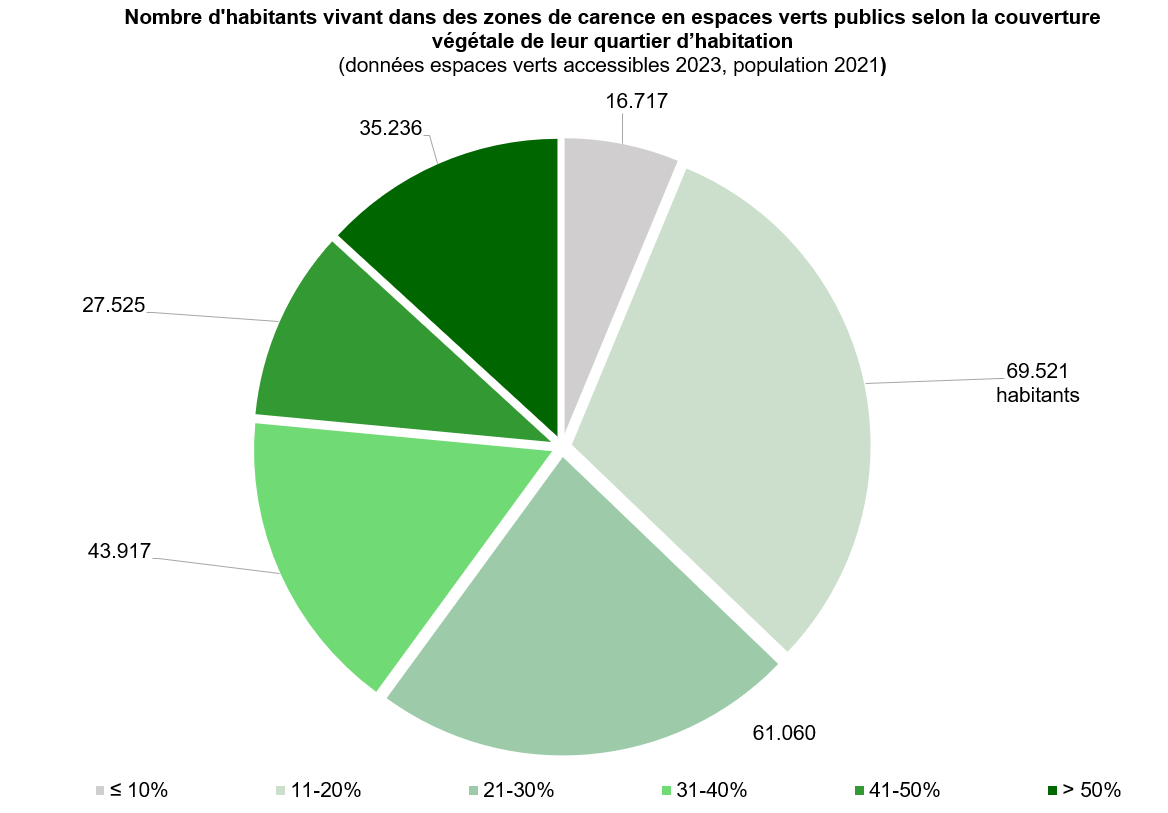
Ces données permettent aussi, par exemple, d’identifier les 10 quartiers bruxellois où le nombre d’habitants qui n’ont pas un accès satisfaisant à un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. de proximité (selon les critères expliqués ci-dessus) est le plus grand. Il s’agit de Molenbeek historique, Cureghem Bara, chaussée de Wavre-Saint-Julien, Dailly, Woeste, Bas Forest, chaussée de Haecht, Globe, Gare de l’Ouest, Chatelain, Vieux Laeken est. Certains de ces quartiers sont en outre très faiblement végétalisés (Molenbeek historique, Cureghem Bara, Gare de l’Ouest, Bas Forest, Chaussée de Haecht, etc.).
Au-delà de cette approche purement quantitative, l’examen de l’offre à des fins de diagnostic doit également prendre en compte les aspects qualitatifs des espaces verts.
Que peut-on dire de l’évolution de l’offre en espaces verts accessibles?
La comparaison des deux inventaires (2009 et 2020) présente des difficultés liées à l’évolution de la définition des espaces verts pris en compte et à une révision des contours cartographiques des espaces verts (plus précis en 2020 ce qui a conduit à une perte de superficie de 23 ha). Les moyens mis en œuvre ont également permis de réaliser un inventaire plus approfondi en 2020. Si les chiffres globaux fournis par ces 2 inventaires ne peuvent dès lors pas être comparés, une analyse plus fine des résultats repris dans la base de données permet néanmoins certaines estimations.
Les données présentées ci-dessous se rapportent aux espaces verts accessibles de fait (donc pas nécessairement de droit).
Entre 2009 et 2020, 90 espaces verts (> 30% de perméabilité) ou espaces publics végétalisés (entre 10 et 30% de perméabilité) ont été « créés ». Ce chiffre englobe de « vraies créations », c’est-à-dire l’aménagement d’espaces verts ou d’espaces publics végétalisés créés de toute pièce à un emplacement où il n'en existait pas auparavant, mais aussi des aménagements légers qui ont permis d’inclure les espaces bénéficiaires dans l’inventaire mis à jour (par ex. berme ou oreille de trottoir où un banc a été ajouté depuis 2008).
Les « vraies créations », au nombre de 49, couvrent une superficie de 26 ha. Les aménagements légers, au nombre de 41, représentent 3 ha.
26 ha d’espaces verts (essentiellement) et d’espaces publics végétalisés (accessoirement) créés entre 2009 et 2020
Source: Bruxelles Environnement 2022
Entre 2009 et 2020, 38 parcs et squares ont été « créés » (y compris aménagements légers). En termes de superficie, près de la moitié des « vraies créations » d’espaces verts ou d’espaces publics végétalisés concernent le territoire de Bruxelles-Ville (12,5 ha dont 11 ha correspondent à la Coulée Verte et au parc Pannenhuis). Près de 5 ha et 3 ha d’espaces verts ou d’espaces publics végétalisés ont également été aménagés sur les communes de Molenbeek (dont parc de la ligne 28 et porte de Ninove) et Anderlecht (dont Boulevard Paepsem - Boulevard Industriel).
Durant cette période, des espaces verts ont également disparu suite à des projets de constructions. Ceci concerne 22 espaces verts ou espaces publics végétalisés totalisant une superficie de 7,9 ha.
L’« accroissement net » de l’offre en espaces verts ou espaces publics végétalisés accessibles (correspondant à des « vraies créations ») a donc été de l’ordre de 18 ha (soit environ 25 terrains de football de la taille du stade du Heysel).
Compte tenu du fait que la population bruxelloise s’est accrue de 149.723 habitants entre 2009 et 2020 (Statbel 2022), cet accroissement net correspond à 1,2 m2 par nouvel habitant.
En conclusion, si les superficies d’espaces verts et d’espaces publics végétalisés se sont accrues entre les 2 inventaires, cette offre rapportée au nombre d’habitants a diminué à l’échelle régionale sur cette même période en raison de la forte croissance démographique.
En ce qui concerne les sites régionaux, environ 85 ha d’espaces verts ont été ouverts ou repris en gestion par Bruxelles Environnement au cours de ces 2 dernières décennies. La promenade verteParcours paysager, destiné à la mobilité douce, reliant les espaces verts naturels et semi-naturels de seconde couronne. Elle permet de faire le tour complet de la Région sans quitter un itinéraire sécurisé et balisé., une boucle de 60 km autour de Bruxelles et qui traverse différents parcs et paysages bruxellois, a également été aménagée pour les promenades pédestres et cyclistes.
Des informations complémentaires à ce sujet figurent dans le sujet consacré aux espaces verts gérés par Bruxelles Environnement.
À télécharger
Fiches documentées
- Apport de la nature à la santé des Bruxellois 2022 (.pdf)
- Représentations sociales des bruxellois.e.s vis-à-vis de leur environnement naturel et des espaces verts bruxellois 2022 (.pdf)
- Le Maillage Vert 2017 (.pdf)
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Les espaces verts gérés par Bruxelles Environnement (2023)
- Focus : Sport et espaces verts en Région bruxelloise (2021)
- Focus : Couverture végétale en Région bruxelloise (2023)
- Focus: La carte d’évaluation biologique de la Région bruxelloise (2022)
- Focus : Le maillage jeux (2022)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Carte «Végétation 2021 – Répartition de la végétation en septembre 2021 »
- Carte « Espaces verts accessibles au public 2024)»
- Carte « Promenade verte »
- Carte « Zones de carence en espaces verts ouverts au public »
Etudes et rapports
- BRAT & NORDEND 2021. « Mise à jour et réorganisation de la base de données Postgis des espaces verts accessibles au public», rapport final, étude effectuée à la demande de Bruxelles environnement, 58 p.
- BRAT 2009. « Inventaire des espaces verts et espaces récréatifs accessibles au public en Région de Bruxelles-Capitale », rapport effectué à la demande de Bruxelles environnement, 72 p. (.pdf)
- BRAT & RUIMTECEL 2009. « Etude pour un redéploiement des aires ludiques et sportives en Région de Bruxelles-Capitale », rapport effectué à la demande de Bruxelles environnement, 51 p. (.pdf)
- BRAT & PEPS 2017. « Développement d'une stratégie globale de redéploiement du sport dans les espaces verts en Région de Bruxelles Capitale », rapport effectué à la demande de Bruxelles environnement
Phase 1 (.pdf) - Phase 2 (.pdf) - Phase 3 (.pdf) - BRAT & PEPS 2017. « Développement d’une stratégie globale de redéploiement du sport dans les espaces verts bruxellois - Synthèse des recommandations de l’étude », rapport effectué à la demande de Bruxelles environnement (.pdf)
- INSTITUT D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME D’ILE DE FRANCE 2009. « La desserte en espaces verts » (.pdf)
Plans et programmes
Sites semi-naturels et espaces verts protégés
Indicateur – Actualisation : septembre 2023
14,6% du territoire bruxellois fait l’objet d’une protection visant spécifiquement la conservation de la nature. Des objectifs de conservation des habitats naturels et des espèces à protéger doivent y être définis et mis en œuvre via des plans de gestion. Les seuls sites bénéficiant actuellement de ce régime de protection, sur une base légale, sont les 18 réserves naturelles et forestières ainsi que les 3 zones Natura 2000 que compte la Région bruxelloise.
Face aux multiples pressions humaines s’exerçant sur l’environnement - et, notamment, sur la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). - les autorités publiques ont mis en place divers outils de protection s’appliquant à certains sites.
En Région bruxelloise, différents statuts de protection plus ou moins contraignants en termes de conservation de la nature coexistent et s’appliquent parfois à un même site. Les régimes de protection les plus stricts s’appliquent aux réserves naturelles et forestières ainsi qu’aux sites Natura 2000.
Pour ces sites la législation prévoit en effet de définir des objectifs de conservation des habitats naturels et des espèces à protéger ainsi que les mesures de gestion nécessaires pour les atteindre. Le plan régional nature 2016-2020 parle de « protection active ».
Outre ces statuts de protection directe découlant de la législation nature, les espaces verts peuvent également bénéficier d’une protection indirecte via les législations relatives à l’aménagement du territoire, à la protection du patrimoine ou à la protection des ressources en eau. Pour reprendre la terminologie du plan nature, il s’agit d’une « protection passive ». Celle-ci n’implique aucune obligation de gestion active visant à un maintien de la valeur biologique de ces espaces verts mais une part des interdictions et prescriptions qui s’y appliquent confèrent un certain degré de protection.
La Région bruxelloise compte 18 réserves naturelles et forestières
La Région bruxelloise compte 16 réserves naturelles et 2 réserves forestières s’étendant respectivement sur près de 135 ha et 159 ha. Au total ces réserves couvrent 1,8% du territoire bruxellois.
Il s’agit d’aires protégées pour leur valeur biologique exceptionnelle ou particulière. Elles bénéficient des régimes de protection les plus stricts.
Les réserves naturelles ou forestières peuvent être soit intégrales soit dirigées, selon que l’on y laisse les phénomènes naturels évoluer selon leur dynamique propre ou que l’on y applique une gestion spécifique. Celle-ci est destinée à maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, certaines espèces et habitats naturels ou à sauvegarder des peuplements d’arbres indigènes ou des formes paysagères (facies) caractéristiques ou remarquables associés à certaines associations végétales.
Bon à savoir
Les options de gestion sont choisies par un comité rassemblant des scientifiques et des membres d’associations de protection de la nature, en fonction de la spécificité des lieux et des objectifs de préservation à atteindre. Elles sont ensuite consignées dans un plan de gestion propre à chaque réserve et qui est soumis à enquête publique. La mise en œuvre de ces plans est assurée par Bruxelles Environnement (parfois en collaboration avec des associations) et fait l’objet d’un suivi scientifique. Un plan de gestion a été officiellement adopté pour 14 des 18 réserves naturelles ou forestières bruxelloises.
Pour en savoir plus sur la gestion des réserves à Bruxelles.
Plusieurs vagues de désignation de réserves se sont succédé depuis la création de la Région bruxelloise.
Deux nouvelles réserves ont été créées en 2019
Source : Bruxelles Environnement 2023
Lire le texte de transcription
Les premières réserves ont été désignées en 1989. Six vagues de désignation se sont ensuite succédées: en 1990 (les réserves naturelle et forestière du Rouge-Cloître), en 1992 (6 réserves naturelles et 1 réserve forestière aux Enfants Noyés), en 1998 (4 réserves naturelles), en 2007 (remplacement de la réserve forestière des Enfants noyés par la réserve forestière intégrale du Grippensdelle), en 2009 (réserve naturelle agrée au Vogelzang) et en 2019 (réserves naturelles agrées du Koevijverdal et roselière de Neerpede).
La superficie de la réserve naturelle du Vogelzangbeek s’est accrue de 25% en 2022
Source : Bruxelles Environnement 2023
En 2022, le statut de réserve naturelleZone constituée par un organisme public ou privé en vue de préserver un spécimen représentatif d'une communauté végétale et animale (biocénose) donnée, principalement dans un but d'ordre scientifique et éducatif. agréé a été renouvelé pour le site du Vogelzangbeek à Anderlecht avec une extension de sa superficie de 3,4 ha. Trois ans auparavant, deux nouvelles petites réserves, localisées sur cette même commune, avaient été désignées : le Koevijverdal et la Roselière de Neerpede.
En juillet 2017, la réserve forestièreLa réserve forestière est une forêt ou une partie de celle-ci, protégée dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables, ou des peuplements d'essence indigène, et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu. intégrale du Grippensdelle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco et ce, conjointement avec 3 autres réserves intégrales de la forêt de Soignes localisées en Régions flamande et wallonne. Ces parties de la forêt de Soignes, couvrant au total une superficie de 270 ha, ont ainsi été reconnues comme composantes d’une série qui compte aujourd’hui 94 hêtraies remarquables situées dans 18 pays européens et qui font toutes l’objet d’une protection stricte. Certaines de ces hêtraies sont des vestiges de forêt primaire ou des massifs pluri-centenaires faiblement altérés par l’homme. L’ensemble de ces hêtraies est reconnu comme un témoignage commun de l’évolution et de l’impact exceptionnels de l’écosystèmeC'est l'ensemble des êtres vivants (faune et flore) et des éléments non vivants (eau, air, matières solides), aux nombreuses interactions, d'un milieu naturel (forêt, champ, etc.). L'écosystème se caractérise essentiellement par des relations d'ordre bio-physico-chimique. du hêtre en Europe depuis la dernière période glaciaire. Du fait du classement de ces réserves de la forêt de Soignes par l’Unesco, l’ensemble du massif sonien est considéré comme zone tampon c’est-à-dire que rien ne peut y être fait qui menace la protection des zones sous statut Unesco.
De plus amples informations concernant ces réserves sont disponibles dans la fiche documentée consacrée aux espaces semi-naturels et espaces verts bénéficiant d’un statut de protection.
Lien vers la carte interactive des réserves naturelles et forestières.
Le réseau Natura 2000 bruxellois couvre 14,3% du territoire bruxellois
Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels qui font l’objet d’un statut spécial de protection en raison des habitats ou des espèces qui s’y trouvent. Il a pour objectif de maintenir la diversité de ces milieux naturels et d’améliorer leur qualité. Pour ce faire, on ne tient pas seulement compte de la fonction de nature, mais aussi d’exigences économiques, sociales, culturelles et régionales.
Le réseau Natura 2000 se compose de sites désignés par les Etats membres en application de 2 directives européennes concernant respectivement la préservation des oiseaux sauvages dite « directive Oiseaux » (directive 2009/147/CE) et la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages dite « directive Habitats » (directive 92/43/CEE). Cette dernière vise à la fois la conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces et la conservation des espèces sauvages, animales et végétales qui y sont liées. Elle reprend, en annexe I, une liste des habitats naturels ou semi-naturels considérés comme d'intérêt communautaire (c’est-à-dire, en résumé, des habitats rares et/ou typiques ou remarquables à l’échelle de l’Union européenne) et, en annexe II, une liste des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire.
Bien que certains sites soient intéressants pour de nombreuses espèces d’oiseaux, la Région ne comporte pas de « zones de protection spéciales » désignées dans le cadre de la « directive Oiseaux ». Cependant, malgré son caractère urbain, le territoire régional compte 10 types d’habitats figurant dans l’annexe I de la directive « Habitats » (en particulier des habitats forestiers dont, principalement, la hêtraie acidophile) et 10 espèces de faune de l’Annexe II (6 espèces de chauves-souris, un insecte, un poisson, un amphibien ainsi qu’un petit mollusque).
La présence de ces habitats naturels et de ces espèces a permis d’établir une liste de sites abritant ces derniers et de proposer ceux-ci comme « zones spéciales de conservation » (ZSC) à la Commission européenne laquelle les a approuvés en décembre 2004. Etant donné le haut degré d’urbanisation de la Région, il ne s’agit pas d’un seul grand site homogène mais de trois sites comprenant une mosaïque de 48 stations.
La désignation des sites Natura 2000 a fait l’objet de trois arrêtés du Gouvernement bruxellois (adoptés en 2015 et 2016) comportant notamment les objectifs de conservation des sites, les moyens de gestion proposés pour les atteindre ainsi que les interdictions particulières applicables dans ou en dehors des sites pour assurer leur préservation. En 2019, la ZSC II a été étendue pour intégrer 13 hectares supplémentaires (site de l’ancien Institut Pasteur) au niveau du plateau Engeland.
Les 3 ZSC couvrent une superficie totale de 2329 hectares :
- ZSC I : Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la vallée de la Woluwe (2066 ha dont 1690 ha d’habitats d’intérêt communautaire);
- ZSC II : Zones boisées et ouvertes au sud de la Région de Bruxelles-Capitale - complexe Verrewinkel – Kinsendael (147 ha dont 81 ha d’habitats d’intérêt communautaire) ;
- ZSC III : Zones boisées et zones humides de la Vallée du Molenbeek dans le nord-ouest de la Région de Bruxelles-Capitale (116 ha dont 81 ha d’habitats d’intérêt communautaire).
Le réseau Natura 2000 couvre 14,3% du territoire bruxellois. Avec une superficie de 1659 ha, la partie bruxelloise de la forêt de Soignes représente une majeure partie du réseau Natura 2000. Bruxelles Environnement gère un peu moins de 90% de la superficie de l’ensemble des sites Natura 2000 régionaux.
Pour en savoir plus sur les habitats et espèces Natura 2000 en Région bruxelloise et les plans de gestion.
Des prairies et roselières protégées comme patrimoine naturel régional
L’ordonnance nature introduit le concept d’ « habitats naturels d'intérêt régional » (HIR) définis comme des « habitats naturels présents sur le territoire régional, pour la conservation desquels la Région a une responsabilité particulière en raison de leur importance pour le patrimoine naturel régional et/ou de leur état de conservation défavorable ». Ces HIR peuvent être localisés au sein des sites Natura 2000 mais également en dehors où ils se rapportent en grande partie à des habitats ouverts. Les HIR inclus en zone Natura 2000 ou dans des réserves naturelles font l’objet d’objectifs de conservation et de mesures de gestion qui s’y rapportent.
6 types d’HIR, couvrant une superficie d’environ 93 ha, ont été délimités au niveau des 3 sites Natura 2000. Il s’agit principalement de prairies comportant certaines plantes déterminées (graminées particulières, populage des marais, potentille des oies, …) et de roselières.
La Région bruxelloise s’est engagée à protéger activement les habitats naturels et espèces liées sur 25% de son territoire d’ici 2030
Si l’on totalise les superficies couvertes par les sites Natura 2000 et celles des réserves naturelles (hors réseau Natura 2000 pour éviter un double comptage), 14,6% du territoire bénéficie d’un statut de protection impliquant que des objectifs de conservation de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). y soient définis et mis en œuvre via une gestion active s’appuyant sur des plans de gestion.
En 2020, au niveau européen, la superficie des sites Natura 2000 s’élevait à 18,5% pour les écosystèmes terrestres et 8% pour les écosystèmes marins (UE 27). A l’échelle belge, ces mêmes pourcentages s’élèvent respectivement à 12,7 et 38,1% du territoire. Dans les pays voisins ces pourcentages sont de 12,9 et 38,8% en France, 14,7% et 25,6% aux Pays-Bas, 15,4% et 45,7% en Allemagne et 27,1% au Grand-Duché de Luxembourg.
En réponse aux engagements pris lors de la COP 15 « Biodiversité » et de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité (voir encadré ci-dessous), la Région bruxelloise s’est engagée, en octobre 2023, à augmenter la protection du territoire bruxellois : d’ici 2030, 25% de son territoire devra être activement protégé ou strictement protégé (réserve intégrale). Cet engagement vise à contribuer à répondre à des enjeux en termes de biodiversité mais aussi de résilience du territoire, de qualité de vie et de santé des Bruxelloises et Bruxellois.
La protection de zones supplémentaires se fera via la mise en place de nouveaux types d’actions juridiques et/ou administratives reposant sur 8 pôles d’action. Ceux-ci porteront par exemple sur des modifications du Plan Régional d’Affectation du Sol (protection planologique ou renforcement de la protection planologique existante), sur la mise en œuvre de plans de gestion plus volontaristes au niveau d’espaces verts existants présentant un intérêt biologique particulier ou encore, sur la protection d’habitats naturels liés à des espèces rares et précieuses (Lucanes cerf-volant par exemple).
Un groupe de travail rassemblant les partenaires contribuant à la mise en œuvre du Pledge sur les aires protégées (notamment Perspective, Bruxelles Environnement et Urban) sera créé. Celui-ci aura pour mission d’identifier les surfaces à désigner comme devant faire l’objet de mesures de protection et d’assurer le suivi des objectifs.
Bon à savoir
L’UE et les NU fixent un objectif de restauration d’au moins 30% des écosystèmes dégradés d’ici 2030
La 15ième Conférence des Parties à la Convention des nations Unies sur la diversité biologique (COP15), tenue à Montréal fin 2022, a abouti à un accord intégrant une vision pour 2050 et 23 cibles à atteindre d’ici 2030. Ces cibles incluent notamment :
- la restauration d’au moins 30% des zones d'écosystèmes terrestres, d'eaux intérieures, côtiers et marins dégradés (…) ;
- la conservation et gestion, par le biais de systèmes d'aires protégées écologiquement représentatifs, bien reliés et gérés de manière équitable (…), d’au moins 30% des écosystèmes terrestres et marins (en particulier ceux présentant une importance particulière pour la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). et les fonctions et services écosystémiquesEnsemble des services rendus par les sols à l’environnement et de facto à notre société : fourniture d’eau potable, limitation des inondations, stockage du Carbone atmosphérique, support pour la faune et la flore...)).
Cet engagement mondial fait lui-même écho à l’adoption, deux ans plus tôt, de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. Cette stratégie contient des engagements (pledges) et des actions spécifiques à mettre en œuvre d'ici 2030, déclinés selon 3 principaux piliers :
- l’établissement d’un réseau européen élargi de zones protégées : il s’agit d’élargir les zones Natura 2000 existantes pour atteindre la création de zones protégées représentant au moins 30% de la superficie terrestre et 30% de la superficie marine ainsi que d’assurer la connectivité écologique nécessaire au brassage génétique des espèces ;
- la mise en place de mesures pour permettre un changement transformateur : intégration de la nature dans les autres politiques (urbanisme, agriculture…), renforcement des connaissances et recherche de financements complémentaires.
- l’adoption d’un règlement européen sur la restauration de la nature (EU Nature Restoration Law) : au travers d’engagements (pledges) concrets et d’objectifs contraignants au niveau de l’UE, cette règlementation vise à restaurer les écosystèmes dégradés d'ici 2030 et à les gérer de manière durable, en s'attaquant aux principaux moteurs de la perte de biodiversité.
La proposition de règlement adoptée en juin 2023 vise à mettre en place des mesures de rétablissement qui couvriront, d'ici à 2030, au moins 20% des zones terrestres et 20% des zones marines de l'UE et, d'ici à 2050, l'ensemble des écosystèmes ayant besoin d'être restaurés. L’adoption de ce règlement est espérée pour fin 2023.
Dans ce cadre, les États membres ont été invités par la Commission européenne à lui fournir deux engagements (pledges) :
- des objectifs quant aux aires protégées : proposition d’une liste de nouvelles zones à désigner à l’échelle du territoire national en vue d’atteindre 30% d’aires protégées à l’horizon 2030 dont au moins 10% d’aires strictement protégées (objectifs mondiaux et européens de protection de la nature). Chaque État membre doit fournir un effort équitable et tout mettre en œuvre afin d’atteindre ce pourcentage. Les engagements seront ensuite évalués par région biogéographique et, si nécessaire, ajustés en fonction des objectifs à atteindre.
- des objectifs de restauration : description des mesures visant à ce qu’au moins 30 % des espèces et des habitats qui ne sont pas actuellement dans un état favorable affichent une forte tendance positive d’ici 2030.
Compte tenu du cadre institutionnel belge, chaque Région et l’Etat fédéral (compétent pour l’environnement marin) doivent apporter une contribution aux engagements (pledges) nationaux sur les aires protégées et les objectifs de restauration.
Fin 2023, un plan de gestion a été officiellement adopté pour 82% de la superficie des stations Natura 2000
Des plans de gestion sont établis pour chacune des stations Natura 2000, le cas échéant en consultant les propriétaires et occupants concernés autres que la Région. Ils doivent ensuite faire l’objet d’une procédure d’approbation incluant une enquête publique. Les plans de gestion adoptés jusqu’à présent couvrent l’ensemble des stations de la ZSC III, la forêt de Soignes ainsi que deux autres petites stations de la ZSC I (talus des Trois tilleuls et Etang floréal). En termes de superficie, ceci correspond à 82% de la superficie des stations Natura 2000 de la Région bruxelloise. Par ailleurs, si l’on prend en compte les plans de gestion adoptés en première lecture et qui doivent être soumis à enquête publique, ce pourcentage s’élève à 86% (octobre 2023).
Liens vers les cartes interactives des sites Natura 2000, des habitats Natura 2000 et des espèces « objectifs » Natura 2000.
Près d’un quart du territoire régional affecté en zones d’espaces verts et agricoles
Les outils de planification jouent un rôle essentiel dans la conservation de zones vertes en ville. Le plan régional d’affectation du sol (PRASLe Plan régional d'Affectation des Sols est l'un des outils majeurs de la politique d'aménagement du territoire régional. Il comprend des prescriptions générales pour l'affectation des sols, des cartes délimitant des zones d'affectation et des prescriptions particulières par zone (notamment pour la protection des espaces verts). Il constitue en outre la référence légale pour l'octroi des permis d'urbanisme, de primes à la rénovation, etc. Il transcrit par ailleurs les objectifs opérationnels du PRD en carte.) et la carte d’affectation du sol qui l’accompagne organisent le territoire en zones de différentes affectations dont 8 se rapportent à des espaces verts, au sens large, ou agricoles.
Lire le texte de transcription
Les zones d’espaces verts (au sens large) et les zones agricoles du PRAS incluent, par ordre d’importance surfacique : les zones forestières (1680 ha), les zones de parcs (929 ha), les zones de sport ou de loisirs de plein air (336 ha), les zones vertes (304 ha), les zones agricoles (228 ha), les zones vertes à haute valeur biologique (179 ha), le domaine royal (171 ha), les zones de cimetières (151 ha).
Le PRASLe Plan régional d'Affectation des Sols est l'un des outils majeurs de la politique d'aménagement du territoire régional. Il comprend des prescriptions générales pour l'affectation des sols, des cartes délimitant des zones d'affectation et des prescriptions particulières par zone (notamment pour la protection des espaces verts). Il constitue en outre la référence légale pour l'octroi des permis d'urbanisme, de primes à la rénovation, etc. Il transcrit par ailleurs les objectifs opérationnels du PRD en carte. instaure également des zones de servitude au pourtour des bois et forêts (excepté lorsqu’un plan particulier d’affectation du sol préexiste au PRAS adopté en 2001). Celles-ci correspondent à une zone non aedificandizone d'emprise d'une largeur de quatre mètres à compter des crêtes de berge s'étendant sur une profondeur de 60 mètres (30 mètres à certaines conditions) à partir de la limite des zones forestières.
Les prescriptions du PRAS s’appliquant aux espaces verts ne confèrent qu’un statut de protection relatif aux sites présentant un intérêt écologique : certains actes et travaux y sont interdits mais rien n’est exigé en termes de maintien de la valeur biologique du site. Pour les affectations « zones vertes », « zones vertes de haute valeur biologiqueValeur reconnue d'un site coté sur base d'une série de critères tels que : la présence d'éléments hydrologiques peu perturbés (sources), la diversité et la rareté des espèces locales de plantes et d'animaux, la présence d'espèces rares, la maturité des végétations (site irremplaçable sauf à très long terme, ex. une forêt séculaire), etc. », « zones forestières » et « zones de parcs », il est cependant tenu compte, à des degrés divers, des aspects écologiques de la zone. Les conditions les plus strictes en ce qui concerne la nature s’appliquent aux « zones vertes de haute valeur biologique » destinées à la conservation et à la régénérationEn sylviculture, opération consistant à remplacer un peuplement mûr soit par voie naturelle, soit par voie artificielle. d’habitats naturels abritant des espèces animales et végétales rares ou présentant une diversité biologique importante. Dans ces zones, seuls sont autorisés les actes et travaux nécessaires à la protection des milieux naturels ou des espèces qu’ils abritent ainsi qu’à la réalisation du maillage vertProgramme fondé sur la protection et la création des espaces verts et l'établissement de liens physiques entre eux, qui vise, outre la préservation du patrimoine naturel et l'accroissement de la biodiversité, à rééquilibrer les disparités régionales au niveau de la verdurisation et de la répartition des espaces verts publics, à améliorer les qualités paysagères et à promouvoir la mobilité douce.. Sur le plan légal, ce statut ne garantit cependant en aucun cas la bonne gestion du site.
312 sites d’une superficie de 2.784 ha protégés pour leur valeur de « patrimoine vert »
La notion de patrimoine s’applique au patrimoine architectural et aux sites archéologiques mais aussi au « patrimoine vivant » incluant des sites et arbres remarquables.
En janvier 2023, selon des données de l’IBSA, 145 sites et 5 arbres couvrant une superficie totale de 2.686 ha bénéficiaient du statut de site classé ce qui implique notamment qu’ils ne peuvent pas être démolis. Ces sites englobent des parcs (parc de Bruxelles, bois de la Cambre, ...), des jardins et abords de bâtiments, des arbres remarquables ainsi que des sites semi-naturels non construits ou partiellement construits (Forêt de Soignes, bois du Wilder, Vogelzang…). Ce statut assure une protection très efficace de la valeur patrimoniale du site mais son caractère assez rigide empêche parfois une gestion adaptée au maintien ou à l’accroissement de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore).. 162 sites (dont 120 arbres remarquables), couvrant 98 ha, étaient en outre repris sur la liste de sauvegarde (statut dont les contraintes sont un peu inférieures à celles du classement, voir fiche documentée « Espaces semi-naturels et espaces verts bénéficiant d’un statut de protection »).
La forêt de Soignes compte également deux sites archéologiques classés en 2002 (camp fortifié néolithique et tertres). Notons encore que trois cité-jardin sont classées comme ensembles dont Le Logis et Le Floréal, très verdurisées et dont la qualité biologique est intéressante.
Une zone de 866 ha pour protéger les captages d’eau de distribution
Certaines zones, incluant des espaces verts mais aussi des espaces urbanisés, bénéficient d’un statut de protection visant avant tout à protéger les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.), les eaux souterraines ou les habitats et espèces directement dépendants de l’eau. En règlementant les activités autorisées sur ces zones, cette protection contribue également indirectement à une certaine protection des milieux naturels qui y sont localisés.
La Région bruxelloise compte 4 types de zones liées à la protection des ressources en eau dont notamment une zone de protection des captages d'eau souterraine destinés à alimenter le réseau public de distribution d’eau potable. Cette zone de protection, d’une superficie d’environ 866 ha, est localisée au niveau du bois de la Cambre et de la forêt de Soignes (drève de Lorraine).
Les autres zones se rapportent aux obligations et modalités d’épuration des eaux uséesL'épuration des eaux usées est l'élimination des déchets organiques et chimiques de l'eau jusqu'à un point permettant à la vie biologique dans les rivières, les lacs et les mers de ne pas subir les conséquences du déversement des ces eaux usées purifiées. (zone couvrant l’entièreté de la Région), à la protection des eaux contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole (zone assez semblable à la zone de protection des captages) et enfin, à des zones où l’utilisation de pesticides est interdite tant pour les gestionnaires publics que privés (lieux et établissements fréquentés par des groupes vulnérables, zone de protection des captages, sites Natura 2000 et réserves naturelles ou forestières).
Quatre zones de protection de 543 ha pour limiter l’impact de la surfréquentation en forêt de Soignes
La forêt de Soignes compte quatre zones de protection spéciale (ZPS), statut défini dans l’ordonnance du 30 mars 1995 relative à la fréquentation des bois et forêts dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ce statut, sans implication sur la gestion écologique, vise à créer des zones tampons autour de zones protégées ou à limiter l’impact de la surfréquentation de certaines zones fragilisées (parcelles de recolonisation, de plantation, etc.) ou refuges pour la faune par des restrictions d’usage (chiens tenus en laisse et accessibilité du public limitée aux chemins et sentiers).
Quatre ZPS occupant une superficie de 587 ha ont ainsi été désignées par arrêté en 2007. En 2016, cette superficie a été réduite à un total de 543 ha pour tenir compte de l’élargissement de la réserve forestièreLa réserve forestière est une forêt ou une partie de celle-ci, protégée dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables, ou des peuplements d'essence indigène, et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu. intégrale du Grippensdelle qui chevauchait en partie la ZPS 4.
À télécharger
Fiche méthodologique
Tableaux reprenant les données
- Nombre de réserves naturelles et forestières en Région de Bruxelles-Capitale (.xls)
- Superficie totale de réserves naturelles et forestières en Région de Bruxelles-Capitale (.xls)
Fiches documentées
- Etat local de conservation des espèces des directives habitats et oiseaux en Région bruxelloise - 2018 (.pdf)
- Surveillance des habitats naturels en Région bruxelloise - 2020 (.pdf)
- Espaces semi-naturels et espaces verts bénéficiant d’un statut de protection - 2019 (.pdf)
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Focus : La carte d’évaluation biologique de la Région bruxelloise - 2022
- Focus : Surveillance des habitats naturels en Région bruxelloise -2020
- Focus : Etat local de conservation des espèces couvertes par les directives "Habitats" et "Oiseaux" - 2018
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Etat de la nature en Région de Bruxelles-Capitale - Synthèse, 2022 (.pdf)
- Registre des zones protégées de la Région de Bruxelles-Capitale en application de l’ordonnance cadre eau – annexe 3 au plan de gestion de l’eau 2022-2027, 2019 (.pdf)
- Carte « Sites Nature »
- Carte « Habitats Natura 2000 »
- Carte « Zone de protection en forêt de Soignes »
- Carte « Fragmentation des espaces verts »
Etudes et rapports
- PRIGNON J.-C. 2015. « Des plans de gestion pour les sites archéologiques du camp fortifié néolithique de « Boitsfort-Etangs » et des Tumuli à Watermael-Boitsfort (BE) », in Notae Praehistoricae, 35/20154 : 77-93. (en français uniquement) (.pdf)
Plans et programmes
- Plan régional nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale, 2016 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre I - Etat des connaissances, 2019 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre II - Objectifs et mesures de gestion, 2019 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre III - Plans de gestion des réserves archéologiques, naturelles et forestières, 2019 (.pdf)
Liens utiles
La carte d’évaluation biologique de la Région bruxelloise
Focus - Actualisation : juin 2022
La carte d’évaluation biologique (CEB) est un outil qui permet de suivre et d’objectiver la valeur biologique des zones composant le territoire régional. Il en ressort que les zones de haute et très haute valeur biologiqueValeur reconnue d'un site coté sur base d'une série de critères tels que : la présence d'éléments hydrologiques peu perturbés (sources), la diversité et la rareté des espèces locales de plantes et d'animaux, la présence d'espèces rares, la maturité des végétations (site irremplaçable sauf à très long terme, ex. une forêt séculaire), etc. couvrent 19% de la Région et se trouvent majoritairement au-delà de la première couronne (données 2018-2019). Elles incluent des sites semi-naturels (forêt et bois, prairies, zones humides, etc.) mais aussi des friches urbaines et certains grands parcs.
Depuis 2012, le droit bruxellois prévoit la réalisation d’une carte d’évaluation biologique
L’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature prévoit que Bruxelles Environnement « dresse et actualise une carte d'évaluation biologique du territoire de la Région, incluant un inventaire des sites de haute valeur biologique et dignes de protection ». Elle stipule également que le Gouvernement peut désigner comme réserve naturelleZone constituée par un organisme public ou privé en vue de préserver un spécimen représentatif d'une communauté végétale et animale (biocénose) donnée, principalement dans un but d'ordre scientifique et éducatif. ou comme réserve forestièreLa réserve forestière est une forêt ou une partie de celle-ci, protégée dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables, ou des peuplements d'essence indigène, et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu. les sites identifiés comme « dignes de protection ». Bien que l’ordonnance ne le précise pas explicitement, rien n’empêche par ailleurs que la CEB puisse contribuer à justifier l’octroi d’une protection active au titre de la protection du patrimoine naturel, ou d’une protection passive par un statut de zone verte ou zone verte de haute valeur biologique au Plan régional d’affectation du sol (PRASLe Plan régional d'Affectation des Sols est l'un des outils majeurs de la politique d'aménagement du territoire régional. Il comprend des prescriptions générales pour l'affectation des sols, des cartes délimitant des zones d'affectation et des prescriptions particulières par zone (notamment pour la protection des espaces verts). Il constitue en outre la référence légale pour l'octroi des permis d'urbanisme, de primes à la rénovation, etc. Il transcrit par ailleurs les objectifs opérationnels du PRD en carte.).
La carte d’évaluation biologique (CEB) elle-même n’a cependant qu’un caractère descriptif et indicatif et ne confère aucune protection légale aux sites évalués. La notion de “haute valeur biologique” figurant dans la CEB ne doit donc pas être confondue avec celle, règlementaire quant à elle, de “zone verte de haute valeur biologique” reprise dans le PRAS (voir fiche documentée « Espaces semi-naturels et espaces verts bénéficiant d’un statut de protection »).
Plusieurs cartes d’évaluation biologique du territoire bruxellois depuis 1978
Avant l’instauration de ce cadre légal, plusieurs inventaires de la valeur biologique des espaces constitutifs du territoire bruxellois avaient déjà été réalisés :
- 1978 : CEB réalisée pour l’ensemble de la Belgique (version 1, échelle 1/25.000) ;
- 1996-1998 : CEB réalisée pour la Région bruxelloise et ses alentours sur base d’une collaboration entre l’Instituut voor Natuurbehoud (Région flamande) et Bruxelles Environnement (actualisation de la version 1 pour le périmètre étudié à une échelle 1/10.000) ;
- 2010 : publication de la version 2 de la CEB de la Région bruxelloise (travail de terrain 1998-2000, échelle 1/10.000).
Ces cartes délimitent les milieux naturels et semi-naturels, en caractérisent la typologie écologique de la couverture du sol et leur valeur biologique. Les critères utilisés pour déterminer la valeur biologique des sites sont surtout basés sur les aspects botaniques, lesquels sont en lien étroit avec le potentiel faunistique. Sur base de ces critères, une valeur a été attribuée à chaque unité cartographique (très haute valeur biologique, haute valeur biologique, valeur biologique moindre, complexes d’éléments de valeur différente, etc.).
Les données de la seconde version de la carte ont alimenté la délimitation de zones protégées en Région bruxelloise, comme les sites Natura 2000. Une actualisation de cette seconde version a été réalisée à la demande de Bruxelles Environnement sur base de photographies aériennes de 2018 et a abouti à une 3ème version publiée fin 2021. Elle comporte deux volets, à savoir une actualisation de la carte originelle (limitée aux sites biologiquement les plus intéressants connus lors des premières éditions) et une analyse des infrastructures vertes à l’échelle de chaque îlot composant le territoire de la Région.
Une actualisation de la CEB qui permet d’évaluer l’évolution de la valeur biologique des biotopes les plus intéressants
Seuls les sites qui avaient été identifiés comme biologiquement intéressants (à des degrés divers) lors de l’inventaire précédent ont fait l’objet d’une actualisation. Ceci concerne environ 25 % du territoire bruxellois et correspond à 1807 « polygones » (surfaces délimitées par une ligne fermée, homogènes en termes de valeur biologique et constituant donc une unité cartographique). Les changements d’habitats éventuels relatifs à ces 1807 polygones ont été évalués par comparaison de photos aériennes (orthophotoplans) prises en 1996 et 2018. Des visites de terrain ont été effectuées lorsque la photo-interprétation ne permettait pas de juger de manière fiable l’évolution des habitats. Un découpage de certains polygones définis en 1996 a été réalisé lorsqu’une portion importante de ceux-ci avait évolué.
Exemple d'un polygone à habitat naturel et/ou usage inchangé entre 1996 et 2018
Source : BiotopeAire géographique de dimensions variables, souvent très petites, offrant des conditions constantes ou cycliques aux espèces constituant la biocénose. Environnement sa et Stratec 2020

Les changements d’habitats (naturels) et/ou usages au niveau de chaque polygone étudié ont été caractérisés comme suit:
- urbanisation totale du polygone ;
- habitat et/ou usage inchangé ;
- succession écologique (par ex. peupleraie en voie de régénérationEn sylviculture, opération consistant à remplacer un peuplement mûr soit par voie naturelle, soit par voie artificielle. après mise à blanc) ;
- succession écologique avec risque de perte de la qualité biologique : cette catégorie n’est pas présentée dans la couche finale car, dans ces cas, une visite de terrain a systématiquement été effectuée pour évaluer l’évolution de la qualité ;
- changement partiel des habitats ou de l’usage ;
- changement important des habitats ou de l’usage.
Une valeur correspondant à l’évaluation biologique a été attribuée à chaque polygone de la CEB 1996 et de la CEB 2018.
Les valeurs possibles sont issues de la classification néerlandophone historiquement employée et sont réparties comme suit :
- z : biologiquement très précieux (biologisch zeer waardevol)
- w : biologiquement précieux (biologisch waardevol)
- m : biologiquement moins précieux (biologisch minder waardevol)
- wz : mélange des catégories précédentes
- mz : mélange des catégories précédentes
- mw : mélange des catégories précédentes
- mwz : mélange des catégories précédentes
La comparaison des valeurs attribuées à chaque polygone (données 1996 versus données 2018) permet d’estimer l’évolution de la qualité biologique de l’ensemble des sites « historiques » étudiés. Par exemple, si la valeur attribuée à un polygone est passée de w à m, la dégradation a été considérée comme très importante. Si cette valeur est passée de z à w, la dégradation a été considérée comme faible.
L’analyse effectuée sur cette base a montré que :
- 0,2% des superficies étudiées (soit 9 ha) ont vu leur qualité biologique s’améliorer ;
- 94% des superficies étudiées (soit 3904 ha) ont vu leur qualité biologique se maintenir ;
- 0,1% des superficies étudiées (soit 6 ha) ont vu leur qualité biologique se dégrader faiblement ;
- 2,5% des superficies étudiées (soit 103 ha) ont vu leur qualité biologique se dégrader fortement ;
- 3,2% des superficies étudiées (soit 132 ha) ont vu leur qualité biologique se dégrader très fortement.
94% des superficies identifiées comme sites de grand intérêt en 1996 ont donc vu leur valeur biologique se maintenir entre 1996 et 2018.
Pour 5,6% d’entre elles, cette valeur s’est par contre dégradée, notamment suite à leur urbanisation partielle ou totale. Une amélioration a été observée pour 0,2% de la surface étudiée.
Une méthodologie permettant d’évaluer la valeur biologique de chaque îlot urbain sur base de données géolocalisées
Pour la première fois, l’évaluation de la qualité biologique de tout le territoire régional a par ailleurs été réalisée. L’unité de base sur laquelle l’évaluation a été réalisée est l’îlot urbain, fort employé en aménagement du territoire. Celui-ci correspond à un ensemble de parcelles, bâties ou non, entièrement séparé des autres par des voiries (sur l’ensemble de son périmètre). Les critères utilisés pour l’évaluation biologique des îlots doivent pouvoir être évalués sur base de données géolocalisées disponibles (pas de travail de terrain).
Deux catégories de critères ont été utilisées pour l’évaluation de la valeur biologique des îlots : des critères dits « internes », associés à la capacité d’accueil des îlots, et des critères dits « externes », associés à l’environnement immédiat des îlots. Il s’agit de critères favorables à la préservation et au développement de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., parmi lesquels le degré de végétalisation, la taille de l’îlot, son degré d’ouverture et ses connexions avec d’autres îlots de valeur (propices à la circulation des espèces), l’observation sur le terrain de biotopes particuliers, etc.
Les critères internes et externes d'évaluation
- Critères dits « internes », associés à la capacité d’accueil des îlots :
- surface végétalisée et degré de végétalisation de l’îlot (carte de végétation, données 2016) ;
- présence de biotopes de valeur biologique (CEB 1996 actualisée – données 2018, carte des stations Natura 2000, carte des réserves naturelles) ;
- perméabilité aux déplacements de la faune (sur base du bâti, données urbanistiques).
Les critères « surface végétalisée » (valeur absolue) et « degré de végétalisation » (valeur relative) sont tous les deux considérés afin d’améliorer la discrimination entre les îlots sur base de la végétation en créant un continuum allant de « petite surface végétalisée avec faible proportion de végétation » à « grande surface végétalisée avec forte proportion de végétation ».
Le critère « perméabilité aux déplacements » mesure le degré d’ouverture de l’îlot par rapport aux îlots environnants. Il a été évalué, pour chaque îlot, selon une double règle consistant, d’une part, à évaluer la perméabilité d’un anneau fictif localisé entre 5 et 15 mètres à l’intérieur de l’îlot sur base de la proportion de bâtiments l’occupant et, d’autre part, à évaluer la perméabilité globale de l’îlot sur base de la proportion de bâtiments occupant l’îlot. Le score attribué est ensuite défini sur base du niveau de perméabilité le plus bas.
Perméabilité des îlots
Source : BiotopeAire géographique de dimensions variables, souvent très petites, offrant des conditions constantes ou cycliques aux espèces constituant la biocénose. Environnement sa et Stratec 2020
Légende : Rouge = fermé, orange = semi-ouvert, vert = ouvert

- Critères dits « externes », associés à l’environnement des îlots :
- score des îlots adjacents en ce qui concerne leurs critères internes ;
- présence d’éléments favorables aux mouvements d’individus (connectivité) dans un rayon de 100 m de l’îlot (rivières, talus et accotements végétalisés des voiries et voies ferrées) ;
- présence d’éléments d’intérêt biologique en Flandre (sur base de la CEB de la Région flamande).
L’évaluation globale pour les critères internes et externes correspond à la somme des scores obtenus pour chaque critère. Les scores totaux s’échelonnent potentiellement entre 0 et 9 pour les critères internes, et entre 0 et 6 pour les critères externes, soit un total par îlot pouvant aller de 0 à 15. La carte ainsi obtenue constitue un outil qui permet de suivre et d’objectiver la valeur biologique des zones composant le territoire régional, sur base d’une unité pertinente en termes d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Les voiries n’étant pas des îlots bâtis, elles n’ont pas été intégrées dans le croisement des données. Cependant, la carte des biotopes a pu mettre en lumière les éléments de voiries qui sont jugés importants pour le développement de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore).. Dès lors, ces voiries ont été intégrées dans la carte finale comme éléments linéaires, soit des « voiries avec une connectivité écologique importante ».
Les rapports finaux de cette étude apportent plus de précisions quant à la méthodologie utilisée (voir liens ci-dessous).
Les zones de haute et très haute valeur biologique couvrent 19% de la Région
La carte d’évaluation biologique dans sa nouvelle mouture 2021 résulte du résultat compilé des deux phases d’élaboration, à savoir l’actualisation de la CEB 1996 et l’analyse régionale des îlots. Dans la production finale, les deux évaluations ont été pondérées de manière équivalente (50% chacune pour l’établissement du score final).
La CEB 2021 offre ainsi une cartographie claire de la valeur biologique de tous les îlots au niveau régional, permettant toujours de distinguer les éléments de plus grande importance, qui avaient été évalués historiquement, qui tendent à se détacher de leur « matrice » environnante. L’intérêt de la démarche permet également de ne pas présupposer l’absence de valeur biologique des sites qui n’avaient pas été étudiés dans les dernières décennies.
Carte d’évaluation biologique de la Région bruxelloise (données 2018)
Source : Bruxelles Environnement – Division Espaces verts 2022
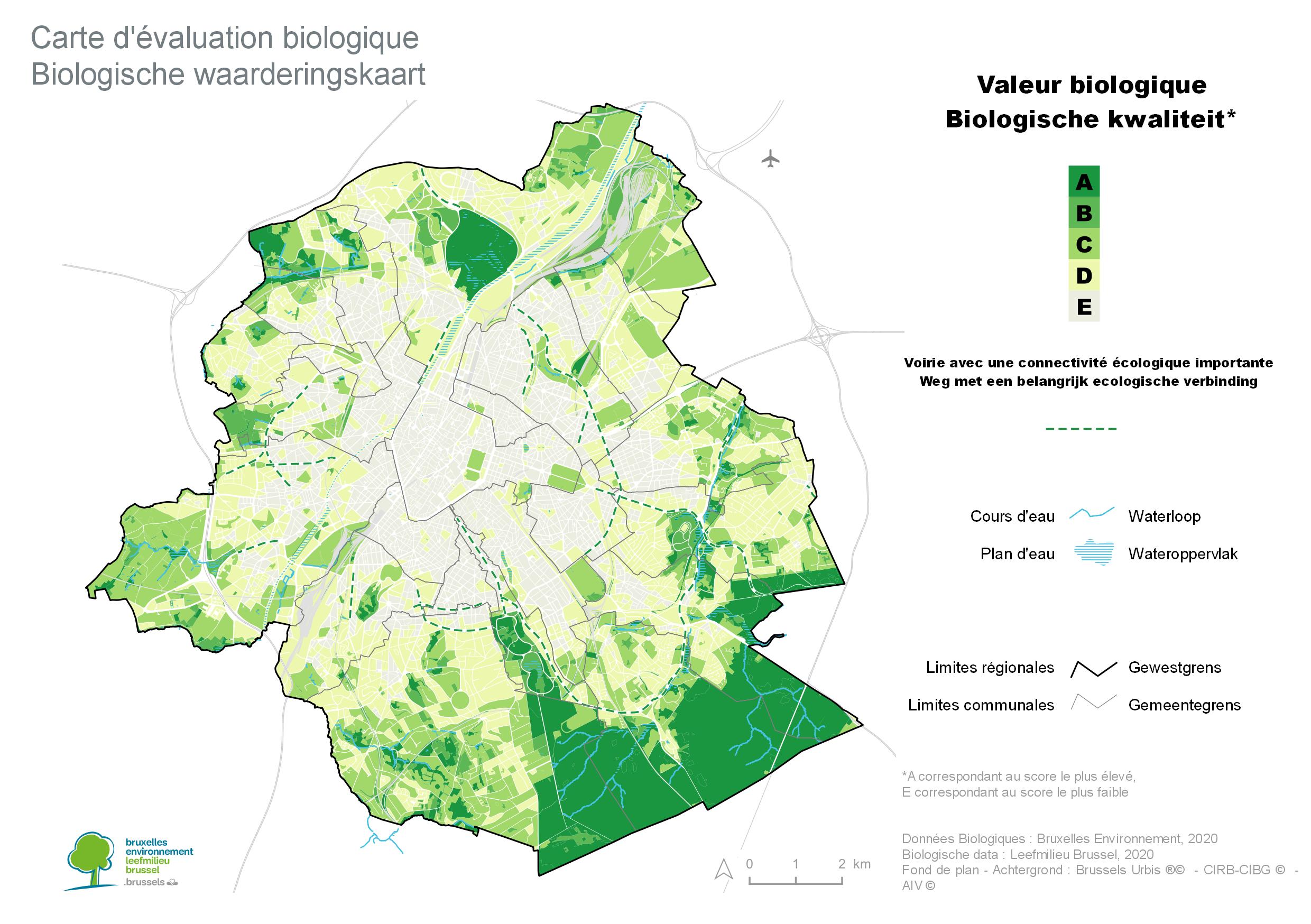
Lien vers la carte interactive
La valeur biologique est à présent exprimée en 5 catégories allant de A à E (A représentant les sites les plus intéressants en termes biologiques et E les plus pauvres). Les sites de haute à très haute valeur biologiqueValeur reconnue d'un site coté sur base d'une série de critères tels que : la présence d'éléments hydrologiques peu perturbés (sources), la diversité et la rareté des espèces locales de plantes et d'animaux, la présence d'espèces rares, la maturité des végétations (site irremplaçable sauf à très long terme, ex. une forêt séculaire), etc. (soit A et B) sont des sites qui contribuent de manière importante à la protection de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). régionale (faune, flore et habitats naturels) et qui étaient pour l’essentiel déjà mis en évidence dans les CEB antérieures.
Description des 5 catégories d'évaluation biologique
Photos illustrant les 5 catégories de valeur biologique
Source : BiotopeAire géographique de dimensions variables, souvent très petites, offrant des conditions constantes ou cycliques aux espèces constituant la biocénose. Environnement sa et Stratec 2020
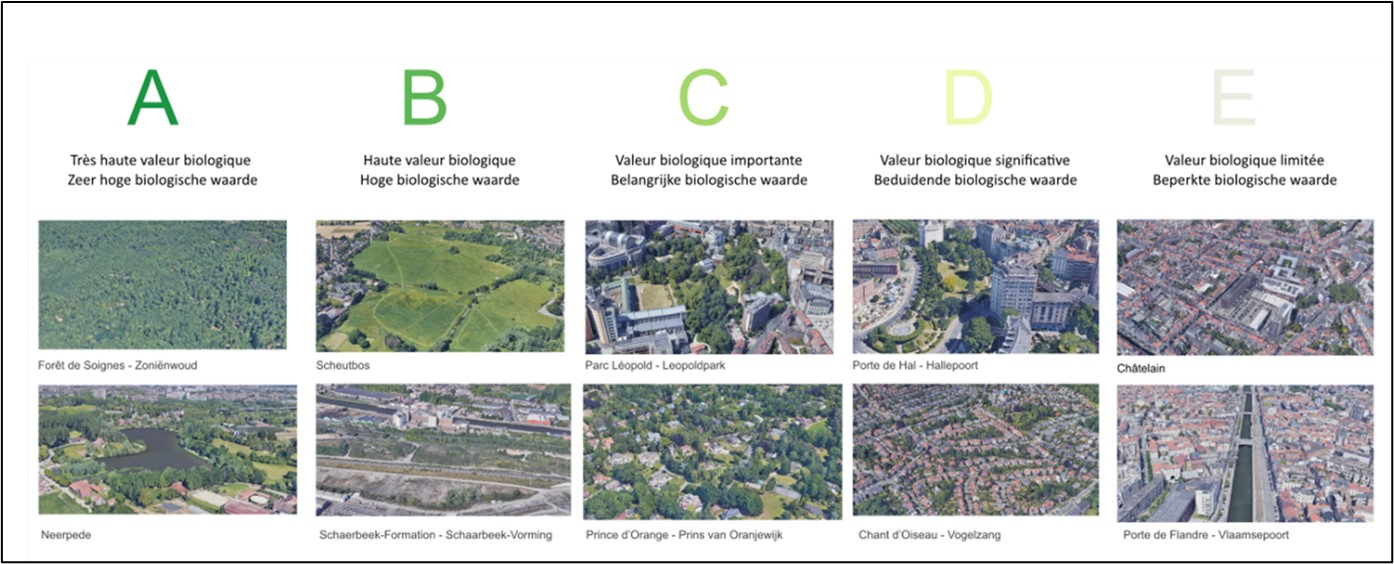
A : Très haute valeur biologiqueValeur reconnue d'un site coté sur base d'une série de critères tels que : la présence d'éléments hydrologiques peu perturbés (sources), la diversité et la rareté des espèces locales de plantes et d'animaux, la présence d'espèces rares, la maturité des végétations (site irremplaçable sauf à très long terme, ex. une forêt séculaire), etc.
La catégorie A regroupe les sites d’une très haute valeur biologique. Ces sites forment les espaces majeurs en termes de biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). sur la Région bruxelloise. Dans de nombreux cas, elles font partie de zones protégées ou caractérisées par un haut degré de naturalité. Se retrouvent dans cette catégorie des sites comme la forêt de Soignes, le Kinsendael-Kriekenput, ainsi que des étangs comme à Neerpede et au parc de Woluwe. Ces sites sont généralement définis avec un degré de détail plus précis que l’échelle des îlots.
B : Haute valeur biologique
Dans la catégorie B se retrouvent des sites de haute valeur biologique. Ces sites forment également les espaces centraux en termes de biodiversité sur la Région bruxelloise. La différence avec la catégorie A est peu marquée et la distinction se fait principalement au regard du biotope et de la naturalité. Dans beaucoup de cas, l’association de ces deux catégories forme un ensemble continu. On retrouve dans la catégorie B des sites comme le parc de Woluwe, le bois de la Cambre et une série de friches comme sur le site de Schaerbeek formation. Ces sites sont généralement définis avec un degré de détail plus précis que l’échelle des îlots.
C : Valeur biologique importante
La catégorie C regroupe les zones d’une valeur biologique importante. Ces espaces verts sont souvent importants au regard de leur surface continue et apportent donc une grande contribution aux infrastructures vertes de la Région. On retrouve dans cette catégorie des sites comme le parc Josaphat, le parc du Cinquantenaire et le cimetière de Bruxelles. De vastes parties de quartiers résidentiels en marge de la forêt de Soignes peuvent être reprises dans cette catégorie.
D : Valeur biologique significative
La catégorie D regroupe les zones d’une valeur biologique significative. On y retrouve des ensembles verts de taille moyenne (Porte de Hal), de grands espaces continus peu végétalisés (zones industrielles le long du canal) ou une association de petits espaces bien connectés entre eux (quartiers résidentiels avec habitats ouverts). Ces espaces apportent une contribution importante à la biodiversité et aux infrastructures vertes en milieu urbain.
E : Valeur biologique limitée
La catégorie E rassemble les zones avec une valeur biologique limitée. Elles se composent principalement d’espaces fermés en milieu urbain dense, où se retrouvent des éléments verts ponctuels, parfois connectés entre eux. Les infrastructures vertes inscrites dans la catégorie E sont, entre autres, des jardins en intérieur d’îlot, des squares ou des petits espaces ouverts. Ces zones sont importantes pour le développement de la faune liée au bâti comme le martinet noir ou le moineau domestique.
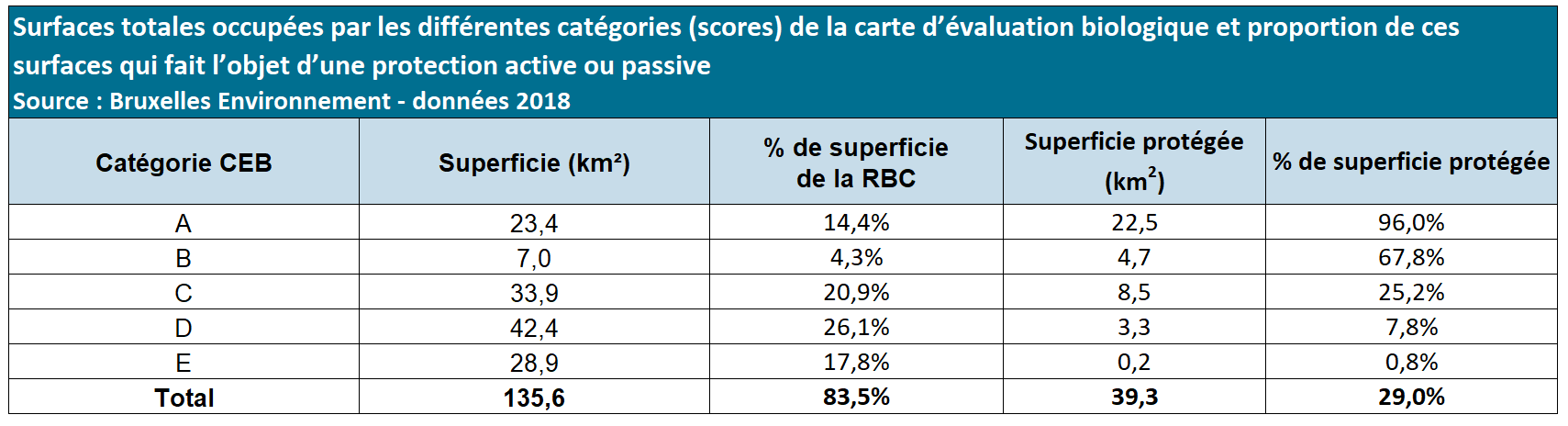
Notons que le total des superficies associées aux différentes catégories n’équivaut pas à la superficie régionale car certains éléments n’ont pas été évalués (par ex. voiries sans intérêt biologique).
Les sites de valeur biologique importante à très haute (A, B, C) couvrent près de 40% du territoire régional. Ces sites participent le plus à la conservation et au développement de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). en ville. Ils se trouvent très majoritairement dans la seconde couronne bruxelloise, avec une surreprésentation dans sa partie sud-est (Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert). Ces terrains témoignent du passé forestier et rural de la périphérie bruxelloise et sont, dans certains cas, relativement bien connectés entre eux.
La plupart des sites de catégories A et B (19% du territoire) sont protégés par différents outils règlementaires, soit via une protection active (sites Natura 2000, réserves naturelles et forestières), soit par une protection passive (zones vertes du PRASLe Plan régional d'Affectation des Sols est l'un des outils majeurs de la politique d'aménagement du territoire régional. Il comprend des prescriptions générales pour l'affectation des sols, des cartes délimitant des zones d'affectation et des prescriptions particulières par zone (notamment pour la protection des espaces verts). Il constitue en outre la référence légale pour l'octroi des permis d'urbanisme, de primes à la rénovation, etc. Il transcrit par ailleurs les objectifs opérationnels du PRD en carte., excepté les zones de sport ou de loisir de plein air) (voir indicateur «Sites semi-naturels et espaces verts protégés »). En effet, 96% de la surface des sites de catégorie A font l’objet d’au moins un statut de protection. Pour les sites de catégorie B, la surface protégée par ces mêmes statuts atteint 67,8%, alors que l’on tombe à 25,2% pour la catégorie C.
Pour les îlots de catégories D et E, on observe des contextes urbains très variables en fonction de leur type d’affectation. On peut par exemple se trouver dans un tissu urbain résidentiel, industriel, commercial ou administratif. Pour ces îlots, les stratégies de développement de la nature dépendront dans une large mesure du type d’affectation.
Au sein de la première couronne, population et bâti se densifient (voir focus sur la couverture végétale de la Région bruxelloise). Les sites de catégories A et B y sont quasi absents et ce sont les grands espaces verts publics – en général des parcs historiques – qui contribuent majoritairement à la qualité biologique. On prendra pour exemples le parc du Cinquantenaire, le parc Léopold, le parc de Forest et le parc Josaphat qui sont repris en catégorie C. Dans cette partie de la ville, les espaces végétalisés sont bien plus morcelés. Les jardins privés et les axes de communication comme les avenues plantées et les talus de chemin de fer assurent parfois la connexion entre les espaces verts sous forme de « pas japonais » ou « stepping stones » (espace d’habitat naturel de petite taille jouant le rôle de relais discontinu), ou même de corridor écologiquePetite bande de végétation utilisée par la faune et la flore et qui permet l'échange potentiel d éléments biotiques entre deux zones., les continuités terrestres étant les plus efficaces en termes de déplacement des espèces.
Lorsque l’on pénètre dans le Pentagone, la très grande majorité des îlots bâtis sont en catégorie E, soit la catégorie la plus basse. Quelques zones éparpillées sont reprises en catégorie D, comme le parc d’Egmont, le square de la Putterie et la zone des anciens quais. Les uniques îlots du Pentagone qui atteignent la catégorie C sont le parc de Bruxelles et le Palais royal.
La CEB, un outil d’analyse et d’aide à la planification territoriale
La CEB fournit des informations sur la valeur biologique des différentes zones composant le territoire régional. Elle constitue un outil d’analyse et d’aide à la planification territoriale, et peut être croisée avec d’autres cartes thématiques (sols, eau, plans d’affectation, etc.). Elle permet notamment d’identifier les sites importants pour la préservation de la biodiversité, qui mériteraient un statut de protection ou un renforcement de celui-ci.
Cette carte concourt aussi à l’actualisation d’autres documents stratégiques, tels que la représentation cartographique du réseau écologique bruxellois défini par l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, ou la révision du Plan régional d’affectation du sol.
La carte ci-dessous illustre les sites de valeur biologique A ou B qui ne bénéficient actuellement de protection ni au PRAS comme zones d’espaces verts ou agricoles (hormis les zones de sport ou de loisir de plein air), ni en tant que réserves naturelles ou forestières, ni en tant que zones spéciales de conservation Natura 2000, ni comme sites classés au titre du patrimoine naturel.
Carte d’évaluation biologique de la Région bruxelloise : zones A et B qui ne font pas l’objet d’une protection active ou passive (données 2018)
Source : Bruxelles Environnement – Division Espaces verts 2022
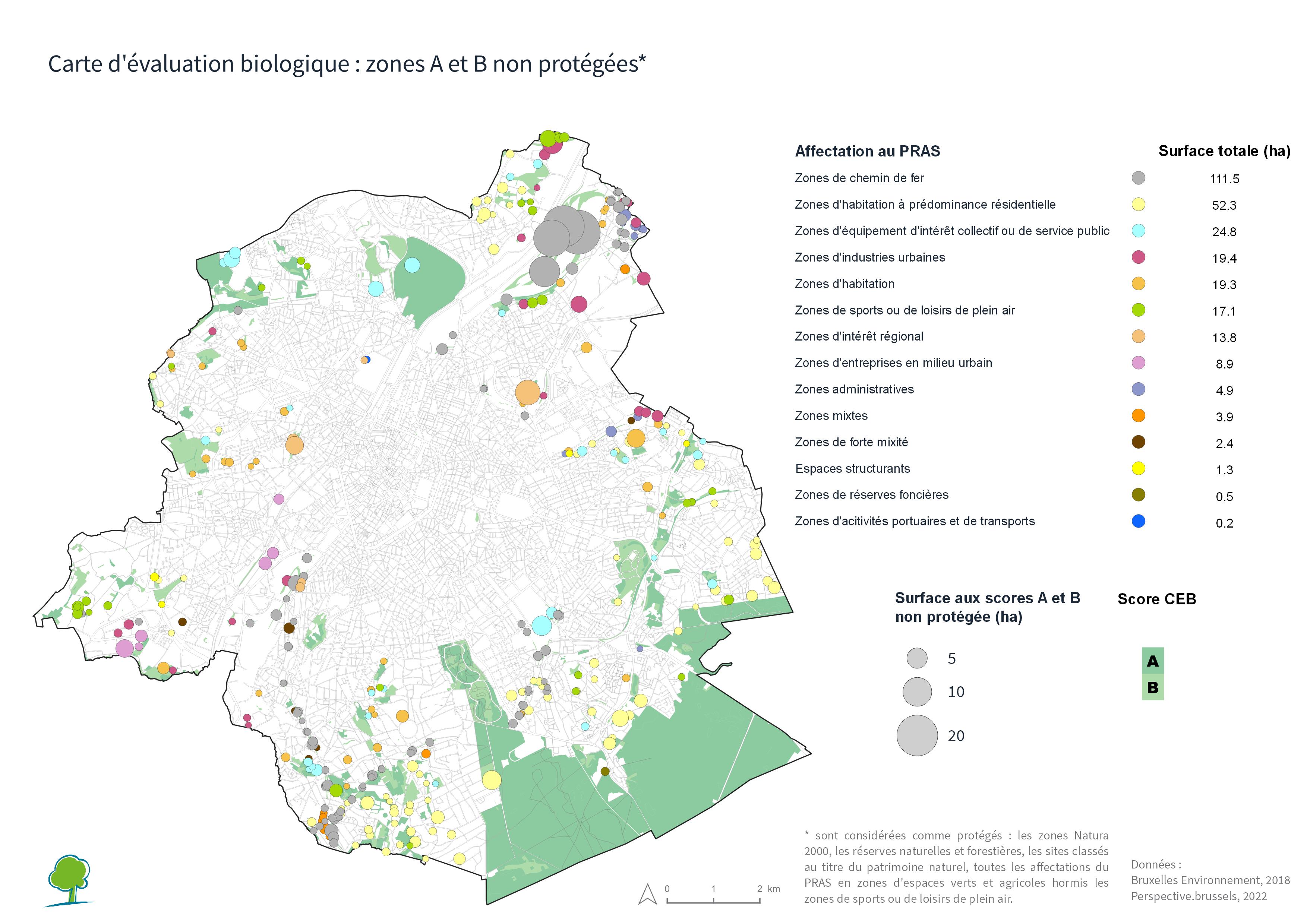
La CEB, un outil parmi d’autres
A la suite (ou en anticipation) de sa publication fin 2021, la carte d’évaluation biologique a été avancée comme l’un des outils phares de la politique de conservation de la nature en Région bruxelloise. Il faut néanmoins contextualiser l’outil – qui reste strictement indicatif – et faire part de ses limites méthodologiques et interprétatives. La carte d’évaluation biologique ne prétend pas être la carte totalisant la somme des connaissances sur l’écosystèmeC'est l'ensemble des êtres vivants (faune et flore) et des éléments non vivants (eau, air, matières solides), aux nombreuses interactions, d'un milieu naturel (forêt, champ, etc.). L'écosystème se caractérise essentiellement par des relations d'ordre bio-physico-chimique. urbain bruxellois.
Il convient d’abord de garder à l’esprit que cette carte ne prend en compte que des paramètres liés aux habitats naturels et à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore).. Des éléments tels que la contribution paysagère, l’importance socio-récréative, la valeur patrimoniale, ou encore l’importance au niveau local comme zone d’infiltration ou comme îlot de fraîcheur, ne sont pas intégrés dans l’analyse. Le score obtenu n’est donc pas représentatif de la “valeur environnementale” ou “écosystémique” au sens large de chaque élément évalué. Les espaces verts du centre-ville et des zones de carence en espaces verts accessibles au public, malgré une valeur biologique moindre (espaces peu connectés au réseau écologique, parcs très fréquentés par le public, végétation plus pauvre, etc.), peuvent avoir une « valeur environnementale » plus élevée que ce que traduit leur score sur la CEB.
La CEB, telle que communiquée, ne rend par ailleurs pas compte des évolutions temporelles des habitats, tant par la positive (amélioration qualitative, création d’espaces verts…) que par la négative (dégradation des espaces, minéralisation, urbanisation…) pour tout le territoire régional. Elle doit être considérée comme une photographie à un “instant t”, et les interprétations et analyses tendancielles sont présentées par ailleurs, notamment dans le rapport sur l’état de l’environnement ou le rapport sur l’état de la nature.
Étant en partie établie sur la carte d’évaluation biologique antérieure, qui ne portait que sur certaines entités historiquement déterminées comme d’intérêt biologique, l’évaluation peut rendre imparfaitement compte de la valeur biologique de certains terrains privés (peu ou pas accessibles) ou de petits éléments écologiques non répertoriés à l’époque des premières CEB. De la même manière, si la faune a bien été intégrée aux analyses des sites historiques, les données disponibles pour la répartition des espèces restent pour l’essentiel non systématiques et plus « opportunistes » dans les sites privés. Pour l’évaluation biologique des îlots à l’échelle de l’ensemble du territoire, la prise en compte des données liées à la végétalisation et à la fragmentation – et donc d’une certaine capacité d’accueil de la faune – s’est donc révélée plus pertinente.
L’analyse par îlot urbain, si elle présente l’avantage d’adopter une unité bien connue des urbanistes et planificateurs, peut engendrer quelques biais à petite échelle, notamment sur des sites en cours de développement urbain. C’est le cas pour les très grands îlots qui peuvent être partiellement traversés par des voiries, entièrement traversés par des voies ferrées, et faire l’objet d’une urbanisation plus ou moins forte, mais dont la surface totale, notamment, tire le score vers le haut. Néanmoins, les variables relatives (taux de végétalisation, perméabilité interne/externe) permettent de conserver un résultat pertinent.
Sur ces sites en évolution, la situation peut par ailleurs évoluer très fortement en quelques mois, soit plus vite que le temps nécessaire à l’acquisition des données, à leur traitement, à la constitution de la carte et sa validation (plus de 3 ans pour l’ensemble du processus). Localement, les résultats peuvent donc être moins fiables. La confrontation des données issues de la CEB avec celles des autres cartes d’analyse territoriale (orthophotoplans disponibles sur une base annuelle, cartes historiques, carte du réseau écologique, carte de la végétation, observations de la faune, etc.) permet d’affiner les interprétations en tenant notamment compte de données plus récentes, au fur et à mesure de leur disponibilité.
Les données de la CEB sont donc présentées à titre indicatif et ne justifient pas l’économie d’une analyse au cas par cas, y compris sur site. Cette analyse doit constituer un préalable à tout plan ou projet (notamment, dans le cadre des rapports et études d’incidences environnementales).
À télécharger
Fiches documentées
Fiches de l’Etat de l’environnement
- Focus : Sites semi-naturels et espaces verts protégés (2021)
- Focus : Couverture végétale en Région bruxelloise (2022)
- Focus : Surveillance des habitats naturels en Région bruxelloise (2020)
- Focus : Patrimoine forestier de la forêt de Soignes bruxelloise (2020)
- Focus : Habitats naturels dans les espaces verts bruxellois (2011)
Etudes et rapports
- DUBOIS Q., 2020. Actualisation de la carte d’évaluation biologique de la Région de Bruxelles-Capitale. Note explicative de la phase 1 – carte des biotopes, Biotope environnement sa et Stratec, Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 9 p. (.pdf)
- DUBOIS Q., 2020. Actualisation de la carte d’évaluation biologique de la Région de Bruxelles-capitale. Note explicative de la phase 2 - Evaluation de la qualité biologique des îlots urbains à l’échelle de la Région de Bruxelles-Capitale (.PDF), Biotope environnement sa et Stratec, Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 12 p. (.pdf)
Plans et programmes
Liens utiles
La couverture végétale en Région bruxelloise
Focus – Actualisation : novembre 2023
La moitié du territoire bruxellois est couvert par de la végétation. Ce pourcentage moyen, relativement élevé, cache cependant de fortes disparités spatiales :
- dans le pentagone, le taux de végétalisation moyen est de 13%. Il est de 26% en première couronne. De nombreux îlots urbains y sont couverts par moins de 10% de végétation;
- la seconde couronne est nettement plus végétalisée : si l’on ne tient pas compte de ses zones pas ou pratiquement pas habitées (forêt de Soignes, bois de la Cambre, Neerpede), le taux de végétalisation moyen y est de 52%.
30% de la superficie régionale est couverte par de la végétation haute, avec ici aussi de très fortes différences entre communes et quartiers.
Pourquoi cartographier la couverture végétale ?
En milieu urbain, les espaces verts et, plus largement, la végétation, remplissent de nombreuses fonctions : espaces de détente, de loisirs, de calme ou encore de rencontres, embellissement de la ville, ombrage et rafraîchissement de l’air, habitats pour la faune et la flore, infiltration des eaux pluviales, filtration de polluants, captage du dioxyde de carbone, protection contre l’érosion des sols, production de légumes, fruits et bois... La végétation en ville contribue à la qualité de vie et à la santé des citadins et constitue un support à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore).. Elle améliore aussi la capacité des villes à résister aux effets des changements climatiques (inondations, vagues de chaleur, sécheresses…).
Extrait de la carte de la répartition de la couverture végétale haute et basse (2021)
Source : Bruxelles Environnement 2021 (Géodata)

Le suivi spatialisé de la végétation (couverture végétale, espaces verts accessibles, habitats naturels, espaces non bâtis, etc.), qualitatif et quantitatif, fournit de précieuses informations pour une planification durable de la ville. En particulier, le taux de couverture végétale, combiné avec d’autres paramètres, apporte des indications relatives à la progression de l’urbanisation et au grignotage et à la fragmentation des espaces verts, au caractère plus ou moins vert d’un quartier, à la perméabilité des sols, à la présence d’îlots de fraîcheur ou encore, à la captation de dioxyde de carbone via la photosynthèse. En contribuant à établir des diagnostics, à dégager des tendances ou à évaluer des scénarios, ces données sont nécessaires aux processus décisionnels de planification territoriale. Elles interviennent dans la réalisation d’autres travaux cartographiques comme la carte des îlots de fraîcheur ou du réseau écologique bruxellois.
Au cours de ces dernières décennies, plusieurs cartes de la couverture végétale ont été réalisées mais ne sont pas totalement comparables entre elles
Différentes sources peuvent être utilisées pour assurer le suivi de la végétation : télédétection (photos aériennes et images satellitaires), validations ou identifications de terrain, bases de données administratives (cadastre, espaces verts, aménagement du territoire, voiries), etc. Celles-ci apportent des informations de natures différentes et complémentaires. La télédétection présente des atouts, notamment en termes de vision globale, de reproductibilité des données ou encore, de combinaison des données obtenues avec d’autres types de données géoréférencées au sein de systèmes d’information géographiques.
En 1997, une cartographie des espaces verts bruxellois a été réalisée à partir de plusieurs types de données : données topographiques, administratives et cadastrales, photos aériennes infrarouge, enquêtes de terrain complétées par des documents divers. Selon cette étude (IGEAT-ULB, Laboratoire de botanique systémique et de phytosociologie de l’ULB & COOPARCH 1997), les espaces verts pris au sens large occupaient dans les années ’90 une superficie de 53% du territoire (voir fiche « Degré de verdurisation et espaces verts »).
Une dizaine d’années plus tard, une nouvelle cartographie a été établie sur base d’images satellitaires haute résolution (pixel de 2,4 x 2,4 mètres) prises par le satellite Quickbird au printemps 2008. L’exploitation de ces images a permis d’estimer que la végétation couvrait 54% du territoire régional (Van de Voorde et al. 2010, voir fiche « Analyse des surfaces non bâties en RBC par interprétation d’images satellitaire » ). La mission Quickbird s’est achevée en 2015, ce type d’images satellitaires n’est donc plus disponible.
En 2016, les données de végétalisation ont été actualisées sur base d’images Worldview II de résolution 0,5 m prises en juillet, période plus propice à l’évaluation de la végétation. La couverture végétale a été estimée à 54,4%. Néanmoins, les différences de paramètres entre les images de 2008 et de 2016 (couloirs et dates de survol différents, résolution variable des images, …) rendent la comparaison peu précise.
La part du territoire imperméabilisée a aussi été cartographiée
La part de surface imperméabilisée est également un indicateur reflétant la couverture végétale même si l’une ne constitue pas le stricte « négatif » de l’autre (la couverture végétale inclut la couronne des arbres, certains sols perméables ne sont pas végétalisés, etc.). L’évolution du taux d’imperméabilisation en Région bruxelloise a aussi fait l’objet de cartographies. L’analyse détaillée de données cartographiques et de télédétection a ainsi estimé que le taux d’imperméabilisation au niveau régional est passé d’environ 26% à 47% entre 1950 et 2006 (Vanhuysse et al. 2006, voir REE 2003-2006 « Prévention et gestion des inondations dues aux pluies d’orage estivales »).
Une nouvelle carte des surfaces imperméables a été réalisée en s’appuyant sur l’interprétation d’images satellites et de photos aériennes. Les résultats de cette étude estiment le pourcentage des surfaces imperméables en Région de Bruxelles-Capitale en 2022 à 53,2%. Les surfaces imperméables incluent les revêtements de sol artificiels, les bâtiments, les parkings, les sols compactés, les toitures vertes. Les surfaces perméables englobent quant à elles les sols couverts de végétation, les sols nus et les zones d’eau ainsi que les terrains de gazon naturels et artificiels (difficulté du modèle d’établir la distinction). Les zones ferroviaires sont considérées comme perméables ou imperméables en fonction du type de revêtement.
Les chiffres de 2022 n’étant pas directement comparables à ceux de l’étude de 2006 (différences dans la zone d’étude et dans la méthodologie), un travail additionnel a été réalisé pour permettre une comparaison. Il en ressort que la progression de la part des surfaces imperméables a poursuivi une tendance linéaire entre 1955 et 2022, passant de 26% à 53% soit un peu plus du double.
Le rapport « Carte des surfaces imperméables de la Région de Bruxelles-Capitale 2022 » ainsi que les données sont accessibles sur le site de Bruxelles Environnement en cliquant ici.
La couverture végétale régionale cartographiée sur base d’une méthodologie constante depuis 2020
Un partenariat a été établi entre Bruxelles Environnement et Paradigm afin de permettre d’effectuer une cartographie de la couverture végétale sur une base régulière et selon une méthodologie reproductible. Ceci facilitera à l’avenir l’interprétation des données permettant d’estimer les évolutions de la végétation.
Extrait d’une photographie aérienne de la Région bruxelloise
Source : Orthophoto 2020 PIR, Paradigm-Urbis

La première carte établie sur cette base a été réalisée à partir de photographies aériennes infrarouges prises en septembre 2020 (commandées par Paradigm). Le processus ne nécessitant pas de travailler avec le haut niveau de détail de l’image (pixel de 5 cm x 5 cm), un prétraitement des images a réduit la résolution à 2 m.
En résumé, l’analyse consiste à réaliser une distinction entre zones vertes et non vertes en se basant sur un indice de végétation. L’indice utilisé est le « Normalized Difference Vegetation Index » (ou NDVI) qui analyse le rapport entre la lumière dont les longueurs d’onde se trouvent dans le proche infrarouge et celles se trouvant dans le rouge (pic d’absorption de la chlorophylle). La construction de cet indice, couramment utilisé, permet de distinguer de manière assez fine les zones ombragées, quantitativement importantes en milieu urbain. La végétation basse a été différenciée de la végétation haute (plus de 2 mètres) sur base d’une interprétation stéréoscopique (c’est-à-dire d’une technique, ici automatisée, permettant une perception du relief à partir de deux photographies aériennes légèrement décalées et combinées comme le ferait notre cerveau avec les images reçues par nos yeux).
Attention
Même avec cette méthodologie reproductible, la comparaison de la couverture végétale au cours du temps comportera toujours une petite marge d’imprécision liée à différents facteurs : prises de vue à des périodes de végétation différentes (y compris si les dates sont identiques vu les variations naturelles des cycles de végétation), croissance de la végétation au cours du temps (canopée plus couvrante), parcelles agricoles dont le sol peut être nu au moment des prises de vue, couverture nuageuse au-dessus de zones végétalisées, etc.
Des petites variations interannuelles du taux de végétalisation à l’échelle régionale ne sont donc pas nécessairement toujours associées à une perte de végétation au profit de surfaces bâties. Excepté lorsque les variations interannuelles sont importantes, l’établissement d’une tendance en matière de taux de végétalisation nécessite de s’appuyer sur un suivi portant sur quelques années et/ou sur des connaissances/validations de terrain au niveau des (principales) zones où la photo-interprétation automatisée a révélé un changement.
De plus amples informations sur la méthodologie d’évaluation du taux de végétalisation sont disponibles sur le site Internet de Bruxelles Environnement.
Une couverture végétale fortement liée à la morphologie de la ville
La carte de la couverture végétale, obtenue selon la méthode explicitée ci-dessus, indique la présence et la répartition de la végétation en Région bruxelloise. Elle représente le taux de couverture végétale (arbres, arbustes, végétation basse, toitures vertes, friches enherbées, etc.) – ou taux de végétalisation – à l’échelle de chaque îlot urbain (ensemble de parcelles, bâties ou non, séparées des autres par des voiries).
Notons que la couverture végétale ainsi estimée diffère quelque peu de la superficie de végétation se trouvant au niveau du sol du fait de la prise en compte de la couronne (plus large que le tronc) des arbres implantés en voiries et des toitures vertes. Par ailleurs, les éventuels champs ou chantiers non couverts par de la végétation durant la période de la prise des photos aériennes analysées ne sont pas pris en compte. Un traitement automatique permet de ne pas comptabiliser comme de la végétation haute les champs couverts par des cultures de plus de 2 mètres (maïs en particulier).
Le taux de végétalisation, mis en regard du nombre d’habitants concernés, a été calculé par grands « secteurs urbains » (terminologie propre) : pentagone, première couronne au nord-ouest du canal, première couronne au sud-est du canal, seconde couronne au nord-ouest du canal, seconde couronne au sud-est du canal (de part et d’autre de la forêt de Soignes), forêt de Soignes et Neerpede.
50,5% du territoire est couvert par de la végétation mais ce taux est spatialement très variable (2021)
Source : Bruxelles Environnement 2023
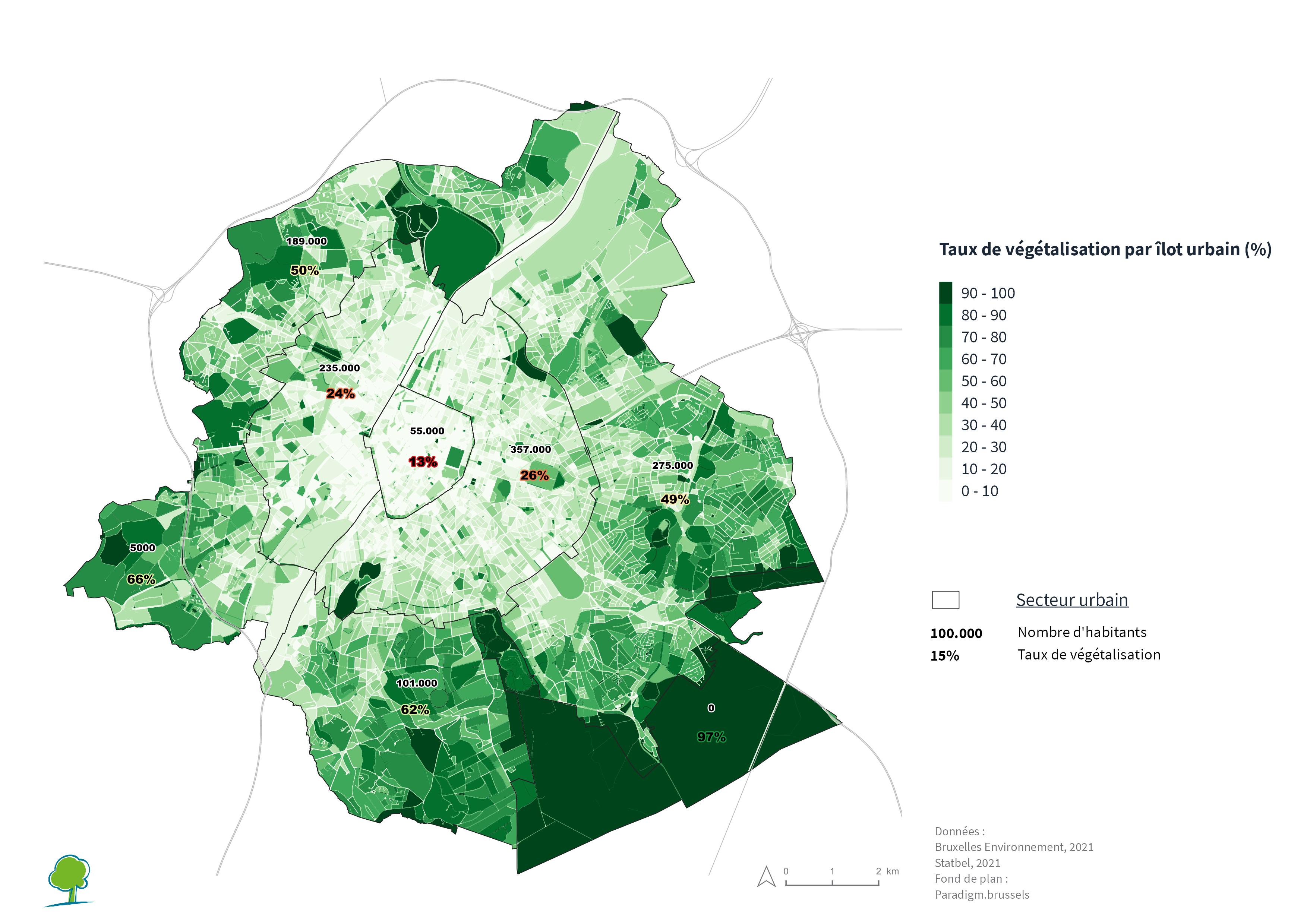
Bon à savoir
A l’échelle globale, environ 50,5% du territoire bruxellois est couvert par de la végétation (2021). Ce taux de végétalisation n’est plus que de 44,5% si l’on ne comptabilise pas la forêt de Soignes.
Mais ce pourcentage moyen cache de très fortes disparités spatiales :
- dans le pentagone (55 000 habitants), le taux de végétalisation moyen est de 13%. Il est de 26% en première couronne (592 000 habitants). De nombreux îlots urbains y sont couverts par moins de 10% de végétation ;
- la seconde couronne (570 000 habitants) est nettement plus végétalisée, en particulier dans le sud-est et les zones surtout périphériques à l’ouest du canal. Si l’on ne tient pas compte des zones peu ou pas habitées (forêt de Soignes, bois de la Cambre, Neerpede), le taux de végétalisation moyen en seconde couronne est de 52% soit le double de celui de la première couronne et le quadruple de celui du pentagone. Si l’on considère l’entièreté de la seconde couronne - forêt de Soignes, bois de la Cambre et Neerpede compris – ce taux de végétalisation moyen est de 60%
En 2020, le taux de couverture végétale avait été estimé à 52%. La réduction apparente de 1,5% de couverture végétale entre 2020 et 2021 peut s’expliquer par plusieurs facteurs :
- poursuite de l’urbanisation ;
- méthodes et données utilisées pour l’extraction de la végétation devenant de plus en plus précises (par exemple, les terrains synthétiques ont été mieux détectés comme non végétalisés en 2021) ;
- un contexte au temps t des photos aériennes de 2020 et 2021 qui peut faire varier légèrement le résultat (terres labourées remplaçant des terres sous culture, turbulence nuageuse au-dessus des zones végétalisées…).
En revanche, l’évolution constatée ne peut pas s’expliquer par une différence de conditions climatiques dans la mesure où le printemps et l’été 2021 ont été pluvieux (contrairement à 2020).
Logiquement, le taux de végétalisation est assez lié à la morphologie de la ville. Il est plus faible dans les quartiers où le bâti est dense et les îlots souvent fermés par un bâti continu. Il est aussi peu élevé dans le tissu (post) industriel situé le long du canal. Il est au contraire plus élevé dans les quartiers d’habitats moins denses avec des îlots ouverts ou semi-ouverts. Les zones vertes se concentrent en particulier dans le sud-est et les zones surtout périphériques à l’ouest du canal, notamment dans et autour de la forêt de Soignes, dans la vallée de la Woluwe, à Neerpede, Ganshoren, Jette, Laeken et Neder-Over-Heembeek. La forêt de Soignes, à elle seule, couvre 10% du territoire régional. Du fait de sa localisation, elle profite avant tout aux habitants du sud-est de la Région.
Une distinction a été faite entre la végétation haute (plus de 2 mètres), de type arbustive et arborée et basse.
Le centre ville et les quartiers jouxtant le canal apparaissent particulièrement pauvres en arbres et arbustes
Source : Bruxelles Environnement 2023
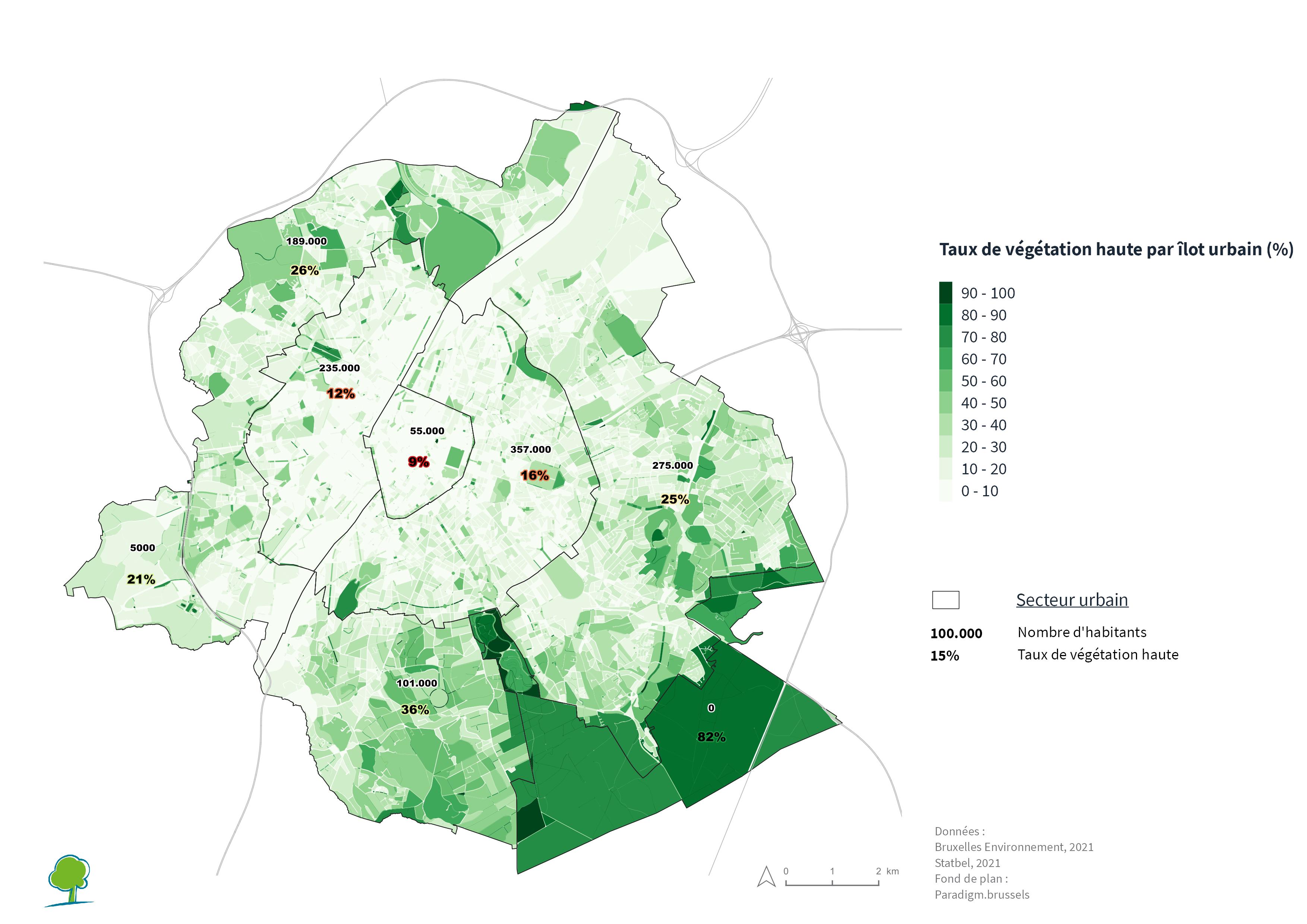
Si l’on s’en réfère à la « règle 3-30-300» proposée par un chercheur-forestier en 2021 (Konijnendijk C.), chaque citadin devrait pouvoir apercevoir au moins 3 arbres de son habitation, vivre dans un environnement proche où la couverture arborée est d’au moins 30% et à moins de 300 mètres d’un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières.. Un institut de recherche a mis en évidence une corrélation positive entre le respect de cette règle et la santé mentale des Barcelonnais (Nieuwenhuijsen M. et al, 2022). Cette règle s’avère toutefois difficile à atteindre dans les villes denses.
Environ 30% du territoire bruxellois est couvert par de la végétation haute mais on observe ici aussi de très fortes disparités entre communes et quartiers. La couverture de végétation haute s’étage ainsi entre 11% (Saint-Gilles) et 65% (Watermael-Boitsfort). Le centre-ville et les quartiers jouxtant le canal apparaissent particulièrement pauvres en arbres et arbustes. Seules 5 communes ont une couverture type arborée sur plus de 30% de leur territoire (Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem, Woluwé -Saint- Pierre et Jette).
Une donnée similaire est également collectée, à partir d’images satellites, pour un millier de villes européennes dans le cadre du projet européen Copernicus (volet surveillance terrestre). D’après cette source, la couverture moyenne de la canopée pour l’ensemble des villes européennes est de 28%, soit sensiblement moins que les 37% estimés selon cette même source pour la Région bruxelloise (2018). Avec des taux de canopée très proches, la Région bruxelloise ainsi que Namur et Leuven sont les villes belges les plus arborées. La présence de la forêt de Soignes sur 10% du territoire bruxellois explique ce score particulièrement élevé.
Remarquons que cette carte est fortement liée à celle des îlots de fraicheur (voir focus Cartographie des îlots de fraicheur à Bruxelles ). Le phénomène d’îlot de chaleur urbain est en effet d’autant plus prononcé que l’urbanisation est importante et que la végétation est peu présente. A cet égard, les couronnes des arbres s’avèrent particulièrement efficaces pour améliorer localement le confort thermique ressenti (voir focus Végétaliser pour refroidir les espaces urbains : des solutions fondées sur la nature ).
Moins de 1/5ème des territoires des communes de Saint-Josse et Saint-Gilles couvert par de la végétation
Sans surprise, le taux de couverture végétale diffère sensiblement entre communes. Une différence marquée s’observe entre les communes périphériques du sud-est dont le taux de végétalisation s’étage entre 64% et 85% (Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem, Uccle, Watermael-Boitsfort) et le reste de la Région (de 17% à 50% de végétalisation). Les taux les plus faibles s’observent dans les communes de Saint-Josse et Saint-Gilles dont moins de 1/5ème du territoire est recouvert par de la végétation (couronne des arbres comprise). Ces deux communes, tout comme le pentagone (dont le taux de végétalisation est de 13%), concentrent des quartiers très denses. Ces disparités en termes de couverture végétale sont encore plus criantes si on les rapporte au nombre d’habitants par commune (voir tableau ci-dessous).
Un déficit de végétation dans les communes les plus centrales
Source : Bruxelles Environnement 2023
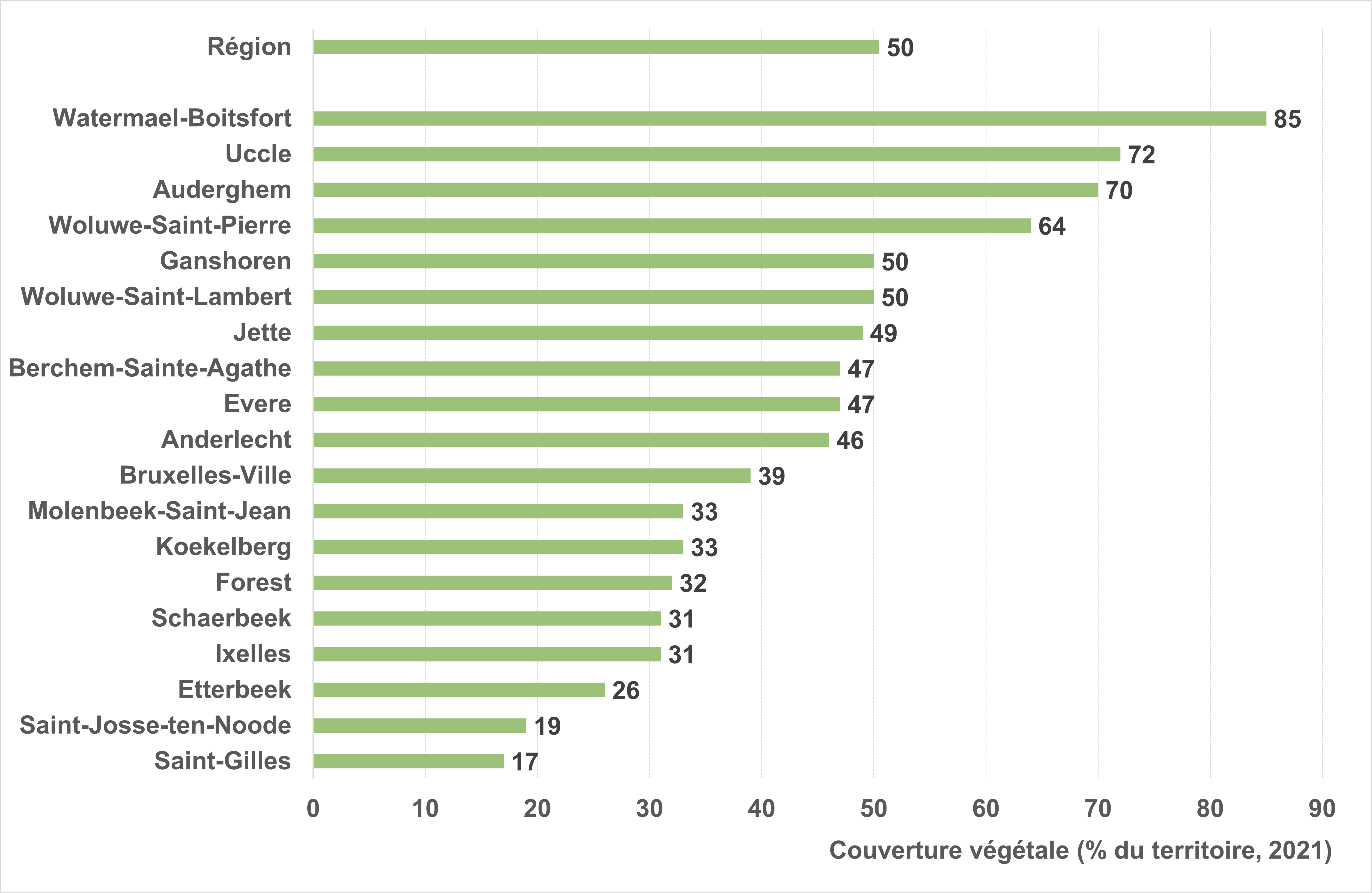
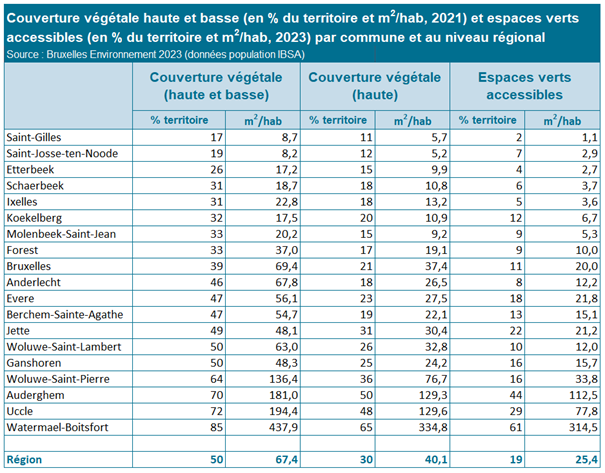
Lire le texte de transcription
Deux communes se situent aux extrêmes : Saint-Gilles (couverture végétale de 17%, espaces verts accessibles sur 2% du territoire, 1 m2 d’espaces verts accessibles par habitant ) et Watermael-Boitsfort (couverture végétale de 85%, espaces verts accessibles sur 61% du territoire, 314 m2 d’espaces verts accessibles par habitant).
Notons que si l’importance de la couverture végétale à Watermael-Boitsfort, Uccle, Auderghem et Woluwe-Saint-Pierre s’explique en partie par une présence importante de parcs et/ou de rues arborées et/ou de grands jardins dans certains quartiers, elle est aussi liée à l’implantation de la forêt de Soignes sur une part plus ou moins grande de ces communes. Ceci doit amener à nuancer les conclusions que l’on peut tirer de ces taux de végétalisation établis à l’échelle d’une commune. Le fait qu’une commune soit dotée d’un important taux de végétalisation moyen n’empêche en effet pas que certains quartiers soient pauvres en espaces verts.
Pas toujours de corrélation entre le taux de couverture végétale et la carence en espaces verts publics
Pour apprécier l’offre en espace verts d’un quartier ou d’une commune, les données de couverture végétale doivent être également accompagnées de données sur la taille et la répartition spatiale des espaces verts publics (voir Focus consacré à l’accessibilité des espaces verts au public ). Par exemple, le tableau ci-dessus montre que si les communes de Saint-Gilles et Saint-Josse ont un taux de couverture végétale ainsi qu’une superficie de couverture végétale par habitant équivalente, les habitants de Saint-Josse disposent d’environ 5 fois plus de m2 d’espaces verts publics par habitant (notamment du fait de la présence du Jardin botanique). Par ailleurs, des communes globalement bien végétalisées peuvent néanmoins avoir une part importante de leur population pour qui l’accès aux espaces verts publics est insuffisant (voir focus sur les espaces verts publics). C’est par exemple le cas de la commune d’Uccle où certains quartiers denses sont peu équipés en espaces verts. D’autres quartiers situés dans des communes globalement assez vertes, voire très vertes, sont également dans cette situation. A contrario, certains grands espaces verts sont bien accessibles pour les habitants d’une commune bien que ces espaces se situent en dehors du territoire communal (voir aussi Focus consacré à l’accessibilité des espaces verts au public ). C’est le cas notamment du parc de Forest ou du parc de la porte de Hal au regard de la commune de Saint-Gilles. Mentionnons également le cas particulier de la ville de Bruxelles qui englobe à la fois le pentagone mais aussi des quartiers périphériques plus végétalisés (bois de la Cambre, Hembeek, Laeken, …). D’un point de vue urbanistique, l’analyse de l’offre en espaces verts est de ce fait surtout pertinente à l’échelle des quartiers.
Que peut-on dire de l’évolution de la couverture végétale ?
Comme expliqué précédemment, il n’est pas possible de comparer totalement les données issues des cartes établies depuis 2020 avec celles résultant de cartographies plus anciennes réalisées avec d'autres techniques et méthodologies (différences de résolution, de mesure de la lumière infrarouge, de classification de la végétation ou encore, de dates de prise des photos aériennes ou images satellites).
Les taux de couverture végétale évalués par les différentes méthodes s’étagent entre 50,5% (2021), 52% (2020), 53% (1997) et 54% (2008, 2016). Ces chiffres ne permettent pas de tirer de réelles conclusions concernant les tendances en raison du manque de comparabilité des données mais aussi des marges d’erreur qui leur sont associées et qui sont susceptibles de masquer les évolutions globales réelles de la couverture végétale (par ex. champ non couvert de végétation au moment de la prise de vue aérienne, fricheZone de terrain laissée à l'abandon et progressivement colonisée par la végétation spontanée. qui se végétalise, petit terrain bâti masqué par la couronne des arbres environnants…). Or une évolution de « seulement » 1% du couvert végétal correspond à une variation de 161 ha soit grosso modo 322 terrains de football ce qui est une superficie considérable pour la Région bruxelloise. Les comparaisons visuelles d’images aériennes sont aussi rendues difficiles par la croissance de la végétation et, en particulier, des arbres.
Bon à savoir
L’analyse de l’évolution de la couverture végétale peut aussi être approchée, dans une certaine mesure, par celle de l’évolution de l’imperméabilisation (voir ci-dessus). Cette évolution a été examinée dans le cadre de l’étude récente sur la cartographie des zones imperméables (WEO 2023). Cette étude visait notamment à comparer le taux d’imperméabilisation calculé en 2022 avec celui évalué pour 2006 (Vanhuysse et al. 2006) sur base d’une méthodologie comparable. La zone couverte par la comparaison est celle de l’étude de 2006 soit 97,7% du territoire régional (exclusion de petites zones, majoritairement perméables, au nord et au sud de la Région bruxelloise). Les résultats obtenus montrent une progression relative de l’imperméabilité de la zone étudiée de 13,8% entre 2006 (taux d’imperméabilisation de 48%) et 2022 (taux d’imperméabilisation de 54,6%). Les communes montrant la plus grande évolution, en surface absolue, de leurs superficies imperméables sont Bruxelles-Ville (243 ha) et Anderlecht (139 ha). En proportion du territoire, les évolutions les plus marquées sont constatées pour Jette (+26%) et Woluwe-Saint-Lambert (+ 25%).
Pour revenir aux données de couverture végétale, une comparaison visuelle de la carte de 2020 et de celle de 2016 a été effectuée (pour rappel, cette carte était aussi basée sur l’analyse de photos aériennes prises dans l’infrarouge). Celle-ci a permis d’identifier 9 zones où la perte de surface végétalisée est supérieure à 1 ha et 2 zones où le gain en surface est supérieur à 1 ha (voir tableau ci-dessous « Pour en savoir plus »). La plupart des zones où un tel espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. continu de plus d'un hectare a disparu sont situées dans le nord de la région, à Haeren et Neder-Over-Heembeek. La zone la plus importante est le site de Keelbeek où la prison de Haeren a été construite, avec une perte de près de 12 hectares de végétation. Des travaux sont également en cours sur d'autres sites où la végétation a disparu. Dans certains cas, une végétation peut réapparaître sur une partie des sites une fois les chantiers terminés (par ex. site de l’OTAN).
Pour plus d’informations : tableau où sont décrites les zones où la perte/le gain de couverture végétale est > 1 ha
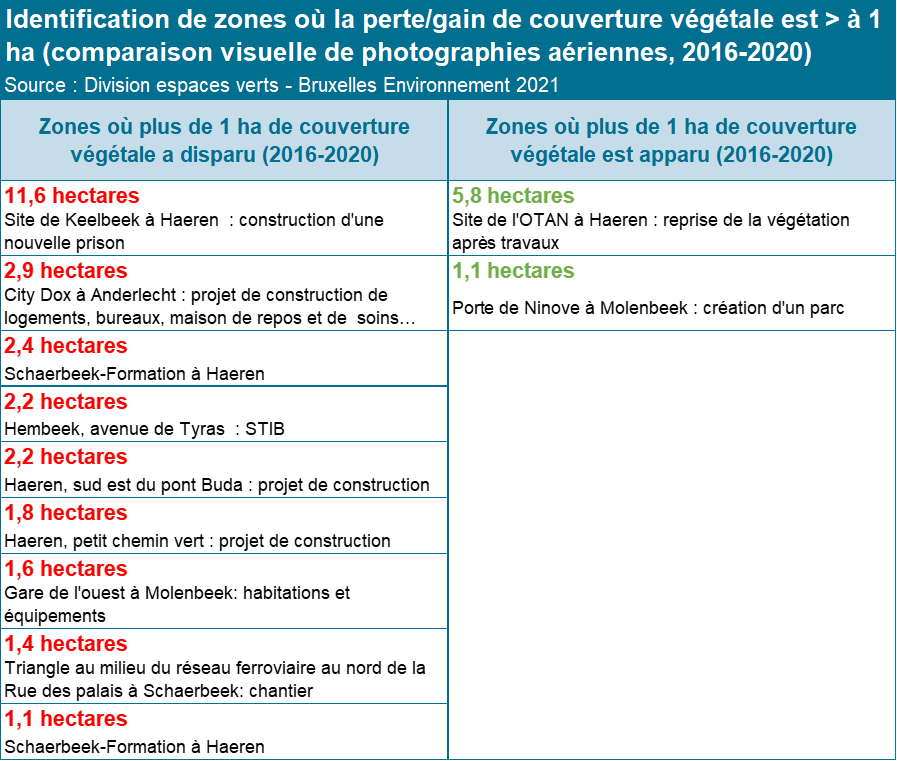
Des chercheurs de l’Université d'Amsterdam ont procédé à la comparaison de deux photographies aériennes infrarouges de la couverture végétale de la Région bruxelloise, datant de 2003 et 2016. Sur la base de ces recherches, les scientifiques ont conclu que 14,4 % de la végétation bruxelloise avait disparu au cours de cette période (Balikçy et al. 2021). Ces résultats doivent être quelque peu nuancés compte tenu des marges d’erreurs inhérentes à la méthode (voir ci-dessus) mais aussi du fait qu’une partie de la Région n’a pas été analysée dans cette étude (ouest de Neerpede, sud de la forêt de Soignes) ce qui amène un biais sur le pourcentage de perte. Ils sont néanmoins assez cohérents par rapport aux résultats de l’étude 2022 portant sur l’imperméabilisation du territoire régional.
Les grandes zones de perte de végétation identifiées par les chercheurs s’inscrivent par ailleurs dans la même tendance géographique que les analyses de Bruxelles Environnement, à savoir une forte pression de l’urbanisation dans le nord-est et le sud-ouest de la Région. Notons que la zone la plus étendue de perte de végétation détectée par les chercheurs entre 2003 et 2016 - et qui correspond à l’ancien site de l’OTAN - est également celle au niveau de laquelle on observe la plus forte progression de la couverture végétale entre 2016 et 2020 (voir tableau ci-dessus). Cette observation correspond à une revégétalisation du site après travaux et témoigne des difficultés qui peuvent se présenter pour tirer des conclusions sur les tendances d’évolution de la végétation à l’échelle régionale.
L’évolution de la couverture végétale est liée à plusieurs facteurs, à savoir essentiellement :
- l’urbanisation, qui a lieu principalement dans des espaces majoritairement végétalisés. Il concerne des surfaces plus ou moins étendues : jardins (construction de terrasses, annexes, etc.), dents creuses (par ex. construction de logements unifamiliaux), friches ou grandes parcelles (par ex. construction de villas, de complexes de logements publics ou privés, d’équipements collectifs), terrains de sport (remplacement d’un terrain enherbé par du gazon artificiel). Cette urbanisation est considérablement plus active en seconde couronne qu’en première couronne ;
- le développement naturel de la végétation, et plus particulièrement des couronnes arborées, dans les espaces végétalisés (voiries, parcs, jardins privés…), ce qui conduit à une augmentation de la couverture végétale observée depuis le ciel. Ce phénomène est particulièrement visible dans les zones de friches (Gare de l’Ouest, Schaerbeek formation…) et sur certains axes routiers (avenue Louise, certains tronçons de la petite ceinture, etc.) ;
- la végétalisation ponctuelle d’espaces bâtis via la plantation d’arbres, la création de toitures végétalisées voire parfois une désimperméabilisation des sols. Ces aménagements, trop peu nombreux pour influencer significativement la couverture végétale régionale, sont par ailleurs bien plus perceptibles au niveau des quartiers fortement minéralisés.
Face à l’accroissement démographique très important qu’a connu la Région bruxelloise (+ 29% entre 2000 et 2023, avec de fortes différences selon les communes (+ 45% à Bruxelles-Ville contre + 2,5% à Watermael-Boitsfort), de nombreux bâtiments - et, en particulier, des logements - ont été construits depuis une vingtaine d’années. Ces constructions se font essentiellement dans des zones non bâties végétalisées, souvent intéressantes en termes de biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). et fréquemment localisées en seconde couronne. Par ailleurs, cet accroissement démographique n’a pas été compensé par une augmentation équivalente des espaces végétalisés accessibles ce qui se traduit par une pression accrue sur les espaces verts existants et une augmentation de la population vivant dans des quartiers peu pourvus en espaces verts de proximité (voir focus Espaces verts accessibles au public).
L’appréciation du caractère plus ou moins vert d’une ville doit aussi tenir compte de la qualité de la végétation. Cet aspect est développé dans le focus consacré à la carte d’évaluation biologique de la Région bruxelloise.
À télécharger
Fiches documentées
- 6. Le Maillage Vert (.pdf)
- 13. Analyse des surfaces non bâties en Région de Bruxelles-Capitale par interprétation d’images satellitaires (.pdf)
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Focus : Espaces verts accessibles au public (2022)
- Focus: La carte d’évaluation biologique de la Région bruxelloise (2022)
- Fragmentation des habitats naturels (2022)
- Focus : Le maillage vert (2015)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Carte «Végétation 2021 – Répartition de la végétation haute et basse en septembre 2021 »
- Carte « Espaces verts accessibles au public »
Etudes et rapports
- BALIKÇI S., GIEZEN M. & ARUNDEL R. 2021. “The paradox of planning the compact and green city: analyzing land-use change in Amsterdam and Brussels”, Journal of Environmental Planning and Management, DOI: 10.1080/09640568.2021.1971069 (.pdf)
- IGEAT, LABORATOIRE DE BOTANIQUE SYSTÉMATIQUE ET DE PHYTOSOCIOLOGIE,
COOPARCH 1997 « Rapport final Maillage vertProgramme fondé sur la protection et la création des espaces verts et l'établissement de liens physiques entre eux, qui vise, outre la préservation du patrimoine naturel et l'accroissement de la biodiversité, à rééquilibrer les disparités régionales au niveau de la verdurisation et de la répartition des espaces verts publics, à améliorer les qualités paysagères et à promouvoir la mobilité douce. – Etablissement de la situation de fait et de droit des espaces verts du territoire de la RBC en vue de l’élaboration du maillage vert », étude réalisée à la demande de Bruxelles Environnement (document interne). - VAN DE VOORDE T., CANTERS F. ET CHEUNG-WAI CHAN J. 2010. « Mapping update and analysis of the evolution of non-built (green) spaces in the Brussels Capital Region – Part I & II», étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement par le “Cartography and GIS Research Group, department of geography, VUB” (.pdf)
- VANHUYSSE S., DEPIREUX J., WOLFF E. 2006. « Etude de l’imperméabilisation du sol en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée par l’ULB-IGEAT pour le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, AED – Direction de l’eau, octobre 2006 (.pdf)
- WIRION C., STEELE R. 2023. « Rapport d’étude de la carte des Surfaces Imperméables de la Région Bruxelles-Capitale – Parties I et II », étude réalisée par le WEO pour le compte de Bruxelles Environnement (.pdf)
- WIRION C., STEELE R. 2023. « Rapport d’étude de la carte des Surfaces Imperméables de la Région Bruxelles-Capitale – Partie III », étude réalisée par le WEO pour le compte de Bruxelles Environnement (.pdf)
Fragmentation des habitats naturels
Focus - Actualisation : novembre 2022
L’amélioration de la connectivité entre les habitats naturels constitue un enjeu majeur pour la préservation de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). en Région bruxelloise. Si le problème de la fragmentation des habitats apparaît particulièrement aigu dans les quartiers densément bâtis, il se pose également en périphérie, notamment en forêt de Soignes. Plusieurs constructions ou aménagements ont été réalisés par les Régions bruxelloise et flamande pour atténuer les effets de la fragmentation sur ce massif transrégional. Ces efforts, qui montrent leur efficacité, doivent se poursuivre. La conservation et la consolidation des espaces verts ouverts à Bruxelles constitue aussi un enjeu régional important, abordé notamment dans le cadre d’une collaboration interrégionale.
La fragmentation des habitats naturels, une menace pour la biodiversité
Tant à l’échelle mondiale que locale, la fragmentation des habitats naturels liée à l’extension des surfaces bâties constitue une cause majeure de perte de biodiversité.
En effet, la présence et le maintien de certaines espèces animales et végétales dépend à la fois de la disponibilité en habitats naturels de taille et qualité suffisantes mais aussi de la possibilité pour ces espèces de se déplacer d’une zone à l’autre pour assurer la recherche de nourriture ou de nouveaux territoires, la reproduction ou encore, la migration. La disparition des connexions entre des milieux naturels et leur séparation par des obstacles dangereux à franchir - voire infranchissables - peuvent avoir des conséquences génétiques et démographiques négatives sur la survie à long terme de certaines espèces, notamment du fait d’une diminution de la capacité de réponse et d’adaptation. Les effets « barrières » peuvent être dus à des infrastructures de transport (routes, parkings mais aussi voies ferrées, canal, etc.) ou à des bâtiments mais aussi, par exemple, à des éclairages artificiels qui perturbent les espèces nocturnes.
La densité du réseau routier et du bâti bruxellois limite fortement la liberté de mouvement de nombreuses espèces
Le maintien de la connectivité et la réduction de la fragmentation des habitats naturels constituent un enjeu important pour la biodiversité bruxelloise.
Une carte de fragmentation des habitats naturels a été établie pour la Région bruxelloise. Elle se base sur 2 types de données :
- la « perméabilité » aux déplacements de chaque îlot urbain: elle mesure le degré d’ouverture (fonction de l’importance du bâti au niveau du périmètre et en intérieur d’îlot) de l’îlot par rapport aux îlots environnants (donnée prise en compte pour l’élaboration de la carte d’évaluation biologique 2020; pour de plus amples informations, voir focus sur la CEB);
- l’importance du trafic routier sur chaque tronçon de voiries (données 2016).
Ceci constitue néanmoins une première approche qui ne prend par exemple pas en compte les dispositifs de passage de la faune existants ou encore, la surélévation de certaines voiries via des viaducs (par exemple, au niveau du ring à l’ouest de la Région).
Notons par ailleurs que si les axes routiers et ferroviaires de même que le canal constituent des obstacles à la progression de la faune et de la flore, ils peuvent également participer au maillage écologique en constituant des « corridors écologiques » qui permettent le déplacement de certaines espèces dans leur longueur (bermes, talus et berges végétalisés, arbres de voiries, réseau d’eau de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) avec présence éventuelle d’îles artificielles végétalisées, etc.).
Fragmentation des habitats naturels bruxellois par les voiries et le bâti
Source : Division Espaces verts 2022
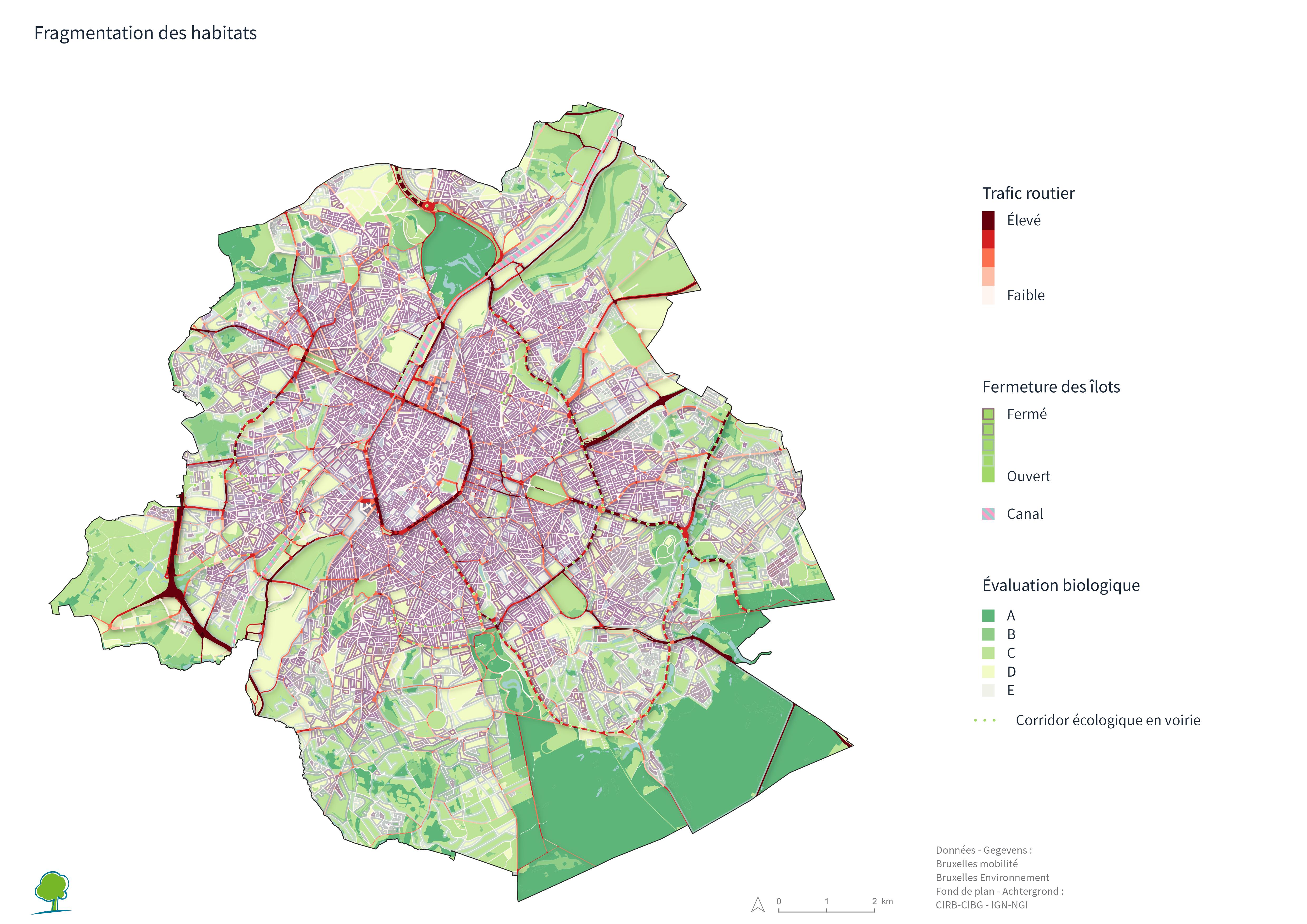
La carte montre que la connectivité spatiale entre les espaces verts est moindre dans les zones du pentagone et de la première couronne où la plupart des espaces végétalisés sont constitués de jardins de taille souvent réduite en intérieur d’îlots fermés. Elle permet aussi de mettre en évidence les grands axes constituant des obstacles à la circulation des espèces.
La fragmentation est aussi problématique en seconde couronne, en particulier en forêt de Soignes morcelée par de nombreuses infrastructures de transport (autoroutes, routes régionales, ligne de chemin de fer...).
Outre les voies de communication et le bâti, barrières tangibles, la pollution lumineuse peut également constituer un obstacle au déplacement des espèces qui fuient la lumière (lucifuges) (voir focus sur la pollution lumineuse).
Les grenouilles, crapauds, tritons ou hérissons sont les premières victimes du trafic
La traversée de routes, et plus rarement de voies ferroviaires, entraîne des risques de mortalité par collision ou écrasement. Le réseau routier belge est extrêmement dense et, pour de nombreuses espèces animales, les accidents de circulation représentent une cause importante de mortalité non naturelle. Le projet « Dieren onder de wielen », mené par la Région flamande en collaboration avec l’asbl Natuurpunt, vise à répertorier et cartographier les animaux victimes de la route. Cette initiative repose sur un projet de sciences participatives incitant les citoyens à encoder leurs observations en ligne, idéalement en enregistrant systématiquement leurs trajets (www.dierenonderdewielen.be ou www.waarnemingen.be). Ces données permettent d’identifier les points noirs et d’y apporter des solutions.
En l’espace de 5 ans, dans le cadre de ce projet, 1.750 amphibiens, reptiles, mammifères ou oiseaux victimes de la route ont été répertoriés en Région bruxelloise. A l’échelle nationale, ce chiffre s’élève à plus de 63.000 individus. Ces données sont par ailleurs largement sous-estimées : selon Natuurpunt, des recherches ont montré que les victimes signalées ne représentent que « la partie émergée de l’iceberg ». De plus, durant la période de confinement en 2020, les enregistrements ont fortement diminué.
Animaux victimes de la route répertoriés en Région bruxelloise durant 5 ans (08/07/2017 – 08/07/2022)
Source : waarnemingen.be (Natuurpunt)
Même si ce recensement est loin d’être exhaustif, il met en évidence le fait que les premières victimes du trafic sont des espèces à déplacement lent comme les grenouilles, crapauds, tritons ou hérissons. Les pigeons, avec leurs mœurs très urbaines et leur tendance à se nourrir de déchets alimentaires au sol, sont également victimes d’écrasement fréquent, jusque dans le centre-ville.
A l’exception du pigeon domestique, toutes ces espèces bénéficient d’une protection stricte sur le territoire bruxellois en vertu de l’Ordonnance Nature. La fouine figure quant à elle dans la liste des espèces d’intérêt régional.
Durant la période considérée, près de 1500 amphibiens morts et, plus rarement, des reptiles, ont été comptabilisés sur les routes bruxelloises. Le mois de mars, période de la migration des amphibiens pour la reproduction, est de loin celui où la mortalité est la plus élevée. Ce chiffre est par ailleurs très largement inférieur à la réalité compte tenu du caractère non systématique de la comptabilisation des victimes, de l’ampleur du phénomène des migrations printanières ainsi que de la petite taille de ces espèces.
Bruxelles Environnement a accordé une subvention annuelle à Natagora dans le but de soutenir et coordonner les actions de sauvetages d’amphibiens en Région bruxelloise.
Ces actions et les données collectées dans le cadre de la réalisation de l’atlas des Amphibiens et reptiles ont permis de réaliser une cartographie des points noirs relatifs aux migrations printanières d’amphibiens (voir fiche documentée sur les Amphibiens et Reptiles ).
Par ailleurs, au cours de ces 5 années, environ 200 mammifères victimes de la route ont été enregistrés. Il s’agit majoritairement de renards mais aussi notamment de hérissons, de fouines ou encore d’écureuils.
Outre cet impact sur la mortalité, la densité du réseau routier bruxellois limite la liberté de mouvement des mammifères terrestres, mais aussi des chauves-souris qui évitent les grands espaces ouverts et ont besoin de structures pour s'orienter (écholocation). Le morcellement par des infrastructures éclairées et les phares des automobilistes constitue également une menace pour les chauves-souris (impact sur les populations d’insectes, perturbation des couloirs de vols…). Plus généralement, la pollution lumineuse peut créer des barrières infranchissables pour les animaux nocturnes.
Les mesures prises pour améliorer la connectivité entre espaces verts
L’ordonnance relative à la conservation de la nature adoptée en 2012 compte parmi ses principaux objectifs la définition conceptuelle d'un réseau écologique bruxellois (REB). Ce REB a été cartographié dans le Plan Nature (2016), qui prévoit une série de mesures pour son renforcement.
Bon à savoir
Le réseau écologique bruxellois correspond à un ensemble cohérent de zones représentant les éléments naturels, semi-naturels et artificiels du territoire qu’il convient de gérer et/ou restaurer pour contribuer à assurer les conditions nécessaires au maintien des habitats naturels et des espèces dans un état de conservation favorable. Il comprend 3 types de zones :
- Les zones centrales, qui sont les zones de (très) haute valeur biologiqueValeur reconnue d'un site coté sur base d'une série de critères tels que : la présence d'éléments hydrologiques peu perturbés (sources), la diversité et la rareté des espèces locales de plantes et d'animaux, la présence d'espèces rares, la maturité des végétations (site irremplaçable sauf à très long terme, ex. une forêt séculaire), etc., qui contribuent de manière importante à la conservation des espèces, essentiellement sous statut de protection active (réserves naturelles ou forestières, sites Natura 2000) ;
- Les zones de développement, qui sont souvent des zones d’extension des zones centrales, qui sont de haute valeur biologique ou susceptibles de l’être, ou qui peuvent le devenir par un entretien et des aménagements appropriés;
Les zones de liaison, existantes ou à (re)créer, qui sont constituées notamment de structures devant permettre aux espèces de circuler et migrer au sein du réseau, entre les complexes de zones centrales et de développement, à travers la matrice urbaine (c’est-à-dire les zones qui sont construites et/ou qui ne sont pas reprises dans le maillage).
Cette politique de maintien ou de restauration de la connectivité entre habitats naturels est toutefois mise en œuvre depuis de nombreuses années dans le cadre du programme de maillage vertProgramme fondé sur la protection et la création des espaces verts et l'établissement de liens physiques entre eux, qui vise, outre la préservation du patrimoine naturel et l'accroissement de la biodiversité, à rééquilibrer les disparités régionales au niveau de la verdurisation et de la répartition des espaces verts publics, à améliorer les qualités paysagères et à promouvoir la mobilité douce. (voir focus ) initié par Bruxelles Environnement dès 1996, introduit ensuite dans le plan régional de développement (PRD 2002) et repris dans sa dernière mouture en date, le plan régional de développement durableMode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Il s'agit donc d une démarche qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement, et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine. (PRDD, 2018). Le maillage vert est également intégré dans les définitions et prescriptions littérales du plan régional d’affectation du sol (PRASLe Plan régional d'Affectation des Sols est l'un des outils majeurs de la politique d'aménagement du territoire régional. Il comprend des prescriptions générales pour l'affectation des sols, des cartes délimitant des zones d'affectation et des prescriptions particulières par zone (notamment pour la protection des espaces verts). Il constitue en outre la référence légale pour l'octroi des permis d'urbanisme, de primes à la rénovation, etc. Il transcrit par ailleurs les objectifs opérationnels du PRD en carte.), en réintégrant la définition du REB, mais sans y être cartographié.
La stratégie de reconnexion repose sur un ensemble de mesures telles que la prise en compte de la connectivité des habitats naturels dans la politique d'octroi de permis d’urbanisme, la protection d’espaces verts de haute valeur biologiqueValeur reconnue d'un site coté sur base d'une série de critères tels que : la présence d'éléments hydrologiques peu perturbés (sources), la diversité et la rareté des espèces locales de plantes et d'animaux, la présence d'espèces rares, la maturité des végétations (site irremplaçable sauf à très long terme, ex. une forêt séculaire), etc. (voir focus sur les sites semi-naturels et espaces verts protégés), la reconnexion de certains cours d’eau au réseau hydrographique et la remise à ciel ouvert de plusieurs tronçons (programme de maillage bleuLe Maillage bleu est un programme mis en œuvre depuis 1999, qui vise plusieurs objectifs : séparer les eaux usées des eaux propres afin de limiter l'apport d'eau aux stations d'épuration, restaurer certains éléments du réseau hydrographique de la Région, réaménager des tronçons de rivières, des étangs et des zones humides pour leur rendre toute leur valeur biologique, et leur faire éventuellement bénéficier de mesures spéciales de protection, et assurer la fonction paysagère et récréative de ces sites., voir fiche documentée), le développement de la promenade verteParcours paysager, destiné à la mobilité douce, reliant les espaces verts naturels et semi-naturels de seconde couronne. Elle permet de faire le tour complet de la Région sans quitter un itinéraire sécurisé et balisé., la gestion écologique des espaces associés aux infrastructures de transport, la réalisation de dispositifs tels qu’écoponts ou encore, la gestion de la pollution lumineuse (voir fiche pollution lumineuse).
Outre l’analyse de la connectivité spatiale des espaces de nature, il est nécessaire d’intégrer une réflexion sur les besoins et niches écologiques variables des espèces et la constitution de sous-réseaux écologiques permettant d’y répondre.
Bon à savoir
Une recherche a porté sur l’examen du rôle potentiel du maillage vertProgramme fondé sur la protection et la création des espaces verts et l'établissement de liens physiques entre eux, qui vise, outre la préservation du patrimoine naturel et l'accroissement de la biodiversité, à rééquilibrer les disparités régionales au niveau de la verdurisation et de la répartition des espaces verts publics, à améliorer les qualités paysagères et à promouvoir la mobilité douce. comme corridor biologique pour des espèces végétales en Région bruxelloise. Celle-ci a notamment mis en évidence des mouvements effectifs des espèces pollinisatrices et une dispersion du pollen le long des éléments paysagers linéaires (bandes boisées, Woluwe), au sein et entre des populations pour les 5 espèces de plantes étudiées.
Source : VAN ROSSUM F. 2007“ For a sustainable conservation of biodiversity in Brussels urban environment : role of the Green Network as fonctionnal corridors between fragmented plant populations”, étude menée par l’unité de recherche du Professeur L.Triest (Algemene Plantkunde en Natuurbeheer, VUB) dans le cadre d’un programme financé par INNOVIRIS
Une forêt à reconnecter
Fragmentation de la forêt de Soignes par les infrastructures de transport
Source : Bruxelles Environnement – département Forêt, 2022
Les infrastructures routières et ferroviaires qui traversent le massif sont particulièrement nombreuses en forêt de Soignes. Elles ont entraîné un morcellement important du site et rendent difficile la circulation du public ainsi que de la faune entre différentes parties de la forêt.
Selon le plan de gestion de la forêt de Soignes, en raison de leur trafic intense et de la vitesse de la circulation, la chaussée de La Hulpe et les autres grands axes routiers et autoroutiers traversant la forêt de Soignes doivent être considérés en journée comme imperméables pour la plupart des espèces de mammifères. De plus, certaines voies secondaires sont fréquemment utilisées comme voies de déviation pour éviter les embouteillages.
La faune paie un lourd tribu à cet état de fait et ce, d’autant plus que l’effarouchement lié à la fréquentation de la forêt - et, en particulier, à la présence de chiens non tenus en laisse -, contraint parfois les animaux à traverser.
Durant l’enquête « Dood doet leven » menée durant la période 2008-2012 (4 ans), un peu plus de 200 grands mammifères ont été répertoriés comme victimes d’accidents routiers dans le massif sonien (qui, pour rappel, s’étend sur les 3 Régions). Il s’agissait essentiellement de chevreuils (environ 60% des victimes signalées) et de renards (environ 30%). 2 sangliers morts ont également été recensés. Notons que depuis cette enquête, de nouveaux dispositifs de reconnexion ainsi que des clôtures à faune ont été aménagés (voir ci-dessous).
Ce morcellement du massif nuit également à terme au brassage génétique de certaines populations animales qui se fractionnent en sous-populations dont la survie peut être mise ne péril.
L’adoption de mesures d’atténuation des impacts des infrastructures de transport s’avère indispensable pour permettre le passage des promeneurs ainsi que les échanges faunistiques. Cet axe de travail a dès lors été défini comme prioritaire dans le cadre du schéma de structure de la forêt de Soignes.
Plusieurs constructions ou aménagements, appuyés par des études antérieures, ont été réalisés depuis une dizaine d’années pour atténuer les effets de cette fragmentation écologique du milieu forestier :
- un écopont au-dessus de la ligne 161 (Région bruxelloise) ;
- un écopont à Groenendael au-dessus du Ring 0 (Région flamande) ;
- des passages pour la faune dans des tunnels existants ;
- de nouveaux tunnels à faune (écopertuis ou écotunnels) ;
- l’aménagement d’une travée du viaduc des Trois-Fontaines (Auderghem)
- des clôtures à faune le long de la E411, du R0 et de la ligne de chemin de fer L161 destinées à guider les animaux vers les passages sûrs (les lisières de ces infrastructures ont été également aménagées pour assurer une diversité d’espèces et de structures) ;
- un pont aérien pour les petits mammifères arboricoles (Région flamande) ;
- des gîtes d’hibernation pour les chauves-souris (Région bruxelloise).
À eux seuls, les deux écoponts reconnectent plus de 2000 ha de forêt. Une partie de ces réalisations constituent des mesures de compensation exigées par la Région bruxelloise pour la perte de surfaces forestières consécutive à la mise à 4 voies de la ligne de chemin de fer Bruxelles-Namur (L161) ou, plus récemment, pour l’installation d’une conduite de gaz traversant la forêt de Soignes. D’autres aménagements ont été réalisés dans le cadre du projet européen Life+ OZON (2013-2018) visant à réduire l’impact du morcellement engendré par les nombreux axes routiers très fréquentés qui traversent la forêt de Soignes. En mai 2021, la construction d’un 3ème écopont, situé au-dessus de la chaussée de la Hulpe à Watermael-Boitsfort, a été inscrite au programme de l’Accord Beliris et est actuellement à l’étude. Il reliera à terme les deux parties bruxelloises de la forêt classées au patrimoine mondial de l’Unesco.
D’autres initiatives devront encore être développées afin de compléter le dispositif de reconnexion écologique des différentes parties du massif sonien et d’assurer aussi des connexions avec les massifs forestiers voisins (forêt de Meerdael et bois de Halle).
Forêt de Soignes et espaces verts environnants
Source : Bruxelles environnement, département Forêt, 2022
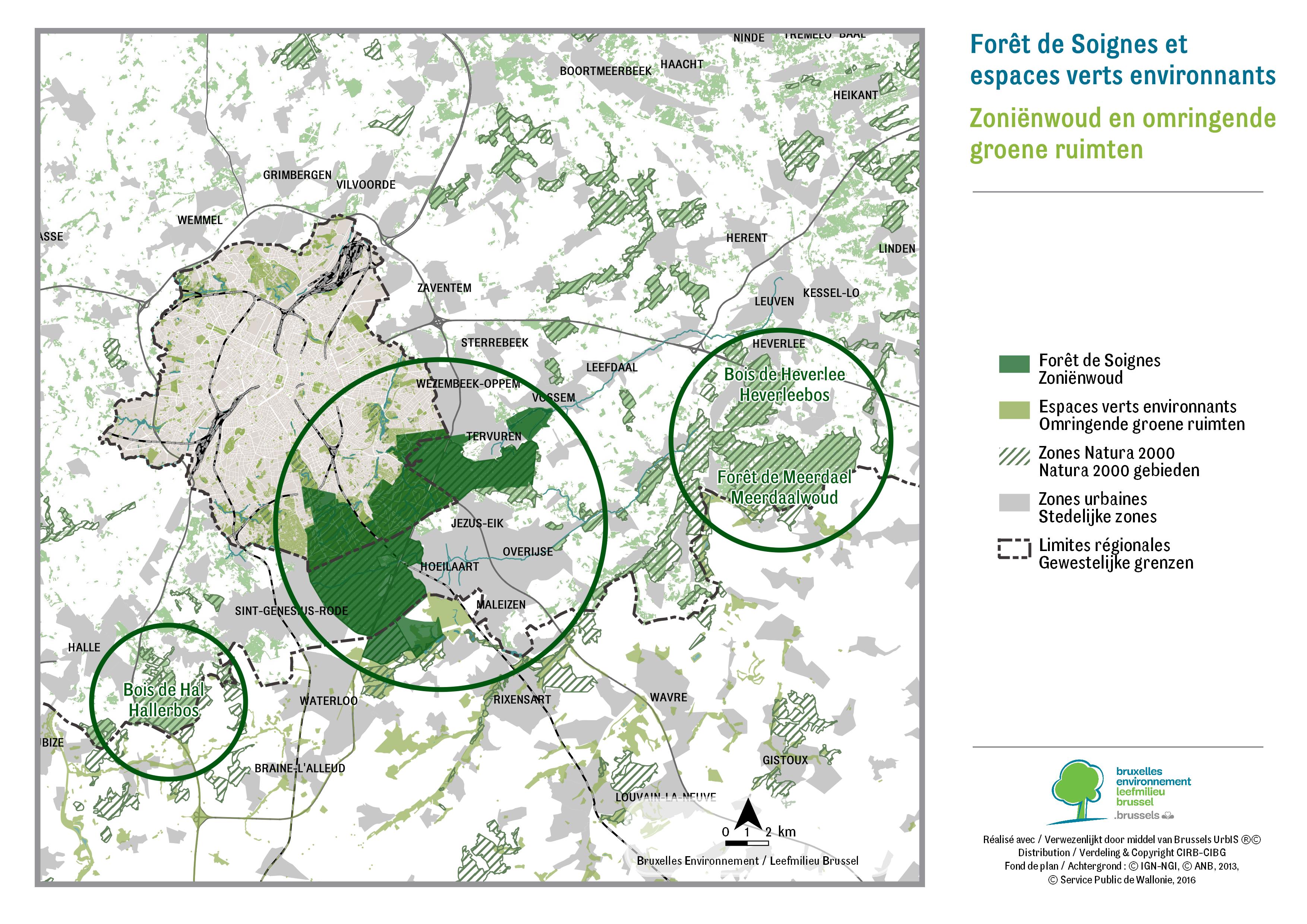
Des dispositifs de reconnexion qui font preuve d’efficacité
L’efficacité des écoponts et écotunnels a été démontrée dans différents suivis. Plus spécifiquement, les réalisations effectuées dans le cadre du projet Life+ OZON ont fait l’objet d’un monitoring afin d’évaluer l’impact de ces installations sur la faune et la flore. Celui-ci a montré que les passages à faune (écoponts, écotunnels, écopertuis, etc.) aménagés au niveau de certaines infrastructures routières ou ferroviaires sont utilisés notamment par des petits et grands mammifères. Il s’avère également que la pose de clôtures en bordure du ring a permis de réduire très fortement le nombre d’animaux victimes d’accidents de la circulation.
Au niveau de l’écopont de Groenendael, le suivi a permis d’identifier 11 espèces de chauves-souris à proximité et 17 autres espèces de mammifères ayant emprunté l’infrastructure. L’écopont est également utilisé par des amphibiens et reptiles et des insectes rares y ont été détectés.
Quant au pont aérien, aussi suivi par caméras, il n’a montré aucun passage entre 2014 et 2017. La construction d’autres ponts aériens a dès lors été abandonnée.
Le renforcement des espaces ouverts dans et autour de Bruxelles
Les milieux ouverts présents en Région bruxelloise (prairies, pelouses, cultures agricoles et maraîchères, friches) sont rares et fragmentés (cf. fiche documentée l’analyse des surfaces non bâties).
Le maintien de milieux ouverts et semi-ouverts représente cependant un enjeu régional non négligeable. Des prairies fleuries entourées de petits éléments paysagers constituent l’habitat de nombreuses espèces animales et végétales remarquables, en forte régression au cours des dernières années. A côté de leur intérêt biologique élevé, les zones ouvertes et les reliques agricoles présentent également un important potentiel pour le développement de l’agriculture urbaine ainsi qu’un intérêt patrimonial, paysager et récréatif élevé qu’il convient de préserver (Plan Nature 2016). Des études menées en Région bruxelloise ont également mis en évidence l’intérêt des potagers urbains bien gérés, complémentairement à d’autres types d’espaces verts, pour le maintien des abeilles sauvages (voir fiche documentée sur les invertébrés).
Les grandes zones de milieux ouverts se concentrent surtout dans l'ouest et le nord de la région. La zone rurale de Neerpede (Anderlecht) constitue la porte bruxelloise du Pajottenland, partie agricole très fertile et vallonée de la ceinture verte autour de Bruxelles. Du côté du Scheutbos (Molenbeek), du Hoogveld et du Kattebroek (Berchem-Saint-Agathe) et, dans une moindre mesure, des vallées du Geleytsbeek et du ruisseau de Verrewinkel (Uccle), on trouve aussi d'importantes continuités de milieux ouverts avec la Région flamande limitrophe.
C’est dans ce contexte, et conformément à l’un des objectifs du plan Nature 2016, que les Régions bruxelloise et flamande travaillent ensemble à la conservation et à la consolidation des espaces ouverts (au sens urbanistique du terme soit des espaces non occupés par des constructions : espaces affectés à la nature et à l’agriculture, abords de bâtiments, bermes le long d’infrastructures linéaires de transport, terrains de sport et de jeux, sites ou friches industrielles, etc.) à Bruxelles et dans la périphérie flamande (voir l’étude interrégionale « Open Brussels, un réseau d’espaces ouverts dans et autour de Bruxelles »).
À télécharger
Fiches documentées
- Analyse des surfaces non bâties en Région de Bruxelles-Capitale par interprétation d’images satellitaires - 2013 (.pdf)
- Le maillage vert - 2017 (.pdf)
- Le maillage bleu – 2017 (.pdf)
- Les Amphibiens et Reptiles en Région bruxelloise – 2022 (.pdf)
- La pollution lumineuse en Région de Bruxelles-Capitale (à paraître)
Fiches de l’état de l’environnement
- La carte d’évaluation biologique de la Région bruxelloise - 2022
- La couverture végétale en Région bruxelloise – 2022
- Le maillage vert - 2015
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Rapport sur l’état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale – 2012 (.pdf)
- Carte « Fragmentation des espaces verts »
- Carte « Fragmentation des milieux ouverts et des milieux fermés»
- Carte « Réseau écologique bruxellois »
Etudes et rapports
- AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, BRUXELLES ENVIRONNEMENT 2019 (?). « Restauration d’habitats naturels pour les espèces en danger critique d’extinction par la défragmentation de la forêt de Soignes », 16 pp.
- AGORA & IRSNB 1998. « Etude de conception du maillage vert - Le maillage vert écologique en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 40 pp.(.pdf)
- RAES D. 2013. « 4 jaar Dood doet Leven, ook in het Zoniënwoud - Eindverslag “, 17 pp. (.pdf) (seulement en néerlandais)
- VAN DE VOORDE ET AL. 2010. “Mapping update and analysis of the evolution of non-built (green) spaces in the Brussels Capital Region – Part I & II”, étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 35 pp. (.pdf)
- VANWIJNSBERGHE S., VAN DER WIJDEN B., SCHOONBROODT O. 2021. “Impact du développement des infrastructures de transport sur la forêt. L’exemple de la ligne de chemin de fer Bruxelles-Namur en forêt de Soignes », in Forêt Nature n°60, p.18-30 (.pdf)
Plans et programmes
- Plan régional nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale, 2016 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre I - Etat des connaissances, 2019 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre II - Objectifs et mesures de gestion, 2019 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre III - Plans de gestion des réserves archéologiques, naturelles et forestières, 2019 (.pdf)
Le maillage vert
Focus - Actualisation : décembre 2015
Depuis une vingtaine d’années, les actions développées au niveau de l’aménagement ou de la rénovation des espaces verts régionaux s’inscrivent dans le cadre général du programme de maillage vertProgramme fondé sur la protection et la création des espaces verts et l'établissement de liens physiques entre eux, qui vise, outre la préservation du patrimoine naturel et l'accroissement de la biodiversité, à rééquilibrer les disparités régionales au niveau de la verdurisation et de la répartition des espaces verts publics, à améliorer les qualités paysagères et à promouvoir la mobilité douce., concept intégrateur combinant des objectifs socio-récréatifs, environnementaux et paysagers. A l’occasion de l’élaboration du projet de plan régional de développement durableMode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Il s'agit donc d une démarche qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement, et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine. (PRDD), Bruxelles Environnement a réalisé une étude visant notamment à actualiser ce programme ainsi que la carte du maillage vert qui l’accompagne. Le nouveau réseau prioritaire de maillage vert totalise environ 161 km de continuités vertes reliant entre eux des espaces verts essentiellement publics mais également privés. Outre l’aménagement ou le réaménagement de nombreux espaces verts, le programme de maillage vert s’est également concrétisé par la réalisation de la promenade verteParcours paysager, destiné à la mobilité douce, reliant les espaces verts naturels et semi-naturels de seconde couronne. Elle permet de faire le tour complet de la Région sans quitter un itinéraire sécurisé et balisé., parcours circulaire de 62 km en seconde couronne entièrement balisé depuis 2009.
Le maillage vert : un concept intégrateur
Les actions développées au niveau des espaces verts bruxellois s’inscrivent dans le cadre général des programmes de maillage vert et bleu. Ceux-ci visent à améliorer, via une stratégie intégrée, l’offre et la qualité des espaces verts et bleus ainsi que l’environnement et la qualité de vie en Région bruxelloise. La structure du maillage vert s’appuie sur un réseau de « continuités vertes » reliant les différents espaces verts entre eux. Le maillage bleuLe Maillage bleu est un programme mis en œuvre depuis 1999, qui vise plusieurs objectifs : séparer les eaux usées des eaux propres afin de limiter l'apport d'eau aux stations d'épuration, restaurer certains éléments du réseau hydrographique de la Région, réaménager des tronçons de rivières, des étangs et des zones humides pour leur rendre toute leur valeur biologique, et leur faire éventuellement bénéficier de mesures spéciales de protection, et assurer la fonction paysagère et récréative de ces sites., indissociable du maillage vert auquel il participe, vise quant à lui à rétablir autant que possible la continuité du réseau hydrographique de surface et à y faire écouler des eaux propres. Développés au milieu des années ’90 par Bruxelles Environnement, ces programmes ont été ensuite intégrés dans la planification régionale.
Au fur et à mesure de sa mise en pratique, le concept de maillage vert s’est progressivement affiné et enrichi, notamment du fait que sa portée, initialement focalisée sur l’espace public (rues, parcs), s’est étendue au patrimoine bâti (toitures et façades vertes) et privé (jardins et domaines privés) et que sa fonction écologique a vu son importance de plus en plus reconnue. Le projet de plan régional de développement durable (PRDD), adopté par le Gouvernement bruxellois fin 2013, met aussi en avant la participation du maillage vert « à la préservation de la capacité du système urbain à répondre aux phénomènes de réchauffement climatique ».
Les multiples fonctions du maillage vert y sont énumérées, à savoir :
- socio-récréative (détente, promenade et mobilité active, pratique du sport de plein air, liens sociaux, contact avec la nature, etc.);
- écologique et environnementale (support à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., établissement de liens entre espaces verts et bleus permettant une meilleure circulation de la faune et de la flore et des échanges génétiques entre populations, fourniture de services écosystémiquesEnsemble des services rendus par les sols à l’environnement et de facto à notre société : fourniture d’eau potable, limitation des inondations, stockage du Carbone atmosphérique, support pour la faune et la flore...) tels que la réduction des effets d’îlots de chaleur, la régulation du cycle de l’eau, etc.);
- paysagère, culturelle et patrimoniale (valeur paysagère, patrimoniale ou historique des espaces verts, mise en valeur du patrimoine bâti, embellissement de la ville, etc.).
La multiplicité de ces objectifs implique une déclinaison du maillage vert au travers de différents « maillages stratégiques » décrits dans le PRDD:
- Le maillage socio-récréatif et le maillage jeux
Ce maillage vise en particulier à satisfaire une large gamme de fonctions socio-récréatives dans un environnement agréable et sain (promenade calme ou sportive, rencontre sociale, détente, quiétude, ressourcement...). Il s’agit d’élargir l’offre en espaces verts et d’améliorer la qualité des espaces verts existants afin que chaque habitant dispose d’un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. de qualité près de son lieu de vie. Le concept de maillage implique aussi qu’un maximum d’espaces verts soient reliés entre eux par des chemins, voiries, places (…) verdurisés. La préservation et le développement de sites potagers et d’autres formes d’agriculture urbaine font également partie de la stratégie de maillage vert.
La fonction ludique fait l’objet, vu son importance et ses spécificités, d’une stratégie particulière élaborée par Bruxelles Environnement. Dans un contexte général de croissance démographique et de rajeunissement de la population, le maillage jeux vise à accroître et améliorer l’offre en espaces ludiques et sportifs, particulièrement en milieu dense, en vue de répondre plus adéquatement à la demande.
Pour plus d’informations, le lecteur intéressé peut se reporter au focus du rapport sur l’état de l’environnement consacré spécifiquement au maillage jeux ainsi qu’au focus et à la fiche documentée consacrés aux potagers collectifs et familiaux.
- Le maillage écologique
Ce maillage, constitué d’éléments naturels et semi-naturels, vise à préserver le milieu naturel et à renforcer la diversité et le fonctionnement dynamique des écosystèmes existants. De nombreuses études ont en effet montré que le potentiel d’accueil de la biodiversité offert par les habitats naturels est, à superficies égales, beaucoup plus grand quand ces derniers sont reliés entre eux par des corridors écologiques que lorsqu’ils sont isolés les uns des autres. Les écosystèmes présents sont ainsi plus équilibrés, plus stables et résilients, c'est-à-dire capables de surmonter d’éventuelles perturbations telles que, par exemple, celles liées au changement climatiqueDésigne de lentes variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l'air, résultant d'activités humaines, menacent de modifier sensiblement les climats, dans le sens d'un réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants : élévation du niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones, etc.), déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d'eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales, etc. ou à des invasions biologiques (projet de plan nature, 2014). Le maillage écologique vise également à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’espèces et d’habitats protégés par la législation européenne (Natura 2000) ou régionale (ordonnance nature) (voir focus consacré aux sites semi-naturels et espaces verts protégés). La mise en place d'un réseau écologique constitue l’un des principaux objectifs de l’ordonnance nature.
- Le maillage bleu
Le maillage bleu vise à rétablir autant que possible la continuité du réseau hydrographique de surface, largement morcelé par l’urbanisation, et à y faire écouler des eaux propres avec comme objectifs :
- d’assurer la qualité de l’eau et mettre en valeur les rivières, les étangs et les zones humides sur le plan paysager et récréatif tout en développant la richesse écologique de ces milieux;
- de remettre les eaux propres (eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.), eaux de drainage, eaux pluviales) dans les cours d’eau et les zones humides afin de les revitaliser, de réduire les problèmes d’inondations et de détourner ces eaux propres des stations d’épuration.
Ce maillage poursuit donc à la fois des objectifs hydrologiques, écologiques, paysagers, patrimoniaux (l’histoire de Bruxelles étant fortement liée à la présence d’eau) et récréatifs. Pour le lecteur intéressé, une fiche documentaire spécifique est consacrée au programme de maillage bleu.
Ces différents maillages stratégiques peuvent coexister au niveau d’un même espace en développant des synergies. Des situations de concurrence peuvent cependant aussi apparaître et exiger la recherche d’équilibres adéquats.
Enjeux associés aux espaces verts et bleus constitutifs du maillage vert
Le maillage vert repose avant tout sur les espaces verts, tant les petits parcs de quartiers que les grands parcs et bois ainsi que les liaisons vertes bordant les voiries, voies ferroviaires, canaux et cours d’eau. Il inclut également les espaces privés autour des bâtiments et logements ainsi que les intérieurs d’îlots, façades et toitures verdurisés.
En résumé, les principaux enjeux associés aux différents éléments constitutifs du maillage sont :
- la création de nouveaux espaces verts et récréatifs dans les quartiers déficitaires - le plus souvent centraux - ainsi que la verdurisationActe volontaire visant à réintroduire de la végétation dans des zones qui en sont dépourvues. des voiries et places publiques;
- le maintien, la rénovation et la gestion durable des espaces verts publics existants en y intégrant de manière optimale leurs différentes fonctions (cf. ci-dessus) compte tenu du contexte local;
- la préservation maximale - malgré la pression démographique - et la gestion écologique des espaces verts semi-naturels subsistants;
- l’intégration de la politique de maillage vert dans les projets urbanistiques régionaux (zones d’intérêt régional, plan canal, etc.);
- la verdurisation des espaces verts interstitiels attenants par exemple aux écoles, entreprises ou bureaux, immeubles à appartements ainsi que des jardins, cours, façades, toitures…;
- l’intégration de la problématique de l’eau dans les projets urbanistiques publics ou privés (remise à ciel ouvert de cours d’eau, réseaux séparatifs pour les égouts et eaux pluviales, zones d’infiltration, toitures vertes, plans d’eau, limitation de l’emprise du bâti, etc.);
- la poursuite et le renforcement de la gestion écologique des talus de chemins de fer (corridors écologiques performants);
- le maintien et l’exploitation durable des terres agricoles encore présentes (objectif s’inscrivant également dans la stratégie « Vers un système alimentaire durable en Région de Bruxelles-Capitale » ou stratégie « Good food » adoptée fin 2015);
- le maintien des potagers existants et la promotion de leur accessibilité au public;
- l’aménagement de cheminements verdurisés séparés de la circulation automobile (y compris le long du canal et des voies ferrées) afin d’encourager les modes de transport actifs (piétons, cyclistes, etc.).
Réalisations du programme de maillage vert
Dans le cadre de l’élaboration du projet de PRDD, une étude, commanditée par Bruxelles Environnement, a été effectuée entre 2011 et 2013 afin d’actualiser le programme de maillage vert. Elle portait, d’une part, sur l’analyse de la situation existante et, d’autre part, sur l’adaptation de la carte du maillage vert. Pour certains sites prioritaires, des projets visant à concrétiser sur le terrain les principes du maillage vert ont été élaborés.
La carte ci-dessous illustre schématiquement le degré de réalisation des différents tronçons (ou « continuités vertes ») du programme de maillage vert tel que défini en 1998 (Annexe à l’AGRBC du 9 juillet 1998 arrêtant le projet de PRD modifiant les dispositions indicatives du PRD de 1995).
Aménagements réalisés sur les tronçons du réseau prioritaire du maillage vert (1998-2011)
Source : Bruxelles Environnement & Agora 2014
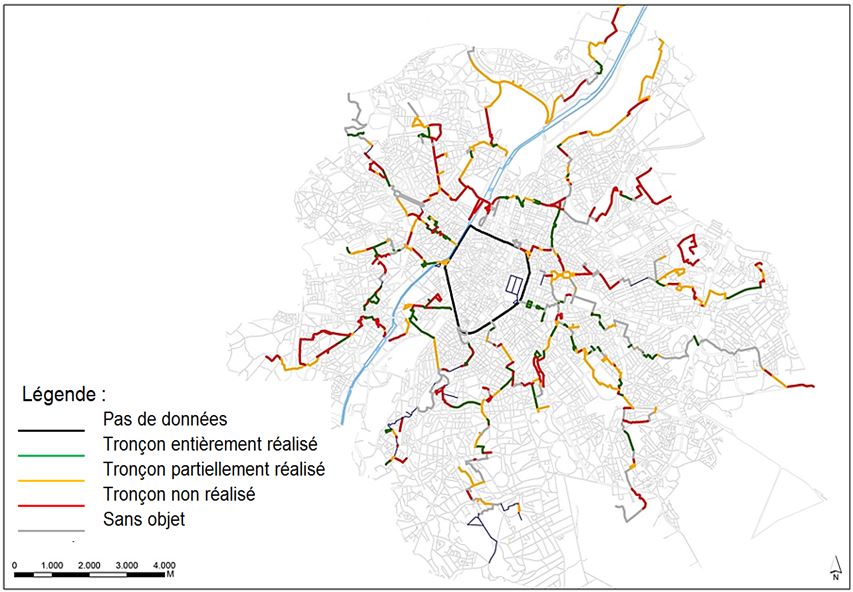
Il en ressort qu’approximativement, sans tenir compte de la promenade verteParcours paysager, destiné à la mobilité douce, reliant les espaces verts naturels et semi-naturels de seconde couronne. Elle permet de faire le tour complet de la Région sans quitter un itinéraire sécurisé et balisé. :
- en 1998, des propositions de travaux d’aménagements visant à l’amélioration de la situation existante ont été formulées pour 70% des fiches techniques relatives aux divers tronçons du réseau prioritaire du maillage vertProgramme fondé sur la protection et la création des espaces verts et l'établissement de liens physiques entre eux, qui vise, outre la préservation du patrimoine naturel et l'accroissement de la biodiversité, à rééquilibrer les disparités régionales au niveau de la verdurisation et de la répartition des espaces verts publics, à améliorer les qualités paysagères et à promouvoir la mobilité douce. (« colonne vertébrale » du maillage vert) ;
- ces propositions ont été mises en œuvre en tout ou en partie dans respectivement 23% et 35% des cas.
L’étude a également montré que, globalement, le potentiel d’amélioration des qualités paysagères, récréatives et écologiques du réseau prioritaire de maillage vert s’avère plus important à l’ouest de la Région.
Depuis son lancement en 1999, la promenade verte régionale - itinéraire circulaire localisé en seconde couronne et destiné aux modes de mobilité active - s’est développée via différents aménagements visant à créer de nouveaux passages (passerelles, nouveaux tronçons…) ou à améliorer des sections existantes en ce qui concerne leur praticabilité pour les usagers ou leurs qualités paysagères et écologiques. A ce jour, 55 projets - d’ampleur très variable - ont été concrétisés sur le parcours de la promenade verte dont 17 pour améliorer l’accessibilité du tronçon correspondant à la « promenade de l’ancien chemin de fer Bruxelles - Tervueren » (entre Auderghem et Woluwé Saint-Lambert). Certaines connections ont été créées avec des promenades communales ainsi qu’avec le réseau cyclable récréatif du Brabant flamand. L’intégralité du parcours de la promenade verte est balisé depuis 2009 et des antennes ont été aménagées à plusieurs endroits. D’autres projets sont en cours de réalisation ou planifiés. La promenade verte correspond actuellement à un parcours de 62 km dont 41% localisés dans des espaces verts, 47% en voiries et 12% dans des voiries à circulation limitée ou interdite (hors espaces verts) ou le long de chemins de halage. Les aménagements spécifiques conçus pour accueillir la promenade verte représentent 26% de la totalité du parcours. Le reste correspond à des infrastructures existantes dépendant d’autres acteurs régionaux (communes et Bruxelles-Mobilité essentiellement).
De très nombreux parcs ont par ailleurs été aménagés ou rénovés. A cet égard, on peut citer en particulier 2 nouveaux parcs multifonctionnels créés sur des friches industrielles dans des quartiers centraux et ouverts au public en 2014, à savoir le parc de la ligne 28, localisé à la frontière de Molenbeek, Jette et Bruxelles (maître d’ouvrage : Beliris, gestionnaire : Bruxelles Environnement) et Parckfarm, localisé sur l’ancienne ligne ferroviaire de Tour & Taxis (maître d’ouvrage et gestionnaire: Bruxelles environnement avec l’appui des habitants). La réalisation de ce parc s’est inscrite dans le cadre d’un projet expérimental visant à inventer de nouveaux usages aux espaces publics, en s’appuyant notamment sur une implication très importante des habitants. Ces parcs sont reliés avec un petit parc communal réalisé dans le cadre d’un contrat de quartier et avec le nouveau parc privé de Tour & Taxis. Dans les années à venir cette suite de parcs sera encore complétée par une connexion verte vers la Place Bockstael (Laeken) ainsi que vers le canal et le projet du pôle régional récréatif « Allée du Kaai ».
La nouvelle carte du maillage vert
Sur base de l’étude précitée, la carte reprenant les continuités vertes à développer prioritairement a été adaptée et a servi de base à la réalisation de la carte « Cadre de vie » du projet de PRDD incluant notamment le maillage vert (voir ci-dessous).
Ces adaptations visaient prioritairement à :
- adapter le tracé aux évolutions de la situation sur le terrain (par ex. nouvelles constructions, changements de propriétaires, etc.);
- améliorer l’efficience et la connectivité du réseau;
- intégrer certaines voies ferroviaires comme axes forts du maillage vert;
- créer davantage de continuités vertes au sein du pentagone;
- créer ou renforcer des liaisons avec les espaces et continuités verts de la périphérie flamande.
Il ressort de ce travail que, si une part importante des tronçons du maillage vert planifié en 1998 a été conservée, la nouvelle carte du maillage vert intègre aussi de nombreux changements (intégration de nouveaux tronçons, abandon ou adaptation d’anciens tronçons).
Le nouveau réseau prioritaire de maillage proposé dans l’étude totalise environ 161 km de continuités vertes, hors promenade verte. Ce nouveau projet présente une connectivité entre espaces verts légèrement supérieure à sa version précédente c’est-à-dire que, globalement, plus d’espaces verts du réseau se trouvent à moins de 200 mètres d’un autre espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. ou élément linéaire du réseau.
Leviers de mise en œuvre du maillage vert
Le plan régional de développement constitue un plan d’orientation qui traduit la vision politique du développement de la ville. Il n’a cependant qu’une valeur indicative contrairement au plan régional d’affectation du sol (PRASLe Plan régional d'Affectation des Sols est l'un des outils majeurs de la politique d'aménagement du territoire régional. Il comprend des prescriptions générales pour l'affectation des sols, des cartes délimitant des zones d'affectation et des prescriptions particulières par zone (notamment pour la protection des espaces verts). Il constitue en outre la référence légale pour l'octroi des permis d'urbanisme, de primes à la rénovation, etc. Il transcrit par ailleurs les objectifs opérationnels du PRD en carte.), à valeur règlementaire, qui fixe les affectations possibles sur le territoire et les prescriptions s’appliquant à chaque zone.
Au niveau du PRAS, le maillage vert se traduit uniquement par l’affectation de certaines parties du territoire en zones vertes de différents types (voir focus consacré aux sites semi-naturels et espaces verts protégés) et, pour les autres affectations, par des prescriptions relatives à la verdurisationActe volontaire visant à réintroduire de la végétation dans des zones qui en sont dépourvues.. La réalisation d’espaces verts est ainsi autorisée sans restriction dans toutes les zones même si, en pratique, cela s’observe rarement. Par ailleurs, les projets de construction portant sur une superficie au sol de plus de 5.000 m² doivent inclure au moins 10% d’espaces verts (…). Dans certaines zones stratégiques (zones d’intérêt régional), le PRAS impose également la réalisation d’une superficie donnée d’espaces verts. Si, de manière générale, les zones vertes du PRAS sont relativement bien protégées, des exceptions sont néanmoins possibles dans le cas de projets d’utilité publique. Par ailleurs, certaines zones affectées en zone verte sont, dans les faits, parfois peu verdurisées (cf. certains cimetières et zones de sport).
Des cartes relatives à la réalisation du maillage vert ou du maillage écologique figurent dans les plans régionaux de développement (cartes « cadre de vie ») ainsi que dans le projet de plan nature.
Cartes « Cadre de vie » du projet de PRDD : priorités du maillage vert
Source : Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2013 (voir https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/181105_cdc.pdf)
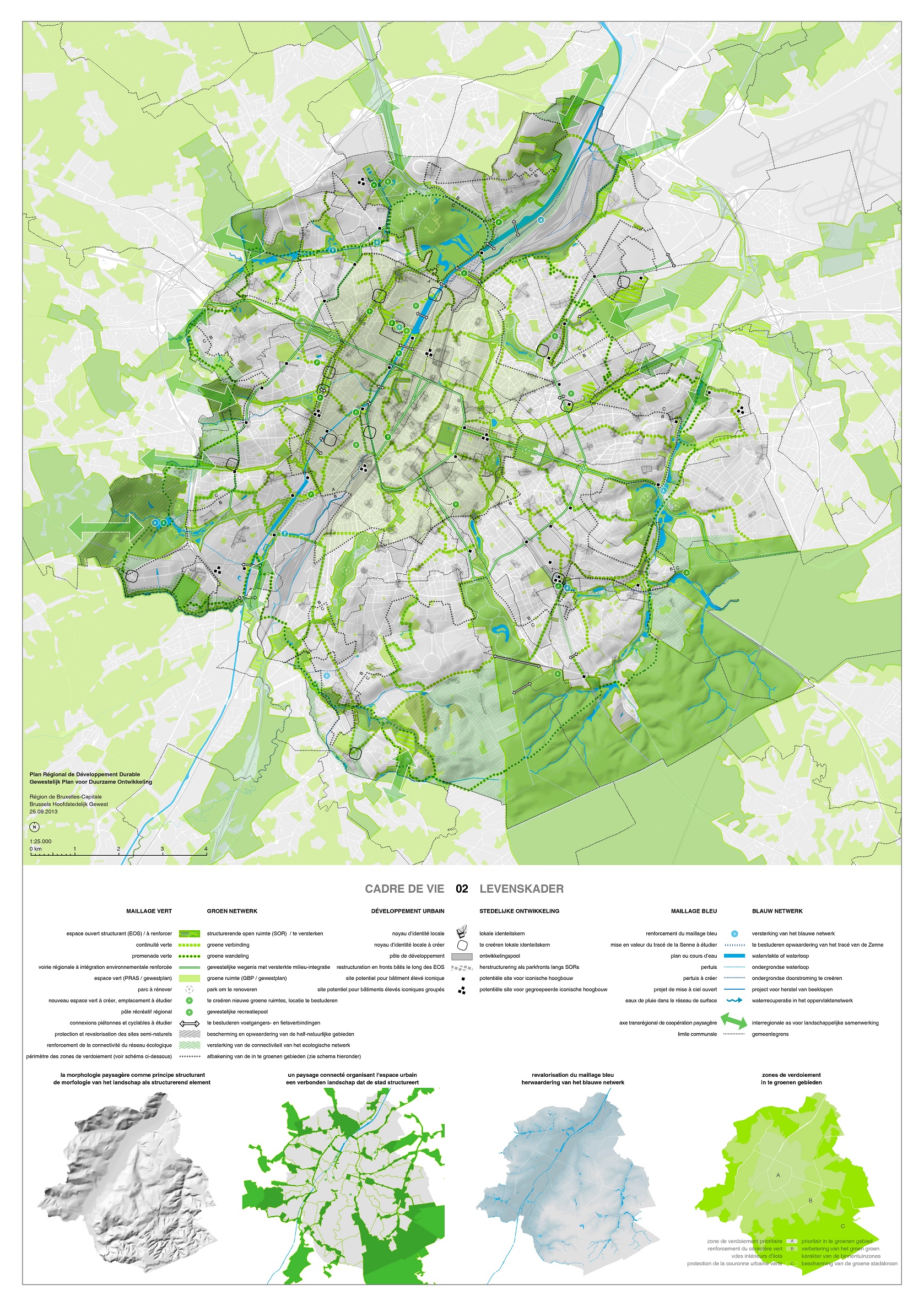
La carte des “zones de verdoiement” découpe le territoire bruxellois en 3 zones concentriques, à savoir, en partant du centre :
- A : Zone de verdoiement prioritaire
- B : Renforcement du caractère vert des intérieurs d’îlots
- C : Protection de la ville verte de seconde couronne
En fonction de la zone dans laquelle ils s’implantent, les projets urbanistiques doivent donner la priorité à l’une ou l’autre fonction du maillage vertProgramme fondé sur la protection et la création des espaces verts et l'établissement de liens physiques entre eux, qui vise, outre la préservation du patrimoine naturel et l'accroissement de la biodiversité, à rééquilibrer les disparités régionales au niveau de la verdurisation et de la répartition des espaces verts publics, à améliorer les qualités paysagères et à promouvoir la mobilité douce.. En zone A, dans la partie centrale et dense de Bruxelles, il existe un déficit important d’espaces verts publics et privés alors que la densité d’habitants est forte. L’objectif est d’y créer, autant que possible, de nouveaux espaces verts mais également, plus généralement, d’améliorer la qualité de l’espace urbain par la plantation d’arbres en voiries ou la mise en valeur des espaces résidentiels, des intérieurs d’îlots, des toitures plates ou des façades. Au niveau de la seconde couronne, en zone C, la volonté est de maintenir le caractère vert et la qualité de l’environnement du tissu bâti et ce, malgré les processus de densification. Pour la zone B, en première couronne, l’objectif est de préserver et renforcer le caractère vert des intérieurs d’îlots.
La carte « Cadre de vie » propose une planification du maillage vert et localise les différents éléments constitutifs du maillage vert, à savoir :
- espaces structurants ouverts à renforcer (ces milieux ouverts, concentrés dans les zones rurales relictuelles de la périphérie ont un intérêt biologique, patrimonial, paysager et récréatif élevé);
- continuités vertes, promenade verteParcours paysager, destiné à la mobilité douce, reliant les espaces verts naturels et semi-naturels de seconde couronne. Elle permet de faire le tour complet de la Région sans quitter un itinéraire sécurisé et balisé. et espaces verts du PRASLe Plan régional d'Affectation des Sols est l'un des outils majeurs de la politique d'aménagement du territoire régional. Il comprend des prescriptions générales pour l'affectation des sols, des cartes délimitant des zones d'affectation et des prescriptions particulières par zone (notamment pour la protection des espaces verts). Il constitue en outre la référence légale pour l'octroi des permis d'urbanisme, de primes à la rénovation, etc. Il transcrit par ailleurs les objectifs opérationnels du PRD en carte. existants, à préserver;
- nouveaux espaces verts, connexions piétonnes et cyclables, à créer ou à étudier;
- voiries régionales dont le caractère vert doit être renforcé;
- parcs à rénover;
- pôles récréatifs régionaux, existants ou à créer;
- zones de protection et de revalorisation des sites semi-naturels (sites présentant une grande valeur patrimoniale, sociale et écologique qu’il convient de protéger et revaloriser dans un contexte de densification du logement);
- zones de renforcement de la connectivité du réseau écologique (essentiellement localisées entre les zones Natura 2000);
- axes transrégionaux de coopération paysagère.
Notons également qu’une carte relative au réseau écologique bruxellois est incluse dans le projet de plan nature.
En pratique, la mise en œuvre du maillage vert s’appuie sur différents leviers, en particulier:
- planification, aménagement, rénovation et gestion d’espaces verts (parcs mais aussi places et voiries verdurisées) et bleus par les instances publiques suivant les orientations du PRD et du projet de PRDD (notamment dans le cadre des « contrats de quartiers durables », de l’élaboration de schémas directeurs, de permis de lotir, etc. ) ;
- procédure de délivrance de permis d’urbanisme (pour la construction d’un nouveau quartier, le réaménagement de voiries ou de places, la construction ou l’extension d’un bâtiment, etc.) :
- obligation des maîtres d’ouvrage de respecter le cadre règlementaire imposé par le PRAS (ou, le cas échéant, le plan particulier d’affectation du sol) et le règlement régional d’urbanisme (règles en matière de toitures vertes et d’imperméabilisation des sols) ;
- intervention de Bruxelles environnement comme instance d’avis (sur base des orientations du PRD et du projet de PRDD)
- possibilité (prévue par le Code bruxellois d’aménagement du territoire ou COBAT) d’imposer des charges d’urbanisme qui peuvent notamment porter sur la réalisation, la transformation ou la rénovation d'espaces verts.
- apport d’expertise de Bruxelles Environnement sur les aspects liés par ex. à l’aménagement d’espaces verts ou à la gestion de l’eau dans le cadre de projets urbanistiques ou immobiliers développés par des pouvoirs publics ou des promoteurs (sur base d’une sollicitation comme instance d’avis ou de manière proactive par prise de contact) ;
- acquisitions foncières de nouveaux terrains par la Région ou conclusion de baux emphytéotiques pour la création de nouveaux espaces verts concourant à la réalisation du maillage vert ;
- possibilité de recourir à l’article 66 de l’ordonnance nature qui permet au Gouvernement d’adopter des arrêtés particuliers de protection et des mesures d'encouragement pour le maintien, la gestion et le développement de biotopes urbains ainsi que des éléments du paysage qui (…) sont essentiels à la migration d'espèces sauvages et améliorent la cohérence écologique du réseau Natura 2000 et du réseau écologique bruxellois ;
- apport d’expertise ou établissement de contrats et conventions pour la reprise en gestion d’espaces verts par Bruxelles Environnement visant à assurer une gestion plus écologique de certains espaces verts gérés par ex. par des communes, sociétés de logement (stations Natura 2000), Infrabel (e.a. talus de chemins de fer), Bruxelles mobilité (bermes centrales et bordures de voiries), propriétaires privés (terrains localisés en zones Natura 2000), Ministère de la défense (terrains militaires), etc. ;
- octroi de primes communales ou régionales (par ex. pour la réalisation de toitures vertes, la verdurisationActe volontaire visant à réintroduire de la végétation dans des zones qui en sont dépourvues. de façades ou l’amélioration des intérieurs d’îlots par démolition d’annexes ou perméabilisation du sol) ;
- appels à projets encourageant des initiatives citoyennes en lien avec la verdurisation des quartiers ou le développement de potagers collectifs (soutien financier et technique) ;
- sensibilisation et communication (publication d’un « vade mecum » sur le maillage jeux par ex.) ;
- mise en place de processus participatifs lors de la conception ou de la rénovation de certains espaces verts.
À télécharger
Fiches documentées
Thème « Occupation des sols et paysages bruxellois »
- n°6. Le maillage vert
- n°13. Analyse des surfaces non bâties en Région de Bruxelles-Capitale par interprétation d’images satellitaires (.pdf)
- n°14. Espaces semi-naturels et espaces verts bénéficiant d’un statut de protection (.pdf)
Thème « L’eau à Bruxelles »
Thème « Contexte bruxellois »
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Focus : Le maillage jeu
- Focus : Les potagers urbains
- Focus : Plans pluriannuels
- Focus : Fragmentation et isolement des espaces verts
- Focus : Surveillance des habitats naturels en Région bruxelloise
- Focus : Espaces verts : accessibilité au public
- Indicateur : Les espaces verts gérés par Bruxelles Environnement
- Indicateur : Sites semi-naturels et espaces verts protégés
- Focus : La carte d'évaluation biologique
- Focus : Couverture végétale
- Focus : Sport et espaces verts
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Rapport sur l’état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale, 2012 (.pdf)
- BRUXELLES ENVIRONNEMENT, BRAT et L’ESCAUT 2015. « Le jeu dans la ville - Pour un maillage jeux à Bruxelles », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 122 pp. (.pdf)
Etudes et rapports
- AGORA 2011. « Etude sur le maillage vertProgramme fondé sur la protection et la création des espaces verts et l'établissement de liens physiques entre eux, qui vise, outre la préservation du patrimoine naturel et l'accroissement de la biodiversité, à rééquilibrer les disparités régionales au niveau de la verdurisation et de la répartition des espaces verts publics, à améliorer les qualités paysagères et à promouvoir la mobilité douce. dans le cadre du plan régional de développement durableMode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Il s'agit donc d une démarche qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement, et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine. (PRDD) », rapport intermédiaire - étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement
- AGORA 2014. « Maillage vert - PRDD, Région de Bruxelles-Capitale, phase 2 : volet opérationnel - partie 1 : approche générale », Étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 96 pp. (.pdf)
- AGORA 2014. « Maillage vert - PRDD, Région de Bruxelles-Capitale, phase 2 : volet opérationnel - partie 2 : Etude de conception - Continuité Cureghem (L28), connexion station Jacques Brel - Cureghem », Étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 18 pp. (.pdf)
- AGORA 2014. « Maillage vert - PRDD, Région de Bruxelles-Capitale, phase 2 : volet opérationnel - partie 2 : Etude de conception - Continuité Fleuriste, connexion Bockstael - parc de la Senne - Jardins du Fleuriste », Étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 23 pp. (.pdf)
- AGORA 2014. « Maillage vert - PRDD, Région de Bruxelles-Capitale, phase 2 : volet opérationnel - partie 2 : Etude de conception - Continuité Foyer Jettois, connexion Parc de la Jeunesse - Tour&Taxis », Étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 16 pp. (.pdf)
- AGORA 2014. « Maillage vert - PRDD, Région de Bruxelles-Capitale, phase 2 : volet opérationnel - partie 2 : Etude de conception - Continuité Van Praet, connexion Flandre (Strombeek-Bever) -Canal-Schaerbeek », Étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 18 pp. (.pdf)
- AGORA 2014. « Maillage vert - PRDD, Région de Bruxelles-Capitale, phase 2 : volet opérationnel - partie 2 : Etude de conception - Continuité senne (sud), connexion Promenade verte - Gare du midi », Étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 30 pp. (.pdf)
- BRAT 2009. « Inventaire des espaces verts et espaces récréatifs accessibles au public en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 40 pp. + annexes (.pdf)
- BRAT et RUIMTECEL 2009. « Etude pour un redéploiement des aires ludiques et sportives en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 49 pp. (.pdf)
- BRUXELLES ENVIRONNEMENT, BRAT et L’ESCAUT 2015. « Le jeu dans la ville - Pour un maillage jeux à Bruxelles », Étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 122 pp. (.pdf)
- MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE 2011. « Développement des sites d’espaces publics dans la zone Tour&Taxis - Note de synthèse d’un marché d’études urbanistiques et paysagères », Étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 22 pp. (.pdf)
- MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE 2011. « Développement des sites d’espaces publics dans la zone Tour&Taxis - Rapport bilingue », Étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 161 pp. (.pdf)
- SUM RESEARCH 2015. « Plan directeur interrégional pour Neerpede - Vlezenbeek - Saint Anna-Pede », Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement et de la Vlaamse Landmaatschappij, 110 pp. (.pdf)
- SUM RESEARCH 2015. « Plan directeur interrégional pour Neerpede - Vlezenbeek - Sint Anna-Pede n°2 : Rapport phase 2 - VISION », Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement et de la Vlaamse Landmaatschappij, 38 pp. (.pdf)
- SUM RESEARCH 2015. « Plan directeur interrégional pour Neerpede - Vlezenbeek - Sint Anna-Pede n°3 : Rapport phase 3 - PLANS D'ACTION», Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement et de la Vlaamse Landmaatschappij, 138 pp. (.pdf)
- VAN DE VOORDE T., CANTERS F. ET CHEUNG-WAI CHAN J. 2010. « Mapping update and analysis of the evolution of non-built (green) spaces in the Brussels Capital Region - Part I & II», cartography and GIS Research Group - department of geography (VUB), Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 35 pp. (.pdf) (en anglais uniquement)
Plans et programmes
Liens utiles
Surveillance des espèces
Indicateur - Actualisation : janvier 2023
Quelles espèces d’animaux, de plantes, de champignons et de lichens sont présentes en Région bruxelloise? Où sont-elles localisées? Sont-elles rares ou fréquentes? Des espèces disparaissent-elles et, a contrario, d’autres apparaissent-elles ? Lesquelles sont exotiques? Pour répondre notamment à ces questions, la faune et la flore bruxelloises font l’objet d’une surveillance et d’un suivi scientifiques. Les données collectées contribuent à l’élaboration des politiques et mesures de gestion de la nature. Malgré son contexte urbain et sa taille limitée, la Région bruxelloise abrite une biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). relativement importante pour certains groupes.
Une surveillance et un suivi scientifique en support à la gestion de la biodiversité
La surveillance et le suivi de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). font partie des missions de Bruxelles Environnement.
Dès 1992 le ‘Réseau d’information et de surveillance de l’évolution de l’état de l’environnement par des bioindicateurs’ a été lancé par Bruxelles Environnement. Depuis, la répartition et les exigences écologiques de dizaines de groupes d’espèces ont été étudiées.
Cette mission repose essentiellement sur des inventaires et des études dont la réalisation est confiée, via des marchés publics, à des universités et instituts de recherche ou, via des subsides, à des associations de protection et de conservation de la nature.

Les données collectées dans ce cadre répondent à divers objectifs :
- répondre aux obligations internationales et bruxelloises liées à la surveillance de la nature et aux rapportages qui s’y rapportent (notamment dans le cadre des directives Natura 2000 et Oiseaux, de l’ordonnance relative à la conservation de la nature, etc.) ;
- contribuer à mettre en évidence les changements intervenant dans l’environnement ;
- élaborer et évaluer les politiques et mesures de gestion en matière de biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). ;
- informer et sensibiliser le public par rapport aux enjeux liés à la biodiversité.
Afin de rationaliser ses divers besoins en informations et ses initiatives de suivi relatifs à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., Bruxelles Environnement a développé en 2009 une stratégie de monitoring pour le suivi de la biodiversité en Région de Bruxelles-Capitale. Cette stratégie a été actualisée en 2020 pour tenir compte des évolutions récentes en matière de besoins, techniques et méthodes de recherche ainsi que de données disponibles.
Par ailleurs, en application de l’ordonnance Nature (art.15 §1er), un arrêté établissant un schéma de surveillance de l'état de conservation des espèces et habitats naturels présents en Région de Bruxelles-Capitale a été adopté en 2018.
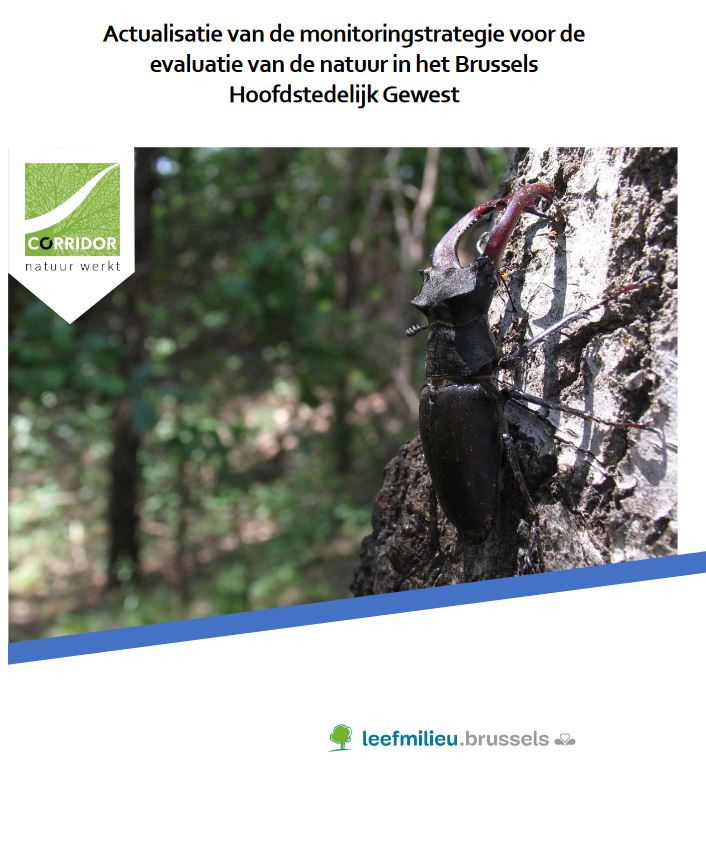
Depuis 2009, Bruxelles Environnement centralise au niveau d’une seule base de données les données dont elle dispose sur les espèces observées en Région bruxelloise. Cette base de données constitue un important point d’appui pour la politique bruxelloise en matière de biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)..
De nombreux inventaires et atlas de la flore et de la faune bruxelloises
Cette fiche se rapporte spécifiquement aux inventaires et suivis de groupes d’espèces effectués à l’échelle de la Région bruxelloise.
D’autres dispositifs de surveillance en lien avec la biodiversité sont présentés par ailleurs dans divers documents constitutifs des rapports sur l’état de l’environnement bruxellois, en particulier ceux relatifs:
- à la qualité biologique des cours d’eau et étangs ;
- à l’état sanitaire des hêtres et chênes en forêt de Soignes ;
- à l’évolution de l’avifaune ;
- à l’état de conservation de certaines espèces visées par les directives Habitats et Oiseaux (voir focus sur l’état de conservation des espèces et focus sur le Lucane cerf-volant) ;
- aux espèces exotiques envahissantes ;
- à la surveillance des habitats naturels ;
- au patrimoine forestier de la forêt de Soignes ;
- au suivi qualitatif et quantitatif des espaces verts (voir focus sur la couverture végétale en Région bruxelloise et focus sur la carte d’évaluation biologique de la Région bruxelloise) ;
- à la plateforme belge de partage et gestion de données d’observations naturalistes (voir focus collecte de données sur la biodiversité bruxelloise par les citoyens).
En complément, des paramètres abiotiques, tels que l’état de la nappe phréatique, sont également mesurés.
La surveillance des espèces a notamment abouti à la réalisation de plusieurs inventaires ou atlas couvrant l’ensemble de la Région bruxelloise.
Les tableaux ci-dessous présentent de manière extrêmement synthétique, pour les différents groupes taxonomiques inventoriés, les principales données quantitatives ressortant de ces études à savoir : le nombre d’espèces recensées pendant la période d’investigation sur le terrain (en distinguant les espèces indigènes des espèces introduites de façon volontaire ou accidentelle) ainsi que, lorsque les données sont disponibles, le nombre d’espèces éteintes au niveau bruxellois.
L’inventaire des espèces localement éteintes repose sur des données historiques (anciens relevés floristiques ou faunistiques, archives, anciens herbiers ou boîtes à insectes, etc.).
La période prise en compte, variable selon les études, est indiquée dans les tableaux ci-dessous. Pour les poissons, les données sont issues de 5 campagnes de mesures effectuées dans le cadre de l’évaluation de la qualité biologique des cours d’eau et étangs bruxellois (voir fiche documentée « Poissons »).
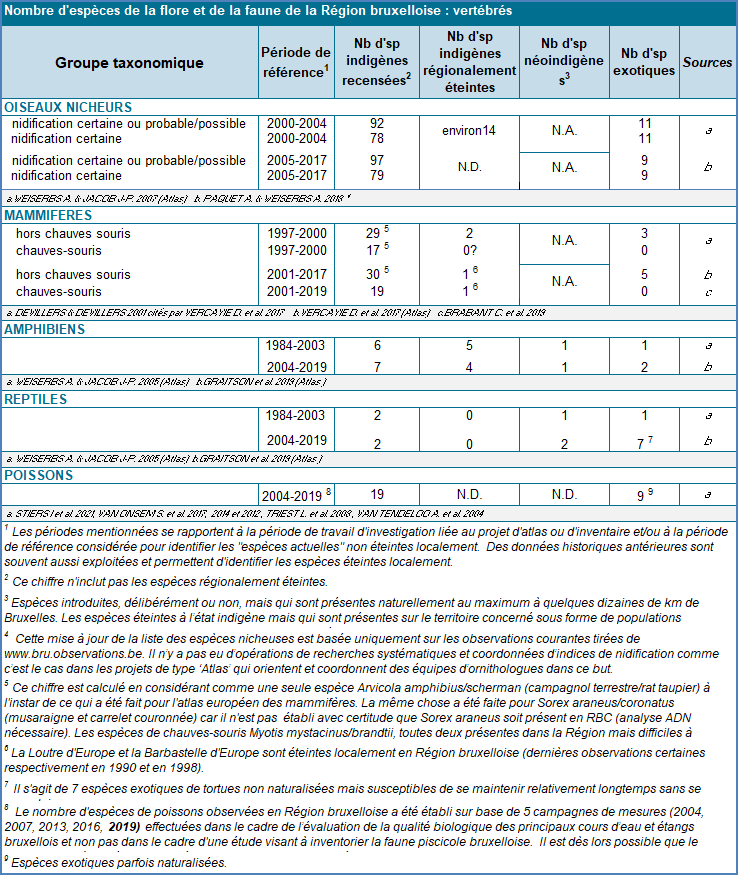
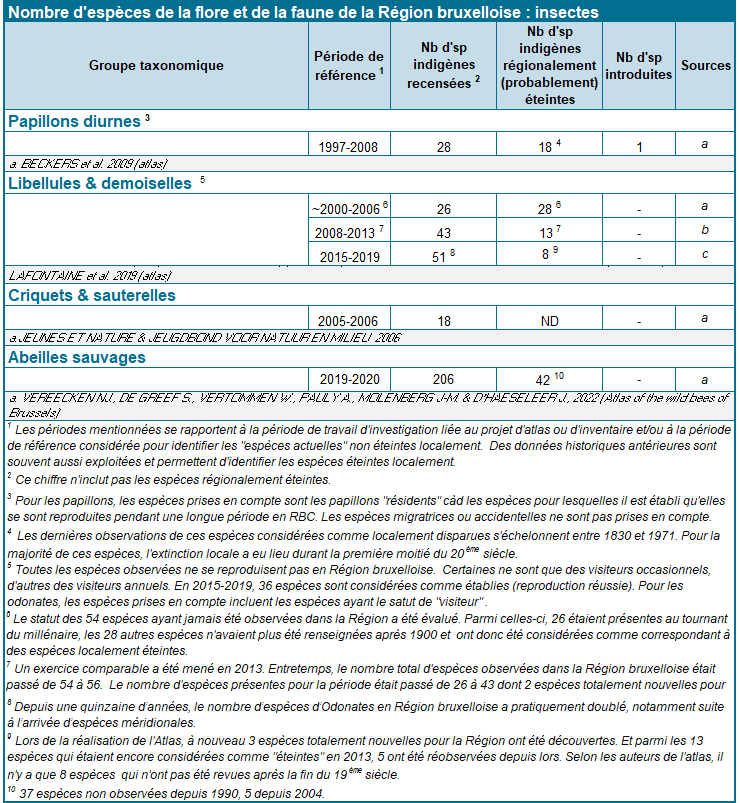
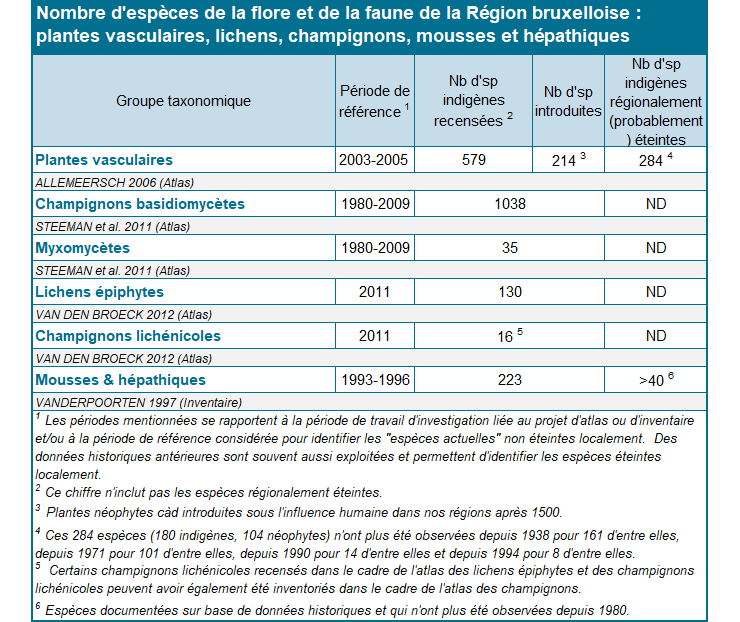
Au-delà des quelques chiffres présentés dans les tableaux ci-dessus, ces inventaires sont surtout intéressants du fait des analyses auxquelles ils aboutissent et qui permettent par exemple :
- d’établir des tendances par rapport à l’abondance et à la répartition spatiale des différentes espèces et de mettre en évidence les espèces les plus vulnérables ;
- d’identifier les sites les plus intéressants d’un point de vue biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). ;
- de recenser l’implantation de nouvelles espèces, que celle-ci soit le fait de l’intervention humaine ou résultant d’un processus naturel (suite par ex. aux changements climatiques) ;
- d’identifier (ou de contribuer à identifier) les facteurs à la base des évolutions constatées.
Ces études, généralement très riches en informations et nuancées quant au constat, peuvent difficilement être résumées en quelques lignes. Pour de plus amples informations, les lecteurs intéressés peuvent se reporter aux divers documents disponibles on-line (publications dans leur intégralité ou synthèses, voir liens ci-dessous vers les différents documents).
Certains groupes taxonomiques sont bien représentés sur le territoire bruxellois
Une comparaison des données présentées ci-dessus avec un inventaire des espèces établi par la DG statistique en 2017 (SPF Economie) montre qu’environ deux tiers des espèces de mammifères et d’odonates (libellules et demoiselles) présentes en Belgique sont également présentes en Région bruxelloise. Pour les groupes des oiseaux, amphibiens, orthoptères (criquets et sauterelles) et plantes vasculaires, cette proportion est de l’ordre de 40 à 50%.
En ce qui concerne les abeilles, 381 espèces ont été dénombrées en Belgique dont 45 sont aujourd’hui éteintes à l’échelle du pays (Liste rouge des abeilles de Belgique, 2019). La Région bruxelloise compte de l’ordre de 60% de l’ensemble des espèces contemporaines présentes en Belgique.
Ces pourcentages sont particulièrement élevés compte tenu de la petite taille du territoire bruxellois et de son caractère extrêmement urbanisé. Ce constat positif doit néanmoins être nuancé dans la mesure où un certain nombre d’espèces sont rares, voire très rares.
En revanche, avec moins d’un tiers d’espèces présentes, les reptiles, papillons diurnes et poissons sont nettement moins représentés en Région bruxelloise.
206 espèces d’abeilles sauvages présentes en Région bruxelloise
Le premier atlas des abeilles sauvages de la Région bruxelloise (2020) établit une liste de 248 espèces d’abeilles sauvages observées entre 1841 et 2020 sur le territoire régional.
Parmi celles-ci, 42 espèces (17%) sont considérées éteintes à l’échelle régionale (37 non observées depuis 1990, 5 depuis 2004). Parmi les 206 espèces encore présentes, près de 60% sont estimées dans une situation favorable (non menacé ou en expansion) et près de 40% dans une situation défavorable (vulnérable ou en danger). Les espèces en expansion sont dans la plupart des cas des observations isolées d’espèces qui n’avaient jamais été observées dans les données historiques. Animal d’élevage considéré éteint à l’état sauvage, l’abeille mellifère ou domestique, est la 249ème espèce d’abeille bruxelloise et n’est pas menacée sur le territoire.
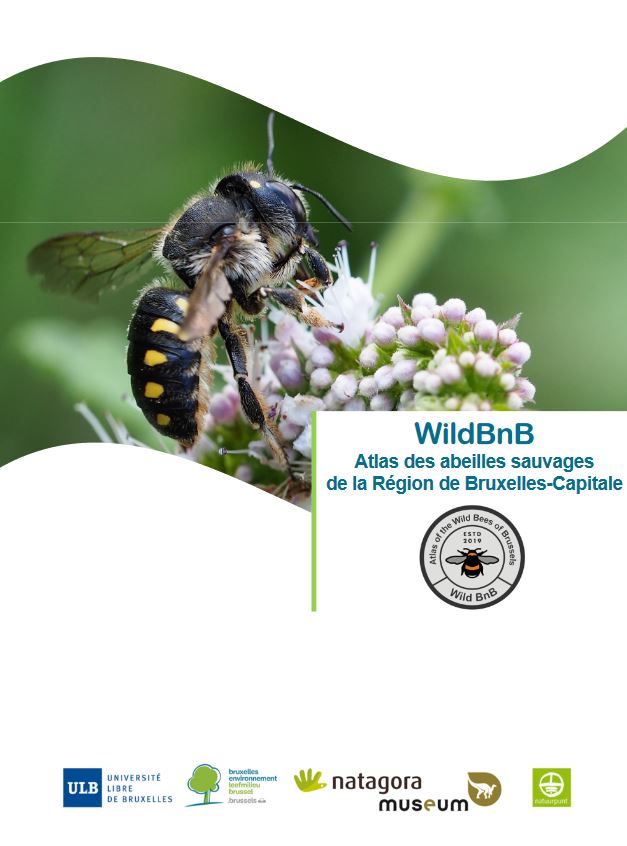
Identifiée comme l’un des sites naturels les plus riches de Belgique, la fricheZone de terrain laissée à l'abandon et progressivement colonisée par la végétation spontanée. Josaphat compte 127 espèces, dont 4 trouvées exclusivement dans ce site.
Depuis 2001, 2 espèces de mammifères terrestres absentes depuis des décennies ont à nouveau été observées et 3 nouvelles espèces de chauves-souris se sont implantées
En ce qui concerne les mammifères, une comparaison entre les 2 atlas ainsi que l’analyse des données collectées dans le cadre du suivi des populations bruxelloises de chauve-souris montrent que 2 espèces observées durant la période 1909-2000 n’ont plus été observées depuis la fin des années ‘80, à savoir : la Barbastelle (Barbastella barbastellus, espèce de chauve-souris) et la Loutre d’Europe (Lutra lutra).
Depuis 2001, 7 espèces qui n’avaient pas été observées auparavant ont été inventoriées :
- 5 espèces indigènes dont 3 espèces de chauve-souris: le Castor européen (Castor fiber), le Sanglier (Sus scrofa), le Verspertilion bicolore (Verspertilio murinus), le Pipistrelle de Kulh (Pipistrellus kuhlii) et l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) ;
- 2 espèces non indigènes (reprises dans la liste européenne des espèces invasives, voir indicateur sur les espèces exotiques envahissantes) : le Muntjac de Chine (Muntiacus reevesi, quelques observations, un individu a été capturé en 2016) et le Raton laveur (Procyon lotor) dont la présence actuelle en forêt de Soignes n’est pas établie avec certitude.
La comparaison des 2 atlas montre que pour respectivement 65% et 7% des espèces de mammifères présentes en Région bruxelloise, l’étendue du territoire sur lequel des observations ont été réalisées a augmenté ou est resté stable. Cette information doit néanmoins être considérée avec prudence compte tenu du fait que pour de nombreuses espèces la connaissance de leur écologie et des zones où elles sont présentes ainsi que les méthodes de détections se sont améliorées.
La richesse spécifique de chauves-souris de la Région bruxelloise est remarquable puisque 20 espèces de chauves-souris (dont une n’a plus été observée depuis une trentaine d’années), sur les 24 espèces de chauves-souris recensées à ce jour en Belgique, ont jusqu’ici été trouvées dans la Région.
Pour en savoir plus :
Le nombre d’espèces d’oiseaux nichant en Région bruxelloise reste stable mais la composition de l’avifaune évolue rapidement
L’évolution de la composition de l’avifaunePartie de la faune d un lieu constituée par les oiseaux. est rapide, tant du point de vue des espèces indigènes que des exotiques. Depuis la réalisation du dernier atlas de l’avifaune (2000-2004), des espèces se sont éteintes en tant que nicheuses certaines, le statut d’autres espèces a été revu à la baisse en « nicheur probable ». A l’inverse, de nouvelles espèces ont fait leur apparition. Des espèces qui dans l’Atlas 2000-2004 avaient été considérées comme récemment éteintes localement sont réapparues. Parmi les espèces nicheuses disparues, 2 sont exotiques (Cygne noir et Ouette de Magellan).
Les amphibiens et reptiles ont particulièrement souffert de la détérioration, destruction et fragmentation de leurs habitats
Le premier atlas de l’herpétofaunePartie de la faune constituée par les amphibiens et reptiles. de Bruxelles faisait le constat d’un déclin généralisé des espèces indigènes suite à la destruction, la détérioration et la fragmentation des milieux favorables. Six espèces indigènes sur les quatorze historiquement signalées dans la capitale étaient considérées comme éteintes. L’atlas 2004-2019, réalisé une dizaine d’années plus tard, confirme ce constat, puisque, à une exception près (la Grenouille verte), aucune des espèces considérées comme éteintes n’a pu être retrouvée, et ce, malgré une augmentation importante des connaissances.
Le phénomène de l’installation récente d’espèces étrangères à la faune bruxelloise, mis en évidence lors du premier atlas, s’est amplifié au cours des dernières années. Il concerne à la fois des espèces exotiques (au moins deux espèces de grenouilles naturalisées et diverses espèces de tortues aquatiques non naturalisées) et deux espèces néo-indigènes (espèces introduites, délibérément ou non, en Région bruxelloise mais qui sont présentes naturellement dans un territoire voisin de celui de l’aire d’introduction).
Les poissons, de retour dans la Senne depuis 2016, ont souffert en 2019
Les campagnes d’échantillonnages menées dans le cadre de l’évaluation de la qualité biologique des cours d’eau (trisannuelles) ont mis en évidence une nette amélioration de l’état de la faune piscicole au niveau de la Senne. En effet, lors des campagnes effectuées en 2007 et 2013, seul un poisson avait été capturé dans la Senne bruxelloise en 2013. Par ailleurs, aucun échantillonnage n’y avait été effectué lors de la campagne 2004 dans la mesure où la qualité de l’eau ne permettait pas d’accueillir une vie piscicole.
Ces résultats contrastent fortement avec ceux obtenus lors de la campagne de 2016 durant laquelle de l’ordre de 300 individus appartenant à 15 espèces différentes ont été recensés dans la Senne. Si l’on se réfère à la liste de référence des espèces historiquement présentes dans ce cours d’eau lorsque celui-ci n’était pas ou peu perturbé par les activités humaines, on constate que 11 espèces sur les 17 figurant dans cette liste ont été observées (parfois à une seule reprise). Parmi les espèces inventoriées en 2016 figurent des espèces écologiquement exigeantes dont, notamment, la Bouvière, espèce bénéficiant d’un statut de protection particulier dans le cadre de la législation européenne Natura 2000 (voir focus sur l’état de conservation des espèces).
Cette progression est avant tout à mettre en relation avec les efforts réalisés en matière d’épuration des eaux uséesL'épuration des eaux usées est l'élimination des déchets organiques et chimiques de l'eau jusqu'à un point permettant à la vie biologique dans les rivières, les lacs et les mers de ne pas subir les conséquences du déversement des ces eaux usées purifiées. et ce, tant en amont de Bruxelles qu’au niveau régional (voir thématique Eau et milieux aquatiques de l’état de l’environnement bruxellois).
Cette tendance positive ne s’est cependant pas confirmée lors de la dernière campagne (2019) laquelle a permis d’inventorier dans la Senne seulement une dizaine d’espèces et un nombre de spécimens largement inférieur à celui obtenu en 2013. Parmi les explications avancées figure notamment la sécheresse observée en 2019 durant laquelle le faible débit de la Senne combiné à des rejets pollués en charge organique a entrainé une chute des teneurs en oxygène dissous. La présence croissante d’une espèce invasive, à savoir le Crabe chinois, est également une explication avancée (voir indicateur sur la qualité biologique des eaux de surface) .
Les libellules et demoiselles, bioindicateurs de l’état des écosystèmes d’eaux douces
L’atlas des libellules et demoiselles (Odonates) réalisé de 2015 à 2019 pour le territoire bruxellois, a permis de répertorier 51 espèces contemporaines sur les 69 espèces observées en Belgique sur la même période. 8 espèces sont considérées comme régionalement éteintes.
A la fin du 20ème siècle, suite à la disparition ou régression de nombreuses zones humides, à la canalisation des cours d’eau et à l’aménagement des berges, à l’exploitation piscicole intensive des plans d’eau ou encore, à la pollution et eutrophisationApport excessif d'éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème. des cours d’eau, la Région bruxelloise n’abritait plus que 27 espèces de libellules et demoiselles. En moins de 2 décennies, l’état des populations d’odonates s’est fortement amélioré tant au niveau du nombre d’espèces observées que de leur statut de conservation. Selon les chercheurs, cette évolution est notamment liée à une amélioration générale de la qualité des eaux et de la gestion des berges, à l’augmentation des surfaces d’eau libre (cf. programme de maillage bleuLe Maillage bleu est un programme mis en œuvre depuis 1999, qui vise plusieurs objectifs : séparer les eaux usées des eaux propres afin de limiter l'apport d'eau aux stations d'épuration, restaurer certains éléments du réseau hydrographique de la Région, réaménager des tronçons de rivières, des étangs et des zones humides pour leur rendre toute leur valeur biologique, et leur faire éventuellement bénéficier de mesures spéciales de protection, et assurer la fonction paysagère et récréative de ces sites. avec remise à ciel ouvert de certains tronçons de cours d’eau) ainsi qu’à une diminution des populations excédentaires de poissons fouisseurs et herbivores. Elle démontre qu’une gestion adaptée peut très rapidement se traduire par des répercussions bénéfiques en termes de biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)..
À télécharger
Fiches méthodologiques
Fiches documentées
- n°1. Les Mammifères en Région bruxelloise, 2021 (.pdf)
- n°2. Oiseaux, 2018 (.pdf)
- n°5. Les Amphibiens et Reptiles en Région bruxelloise, 2022 (.pdf)
- n°6. Plantes supérieures, 2003 (.pdf)
- n°7. Bryophytes, champignons et lichens, 2003 (.pdf)
- n°8. Poissons, 2017 (.pdf) (2023 in prep)
- n°9. Invertébrés, 2017 (.pdf)
- n°11. Lichens épiphytes, 2012 (.pdf)
- n°12. Champignons, 2013 (.pdf)
- n°23. Avifaune liée au bâti et mobilisation pour sa sauvegarde, 2022
- n° 25. Les abeilles en Région de Bruxelles-Capitale, 2022 (.pdf)
- n°26. Les chauves-souris en Région de Bruxelles-Capitale, 2022 (.pdf)
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Evolution de l’avifaune (2022)
- Les amphibiens et reptiles en Région bruxelloise (2022)
- Libellules et demoiselles en Région bruxelloise (2022)
- Qualité biologique des principaux cours d’eau et étangs (2022)
- Les mammifères en Région bruxelloise (2021)
- Collecte de données sur la biodiversité bruxelloise par les citoyens (« crowdsourcing ») (2021)
- Champignons et lichens (édition 2011-2012)
- Habitats naturels dans les espaces verts bruxellois (édition 2007-2010)
- Biodiversité : les papillons de jour (édition 2007-2008) (.pdf)
- Environnement semi-naturel et espaces verts publics bruxellois : Etat de la flore et de la faune (édition 2003-2006) (.pdf)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Les abeilles sauvages en Région de Bruxelles-Capitale, 2018 (.pdf)
- Amphibiens et reptiles en Région de Bruxelles-Capitale, 2017 (.pdf)
- Les papillons de jour en Région de Bruxelles-Capitale, 2017 (.pdf)
- Les mammifères en Région de Bruxelles-Capitale, 2017 (.pdf)
- Les champignons en Région de Bruxelles-Capitale, 2017 (.pdf)
- Oiseaux en Région de Bruxelles-Capitale, 2018 (.pdf)
- Les chauves-souris – Connaître et protéger, 2019 (.pdf)
- Rapport sur l’état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale, 2012 (.pdf)
- Carte « Evolution de la population de papillons »
Etudes et rapports
- ADRIAENS P. 2020. “ Actualisatie van de monitoringstrategie voor de evaluatie van de natuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.” Corridor cvba, étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, Nazareth, 38 p. (néerlandais uniquement)
- ALLERMEERSCH L. 2006. "Opmaak van volledige floristische inventaris van het BHG en een florakartering", étude réalisée par le Jardin Botanique National de Belgique pour le compte de Bruxelles Environnement, 322 p. (.pdf) (néerlandais uniquement)
- BECKERS, K., OTTART, N., FICHEFET, V., BECK, O., GRYSEELS, M., MAES, D. 2009. "Papillons de jour en Région de Bruxelles-Capitale (1830 - 2008): distribution et conservation", Bruxelles Environnement & Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Bruxelles, 157 p. (En vente auprès du Service Info-environnement de Bruxelles Environnement)
- BRABANT C., NYSSEN P., WEISERBS A. & SAN MARTIN G., 2019. “Analyse des données de monitoring et développement de critères pour l’état de conservation local des ChiroptèresOrdre de mammifères souvent nocturnes et insectivores, adaptés au vol grâce à des membranes alaires fixées entre leurs doigts, sur les flancs et parfois sur la queue, et appelés communément chauves-souris. en Région de Bruxelles-Capitale”, étude effectuée par Natagora à la demande de Bruxelles environnement
- Website Rode Lijsten in Vlaanderen (néerlandais uniquement)
- DEVILLERS P., DEVILLERS-TERSCHUREN J. 1998. “Mammifères de Bruxelles, facteurs de risque et mesures de gestion” in IBGE "Qualité de l'environnement et biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). en RBC", document de travail de l'I.R.Sc.N.B. nr. 93: 147-164.
- GRAITSON E., PAQUET A., VERBELEN D. 2022. “Atlas des Amphibiens et Reptiles de la Région de Bruxelles-Capitale”, étude effectuée par Natagora, Natuurpunt & BE/LB à la demande de Bruxelles Environnement, 106 p.
- IPBES 2018. “The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia”, 892 p. (.pdf) (en anglais uniquement).
- JEUNES ET NATURE & JEUGDBOND VOOR NATUUR EN MILIEU "Atlas des orthoptères (criquets et sauterelles) de Bruxelles", étude réalisée par le groupe de travail Saltabel dans le cadre du projet SaltaBru avec le soutien de Bruxelles Environnement, publiée dans la feuille de contact n°3 (été 2006) de J&N et JNM, 11 p. (.pdf)
- JOORIS R. 2007. “Inventarisatie amfibieën en reptielen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, rapport de Natuurpunt (studie 2007/3, werkgroep Hyla), réalisé pour le compte du Ministerie voor Leefmilieu, Energie en Waterbeleid et Bruxelles Environnement – département biodiversité, Mechelen, 19 p. (.pdf) (néerlandais uniquement)
- LAFONTAINE, R-M., CARPENTIER, C., GOFFETTE, J., OGER, M., MAREE S., PASAU, B., DAEMS, V., DE BOECK, B., BOECKX, A., BOON, L. & DEVILLERS, P. 2019. “Atlas des libellules de la Région de Bruxelles Capitale”. Rapport final lié à la subvention SUB/2018/IRSNB – Bruxelles Environnement (.pdf)
- LAFONTAINE R.-M., DELSINNE T., DEVILLERS P. (IRSNB) "Evolution des populations de libellules de la RBC - leurs récentes augmentations - importance de la gestion des étangs" in Les Naturalistes belges 2013, 94, 2-3-4: 33-70. (html)
- MAES D., BAERT K., CASAER J., CRIEL D., CREVECOEUR L., DEKEUKELEIRE D., GOUWY J., GYSELINGS R., HAELTERS J., HERMAN D., HERREMANS M., HUYSENTRUYT F., LEFEBVRE A., OKELINX T., STUYCK J., THOMAES A., VAN DEN BERGE K., VANDENDRIESSCHE B., VERBEYLEN G., VERCAYIE D. 2014. « De IUCN Rode Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen », rapport de l’ Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek (INBO.R.2014.182811), Brussel. (html) (néerlandais uniquement)
- MAES D.,VANREUSEL W., JACOBS I., BERWAERTS K., VAN DYCK H., « De IUCN Rode Lijst van de dagvlinders in Vlaanderen », rapport de l’Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek (21), Brussel. (html) (néerlandais uniquement)
- PAQUET A. 2022. « Monitoring des populations d’oiseaux en Région de Bruxelles-Capitale - rapport 2021 », rapport annuel effectué par Natagora Aves pour le compte de Bruxelles Environnement, 97 p. (.pdf) (autres années disponibles)
- STEEMAN R., ASPERGES M., BUELENS G., DE CEUSTER R., DECLERCQ B., KISZKA A., LEYSEN R., MEUWIS T., MONNENS J., ROBIJNS J., VAN DEN WIJNGAERT M., VAN ROY J., VERAGHTERT W. & VERSTRAETEN P. 2011. “Paddenstoelen in Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 1980-2009. Verspreiding en ecologie”, étude de Natuurpunt réalisée avec le soutien de Bruxelles Environnement, 725 p. (néerlandais uniquement) (En vente auprès de Natuurpunt)STIERS I., AYMERE AWOKE A., VAN WICHELEN J., BREINE J., TRIEST L., 2021. « De biologische kwaliteit van waterlopen, kanaal en vijvers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2019. Fytoplankton, fytobenthos, macrofyten, macro-invertebraten en vissen », étude VUB & INBO réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 111 pp. (seulement en néerlandais) VAN CALSTER H., BAUWENS D. 2010. “Naar een monitoringstrategie voor de evaluatie van de toestand van de natuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, étude effectuée par Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek (INBO.R.2010.37) pour le compte de Bruxelles Environnement, Brussel, 183 p. (.pdf) (néerlandais uniquement)
- VAN DEN BROECK D. 2012. « Atlas van de epifytische korstmossen en de erop voorkomende lichenicole fungi van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, étude effectuée par le Jardin Botanique National de Belgique pour le compte de Bruxelles Environnement, 161 p. (.pdf) (néerlandais uniquement)
- VANDERPOORTEN A. 1997. “A bryological survey of the Brussels Capital Region”, in Scripta Botanica Belgica, vol 14, pp 1-51. (html) (anglais uniquement)
- VAN LANDUYT W., HOSTE I., VANHECKE L., VAN DEN BREMPT P., VERCRUYSSE W. en DE BEER D. 2006. “Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest”, Instituut voor natuur- en bosonderzoek, Nationale Plantentuin van België & Flo.Wer., 99 p. (.pdf) (néerlandais uniquement)
- Van Onsem S., BREINE J., TRIEST (VUB & INBO), 2017. “De biologische kwaliteit van waterlopen, kanaal en vijvers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016”, étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 92 p. + annexes. (.pdf) (néerlandais uniquement)
- Vercayie D., Paquet A., Feys S., Willems W. & PaquET J-Y. 2020. « Zoogdierenatlas van het Brussels Gewest. 2001-2017 », rapport Natuurpunt Studie 2017/39 réalisé pour le compte de Bruxelles Environnement, Mechelen.
- VEREECKEN NJ., DE GREEF S., VERTOMMEN W., PAULY A., MOLENBERG J-M. & D’HAESELEER J., 2022. « WildBnB : Atlas des abeilles sauvages de la Région de Bruxelles-Capitale », rapport final, étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 202 p. (.pdf)
https://document.environnement.brussels/opac_css/doc_num.php?explnum_id=10747 - WEISERBS A., JACOB J.-P. 2007. « Oiseaux nicheurs de Bruxelles 2000-2004: répartition, effectifs, évolution », étude effectuée par Aves pour le compte de Bruxelles Environnement, Liège, 292 p. (En vente auprès de Natagora)
- WEISERBS A., JACOB J.-P. 2005. «Amphibiens et reptiles de la Région de Bruxelles-Capitale", étude effectuée par AVES et Bruxelles Environnement - IBGE, Bruxelles, 107 p. (.pdf)
Plans et programmes
Liens utiles
Evolution de l'avifaune
Focus – Actualisation : septembre 2023
Un déclin s’observe pour près de 30% de la quarantaine d’espèces d’oiseaux communs suivis annuellement depuis 1992. Pour le groupe des espèces indigènes, l’analyse des données suggère un déclin sur le long terme et une tendance stable depuis 10 ans. Les oiseaux communs dont le déclin sur le long terme est le plus marqué sont des espèces nichant dans le bâti ainsi que des espèces migratrices. Une évolution globalement favorable est par contre observée pour les espèces exotiques et les Corvidés.
Les oiseaux, de bons indicateurs de l’état de la biodiversité
Les oiseaux constituent de bons indicateurs de l’état de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore).. Leur capacité de dispersion particulièrement élevée leur permet en effet de réagir rapidement aux changements qui interviennent dans l’environnement. En outre, les oiseaux sont présents dans la plupart des habitats naturels et milieux (semi)-urbanisés et sont représentés pratiquement à tous les niveaux de la chaîne alimentaire y compris aux niveaux les plus élevés (insectivores, prédateurs). Ils peuvent aussi être facilement observés.
Le suivi de l’avifaunePartie de la faune d un lieu constituée par les oiseaux. bruxelloise repose sur différents dispositifs : réalisation d’atlas inventoriant la répartition et l’abondance des oiseaux nicheurs (tous les 15-20 ans), suivis annuels de l’avifaune commune ou de groupes d’espèces ciblées permettant d’évaluer des tendances (oiseaux d’eau entre autres), études scientifiques spécifiques, monitoring d’espèces d’intérêt communautaire et régional, etc. Ce travail a été jusqu’à présent essentiellement assuré par Aves, le pôle ornithologique de Natagora asbl, à la demande de Bruxelles Environnement.
Un déclin à long terme confirmé pour près de 30% des espèces pour lesquelles une tendance est mise en évidence
Le suivi annuel des oiseaux communs est organisé depuis 1992. Il se fait via la méthode des « points d’écoute » qui consiste à inventorier, au printemps, l’ensemble des oiseaux vus ou entendus pendant 15 minutes lors de deux passages en un site d’observation fixe, identique d’années en années. Cette méthode, convenant surtout aux espèces dont la manifestation territoriale se fait par le chant, permet de suivre un peu moins de la moitié de l’avifaune nicheuse bruxelloise. Les espèces non concernées sont des migrateurs qui peuvent effectuer une halte à Bruxelles pendant le printemps mais n’y nichent jamais, des espèces pour lesquelles la technique des points d’écoute est inadéquate (oiseaux d’eau, hirondelles, rapaces nocturnes…) ainsi que des nicheurs rares pour lesquels le nombre de contacts est insuffisant.
Le réseau de points d’écoute compte actuellement 116 stations représentatives de la diversité des espaces verts bruxellois mais aussi de milieux densément bâtis.
Pour la période 1992-2022, une tendance statistiquement significative a pu être mise en évidence pour 42 espèces (espèces vues ou entendues avec une fréquence suffisante soit la plupart des espèces répandues en Région bruxelloise) soit un peu moins de la moitié des espèces d’oiseaux nichant avec certitude en Région bruxelloise. Parmi celles-ci :
- 1 espèce (soit 2%) est en fort déclin, à savoir le Moineau domestique (Passer domesticus) ;
- 11 espèces (soit 26%) sont en déclin ;
- 13 espèces (soit 31%) sont stables sur le long terme ;
- 15 espèces (soit 36%) sont en augmentation dont 2 exotiques (la Perruche à collier et le Faisan de Colchide) ;
- 2 espèces (soit 5%) sont en forte augmentation dont 1 exotique (l’Ouette d’Egypte).
Rappelons que ce bilan ne concerne qu’une partie de l’avifaune essentiellement composée des espèces nicheuses les plus répandues. Un grand nombre d’espèces non suivies par la méthode des points d’écoute sont en déclin à l’échelle régionale ; il s’agit le plus souvent d’espèces ayant davantage d’exigences écologiques lors de la nidification.
Le graphique ci-dessous permet d’identifier les espèces en progression, stables ou en déclin.
Une tendance évolutive à long terme positive ou stable a été établie pour 30 espèces communes d’oiseaux parmi les 42 espèces pour lesquelles une tendance a pu être établie (1992-2022)
Source : Paquet A 2023 (Natagora-Aves)
La définition des cinq catégories de tendance des populations est définie en fonction du taux de croissance annuel moyen et de la fiabilité de l’estimation (pour plus de détails, voir Monitoring des populations d’oiseaux en Région de Bruxelles-Capitale, Rapport 2022, p. 18).
Pour en savoir plus sur le pourcentage d’évolution de l’avifaune commune depuis 1992
Les effectifs de plusieurs espèces autrefois très communes ont chuté
4 espèces ont vu leurs effectifs chuter de plus de 80% en l’espace de 30 ans, à savoir, le Moineau domestique, la Fauvette des jardins, l’Etourneau sansonnet et la Tourterelle turque. Parmi ces oiseaux, le Moineau domestique, l’Etourneau sansonnet et la Tourterelle turque étaient considérés comme des oiseaux très communs à Bruxelles et dans les villes en général.
6 autres espèces connaissent un déclin compris entre 50 et 80% sur la même période : le Verdier d’Europe, la Fauvette grisette, la Mésange huppée, le Roitelet huppé, le Rougequeue noir ainsi que le Martinet noir.
Les 4 espèces liées au bâti en Région bruxelloise, à savoir le Moineau domestique, l’Étourneau sansonnet, le Rougequeue noir et le Martinet noir, sont donc en déclin marqué.
Avec des réductions d’effectifs proches de 50%, le déclin d'espèces très communes comme I'Accenteur mouchet, le Merle noir et le Troglodyte mignon est interpellant et a de quoi inquiéter. Ces oiseaux des jardins, parcs et forêts ont un régime alimentaire principalement basé sur les invertébrés du sol, de la litière et des sous-étages des habitats arborés qu'ils fréquentent. Les variations épisodiques des populations d'Accenteurs mouchets et de Troglodytes sont souvent dues aux hivers rigoureux. Dans le cas présent, la tendance est lourde et semble transcender les épisodes d'hivers froids.
Divers facteurs peuvent contribuer à expliquer le déclin de nombreuses espèces, notamment la diminution et le morcellement des espaces verts et des friches, la raréfaction des sources de nourriture (cf. forte régression des populations d’insectes, des graminées, des plantes sauvages à baies, des vergers, des poulaillers, etc.) et des zones favorables à la nidification, la pollution (dont les pesticides), l’évolution climatique ou encore, la rénovation du bâti qui réduit les possibilités de nidification des espèces cavernicoles. Certaines espèces telles que le moineau ou le merle sont en outre victimes d’épizooties. Le Merle noir a, par exemple, fortement souffert du virus USUTU qui a touché les populations urbaines en Belgique entre 2016 et 2019. La population semble se rétablir petit à petit.
La Mésange boréale n’est plus reprise dans le tableau car elle s’est éteinte en tant qu’espèce nidificatrice régionale. Les résultats concernant le Martinet noir, espèce très mobile, doivent être pris avec réserve et considérés comme un indice de présence globale.
Les espèces généralistes progressent
Les espèces moins exigeantes telles que les pigeons ou les geais, sont capables de s’adapter à ce que leur offre le milieu urbain. Le Choucas des tours a multiplié ses effectifs par 21 depuis 1992.
La population de Pies bavardes, communément perçue comme étant en augmentation, apparaît stable.
Notons l’apparition, dans le graphique, du Faisan de Colchide pour la première fois depuis 1992 et ce, parmi les 6 espèces ayant la plus forte croissance. Le Faisan de Colchide est une espèce exotiqueDésigne une espèce qui n'était pas présente à l'origine dans les zones où on la trouve maintenant, et dont la présence est attribuable directement ou indirectement à l'activité humaine. Opposée à espèce indigène. introduite comme oiseau d’ornement et comme gibier pour l’exercice de la chasse en plaine agricole. En Région bruxelloise, il est observé essentiellement à Neerpede et dans le Vogelzangbeek (Anderlecht). Cette espèce constitue une menace avérée pour les lézards (dont les Orvets) et les serpents. Par ailleurs, la concentration de Faisans de Colchide non immunisés dans un même endroit suite à des lâchers massifs serait, selon l’AFSCA, un facteur d’amplification des épidémies de grippe aviaire (comm.pers. A. Paquet, 2023 voir réf. ci-dessous).
La tendance est incertaine pour 17 espèces dont la plupart sont en danger d’extinction ou nouvellement installées
Outre les espèces dont le comportement ne se prête pas à la méthodologie du suivi par points d’écoute, quelques espèces communes ne fournissent pas suffisamment de données de contact permettant au modèle statistique d’obtenir des résultats statistiquement significatifs.
Pour ces espèces, les données permettent malgré tout de dresser le constat suivant :
- 7 espèces indigènes, auparavant communes en Région bruxelloise, sont gravement menacées : Mésange boréale (Poecile montanus), possiblement éteinte localement, Gobemouche gris (Muscicapa striata), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus), Grive draine (Turdus viscivorus), Mésange noire (Periparus ater) et Hirondelle rustique (Hirundo rustica) ;
- 6 espèces communes sont nouvellement installées en Région bruxelloise: Bernache du Canada (Branta canadensis), Perruche alexandre (Psittacula eupatria), Pic mar (Dendrocoptes medius), Autour des palombes (Accipiter gentilis), Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) et Pic noir (Dryocopus martius) ;
- Une tendance non significative peut être établie pour 4 espèces : Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), possiblement en croissance légère, Pic épeichette (Dryobates minor), possiblement en déclin léger, Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes Coccothraustes), possiblement en croissance et Bergeronnette grise (Motacilla alba), possiblement en déclin.
Des évolutions contrastées en fonction des espèces
Pour la période 1992-2022, les oiseaux communs dont le déclin est le plus marqué sont des migrateurs et des espèces liées au bâti. Une évolution globalement favorable est par contre observée pour les espèces exotiques et les corvidés. Pour les espèces cavernicoles indigènes, la tendance est globalement stable.
Les graphiques ci-dessous mettent en évidence l’évolution de groupes particuliers d’oiseaux.
L’analyse par groupe d’espèces (MSI, Multi Species Index ou, en français, Indice multispécifique) repose sur une moyenne géométrique des courbes de tendance des différentes espèces d’un même groupe, le ‘poids’ de chaque espèce étant considéré comme égal aux autres alors que la taille de leur population respective peut différer. Il est important de prendre en compte cette particularité de calcul pour tirer des interprétations correctes des tendances.
La courbe de tendance est établie sur base des fluctuations annuelles de l’indice MSI. Les deux courbes en pointillé situées de part et d’autre de cette courbe indiquent la marge d’erreur associée à la courbe de tendance. La tendance annuelle est obtenue en mesurant la pente d’une droite, sorte de droite de régression, calculée par un modèle statistique sur les années choisies. L’analyse ne prend en compte que les espèces pour lesquelles les tendances sont statistiquement significatives.
Pour les espèces communes indigènes, les résultats sont statistiquement significatifs pour la période 1992-2022 pour 33 espèces.
Entre 1992 et 2022, l’indice multispécifique relatif à 33 espèces d’oiseaux indigènes communes s’est globalement réduit d’environ 16% et semble stable depuis 10 ans
Source : PAQUET A. et DEROUAUX A. 2023 (Natagora-Aves)
L’analyse statistique de l’indice multi-espèces (MSI) effectué pour le groupe des espèces indigènes suggère un déclin modéré (-16% depuis 1992) sur le long terme et une tendance stable depuis 10 ans.
Au niveau européen également, le monitoring des espèces communes d’oiseaux met en évidence un déclin significatif sur le long terme.
Pour en savoir plus sur les tendances à l’échelle européenne
Ce déclin sur le long terme (25 ans) s’observe en particulier chez les espèces d’oiseaux inféodées aux espaces agricoles (SOER, 2020). Selon l’Agence européenne de l’environnement (SOER 2020), cette tendance est avant tout liée à la perte, fragmentation et dégradation des écosystèmes naturels ou semi-naturels (résultant pour une part importante de l’intensification de l’agriculture) ainsi qu’à l’urbanisation croissante des terres qui accroît notamment la pollution lumineuse et sonore. Le déclin drastique des populations d’insectes impacte également les nombreuses espèces d’oiseaux qui dépendent d’eux pour se nourrir ou nourrir leurs petits. Cette tendance a été confirmée par une récente étude qui a estimé qu’au niveau de l’Union européenne, les effectifs de 378 espèces d’oiseaux indigènes nichant en Europe (sur 445) ont globalement diminué de 16 à 18% entre 1980 et 2017. Les changements les plus importants ont été observés chez les espèces associées aux milieux agricoles et prairies, aux rivages ainsi que chez les espèces migratrices à longue distance (Burns et al. 2021).
Entre 1992 et 2022, l’indice multispécifique relatif à 25 espèces d’oiseaux présents en forêt de Soignes apparait globalement stable
Source : PAQUET A. et DEROUAUX A. 2023 (Natagora-Aves)
Entre 1992 et 2022, l’indice multispécifique relatif aux oiseaux de la forêt de Soignes suivis par la méthode des points d’écoute serait resté relativement stable (+3% sur la période 1992-2022). Comparativement à d’autres groupes d’espèces, tels que ceux des quartiers résidentiels ou les espèces nichant dans le bâti, les oiseaux communs de la forêt de Soignes se portent mieux. L’analyse des résultats d’écoute montre par exemple que le Merle noir résiste bien en forêt alors que ses effectifs ont fortement régressé sur le reste du territoire bruxellois.
Entre 1992 et 2022, l’indice multispécifique relatif à 14 espèces d’oiseaux des quartiers résidentiels s’est globalement réduit d’environ un tiers
Source : PAQUET A. et DEROUAUX A. 2023 (Natagora-Aves)
Entre 1992 et 2022, l’indice multispécifique relatif aux espèces d’oiseaux des quartiers résidentiels suivis par la méthode des points d’écoute (hors forêt de Soignes) aurait baissé de 34% sur la période 1992-2022. Ce groupe contient la Mésange charbonnière, la Mésange bleue, l’Orite à longue queue (anciennement Mésange à longue queue), le Rougegorge familier, le Troglodyte mignon, l’Accenteur mouchet, le Merle noir, l’Etourneau sansonnet, le Pinson des arbres, le Pigeon ramier, le Verdier d'Europe, la Tourterelle turque, la Pie bavarde, la Corneille noire et le Moineau domestique.
Entre 1992 et 2022, l’indice multispécifique relatif à 5 espèces communes d’oiseaux exotiques a globalement été multiplié par plus de 5
Source : PAQUET A. et DEROUAUX A. 2023 (Natagora-Aves)
Le groupe des espèces exotiques est en forte croissance (MSI +441% sur la période 1992-2022) mais semble se stabiliser ces dernières années. Ce groupe comprend l’Ouette d'Egypte, la Bernache du Canada, la Perruche à collier, la Perruche Alexandre et la Perriche jeune-veuve.
L’Ouette de Magellan et le Cygne noir ne nichent plus à Bruxelles et sont au bord de la disparition.
Entre 1992 et 2022 l’indice multispécifique relatif à 4 espèces communes d’oiseaux nichant sur le bâti a globalement diminué de trois quarts
Source : PAQUET A. et DEROUAUX A. 2023 (Natagora-Aves)
Bon à savoir
Plusieurs facteurs expliquent la baisse impressionnante des espèces nichant sur le bâti, familières et emblématiques des villes : la rénovation des bâtiments éliminant les cavités anciennes (corniches, trous de boulin…), le bâti moderne laissant peu de place à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). (fer, béton et verre), la baisse globale de la biomasseEnsemble des végétaux et des animaux, ainsi que des déchets organiques qui leur sont associés. La biomasse végétale provient de la photosynthèse et constitue une source d'énergie renouvelable. en insectes (voir fiche documentée sur les invertébrés) et, en ce qui concerne les moineaux, la pénurie de graines. L’intégration de dispositifs d’accueil de ces espèces liées au bâti lors des travaux d’isolation des bâtiments constitue un enjeu de taille en termes de préservation de la biodiversité.
Pour plus d’informations, voir la fiche documentée « Avifaune liée au bâti et mobilisations pour sa sauvegarde ».
Entre 1992 et 2022, l’indice multispécifique relatif à 11 espèces indigènes d’oiseaux cavernicoles a globalement progressé de près d’un cinquième
Source : PAQUET A. et DEROUAUX A. 2023 (Natagora-Aves)
Les espèces cavernicoles indigènes sont globalement en tendance stable pour les trois dernières décennies. Ce groupe comprend le Pigeon colombin, le Pic vert, le Pic épeiche, le Pic mar, la Mésange charbonnière, la Mésange bleue, la Mésange nonnette, la Sitelle torchepot, le Grimpereau des jardins, l’Etourneau sansonnet et le Choucas des tours. Parmi ces 11 espèces, 1 est en déclin, 3 sont stables, 6 augmentent et la tendance est incertaine pour 1. La Mésange boréale semble au bord de l’extinction locale.
Entre 1992 et 2022, l’indice multispécifique relatif à 4 espèces de Corvidés a globalement été multiplié par 2,5
Source : PAQUET A. et DEROUAUX A. 2023 (Natagora-Aves)
Les Corvidae sont en progression (MSI : +150% à long terme). Ce groupe comprend la Corneille noire (en augmentation), le Choucas des tours (en forte augmentation), la Pie bavarde (stable) et le Geai des chênes (en augmentation).
Le Corbeau freux n’apparaît pas encore dans les résultats statistiquement significatifs bien qu’il soit en train de s’établir rapidement dans la capitale. Quelques colonies, de taille variable, sont déjà dénombrées.
Entre 1992 et 2022, l’indice multispécifique relatif à 5 espèces d’oiseaux migrateurs a globalement été réduit de plus de moitié
Source : PAQUET A. et DEROUAUX A. 2023 (Natagora-Aves)
Le groupe des espèces migratrices, toutes insectivores (Martinet noir, Fauvette grisette, Fauvette à tête noire, Pouillot fitis, Pouillot véloce) est en déclin marqué (MSI -55%) sur le long terme mais semble montrer un léger fléchissement du déclin depuis quelques années. Une partie du groupe des insectivores migrateurs est constituée d’espèces (Sylviidae) liées aux friches. Etant donné que ces dernières disparaissent progressivement suite à leur urbanisation, les Sylviidae (Fauvettes et autres) contribuent certainement à la tendance négative globale du groupe observé sur le long terme. Notons que plusieurs espèces migratrices dont les observations sont trop peu nombreuses ne sont plus prises en compte dans l’analyse de tendance.
En période de nidification, environ un quart des oiseaux aquatiques présents sont exotiques
Depuis 1995, une vingtaine de sites humides bruxellois sont échantillonnés une fois par an au cours de la seconde quinzaine du mois de mai en période de reproduction.
Le dernier suivi a permis de dénombrer 14 espèces. Les populations les plus abondantes sont celles de Foulques macroules (Fulica atra), de Canards colverts (Anas platyrhynchos), de Bernaches du Canada (Branta canadensis) et d’Ouettes d’Egypte (Alopochen aegyptiaca). Ces espèces représentaient à elles seules près de 80% des populations d’oiseaux d’eau communs nicheurs au niveau des sites étudiés. Ce pourcentage était identique au printemps 2020 et 2018. Deux espèces exotiques sont en forte croissance, à savoir la Bernache du Canada et l’Ouette d’Egypte (effectifs multipliés par 14 environ en 30 ans). Lors des dénombrements les plus récents, 2 autres espèces exotiques ont également été rencontrées : le Canard mandarin (Aix galericulata) et le Canard carolin (Aix sponsa). Durant la période de nidification, ces 4 espèces exotiques représentent actuellement plus d’un quart de l’effectif global des populations d’oiseaux aquatiques.
Bon à savoir
L’Ouette d’Egypte et la Bernache du Canada sont des espèces reprises comme espèces exotiques envahissantes dans la législation, respectivement européenne et bruxelloise (voir indicateur Espèces exotiques envahissantes ).
Ces oiseaux de parc ornementaux étaient très à la mode dans les jardins privés, d’où ils se sont échappés pour s’établir dans la nature. Ces espèces, qui nichent en Région bruxelloise, se rassemblent en groupes importants lors de leur mue. Le rassemblement de ces oiseaux durant quelques semaines en un même endroit peut occasionner des dégâts importants aux habitats rivulaires en raison du piétinement et des déjections. Ces dernières rendent les sentiers de promenade et les pelouses impropres aux loisirs et augmentent les quantités de nutriments qui parviennent dans l’eau, provoquant le développement d’algues bleues et du botulisme. D’autres impacts sont également problématiques comme leur potentiel en tant que vecteur de maladies touchant l’avifaunePartie de la faune d un lieu constituée par les oiseaux. (comportement grégaire) ou leur comportement agressif vis-à-vis des promeneurs et/ou leur caractère compétitif vis-à-vis d’autres espèces (agressivité, occupation par les Ouettes des sites de nidification très tôt dans l’année, vol de nids, broutage intensif).
Les effectifs d’oiseaux d’eau les plus élevés se trouvent aux étangs Mellaerts, aux étangs de Neerpede et au Parc de Woluwe. Les sites les plus riches en espèces sont les étangs de Neerpede, l’étang de Val Duchesse et le Parc de Woluwe.
La Région bruxelloise accueille une riche biodiversité d’oiseaux aquatiques en hiver
Pendant l’hiver 2021-2022, une cinquantaine de sites ont été visités à 4 reprises et ont permis de dénombrer 32 espèces d’oiseaux aquatiques (au sens large) ce qui témoigne d’une riche biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore).. Les espèces les plus abondantes par ordre décroissant sont la Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus), la Foulque macroule (Fulica atra), le Canard colvert (Anas platyrhinchos), la Bernache du Canada (Branta canadensis), le Goéland argenté (Larus argentatus), la Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus), le Canard chipeau (Mareca strepera), l’Ouette d’Égypte (Alopochen aegyptiaca), le Fuligule milouin (Aythya ferina), le Fuligule morillon (Aythya fuligula) et le Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo).
Pendant l’hiver 2021-2022, les trois sites qui ont abrité la plus grande biodiversité sont le Domaine Royal de Laeken, les étangs de Neerpede et la partie nord du canal de Bruxelles. En termes d’effectifs, le domaine royal de Laeken, la Senne nord (Haren) et l’étang Ten Reuken offrent dans l’ordre décroissant les plus grandes populations.
Bon à savoir
Selon Natagora-Aves, les recensements montrent globalement une progression de bon nombre d’espèces indigènes liées au milieu aquatique. Cette évolution serait liée à la protection partielle ou totale qui leur est accordée depuis la fin du 20e siècle ainsi qu’à la mise en œuvre de programmes de restauration écologique des milieux humides et ce, tant en Région bruxelloise que dans les régions et pays voisins. Notons à cet égard la renaturalisation de certaines berges du Rouge-Cloître avec notamment la création d’une roselière qui, malgré sa surface restreinte et sa localisation sur un site très fréquenté, attire de nombreuses espèces rares, aussi bien en période de nidification qu’en période d’hivernage.
5 espèces de pics présentes en forêt de Soignes
Les pics sont des bio-indicateurs reconnus de la santé et de la maturité du milieu forestier. Selon leur espèce, ils requièrent en effet des habitats incluant la présence de très vieux arbres et à gros diamètre, de bois mort, de lichens, de lisières, etc. 5 espèces de pics nichent en forêt de Soignes bruxelloise (Pic épeiche, Pic épeichette, Pic vert, Pic noir, Pic mar). Le Pic cendré, espèce rarissime en Belgique et disparu de la forêt de Soignes à la fin du 19e siècle, y a été également récemment cantonné 2-3 ans. Avec 5 à 6 espèces de pics, la forêt de Soignes est parmi les forêts les plus riches de Belgique en Picidae. Une telle biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). est un fait peu commun en Europe occidentale et témoigne de la qualité écologique grandissante de la forêt de Soignes.
Un impact positif de l’amélioration de la qualité de la Senne et de sa renaturation sur l’avifaune ?
Trois espèces d’hirondelles sont considérées comme « espèces d’intérêt régional » en vertu de l’ordonnance Nature.
Après un déclin drastique entre 1992 et 2002 en tant qu’espèce nicheuse, les populations d’Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) affichent une croissance marquée passant de 33 couples en 2002 à 393 en 2020, probablement en partie à la suite de plusieurs campagnes de poses de nichoirs réalisées dans quelques communes bruxelloises. Une baisse significative est intervenue en 2021-2022, années durant lesquelles respectivement 333 et 262 nids étaient occupés. Avec 477 nids occupés sur l’ensemble des colonies, l’année 2023 a été particulièrement bonne pour cette espèce.
Depuis 1992, 3 nouvelles colonies ont vu le jour dont la dernière en 2022, au marais du Wiels à Forest (bâtiment du Brass). 4 colonies ont en revanche disparu depuis les années 2000. Le très faible nombre actuel de colonies (8 en comptant le marais Wiels), largement inférieur à celui de 1992, dénote une précarité persistante de l’espèce. Ces 8 colonies peuvent être divisées en deux groupes distincts : le groupe sud-est (communes de Woluwé Saint-Pierre, Woluwé Saint-Lambert et Watermael-Boitsfort) et le groupe Senne/canal à Haren et Forest.
Une croissance de la taille des deux colonies dites « naturelles » de Haren et Forest (totalité ou majorité de nids naturels en boue) est observée. La part de nids naturels en boue (68%) donne à l’axe défini par la Senne et le canal un rôle moteur dans la croissance de la population bruxelloise d’Hirondelles de fenêtre. Les raisons de cette augmentation restent à étudier. Toujours est-il que, selon les experts chargés du suivi de l’avifaunePartie de la faune d un lieu constituée par les oiseaux., « l’épuration des eaux de la Senne, l’ouverture à ciel ouvert de tronçons et certains aménagements écologiques de ses berges semblent avoir un début d’impact positif sur l’avifaune qui se réinstalle progressivement ». Ces derniers indiquent par ailleurs que « la principale source de nourriture pour les hirondelles de Haren et de Forest pourrait provenir de la Senne où les émergences massives de diptères à larves aquatiques (moustiques par ex.) constituent un apport providentiel de petites proies. Le canal - et peut-être les derniers petits lambeaux de friches et abords des voies ferrées - favorisent aussi l’émergence d’insectes volants » (Paquet A. 2023).
L’Hirondelle rustique, anciennement dénommée Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica) a fortement pâti de la disparition des espaces ruraux régionaux. Les dénombrements réalisés indiquent un effectif oscillant entre 10 et 20 couples localisés dans les zones rurales de Neerpede alors qu’elle était encore commune et bien répartie dans la ceinture verte de la Région bruxelloise dans les années 80-90.
Une nidification d’Hirondelles de rivage le long du canal après plus de 40 ans d’absence
L’Hirondelle de rivage nichait en Région bruxelloise jusque fin des années ’70 mais n’était plus observable depuis que durant sa migration. En 2021, la nidification d’au moins 10 couples et leurs petits a été observée à proximité d’un mur de nichoirs (remplis de sableParticules de sol dont la taille est supérieure à 0,05 mm) installé cette même année le long du canal à Neder-Over-Hembeek pour cette espèce qui niche dans les berges sablonneuses. En 2023, avec 35 couples nicheurs certains, la colonie s’est sensiblement renforcée.
Les effectifs de Martinets noirs marquent une tendance à la baisse
Une étude spécifique sur le Martinet noir (Weiserbs et al. 2020) a été menée entre 2016 et 2018 Celle-ci a permis d’améliorer les connaissances sur les préférences et habitudes de cette population en termes d’habitat et de mieux comprendre comment la préserver et tenter d’enrayer son déclin. En résumé, les auteurs de l’étude concluent à la prédominance de colonies de petite taille. Celles-ci occupent majoritairement des cavités situées sous les corniches, dans les zones d’habitations à prédominance de bâtiments mitoyens, situées le long de voiries relativement étroites. Du fait de son habitat, cette espèce est potentiellement impactée par les rénovations qui tendent à rendre les bâtiments plus hermétiques (voir aussi le paragraphe ci-dessous concernant l’évolution des espèces liées au bâti).
Un protocole d’échantillonnage a également été défini afin de mettre en place un suivi routinier à l’échelle régionale. Les effectifs de Martinets noirs marquent une tendance à la baisse.
Des données plus détaillées concernant les tendances, les observations et les hypothèses avancées pour expliquer le déclin des populations de Martinets en Région bruxelloise sont disponibles dans la fiche documentée portant sur l’avifaune liée aux espaces bâtis.
Parmi 7 espèces d’oiseaux suivies dans le cadre de la législation Natura 2000, 5 ont été évaluées en état de conservation favorable
En application des mesures de conservation imposées pour les sites Natura 2000, un monitoring de certaines espèces animales et d’habitats naturels est effectué. Dans ce cadre, l’état de conservation de 7 espèces d’oiseaux présentes en Région bruxelloise et qui figurent à l’annexe I de la directive Oiseaux (espèces considérées comme plus particulièrement menacées et dont environ 70 nichent, hivernent ou sont de passage en Belgique) a été évalué en 2016.
L’état local de conservation a été évalué comme favorable pour 5 espèces d’oiseaux, à savoir :
- la Bondrée apivore présente en forêt de Soignes ;
- le Faucon pèlerin présent sur différents sites couvrant l’entièreté du territoire bruxellois ;
- le Martin-pêcheur présent sur différents sites couvrant l’entièreté du territoire bruxellois ;
- le Pic noir présent en forêt de Soignes ;
- le Pic mar présent en forêt de Soignes.
Il a en revanche été évalué comme défavorable pour 2 espèces qui sont observées sporadiquement dans la Région : l’Engoulevent d’Europe et la Grande aigrette (pour plus de détails, voir focus Etat de conservation des espèces couvertes par les directives « Habitats » et « Oiseaux »).
Le maintien, voire la progression, de ces espèces au niveau régional impliquent la sauvegarde de leurs biotopes (présence de vastes clairières et zones sablonneuses en forêt de Soignes, forêt diversifiée incluant chênes et pins, maintien d’arbres vieux ou morts et d’arbres à cavités, zones humides avec berges abruptes et dégagées, campagnes riches en haies et prés…).
En 2013, en application de la directive Oiseaux imposant notamment un monitoring, une estimation de l’effectif et des tendances concernant les espèces nicheuses a été effectuée par les 3 Régions pour contribuer à l’élaboration d’un rapport établi à l’échelle nationale. Il en ressort que 107 espèces d’oiseaux ont niché en Région bruxelloise durant la période 2000-2012 (dont 11 non indigènes) soit près de 60% du total des espèces nicheuses de Belgique. Les données disponibles permettent de mettre en évidence une stabilité ou une croissance des populations bruxelloises pour 50% des espèces et une régression pour 20% d’entre elles. Par ailleurs, selon ce rapport, 5 nouvelles espèces d’oiseaux nicheuses se seraient implantées entre 2000 et 2012 alors que 6 se seraient éteintes au niveau local.
Un nouvel atlas des oiseaux de Bruxelles 2022-2025 en cours de réalisation
Aves, le Pôle ornithologique de Natagora et Natuurpunt Studie ont été chargé de réaliser un nouvel atlas des oiseaux, nicheurs et hivernants, de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce projet, comme les précédents, fait appel à la communauté des ornithologues bénévoles. Il est synchronisé avec les deux autres Régions. Il vise à déterminer la liste des espèces présentes sur le territoire bruxellois ainsi que les effectifs et la distribution de chaque espèce. Il doit aussi permettre une évaluation de l’impact sur l’avifaunePartie de la faune d un lieu constituée par les oiseaux. bruxelloise des diverses pressions qui s’exercent sur la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). (urbanisation et fragmentation des habitats naturels, réchauffement climatique, progression des espèces exotiques, sur fréquentation de certains sites, épizooties aviaires) et des mesures de conservation mises en œuvre.
Pour plus d’information, voir le site dédié à l’atlas des oiseaux de Bruxelles 2022-2025.
L‘atlas des oiseaux nicheurs couvrant la période 2000-2004 a mis en évidence de profonds changements : réduction du nombre moyen d’espèces par km2, disparition de nombreuses espèces, progression des espèces exotiques…
Le dernier atlas des oiseaux nicheurs de la Région bruxelloise, couvrant la période 2000-2004, a permis de recenser 103 espèces ce qui correspond à près de la moitié des espèces nichant en Belgique. La nidification a été établie pour 89 d’entre elles et est considérée comme probable pour les autres. Ces 103 espèces, incluent 11 espèces non indigènes et 7 qui se sont éteintes localement ou étaient au seuil de l’extinction durant la réalisation de l’atlas. Parmi ces espèces, seules 16 peuvent être considérées comme abondantes. Il s’agit essentiellement d’espèces opportunistes capables de s’adapter au milieu urbain (certains passereaux, Pigeons ramiers, Corneilles noires…), les espèces ayant davantage d’exigences écologiques étant le plus souvent rares.
L’analyse des données historiques couvrant la Région bruxelloise a permis aux auteurs de l’atlas de mettre en évidence de profonds changements, tant au niveau des densités de nidification que de la composition des espèces :
- le nombre moyen d’espèces par km2 s’est réduit, passant de 36,1 en 1989-1991 à 33,7 en 2000-2004 ;
- 14 espèces ont récemment disparu ou quasi disparu au niveau régional et, plus largement, à l’échelle du Brabant ;
- une quinzaine d’espèces inféodées aux milieux ouverts et semi-ouverts (champs, friches…) ont disparu entre 1944 et 2004 ;
- le nombre d’espèces d’oiseaux nicheurs non indigènes progresse fortement et les populations de certaines espèces exotiques augmentent de façon exponentielle (perruches).
Ces tendances négatives sont quelque peu tempérées par la résurgence ou l’émergence d’oiseaux nicheurs remarquables (Autour des palombes, Pic mar, Faucon pèlerin) ainsi que par l’augmentation de plusieurs espèces indigènes qui profitent des biotopes plus favorables ou plus fréquents (notamment les parcs et jardins), de mesures de gestion des milieux naturels plus adéquates ou de mesures de protection.
Entre 2005 et 2017, 7 nouvelles espèces indigènes n’ayant auparavant jamais niché - du moins avec certitude - en Région bruxelloise se sont implantées : Bruant des roseaux (2009), Corbeau freux (2010), Pouillot siffleur (2011), Tarier pâtre (2013), Rougequeue à front blanc (2013), Pipit des arbres (2014), Canard chipeau (2015). La plupart de ces espèces ont des effectifs réduits ou sont irrégulières. 9 autres espèces ont tenté de nicher, voire ont peut-être niché (nidification possible mais non certaine). A l’inverse, 8 espèces se sont éteintes régionalement en tant qu’espèce nicheuse certaine : Hypolaïs ictérine, Cygne noir (espèce exotiqueDésigne une espèce qui n'était pas présente à l'origine dans les zones où on la trouve maintenant, et dont la présence est attribuable directement ou indirectement à l'activité humaine. Opposée à espèce indigène.), Ouette de Magellan (espèce exotique), Faucon hobereau, Perdrix grise, Moineau friquet, Bec-croisé des sapins, Linotte mélodieuse. Compte tenu de la disparition de 8 espèces et de l’apparition de 7 espèces nouvelles, le nombre d’espèces nicheuses certaines est passé de 89 (2000-2004) à 88 (2005-2017) (Paquet A et Weiserbs A. 2018).
À télécharger
Fiches documentées
- Etat local de conservation des espèces des directives habitats et oiseaux en Région bruxelloise, 2018 (.pdf)
- Avifaune liée au bâti et mobilisations pour sa sauvegarde, 2022 (.pdf)
Fiches de l’Etat de l’Environnement
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Rapport sur l’état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale, 2022
- Carte « Moineaux de Bruxelles »
- Carte « Martinets de Bruxelles »
- Oiseaux en Région de Bruxelles-Capitale, 2018 (.pdf)
Etudes et rapports
- AGENCE EUROPEENNE DE L’ENVIRONNEMENT 2019. « The European environment - state and outlook 2020 - Knowledge for transition to a sustainable Europe”, 499 p (en anglais uniquement)
- BELGIQUE 2013. «National summary for 2008-2012 for Article 12, Belgium », rapportage belge dans le cadre de la directive Oiseaux (79/409/EEC) et Habitats (92/43/EEC), 23 p. (.pdf) (en anglais uniquement)
- Burns F., Eaton M., Burfield J., Klvaňová A., Šilarová E., Staneva A., Gregory R 2021. “Abundance decline in the avifauna of the European Union reveals cross-continental similarities in biodiversity change”; in Ecology and Evolution 2021; 11:16647–16660. (.pdf) (en anglais uniquement)
- IPBES 2018. “The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia”, 892 p. (pdf) (en anglais uniquement).
- PAILHES 2023. « Nidification des hirondelles à Bruxelles en 2023 », blog Aves-Natagora
- PAQUET A. 2023. « Monitoring des populations d’oiseaux en Région de Bruxelles-Capitale - rapport 2022 », rapport effectué par Natagora Aves pour le compte de Bruxelles Environnement, 167 pp. (.pdf) (autres années disponibles en ligne depuis 2011)
- PAQUET A., WEISERBS A. 2018. « Oiseaux rares observés à Bruxelles en 2007-2017. Oiseaux de Bruxelles n°6 » étude effectuée par Natagora Aves pour le compte de Bruxelles Environnement, 7 pages. (.pdf)
- WEISERBS A., PAQUET A., WAUTERS M., SEVRIN D. 2020. “Population et habitat du Martinet noir Apus apus en Région de Bruxelles-Capitale”, in AVES, 57/2.(.pdf)
- WEISERBS A. 2016. « Le point sur les oiseaux nicheurs – Oiseaux de Bruxelles n°5», étude effectuée par Natagora Aves pour le compte de Bruxelles Environnement, 7 pages. (.pdf)
- WEISERBS A. 2013. « Statut des oiseaux Natura 2000 à Bruxelles – Oiseaux de Bruxelles n°4», étude effectuée par Natagora Aves pour le compte de Bruxelles Environnement, 7 p. (.pdf)
- WEISERBS A. 2012. « Du martinet à Bruxelles - Oiseaux de Bruxelles n°3», étude effectuée par Natagora Aves pour le compte de Bruxelles Environnement, 7 p. (.pdf)
- WEISERBS A 2010. « Oiseaux communs de Bruxelles – Cartographie des tendances - Oiseaux de Bruxelles n°2», étude effectuée par Natagora Aves pour le compte de Bruxelles Environnement, 7 p. (.pdf)
- WEISERBS A. & PAQUET J.-Y. 2009. « Oiseaux communs de Bruxelles – Evolution 1992-2008 - Oiseaux de Bruxelles n°1», étude effectuée par Natagora Aves pour le compte de Bruxelles Environnement, 7 p.(.pdf)
- WEISERBS A. & JACOB J.-P. 2007. « Oiseaux nicheurs de Bruxelles 2000-2004: répartition, effectifs, évolution », étude effectuée par Natagora Aves pour le compte de Bruxelles Environnement, 292 p. (.pdf)
Plans et programmes
Liens utiles
- Natagora – Aves
- Centre belge de baguage (Institut royal des sciences naturelles de Belgique)
- Belgian Biodiversity platform (en anglais uniquement)
Etat local de conservation des espèces couvertes par les directives "Habitats" et "Oiseaux"
Focus - Actualisation : janvier 2018
Une évaluation de l’état de conservation, à l’échelle bruxelloise, de 12 espèces animales protégées par les directives « Habitats » ou « Oiseaux » a récemment été réalisée. Sur base des données d’observation disponibles, 7 de ces espèces ont été jugées dans un état de conservation favorable. Il s’agit de 5 espèces d’oiseaux (Bondrée apivore, Pic noir, Pic mar, Faucon pèlerin et Martin-pêcheur) et de 2 insectes (Lucane cerf-volant et Spinx de l’épilobe). Par ailleurs, pour une espèce de poisson (Bouvière), l’état de conservation a été jugé défavorable pour les populations établies au niveau de la Senne et du canal mais a par contre été jugé favorable pour les populations de la Woluwe et de ses étangs.
Un instrument pour évaluer à l’échelle bruxelloise l’état de conservation d’espèces protégées par les directives « Habitats » et « Oiseaux »
Les directives « Habitats » (92/43/CE) et « Oiseaux » (2009/147/CE) imposent aux Etats membres d’évaluer régulièrement l’état de conservation et les tendances de certaines espèces considérées comme étant en danger, vulnérables ou rares ou qui vivent dans des milieux très spécifiques.
Dans ce cadre, Bruxelles Environnement s’est attelé à développer une méthodologie lui permettant d’évaluer l’état local de conservation, à l’échelle bruxelloise, des espèces animales visées par ces deux directives et présentes sur le territoire régional (à l’exception des chauves-souris qui font l’objet d’un suivi spécifique). Ce projet répond à un besoin de disposer d’un instrument qui pourra servir de base pour déterminer, conjointement avec les autres Régions et Etats concernés, l’état de conservation de ces espèces à l’échelle de la zone biogéographique atlantique (pour les espèces autres que les oiseaux) - dont fait partie la Région bruxelloise - ou de la Belgique (pour les oiseaux) et de répondre ainsi aux obligations de rapportage imposées par les directives. La méthodologie se base par ailleurs sur le cadre d’évaluation établi pour la Flandre, excepté pour 2 espèces (Lézard des murailles et Sphinx de l’épilobe) pour lesquelles ce cadre n’existait pas encore.
L’état local de conservation d’une espèce correspond à l’état de conservation établi au niveau d’une population ou de l’habitat d’individus qui interagissent entre eux au niveau local. Les critères d’évaluation utilisés sont la situation de la population (densité de population, présence de juvéniles, etc.) et la qualité de l’habitat. Ces critères sont évalués concrètement à l’aide d’indicateurs mesurables qui diffèrent selon les espèces considérées. Contrairement aux évaluations établies au niveau de la région biogéographique ou de l’Etat membre, le critère relatif à l’évolution de l’aire de répartition n’est pas pris en compte de même que les tendances (éléments non pertinents à l’échelle locale).
Chaque indicateur a reçu une évaluation (favorable/défavorable) établie en comparant les données d’observation disponibles avec des valeurs de référence issues d’études scientifiques. En l’absence de données suffisantes, l’indicateur a été évalué sur base d’un jugement d’experts ou considéré comme «situation inconnue». En principe, selon la méthodologie développée par la Commisssion européenne, l’évaluation globale est positive uniquement si tous les indicateurs sont évalués favorablement. Néanmoins, dans la mesure où cette approche apporte peu de nuances et d’informations, cette manière de procéder a été légèrement adaptée dans quelques cas. Par ailleurs, l’état de conservation est jugé inconnu si tous les indicateurs permettant d’évaluer le critère « population » ou le critère « qualité de l’habitat » sont considérés comme inconnus.
7 des 12 espèces évaluées ont été jugées dans un état local de conservation favorable
Le tableau suivant synthétise les résultats de l’évaluation de l’état local de conservation de 12 espèces animales visées par les directives Habitats et Oiseaux. Il reprend aussi une évaluation de l’importance relative, d’un point de vue écologique, des populations bruxelloises par rapport aux populations présentes dans la partie belge de la région biogéographique Atlantique (espèces visées par la directive Habitats) ou en Belgique (espèces visées par la directive Oiseaux).
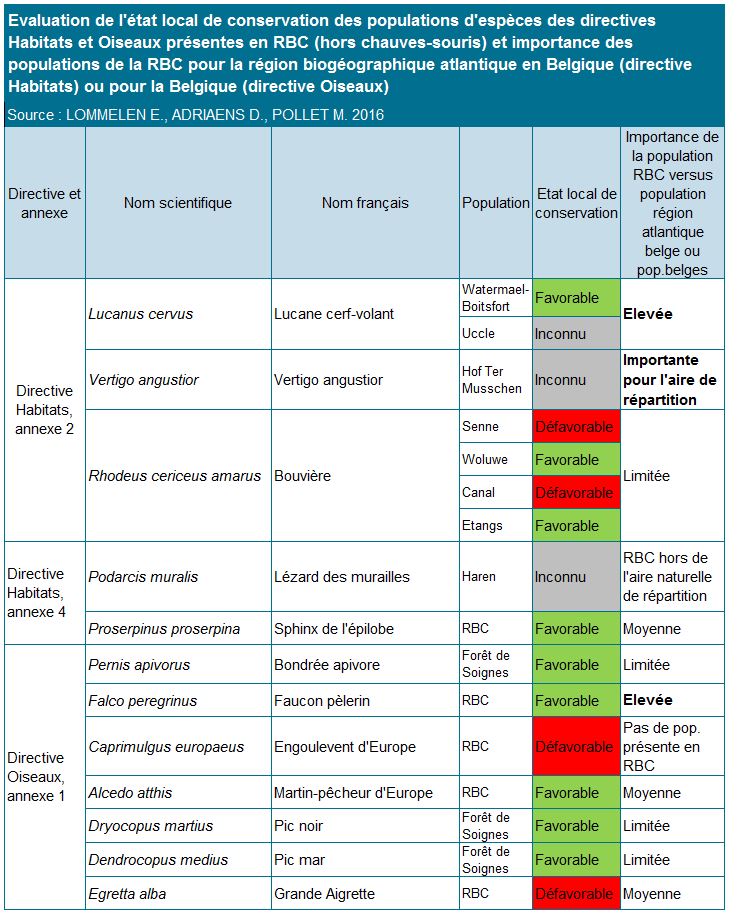
L’état local de conservation s’avère favorable pour 7 espèces, à savoir :
- 5 oiseaux : Bondrée apivore, Pic noir et Pic mar (présents en forêt de Soignes), Faucon pèlerin et Martin-pêcheur (présent sur différents sites) ;
- 1 papillon : Sphinx de l’épilobe (présent sur l’ensemble du territoire) ;
- 1 insecte : Lucane cerf-volant (populations présentes dans 2 communes avec un statut favorable pour les populations de Watermael-Boitsfort mais inconnu par manque de données pour les populations d’Uccle).
Pour 1 espèce, à savoir la Bouvière (poisson), l’état local de conservation s’avère favorable seulement pour les populations présentes au niveau de la Woluwe et des étangs. Il est par contre défavorable pour les populations de la Senne et du canal.
L’état local de conservation s’avère par contre défavorable pour 2 espèces d’oiseaux : l’Engoulevent d’Europe et la Grande Aigrette. Enfin, les données disponibles concernant les populations de Lézards des murailles (site à Haren) et de Vertigo angustior (mollusque présent à Woluwé-Saint-Lambert, Hof Ter Musschen) sont insuffisantes pour évaluer leur statut de conservation.
De manière générale, on peut affirmer que les espèces qui se portent plutôt bien dans la Région sont des espèces dites « synanthropes » (c’est-à-dire liées à l’homme et à ses activités) avec une préférence pour l’environnement urbain ainsi que des espèces des massifs forestiers anciens qui trouvent dans la forêt de Soignes un biotopeAire géographique de dimensions variables, souvent très petites, offrant des conditions constantes ou cycliques aux espèces constituant la biocénose. qui leur convient.
L’évaluation réalisée a par ailleurs permis d’estimer que les populations bruxelloises de Faucons pèlerins et de Lucanes Cerf-volant représentent respectivement environ 15% et 20% des populations présentes en Région atlantique belge. A ce titre, ces populations revêtent une importance particulièrement élevée. Par ailleurs, la population bruxelloise du mollusque Vertigo angustior se révèle importante pour la Région atlantique belge de par sa localisation: une disparition de cette population signifierait une réduction de l’aire de répartition de l’espèce.
Précisons toutefois que les données disponibles n’ont pas permis de statuer sur certains des indicateurs sous-tendant l’évaluation. Les résultats présentés ci‐dessus doivent dès lors être interprétés avec la prudence nécessaire.
À télécharger
Fiches documentées
- n°18. Etat local de conservation des espèces des directives habitats et oiseaux en Région bruxelloise (.pdf)
- n°2. Oiseaux (.pdf)
- n°8. Poissons (.pdf)
- n°10. Habitats naturels dans les espaces verts bruxellois (.pdf)
Thème « L’occupation du sol et les paysages bruxellois »
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Focus : Le lucane cerf-volant : une espèce européenne protégée (édition 2011-2014)
- Focus : Habitats naturels dans les espaces verts bruxellois (édition 2007-2010)
Autres publications de Bruxelles Environnement
Etudes et rapports
- BELGIQUE 2013. «National summary for 2008-2012 for Article 12, Belgium », rapportage belge dans le cadre de la directive Oiseaux (79/409/EEC) et Habitats (92/43/EEC), 23 p. (.pdf) (en anglais uniquement)
- LOMMELEN E., ADRIAENS D., POLLET M. 2016. "Lokale staat van instandhouding voor habitat- en vogelrichtlijnsoorten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", rapport effectué par l’INBO (lnstituut voor natuur- en bosonderzoek) pour le compte de Bruxelles Environnement (INBO.R.2016.11510159), 74 p. (.pdf) (en néerlandais uniquement)
- WEISERBS A. 2013. « Statut des oiseaux Natura 2000 à Bruxelles - Oiseaux de Bruxelles n°4», étude effectuée par Natagora Aves pour le compte de Bruxelles Environnement, 7 p. (.pdf)
Plans et programmes
Liens utiles
- European Environment Agency - Explore nature reporting data
Le lucane cerf-volant, une espèce européenne protégée
Focus - Actualisation : décembre 2015
Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), coléoptère rare figurant dans l'annexe II de la Directive « Habitat » (annexe reprenant les espèces de faune et de flore dites d'intérêt communautaire bénéficiant d’une protection particulière), comporte une population relativement importante en Région bruxelloise, essentiellement implantée à Watermael-Boitsfort. Depuis plusieurs années, Bruxelles Environnement - mais également d’autres acteurs dont la commune de Watermael-Boitsfort - met en place des mesures de gestion destinées à maintenir et développer cette population.
Une évaluation réalisée en 2013 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive « Habitat » a estimé que l’état local de conservation des populations de Lucane cerf-volant à Watermael-Boitsfort était favorable. En ce qui concerne les populations présentes à Uccle, les données disponibles n’ont pas permis pas de tirer de conclusions.
S'il est une espèce dont la Région de Bruxelles Capitale peut être fière, c'est probablement du Lucane cerf-volant (Lucanus cervus). La population de Lucanes présente au sein de la Région constitue sans doute le noyau le plus important de la population qui s'étend de Hal à Leuven et revêt dès lors une importance vitale pour le maintien de cette espèce au niveau local.
Identification et écologie
Le Lucane cerf-volant est le plus grand coléoptère d'Europe. Outre sa taille, c'est surtout la « ramure » du mâle qui frappe l'imagination. Cette ramure est constituée d'énormes mandibules qui lui permettent de défendre son territoire vis-à-vis d'autres mâles. Elle lui sert aussi à retenir les femelles lors de l'accouplement et à impressionner ses ennemis naturels, tels que les pics, les corvidés, les hiboux et les chats.
Si l'on veut gérer ou restaurer une population, il est important de savoir que le Lucane cerf-volant ne vole pas bien et ne parcourt donc pas de longues distances. Il ressort de la littérature que la capacité maximale de dispersion est de 1 km pour les femelles et de 3 km pour les mâles.
Le Lucane cerf-volant est un coléoptère qui aime la chaleur et qui apprécie dès lors particulièrement les pentes orientées au sud. Pour leur territoire, ils ont besoin de bois mort de grand diamètre ou de grands arbres en fin de vie, en contact avec le sol, et d'un sol bien drainé que l'on peut facilement creuser. Les femelles creusent des galeries dans le sol et pondent dans le sous-sol, contre du bois mort. Les larves se nourrissent du bois mort. L'essence de l’arbre ne semble pas avoir d'importance.
Dispersion et statut en Région de Bruxelles-Capitale
Du fait des menaces de disparition qui pèsent sur cette espèce, la Lucane cerf-volant figure à l’annexe II de la directive Habitat (Natura 2000), ce qui lui confère un statut de protection particulier. Sa présence en Région bruxelloise a contribué à la sélection et délimitation des zones de protection spéciales du réseau Natura 2000.
En Flandre, l'espèce a été étudiée dans le cadre de la constitution de liste rouge et son statut a été considéré comme « menacé » (Thomaes A. et Maes D., 2014).
Selon certains témoignages, le Lucane cerf-volant semble avoir été courant jusque dans les années ’60 à Bruxelles et dans ses environs (Thomaes et al., 2007). On observe un net recul à partir des années '70. Une des explications possibles est le changement intervenu dans la gestion de la Forêt de Soignes. Jadis, lorsque le Lucane cerf-volant était plus répandu, la Forêt de Soignes était partiellement traitée en taillis sous futaiePeuplement forestier composé d'arbres directement issus de semences sur place et qui sont destinés à atteindre un plein développement avant d'être coupés. et était beaucoup plus ouverte (notamment par la présence de prairies et de grandes coupes à blanc). Aujourd'hui, la Forêt de Soignes est beaucoup plus dense. La dernière observation dans la partie bruxelloise de la Forêt de Soignes date de 2004. Les populations relictuelles sont présentes à des endroits qui ont été annexés par l'agriculture (bandes boisées, etc.) et dans des jardins. On peut en conclure qu'en Belgique, le Lucane cerf-volant n'est pas véritablement une espèce forestière mais plutôt une espèce des lisières et des talus boisés, où le microclimat compense le manque de bois mort.
Au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale, les quartiers "Le Logis" et "Floréal" (Watermael-Boitsfort) abritent la population la plus connue de Lucanes cerf-volant. Les vieux Cerisiers du Japon (parfois morts) qui bordent les rues de ces quartiers, notamment, leur offrent des possibilités de nicher, de même que les vieilles billes de chemin de fer de l'école au niveau du Jagersveld et que les talus avec leurs vieux grands chênes, tels que les talus Busard, Trois Tilleuls et Fauconnerie. Une étude menée selon la méthode de « capture-recapture » indique que la population locale à Watermael-Boitsfort se composerait au moins de 200 à 300 individus et resterait stable (communication personnelle CAMMAERTS R. citée dans NIJS G. et al. 2013). La carte ci-dessous donne un aperçu des carrés-kilomètre où l'espèce a été observée durant la période 2003-2014. Il ressort des observations disponibles pour la période 2003-2014 que l'espèce continue de se disperser sur tout le territoire de Watermael-Boitsfort jusque juste au-delà des frontières avec les communes avoisinantes. Il est toutefois difficile de dire si l'espèce se porte réellement mieux ou s'il s'agit d'un effet d'observation.
Dans le sud-ouest d'Uccle, l'espèce a été mentionnée une dizaine de fois durant la période 2007-2010, ensuite plus. Un individu mort a également été trouvé à Woluwe-Saint-Pierre, à la limite de Wezembeek-Oppem. Aucune donnée historique n'est disponible pour ces 2 communes.
Carrés kilomètre en Région de Bruxelles-Capitale où le Lucane cerf-volant a été observé durant la période 2003-2014
Source: Bruxelles Environnement, sur base d'observations.be
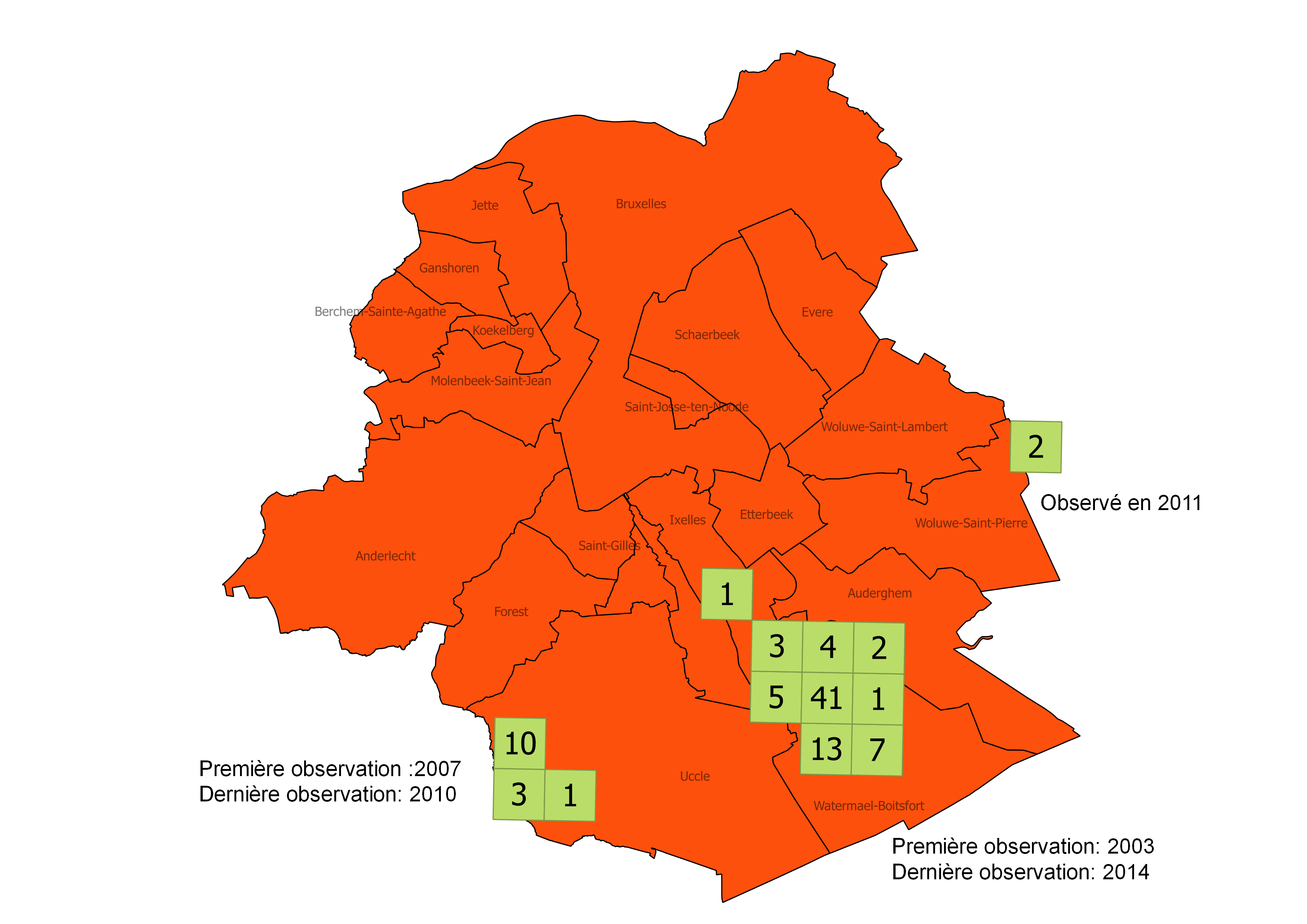
Tout comme les autres espèces d’intérêt communautaire présentes en Région bruxelloise, le Lucane cerf-volant doit faire l’objet d’un monitoring de l’état de ses populations ainsi que de mesures de conservation et de protection. Une évaluation réalisée en 2013 a estimé que, compte tenu de la taille des populations et des caractéristiques actuelles de leur habitat, l’état local de conservation des populations de Lucanes cerf-volant à Watermael-Boitsfort était favorable. En ce qui concerne les populations présentes à Uccle, les données disponibles n’ont pas permis pas de tirer des conclusions (NIJS G. et al., 2013).
Bruxelles Environnement entre en action
Il existe une proposition de plan de gestion pour les quartiers “Le Logis“ et “Floréal” où l'espèce a été observée en nombre en de nombreux endroits différents, entre autres au niveau d’une station Natura 2000 (talus des Trois-tilleuls).
Comme mentionné ci-dessus, la capacité maximale de dispersion est de 1 km pour les femelles et de 3 km pour les mâles. Sur base de ces données et compte tenu du statut de protection spéciale dont jouit le Lucane cerf-volant en tant qu'espèce de l'Annexe II de la directive Habitats, les objectifs de gestion en vue du maintien d'une population viable de Lucanes cerf-volant ne se sont pas limités à la zone spéciale de conservation proprement dite. Pour garantir la préservation de cette espèce, des mesures s'appliquant au niveau des quartiers “Le Logis“ et “Floréal” dans leur ensemble – et en dehors – s’avèrent en effet indispensables.
En résumé, le projet de plan de gestion contient les mesures suivantes :
- maintien du bois mort sur pied et des arbres en fin de vie dans les quartiers (en tenant compte de la sécurité des habitants et du trafic), en particulier pour le bois mort situé dans des zones plus chaudes et ensoleillées;
- afin d'assurer une offre suffisante d'arbres qui permettront aux Lucanes d’y nicher dans le futur, il convient de planter des arbres dans tout le quartier (chêne indigène, Cerisier du Japon), à une distance suffisante les uns des autres;
- actions de sensibilisation (notamment sous la forme de séances d'information) vis-à-vis des acteurs concernées;
- sur 2 talus (“Trois Tilleuls” et “Kiekendief”), il faut viser une structure forestière ouverte avec beaucoup de bois mort et le chêne indigène comme essence dominante.
Ces talus ont été repris en gestion début 2015 par Bruxelles Environnement dans le cadre d’une convention de partenariat avec le propriétaire (Société de Logement Social Le Logis - Floréal). Les mesures décrites ci-dessus sont déjà partiellement mises en œuvre depuis plusieurs années par l’équipe des éco-cantonniers : remise en lumière des talus, éclaircies du couvert forestier avec maintien de bois mort de gros diamètre au sol, conservation de troncs de cerisiers du Japon susceptibles d’abriter le Lucane cerf-volant. Ces mesures s’étaleront sur plusieurs années avant d’atteindre une qualité d’habitats optimale pour cette espèce sur l’ensemble des superficies concernées. Ce plan sera officiellement adopté après désignation officielle de la Zone spéciale de conservation I du réseau Natura 2000 incluant les stations hébergeant des populations de Lucane.
Outre ce plan de gestion, une étude a été réalisée sur des zones qui potentiellement pourraient accueillir des populations de Lucanes cerf-volant, notamment au bois de La Cambre et dans la Forêt de Soignes (Godefroid et Koedam, 2006).
À télécharger
Fiches documentées
Thème « Occupation des sols et paysages bruxellois »
Fiches de l’Etat de l’Environnement
Autres publications de Bruxelles Environnement
Etudes et rapports
- GODEFROID S., KOEDAM N (LABORATORIUM VOOR ALGEMENE PLANTKUNDE EN NATUURBEHEER - VUB) 2006. “ Contribution au monitoring du Lucane cerf-volant (Lucanus cervus – annexe 2 de la directive Habitat 92/43/CEE) en Région de Bruxelles-Capitale ”. Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 19 pp. + annexes. (en fr et nl) (.pdf)
- PLESSERS I., VAN BRUSSEL S., HENDRICKX P., VERHEIJEN W. (ARCADIS) 2008. “Beheerplan voor Natura 2000-gebied in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gebied IA11: Taluds “Drielinden””, Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 24 pp. (néerlandais uniquement) (.pdf)
- NIJS G., LAMBRECHTS J., VERBELEN D., WEISERBS A. 2013. « Opvolging Lokale Staat van Instandhouding van soorten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest », Natuurpunt Studie 2013/7. Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 108 pp. (néerlandais uniquement) (rapport interne)
- THOMAES A. 2009. “A protection strategy for the stag beetle (Lucanus cervus,(L., 1758), Lucanidae) based on habitat requirements and colonisation capacity”, proceedings of the 5th Symposium and Workshop on the Conservation of Saproxylic Beetles, pp.149-160 (anglais uniquement) (.pdf)
- THOMAES A., BECK O., CREVECOEUR L., ENGELBEEN M., CAMMAERTS, R., MAES D. 2007. “Het Vliegend hert in Vlaanderen en in het Brussels Gewest”, Natuur.focus 6(3):76-82. (néerlandais uniquement) (.pdf)
- THOMAES A., KERVYN T., BECK O., CAMMAERTS R. 2008. ”Distribution of Lucanus cervus (Coleoptera, Lucanidae) in Belgium : surviving in a changing landscape”, in Vignon V., Asmod&eEacute; J.-F. (eds), proceedings of the 4th Symposium on the Conservation and Workshop of Saproxylic Beetles, Vivoin (72) / France, 27th-29th June, 2006. Rev. Écol. (Terre Vie), suppt. 10. (anglais uniquement) (.pdf)
- THOMAES A., MAES D. 2014. “Rode-Lijststatus van het Vliegend hert (Lucanus cervus). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2014 (1549345)”, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. (néerlandais uniquement) (.pdf)
- THOMAES A., VANDEKERKHOVE, K. 2004. “Ecologie en verspreiding van Vliegend hert in Vlaanderen”. Rapport IBW Bb R2004.015. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Geraardsbergen. (néerlandais uniquement) (.pdf)
- THOMAES, A., KERVYN, T., BECK, O. & CAMMAERTS, R., année inconnue. « Stag beetle (Lucanus cervus) distribution in Belgium (Coleoptera: Lucanidae)”, poster. (anglais uniquement)
Plans et programmes
Liens utiles
Les Mammifères en Région bruxelloise
Focus – Actualisation : juin 2021
Le second atlas des mammifères de la Région bruxelloise a permis d’inventorier la présence de 47 espèces indigènes et 5 espèces exotiques sur la période 2001-2017. Ceci correspond à près de 70% de la faune mammalienne belge (espèces exotiques et marines comprises). 3 espèces recensées lors de la réalisation du premier atlas (1997-2000) n'ont plus été observées lors de la réalisation du second atlas, à savoir, 2 espèces de chauve-souris et la loutre. Inversément 6 nouvelles espèces ont été inventoriées : le sanglier, le castor, 2 espèces de chauve-souris ainsi que 2 espèces exotiques. Pour 13% des espèces indigènes, les observations montrent une diminution de l’aire de répartition entre la réalisation des 2 atlas.
Un nouvel atlas des mammifères, réalisé avec l’appui des citoyens
Le premier atlas des mammifères de la Région bruxelloise couvrait la période 1997-2000. Un second atlas se rapportant à la période 2001-2017 a été récemment finalisé.
Ce projet, réalisé par Natuurpunt et Natagora pour le compte de Bruxelles Environnement, a rassemblé toutes les données existantes sur les mammifères présents en Région bruxelloise provenant d'études antérieures. Ces données ont été complétées par des données supplémentaires collectées en s’appuyant sur l’aide de citoyens. Le grand public a été sollicité pour signaler, via un site Internet, les observations de mammifères facilement reconnaissables. Pour l'inventaire des espèces plus difficiles à reconnaître, une soixantaine de volontaires ont été formés pour travailler respectivement avec des pièges à caméra et des pièges (non létaux).
Après validation des données, 24 109 données d’observation effectuées entre 1909 et 2017 ont ainsi pu être compilées dont 20 392 se rapportant à la période couverte par l’actuel atlas. Plus d’explications concernant la méthodologie utilisée figurent dans la fiche documentée sur les mammifères.
Les informations collectées contribuent à une meilleure connaissance de l’évolution des espèces de mammifères présentes en Région bruxelloise et constituent un précieux support à l’élaboration de mesures de protection et gestion appropriées.
47 espèces indigènes de mammifères observées entre 2001 et 2017
Le tableau ci-dessous fournit la liste complète des espèces de mammifères sauvages observées en Région bruxelloise, classées par classe de rareté (2001-2017). Il montre dans combien de mailles de 1x1 km (correspondant au maillage utilisé pour répertorier les observations de l’atlas) l'espèce a été observée avant 2000 (aire avant 2000) et dans la période entre 2001 et 2017 (aire 2001-2017) ainsi que la tendance en terme d’expansion (la méthodologie de calcul du degré de rareté et des tendances est expliqué dans la fiche documentée sur les mammifères).
Au cours de la période 2001-2017, 52 espèces de mammifères ont été observées en Région bruxelloise ce qui représente une diversité d’espèces assez élevée compte tenu de la superficie régionale limitée (162 km2). 5 de ces espèces sont des espèces exotiques. Par ailleurs, 20 de ces espèces (dont 4 exotiques) sont occasionnelles ou très rares.
3 espèces recensées dans le premier atlas n'ont pas été observées lors de la réalisation du second atlas :
- 2 espèces de chauves-souris : la barbastelle et le grand murin, espèces dont les dernières observations dans la Région datent de la fin des années ’90 ;
- la loutre d’Europe, considérée comme régionalement éteinte depuis la seconde moitié du 20ème siècle.
Inversément 6 espèces sont nouvelles par rapport à la période précédente de l'atlas :
- le sanglier ;
- le castor européen (1 observation) ;
- 2 espèces de chauves-souris : la pipistrelle de Kuhls (2 observations) et le vespertilion bicolore (2 observations) ;
- 2 espèces exotiques : le muntjac de Chine (1 observation) et le raton laveur (2 observations dont l’une en Région flamande à proximité de la limite régionale).
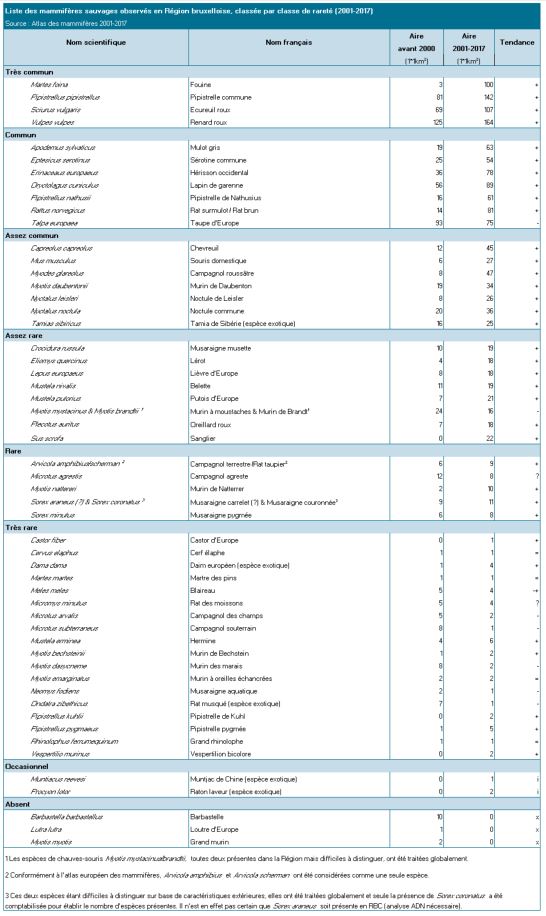
En 2010, pour la première fois, un castor a été observé à Bruxelles, plus précisément dans le canal. Un autre constat positif est que certaines espèces qui n’avaient plus été observées depuis longtemps dans la Région ont refait une très timide apparition. C’est le cas du blaireau et de la martre des pins.
En Flandre, il existe 13 espèces de mammifères indigènes qui ne sont pas ou ne sont plus présentes en Région bruxelloise. Pour 4 d’entre elles, une implantation à Bruxelles ne peut être attendue en raison de l’inadéquation des habitats présents ou de leur aire de répartition. A l’opposé, 2 espèces de chauves-souris ont été observées à Bruxelles mais pas en Flandre (grand rhinolophe, pipistrelle de Kuhl).
De même, la Région wallonne compte 17 espèces de mammifères indigènes qui ne sont pas ou ne sont plus présentes à Bruxelles dont 5 dont l’implantation en Région bruxelloise semble exclue. Toutes les espèces observées en Région bruxelloise sont également présentes en Région wallonne.
Au total, 75 espèces de mammifères sauvages ont été recensées en Belgique, en ce compris les mammifères marins et exotiques.
Une région particulièrement riche en Chiroptères
Aux 17 espèces de chauve-souris comptabilisées dans l’atlas des mammifères, il convient de rajouter l'Oreillard gris (Plecotus austriacus) recensé par Pletocus (le groupe de travail chauves-souris de Natagora) dans le cadre des monitoring qu’elle effectue pour la Région bruxelloise. Si l’on sait que la Belgique compte 23 espèces de chauve-souris, la faune bruxelloise s’avère donc particulièrement riche en ChiroptèresOrdre de mammifères souvent nocturnes et insectivores, adaptés au vol grâce à des membranes alaires fixées entre leurs doigts, sur les flancs et parfois sur la queue, et appelés communément chauves-souris..
Cette richesse s’explique par la valeur biologique très élevée de la forêt de Soignes et sa localisation à proximité de terrains de chasse favorables, en particulier au-dessus et autour des étangs du réseau hydrographique de la Woluwe. L’existence de nombreux vieux arbres comportant des cavités constitue également un élément essentiel pour la plupart des chauves-souris. La présence de 6 espèces de chauves-souris dites d’intérêt communautaire (voir focus sur l’ Etat local de conservation des espèces couvertes par les directives "Habitats" et "Oiseaux") a été déterminante dans l’identification des Zones Spéciales de Conservation qui composent le réseau Natura 2000 bruxellois.
Le renard, la pipistrelle, l'écureuil roux et la fouine sont les espèces dont les observations couvrent le territoire le plus étendu
Certaines espèces, le plus souvent ubiquistes (c’est-à-dire que l’on rencontre dans des habitats variés) et présentant de fortes capacités d’adaptation, trouvent en milieu urbain des conditions propices à leur développement. En 2017, par exemple, le renard est présent sur une large part du territoire bruxellois (164 des 200 mailles couvrant la région). Cette espèce, devenue moins farouche, s’est adaptée à l’homme et profite de l’abondante nourriture présente dans la ville, notamment dans les poubelles. Plus récemment, la fouine a aussi connu une extension fulgurante : alors qu’avant 2001, les observations recensées étaient localisées dans 3 carrés-km, elles occupaient 100 mailles lors du second atlas. Notons que les renards et les fouines sont des prédateurs territoriaux et sont donc naturellement présents en densités relativement faibles. Le renard, la fouine mais aussi la pipistrelle (petite chauve-souris) et l’écureuil roux sont les mammifères pour lesquels les observations couvrent le territoire le plus grand.
Pour 13% des espèces indigènes, les observations montrent une diminution de l’aire de répartition entre la réalisation des 2 atlas
Pourcentage de mammifères par classe de tendance (progression spatiale, espèces exotiques inclues)
Source : Atlas des mamifères 2001-2017
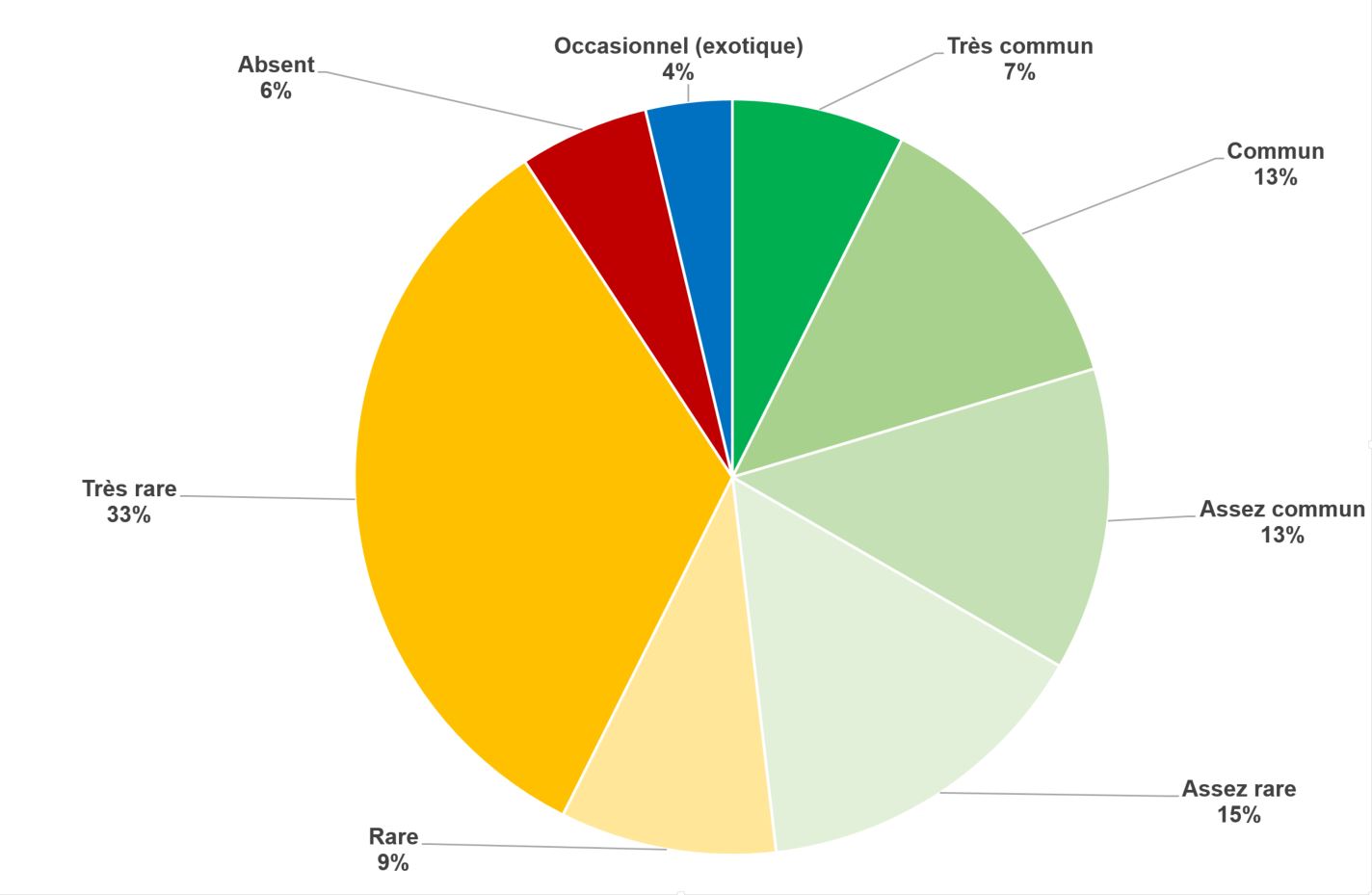
La tendance indique si l'espèce a été observée dans plus ou moins de mailles au cours de la période 2001-2017 par rapport à la période avant 2001. Cette tendance est positive ou stable pour environ trois quart des espèces indigènes. Il convient néanmoins de garder à l’esprit que si l'espèce a été détectée dans plus de mailles au cours de la période actuelle de l'atlas qu'avant 2001, ceci ne signifie pas nécessairement que l’aire de répartition de l'espèce a réellement augmenté. Cet accroissement peut en effet être lié à une plus grande intensité d’observations, à une amélioration des méthodes de détection ou encore, à une meilleure connaissance de l’écologie des espèces et de leur habitat.
Les observations sont par contre géogaphiquement moins étendues pour environ 13% des espèces indigènes: la taupe, 2 espèces de campagnol, la musaraigne aquatique ainsi que 3 espèces de chauves-souris. Ceci témoigne vraisemblablement d’une régression de l’aire de répartition de ces espèces.
Une diversité d’espèces qui reflète la diversité des milieux
Les régions les plus riches en espèces de mammifères sont la forêt de Soignes, la vallée de la Woluwe, le bois du Laerbeek, le bois de la Cambre, le bois du Verrewinkel et quelques autres sites semi-naturels tels que le Vogelzang ou le Scheutbos. Outre la présence de nombreuses zones boisées et des lisières attenantes, la richesse en mammifères est aussi liée à la présence de nombreux cours d’eaux et étangs (zones de gagnage des chauves-souris, habitat de la musaraigne aquatique et du putois notamment), de formations herbacées résiduelles (lièvre, rat des moissons) ou encore de ronces, d’arbustes et d’arbrisseaux à fruits (hérisson, souris, rat, fouine, belette, …).
Les mailles les plus riches comportent jusqu’à 26 espèces de mammifères par km2.
La répartion spatiale de la richesse en espèces s’explique par le caractère plus ou moins vert des mailles mais aussi par le fait que les efforts de recherche se sont davantage concentrés sur les zones vertes.
Richesse en espèces de mammifères observées par maille durant la période 2001-2017 (1*1 km2)
Source : Atlas des mamifères 2001-2017
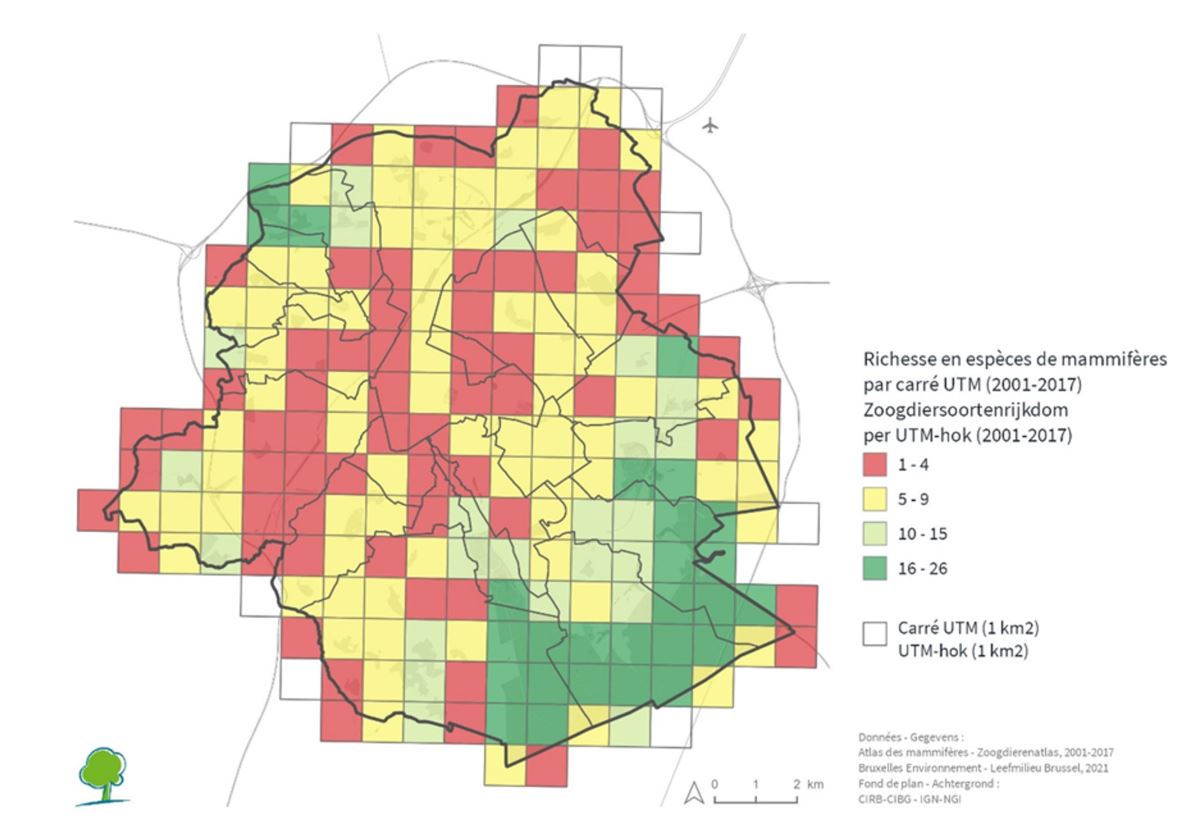
La fouine et le lérot, espèces d’intérêt régional, sont en expansion
L’ordonnance Nature a introduit le concept d’espèces d’intérêt régional. Celles-ci sont définies comme des espèces indigènes pour la conservation desquelles la Région a une responsabilité particulière en raison de leur importance pour le patrimoine naturel régional et/ou de leur état de conservation dévavorable. Ce statut s’applique à 4 espèces de mammifères : la fouine (Martes foina), la martre des pins (Martes martes), le lérot (Eliomys quercinus) et le muscardin (Muscardinus avellanarius).
Comme mentionné précédemment, la fouine - espèce synanthrope - connait depuis une dizaine d’années une très forte progression, à tel point que sa présence est devenue très commune dans la Région et ne va pas sans poser quelques difficultés de cohabitation (voir infofiche).
La martre, autre petit mammifère carnivore, est inféodée aux milieux forestiers. En Région bruxelloise, l’espèce est très rare puisqu’elle n’a été observée qu’à une reprise tant lors de la réalisation du premier atlas que du second.
Les observations de lérot ont par contre été plus nombreuses et géographiquement beaucoup plus dispersées lors du récent atlas, ce qui pourrait indiquer une extension de l’espèce sur le territoire bruxellois. Aucun muscardin n’a été observé en Région bruxelloise. Etant donné la capacité de dispersion limitée de l'espèce et le fait que la population la plus proche se trouve actuellement à une cinquantaine de km, séparée par des habitats très peu adaptés, il est très peu probable que l'espèce n’atteigne la Région bruxelloise dans un avenir proche.
5 espèces exotiques envahissantes de mammifères observées en Région bruxelloise
Depuis le dernier atlas, 2 nouvelles espèces exotiques envahissantes ont été observées de manière exceptionnelle: le muntjac de Chine ainsi que le raton laveur. Ces deux espèces sont incluses dans la liste européenne des espèces exotiques envahissantes. En outre, trois espèces exotiques déjà présentes lors de la réalisation du premier atlas sont toujours observées: le tamia de Sibérie (communément désigné sous le nom d’Ecureuil de Corée) et, beaucoup plus rarement, le rat musqué et le daim. Le tamia de Sibérie et le rat musqué figurent également sur la liste européenne précitée. Le daim est quant à lui repris dans la liste bruxelloise des espèces envahissantes (annexe IV de l'odonnance Nature. Voir focus sur les espèces exotiques envahissantes).
D’après les études de risque du forum belge sur les espèces invasives, le tamia de Sibérie, fréquent en forêt de Soignes et ses abords, pourrait avoir un impact sur les espèces d'oiseaux nicheurs ou sur des espèces indigènes de rongeurs présentes en forêt. Aucune preuve formelle d’un impact sur l’avifaunePartie de la faune d un lieu constituée par les oiseaux. sonienne n'a cependant été trouvée dans les études de suivi réalisées. Dans les forêts périurbaines, le tamia de Sibérie pourrait aussi contribuer à une tranmission accrue de la maladie de Lyme (http://ias.biodiversity.be/species/show/31, consulté le 8/9/2020).
La préservation et reconnexion des habitats, un enjeu pour la biodiversité
Le réseau routier bruxellois, très dense, limite la liberté de mouvement des mammifères terrestres mais aussi des chauves-souris qui évitent les grands espaces ouverts et ont besoin de structures pour s'orienter (écholocation). L’éclairage constitue également une menace pour les chauves-souris (impact sur les populations d’insectes, perturbation des couloirs de vols…).
Pour les grands mammifères se nourrissant en lisière de forêt ou dans des espaces ouverts, la forte urbanisation en bordure de la forêt de Soignes de ces dernières décennies a été préjudiciable. Pour d'autres mammifères moins liés à la forêt, la destruction et la fragmentation d’habitats comme les bosquets et les fourrés, ont également été négatives.
De manière générale, le maintien de la connectivité et la réduction de la fragmentation des habitats naturels constitue un enjeu important pour la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore).. Plusieurs études ont été menées ces dernières années sur ce sujet tant en Région bruxelloise que flamande et ont abouti à la réalisation de divers projets de reconnexion au niveau du massif sonien (voir focus sur le chevreuil ). D’autres projets sont à l’étude. Le suivi scientifique effectué a montré que les passages à faune (écoducs, tunnels, écobuses) aménagés au niveau de certaines infrastructures routières ou ferroviaires sont utilisés nortamment par des petits et grands mammifères et que la pose de clôtures en bordures du ring avait permis de réduire très fortement le nombre d’animaux victimes d’accidents de la circulation.
En Région bruxelloise, la préservation et reconnexion des habitats passe aussi notamment par le développement du réseau écologique bruxellois et la protection d’espaces verts de haute valeur biologiqueValeur reconnue d'un site coté sur base d'une série de critères tels que : la présence d'éléments hydrologiques peu perturbés (sources), la diversité et la rareté des espèces locales de plantes et d'animaux, la présence d'espèces rares, la maturité des végétations (site irremplaçable sauf à très long terme, ex. une forêt séculaire), etc. (voir focus et fiche documentée sur les sites semi-naturels et espaces verts protégés ainsi que le focus sur le maillage vert). La problématique de la pollution lumineuse est également prise en compte, notamment via les conditions imposées dans les permis d’environnement et au niveau de l’aménagement des espaces publics.
À télécharger
Fiches documentées
- 1. Les mammifères en Région bruxelloise (.pdf) (2020)
- 19. Le chevreuil en Région bruxelloise (.pdf) (2020)
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Focus : Le chevreuil en Région bruxelloise (2020)
- Surveillance des espèces (2020)
- Espèces exotiques envahissantes (2020)
- Sites semi-naturels et espaces verts protégés (2021)
- Focus : Fragmentation et isolement des espaces verts (2014)
- Focus : Le maillage vert (2015)
- Focus : Habitat naturels dans les espaces verts bruxellois (2011)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Les mammifères en Région de Bruxelles-Capitale
- La fouine (info fiches- biodiversité)
- Gîtes pour l’écureuil roux (info fiches- biodiversité)
- Gîtes pour le hérisson commun (info fiches-biodiversité)s'ouvre dans une nouvelle fenêtre
- Gîtes pour le lérot (info fiches -biodiversité)s'ouvre dans une nouvelle fenêtre
- Gîtes pour la pipistrelle commune (info fiches-biodiversité)s'ouvre dans une nouvelle fenêtre
- Le renard (info fiches- biodiversité)
- Le sanglier (info fiches- biodiversité)
- Le chevreuil (info fiches- biodiversité)
- Carte « Réseau écologique bruxellois »
- Carte « Ecureuils de Buxelles »
- Carte « Lérots de Bruxelles »
- Carte « Hérissons de Bruxelles »
Etudes et rapport
- NATUURPUNT 2020. « Van dwergspitsmuis tot wild zwijn: deze soorten profiteren van faunapassages in Zoniënwoud", in Natuurbericht, juni 2020. (en néerlandais uniquement)
- VERCAYIE D., PAQUET A., FEYS S., WILLEMS W. & PAQUET J-Y. 2020. « Zoogdierenatlas van het Brussels Gewest. 2001-2017 », rapport Natuurpunt Studie 2017/39 réalisé pour le compte de Bruxelles environnement, Mechelen. (en voie de publication)
- VERCAYIE D. & SWINNEN K. 2018. "Monitoring van de ecologische infrastructuur ter ontsnippering van het Zoniënwoud", rapport final, Rapport Natuurpunt Studie 2018/12, Mechelen.
Plans et programmes
Liens utiles
Evolution des populations de chauves-souris en Région bruxelloise
Focus - Actualisation : mars 2023
La Région de Bruxelles-Capitale héberge 20 espèces de chauves-souris (dont une considérée comme régionalement éteinte depuis la fin du 20ème siècle), ce qui représente une belle richesse spécifique pour un milieu fortement urbain. Cette diversité s’explique en partie grâce à la présence de la forêt de Soignes et d’un chapelet d’étangs dans le bassin de la Woluwe. Le suivi des populations bruxelloises de chiroptèresOrdre de mammifères souvent nocturnes et insectivores, adaptés au vol grâce à des membranes alaires fixées entre leurs doigts, sur les flancs et parfois sur la queue, et appelés communément chauves-souris. montre notamment une progression du nombre de chauves-souris en forêt de Soignes. Il met également en évidence le fait que les espèces lucifuges de chauves-souris sont observées en périphérie de la Région bruxelloise, dans les zones préservées de la pollution lumineuse.
Une large variété d’habitats
Les chauves-souris (ou chiroptères) utilisent une large variété d’habitats pour leur reproduction, leur alimentation, leur hibernation. Selon les espèces et les saisons, elles gîtent dans des cavités de vieux arbres, des bâtiments (des charpentes aux caves y compris dans les fissures) ou encore, des milieux souterrains (grottes, tunnels, etc.). De nombreuses espèces sont forestières : dans les bois, elles trouvent nourriture et gîtes. Certaines espèces, comme les pipistrelles, préfèrent les lisières et les espaces plus dégagés. Les chauves-souris chassent dans des sites naturels tels que les forêts, les milieux aquatiques ou encore, les parcs et les lisières. Leurs routes de vol pour passer de leur(s) gîte(s) à leur(s) terrain(s) de chasse suivent les éléments linéaires et verticaux de leur environnement tels que les routes et canaux bordés d’arbres, les bandes boisées, les haies et les lisières forestières.
Par leur régime alimentaire insectivore et leur position en bout de chaîne alimentaire, la diversité des milieux qu’elles occupent, leur forte sensibilité aux modifications de l’environnement et leur spécialisation extrême (gîtes, insectes chassés, etc.), les chauves-souris constituent de bons indicateurs de l’état de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). et du fonctionnement des écosystèmes.
Les chauves-souris, régulatrices des populations d’insectes

Selon les espèces et la période de l’année, les proies des chauves-souris européennes sont notamment constituées de mouches, moustiques, papillons, coléoptères ou encore, araignées. Le vol nécessitant beaucoup d’énergie, il leur faut trouver beaucoup d’insectes en un temps le plus court possible. Selon Plecotus-Natagora, en une nuit, une chauve-souris peut consommer environ 1/4 de sa masse corporelle, voire plus, ce qui représente, pour une espèce de taille moyenne pesant 8 g, environ un kilo d’insectes par an. De ce fait, les chauves-souris participent à la régulation des populations d’insectes, parmi lesquels des vecteurs de maladies et des ravageurs de cultures. A titre d’exemple, la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), l’espèce de chauve-souris la plus présente en Région bruxelloise, peut capturer 2000 à 3000 moustiques par nuit d’été.
De multiples facteurs menacent les chauves-souris
Les chauves-souris sont des animaux très vulnérables en raison notamment du fait qu’elles se reproduisent à un rythme très lent (un petit par femelle et par an), évoluent dans plusieurs types d’habitats et réagissent mal à des modifications brusques de leur environnement. Un déclin massif des effectifs de toutes les espèces européennes de chauves-souris a été observé depuis le milieu du 20ème siècle. Il est dû principalement à la transformation et à la fragmentation de leurs habitats naturels, à l’intensification des pratiques agricoles et sylvicoles, à l’utilisation de pesticides (y compris pour les charpentes) et à des campagnes volontaires de destruction (EUROBATS). Les insecticides sont doublement nocifs pour les chauves-souris : non seulement ils réduisent la quantité de proies disponibles pour celles-ci mais ils ont aussi tendance à s’accumuler dans leur organisme ce qui peut conduire à les intoxiquer.
Les chauves-souris subissent malheureusement toujours de nombreuses pressions :
- disparition ou modification des gîtes : rénovation et isolation des bâtiments ou des ponts, fermeture de l’entrée des gîtes souterrains, abattage des arbres à cavités, éclairage des monuments… ;
- régression de la qualité des paysages et de la nature : disparition des haies, des talus boisés, des vergers ou encore de zones humides, morcèlement des habitats et ruptures de connexions qui ne permettent parfois plus aux espèces de se déplacer entre les zones qui présentent le plus grand intérêt écologique pour elles (voir Fragmentation des habitats naturels);
- pollution lumineusequi entraîne des conséquences négatives tant sur les chauves-souris que sur de nombreuses autres espèces animales (voir Pollution lumineuse en Région de Bruxelles-Capitale) ;
- dérangements durant l’hibernation ou la reproduction (notamment par les spéléologues) ;
- utilisation de produits chimiques : traitement de charpentes, pesticides, antiparasitaires... ;
- mortalité directe : prédation par le chat domestique, impact des éoliennes... ;
- disparition des proies.
Bon à savoir
Des routes de vol
Le gîte où les chauves-souris se reposent la journée est parfois séparé de plusieurs kilomètres de leurs zones de chasse. Etant donné que la plupart des chauves-souris évitent les espaces ouverts (manque de points de repère nécessaires à l’écholocation), elles utilisent ce que l’on appelle des routes de vol pour se déplacer entre gites et zones de chasse. Ces routes, les mêmes utilisées toutes les nuits, longent des éléments linéaires du paysage tels que des alignements d’arbres et d’arbustes, des lisières forestières, des haies, etc. Le maintien des routes de vol par la préservation de ces éléments paysagers est donc essentiel pour les chauves-souris. Il est également intéressant pour d’autres animaux tels que les insectes ou les oiseaux. C’est pourquoi, même en milieu urbain, il est nécessaire de maintenir et développer le réseau écologique.
Des mesures en faveur des chauves-souris…
Dans la plupart des pays européens, les chauves-souris et leurs habitats sont désormais protégés par la législation. En Région de Bruxelles-Capitale, les chauves-souris - comme les autres mammifères indigènes -, sont protégées par l’ordonnance Nature ; elles bénéficient d’une protection stricte sur l’ensemble du territoire régional. Un certain nombre de mesures et actions régionales participent à la protection des chauves-souris : désignation de sites naturels protégés (voir ci-dessous), maintien de vieux arbres, aménagement de gîtes, limitation ou adaptation de l’éclairage nocturne, interdiction des pesticides dans les espaces publics, développement de lisières et de clairières, mise en place d’un réseau écologique, etc. Une protection efficace repose sur une protection tant des gîtes d’hibernation que des gîtes estivaux, des zones de chasse et des routes de vol.
… qui portent certains résultats
Un vaste projet de monitoring des chauves-souris a été réalisé à l’échelle européenne. Dans ce cadre, les données relatives à 6000 sites d’hibernation couvrant 6 régions biogéographiques, 9 pays, une période de 6 à 26 années et 27 espèces de chauves-souris ont été analysées. Elles ont permis de dégager des tendances pour 16 espèces. L’étude, publiée par l’Agence européenne de l’environnement en 2013, fait état d’une augmentation de 43% des effectifs de chauves-souris au niveau de sites d’hibernation entre 1993 et 2011. Neuf des espèces étudiées montrent une tendance européenne positive et une espèce montre un déclin significatif. Ces résultats encourageants doivent cependant être tempérés vu qu’ils portent sur un nombre limité d’espèces et de sites.
En France, selon le Plan national d’actions en faveur des chiroptèresOrdre de mammifères souvent nocturnes et insectivores, adaptés au vol grâce à des membranes alaires fixées entre leurs doigts, sur les flancs et parfois sur la queue, et appelés communément chauves-souris. 2016-2025 (publié en 2017) , certaines populations semblent être en augmentation tout en restant cependant loin des effectifs prévalant dans les années 1950-1960. D’autres sont en revanche en déclin.
La présence de 6 espèces de chauves-souris rares a contribué à la désignation des zones Natura 2000 en Région bruxelloise
Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels qui font l’objet d’un statut spécial de protection en raison des habitats ou des espèces qui s’y trouvent. En Région bruxelloise, la désignation en 2015 et 2016 des trois zones spéciales de conservation Natura 2000 a été largement déterminée par la présence de 6 espèces rares (considérées d’intérêt communautaire) de chauves-souris (voir Sites semi-naturels et espaces verts protégés).
La détection, en 2017, au niveau du plateau Engeland, d’une espèce rare (le Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus), a contribué à justifier une extension de 13 ha de cette zone Natura 2000 en 2019.
La Région bruxelloise, une référence européenne pour le monitoring des chauves-souris
Des recensements de chauves-souris sont régulièrement organisés en Région de Bruxelles-Capitale pour le compte de Bruxelles Environnement. La surveillance de l’état et des tendances des populations pour les différentes espèces de chauves-souris est imposée par la directive européenne Habitats (Natura 2000), l'Accord international sur la conservation des populations de chauve-souris européennes (développé dans le cadre de la Convention sur la conservation des espèces migratrices ou Convention de Bonn) ainsi que par l’ordonnance régionale du 1er mars 2012 concernant la conservation de la nature. Les données sont aussi utilisées à des fins de gestion, notamment pour remettre des avis lors des procédures de permis.
Le protocole de monitoring bruxellois a été mis en place en 2006 et a peu changé depuis (d’autres méthodes ont été testées sans s’avérer très probantes). Il s’appuie sur :
- près de 400 points d’écoute en milieu aquatique;
- une trentaine de transects en milieu forestier (un transect correspondant à 1 ligne de 20 points d’écoute).
L’activité de chasse des chauves-souris sur les étangs et plans d’eau ainsi que dans les massifs forestiers est mesurée à l’aide d’un détecteur d’ultrasons au niveau de ces points d’écoute.
Un tiers des points d’écoute et des transects sont inventoriés chaque année, à raison de 3 passages par an. Le nombre de « contacts » (détection d‘ultrasons émis par une chauve-souris) par point d’écoute est noté en distinguant les groupes taxonomiques des Pipistrelles (Pipistrellus sp.), des Murins (Myotis sp.) et des Sérotines/Noctules (Eptesicus sp. / Nyctalus sp.).
Un suivi des gîtes d’hiver est aussi organisé depuis 1982. Une quarantaine de sites hivernaux sont connus à Bruxelles. Depuis 2008, une vingtaine d’entre eux font l’objet d’un suivi annuel.
Pour répondre à des questions spécifiques, d’autres méthodes d’inventaire peuvent être utilisées : système d’enregistrement automatique, captures de chauve-souris (identification d’espèces rares, pose d’un émetteur), prospection de bâtiments, suivi des nichoirs, etc. Certains sites présentant un intérêt potentiel ou un enjeu particulier font l’objet d’inventaires supplémentaires.
La complémentarité des méthodes d’inventaires déployées permet un suivi plus ou moins précis de l’ensemble des espèces.
La Région de Bruxelles-Capitale constitue une référence à l’échelle européenne pour le monitoring par points d’écoute en milieu aquatique et par transects forestiers : un suivi aussi régulier sur une aussi longue période n’est pas connu dans d’autres régions. Il est rendu possible par l’investissement de très nombreux bénévoles.
Bon à savoir
L’écholocation
Dotée d’une assez bonne vue mais mal adaptée à la vision de nuit, les chauves-souris ont développé un autre système pour se diriger et chasser dans le noir : l’écholocation c’est-à-dire l’émission d’ultrasons dont l’écho leur permet de se repérer dans l’espace et de localiser leurs proies. Les impulsions sonores émises sont différentes selon le comportement de la chauve-souris (chasse, capture d’une proie, transit, etc.) et son espèce. Cette faculté des chiroptèresOrdre de mammifères souvent nocturnes et insectivores, adaptés au vol grâce à des membranes alaires fixées entre leurs doigts, sur les flancs et parfois sur la queue, et appelés communément chauves-souris. est utilisée pour leur recensement et étude : un détecteur d’ultrasons (ou batbox) permet de percevoir les ondes émises par les chauves-souris, de préciser leur comportement et, parfois, d’identifier les espèces.
Pour de plus amples informations concernant les méthodologies de monitoring et d’analyse des données, voir le rapport « Analyse des données de monitoring et développement de critères pour l’état de conservation local des chiroptères en Région de Bruxelles-Capitale ».
Une Région particulièrement riche en espèces de chauves-souris
En 2018-2019, une étude a été réalisée pour rassembler, organiser et analyser les données de monitoring des chauves-souris réalisés depuis 40 ans en Région bruxelloise (Brabant et al., 2019).
Au total 20 espèces de chauves-souris sur les 24 espèces observées à ce jour en Belgique ont été recensées. Certaines de ces espèces n’ont néanmoins été que rarement observées à Bruxelles. Par ailleurs, une espèce - la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) - est considérée comme probablement localement éteinte (la dernière observation date de la fin du 20ème siècle).
Cette grande diversité s’explique en partie par la présence de deux milieux qui présentent une faible pollution lumineuse :
- la forêt de Soignes est surtout essentielle par son apport en cavités d’arbres, servant tant de gîtes d’été que de gîtes d’hiver. Les vieux arbres, en plus d’offrir un grand nombre de gîtes, sont très productifs en insectes. Les points d’eau en forêt sont les zones qui donnent lieu au plus grand nombre d’observations de chauves-souris en chasse. Les clairières intra-forestières et les prairies de fonds de vallée sont aussi des lieux de gagnage importants pour les chauves-souris ;
- le chapelet d’étangs dans le bassin de la Woluwe dont l’attractivité pour les chiroptèresOrdre de mammifères souvent nocturnes et insectivores, adaptés au vol grâce à des membranes alaires fixées entre leurs doigts, sur les flancs et parfois sur la queue, et appelés communément chauves-souris. est liée à l’émergence des insectes aquatiques qui y développent la plupart du temps leur stade larvaire. L’attrait des étangs est aussi très dépendant de la qualité et de la continuité des liaisons arborées avec les zones de gîtes de la forêt.
Le centre urbain, largement bâti mais ponctué de parcs, jardins et intérieurs d’ilots, apporte quant à lui un habitat intéressant pour les espèces anthropophiles, opportunistes et moins lucifuges telles que la pipistrelle commune (Pipistrellus) et la sérotine commune (Eptesicus serotinus). Le nombre d’espèces y reste cependant assez faible au regard de ce qu’on peut observer dans la forêt de Soignes par exemple.
Richesse spécifique en Chiroptères en Région de Bruxelles-Capitale (2001-2018)
Source : Brabant et al. 2019
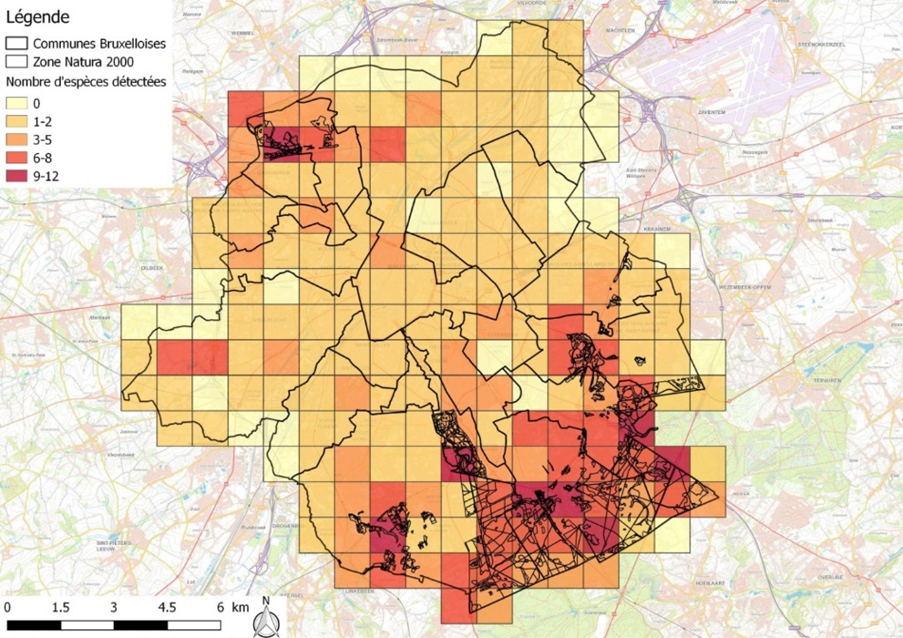
Globalement, les zones géographiques les plus intéressantes pour les chauves-souris sont celles qui entourent les étangs des Enfants Noyés, les abords du Rouge-Cloître, le plateau Engeland et le bois de la Cambre.
La Pipistrelle commune et la Sérotine commune, deux espèces anthropophiles présentes en Région bruxelloise (2001-2018)
Source : Bruxelles Environnement 2019

La Pipistrelle commune est de loin la chauve-souris la plus uniformément répandue et celle qui se rencontre dans la plus grande diversité de milieux. Elle a été contactée en forêt de Soignes, le long de ses lisières, dans les parcs, dans les quartiers résidentiels arborés, dans quelques avenues plantées de grands arbres, au-dessus d’étangs tant urbains que périurbains et, occasionnellement, dans le centre urbain. C’est la seule espèce bien représentée en dehors des espaces verts à haute valeur biologiqueValeur reconnue d'un site coté sur base d'une série de critères tels que : la présence d'éléments hydrologiques peu perturbés (sources), la diversité et la rareté des espèces locales de plantes et d'animaux, la présence d'espèces rares, la maturité des végétations (site irremplaçable sauf à très long terme, ex. une forêt séculaire), etc.. Des concentrations très importantes s’observent là où se conjugue présence d’arbres et de plans d’eau. La Pipistrelle commune est par ailleurs l’une des rares espèces européennes qui profite des éclairages urbains ou routiers pour chasser les insectes.
Pour chacune des espèces répertoriées, des cartes de répartition régionale ont été réalisées à l’exemple de celle reprise ci-dessous pour la Pipistrelle. Les données ont également été analysées en fonction de différentes variables disponibles sur base d’informations cartographiques (distance à la forêt, indice de luminosité et type d’habitats / occupation du sol, habitats Natura 2000, sites Natura 2000, âge et nature des peuplements, fragmentation du paysage).
Carte de répartition de la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) en Région bruxelloise
Source : Brabant et al. 2019
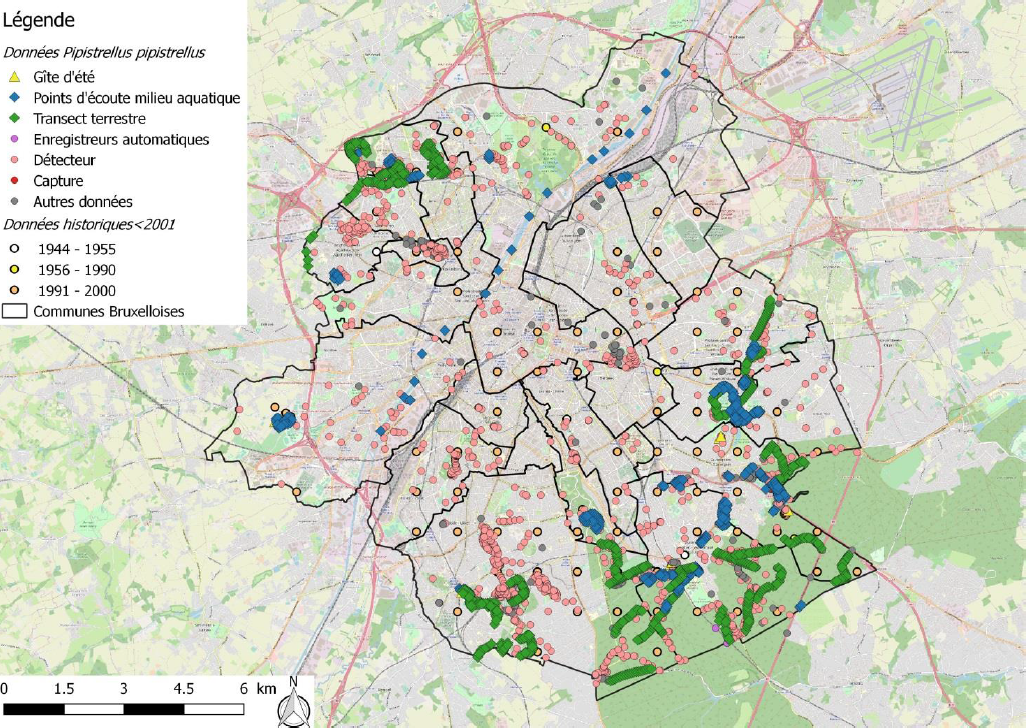
Les intérieurs d’îlots sont particulièrement importants pour la Pipistrelle commune qui utilise ces zones comme terrains de chasse en milieu densément bâti.
Une autre espèce courante est la Sérotine commune. Les observations sont néanmoins concentrées dans la partie sud est de la Région.
Bon à savoir
Sur les 16 espèces présentes en Région bruxelloise pour lesquelles un statut de conservation a pu être établi au niveau de la Région flamande (données suffisantes), 13 sont considérées comme (très) rares,(très) vulnérables, menacées ou probablement éteinte en Flandre.
Ceci montre, si besoin est, que les mesures de conservation prises en faveur des chiroptèresOrdre de mammifères souvent nocturnes et insectivores, adaptés au vol grâce à des membranes alaires fixées entre leurs doigts, sur les flancs et parfois sur la queue, et appelés communément chauves-souris. en Région bruxelloise sont non seulement importantes pour la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). régionale mais également à plus grande échelle.
Les chauves-souris du genre Pipistrellus progressent en nombre et en distribution
Les différentes analyses effectuées à partir des résultats des points d’écoute indiquent une augmentation des chauves-souris appartenant au genre Pipistrellus au cours de la période 2006-2017, en milieu forestier et aquatique, tant en nombre qu’en matière d’occupation spatiale. L’analyse par espèce suggère que cette augmentation serait nettement liée à la progression de la Pipistrelle commune en milieu forestier tandis qu’en milieu aquatique elle est liée à celle de l’ensemble des espèces de Pipistrelles.
Le nombre de chauves-souris du genre Myotis progresse en milieu forestier mais semble décliner en milieu aquatique
En milieu forestier, l’analyse des données effectuées à partir des résultats des points d’écoute révèle une augmentation des abondances des chauves-souris appartenant au genre Myotis. En milieu aquatique, la seule tendance qui se dégage est un déclin en matière d’abondance à l’échelle de ce groupe.
Le nombre de chauves-souris du groupe Eptesicus/Nyctalus progresse en milieu forestier
Les données d’abondance montrent une nette augmentation du groupe Eptesicus/Nyctalus en milieu forestier. Trois taxons de ce groupe présentent une croissance significative : la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) et le taxon qui regroupe Sérotines et Noctules de façon indéterminée (Eptesicus/Nyctalus sp.). En milieu aquatique, l’analyse par espèce suggère une augmentation de trois taxons : la Sérotine commune, la Noctule de Leisler (essentiellement en 2015 et 2016) ainsi que le taxon qui regroupe les Noctules de façon indéterminée (Nyctalus sp.).
65% des chauves-souris hibernent dans des conduits
Globalement, la diversité spécifique des chauves-souris dans les sites d’hiver est assez réduite en Région bruxelloise. Environ 65 % des chauves-souris y hibernent dans des conduits, c’est-à-dire des passages sous route ou sous voie de chemin de fer. L’importance de la prise en compte de ce type de site pour la protection des chauves-souris en période hivernale est donc essentielle.
Les données de suivi mettent en évidence l’impact de certaines mesures
Les transects forestiers montrent une augmentation du nombre de contacts et du nombre d’espèces pour un grand nombre de sites.
La présence des chauves-souris dans les forêts, ainsi que leurs activités, dépendent fortement de la manière dont les activités sylvicoles sont réalisées. La structure des forêts, leur âge, leurs essences, influent sur les ressources alimentaires présentes et les gîtes potentiels. La méthode de gestion naturelle du milieu forestier bruxellois semble donc avoir un impact favorable sur la présence des chauves-souris (voir Patrimoine forestier de la forêt de Soignes bruxelloise).
Plusieurs points d’eau présentent une augmentation du nombre de contacts et du nombre d’espèces. A contrario, quelques sites liés aux milieux aquatiques présentent une diminution du nombre de contacts et du nombre d’espèces. Il semble que certains aménagements aient un impact négatif sur les chauves-souris (éclairage du site, nuisances sonores, coupe d’arbres), d’autres ont un impact positif (mise en assec des étangs, curage, creusement de mares, fossés et chenaux, etc.).
Les données récoltées montrent également que la présence d’espèces lucifuges de chauves-souris se situe en périphérie de la Région bruxelloise, dans les zones préservées de la pollution lumineuse. L’éclairage provoque ainsi un déséquilibre en favorisant localement les espèces tolérantes à la lumière, souvent plus communes, et en évinçant les intolérantes, souvent rares et menacées.
Un maillage étoilé pour favoriser les déplacements des chauves-souris et la biodiversité en général
Bon à savoir
La plupart des espèces de chauves-souris de nos régions, notamment les Rhinolophes (Rhinolophus spp) et les Murins (Myotis spp.), fuient la lumière (espèces lucifuges). Certaines peuvent ainsi être coupées d'une partie de leurs terrains de chasse par la simple illumination d'une route ou d'un chemin situés sur leur trajet habituel. De même, un terrain de chasse illuminé est abandonné. La lumière artificielle nocturne peut donc fragmenter des populations déjà souvent fragilisées. La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrelus) et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), espèces moins lucifuges, viennent par contre chasser les insectes attirés par des points lumineux. Ce n'est pas forcément une bonne chose car les insectes attirés vers la lumière quittent les endroits non éclairés, privant ainsi les espèces lucifuges de la quantité de nourriture habituelle. Des études ont aussi démontré que les colonies de chauves-souris dont les accès sont éclairés sortent plus tard que lorsque ces mêmes accès ne sont pas éclairés. Ce retard peut obliger les chauves-souris à voler plus longtemps pour attraper la même quantité de proies car c'est en tout début de nuit qu'il y a le plus d'insectes disponibles.
Plus généralement, l’éclairage public nocturne déséquilibre les cycles d’exposition à la lumière avec des conséquences néfastes sur la faune, la flore et les écosystèmes ainsi que des effets suspectés ou avérés sur la santé humaine (pour plus d'informations, voir fiche documentée Pollution lumineuse en Région de Bruxelles-Capitale).
Comme dans toutes les villes, la pollution lumineuse est omniprésente sur le territoire régional. Compte tenu de ses impacts environnementaux (écosystèmes, consommation énergétique et émissions de gaz à effet de serreGaz qui absorbe une partie des rayons du soleil et les restitue sous la forme de rayonnements, lesquels rencontrent d'autres molécules de gaz et reproduisent ainsi le processus, entraînant l’effet de serre, qui engendre une augmentation de chaleur. Les principaux gaz à effet de serre dont l’origine est essentiellement liée à des activités humaines sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’ozone troposphérique (O3). associées), patrimoniaux (absence de ciel étoilé) et, potentiellement, sur la santé humaine, de plus en plus de villes commencent à intégrer la pollution lumineuse dans leurs décisions urbanistiques. Le Plan lumière régional, revu en 2017, fait état de l’impact de l’éclairage public sur les biotopes. Si ce plan prévoit certaines mesures pour réduire l’impact environnemental des éclairages publics (diminution ou extinction de tout éclairage inutile, orientation des lumières vers le bas, choix des longueurs d’onde et des appareils, etc.), celles-ci sont toutefois insuffisantes par rapport aux enjeux relatifs à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). nocturne, notamment à celle des insectes. Des réflexions pour la mise en place d’un maillage étoilé en Région bruxelloise sont en cours et devraient permettre à terme de renforcer la prise en compte de la nature dans l’éclairage public.
Le maillage étoilé - également appelé trame sombre ou trame noire – consiste en une continuité obscure visant à préserver ou recréer un réseau écologique propice à la vie nocturne. Pour les chauves-souris, elle permettrait de diminuer l’isolement d’ilots naturels sombres et de créer des corridors vers les zones naturelles suffisamment grandes pour qu’elles puissent y chasser. Des aménagements au niveau du canal et de la Senne - qui constituent un corridor de migration naturel - devraient également être envisagés.
Notons que la récente « Stratégie pour les insectes pollinisateurs et auxiliaires en Région de Bruxelles-Capitale 2023-2030 » a notamment pour objectif de « Formaliser une série de recommandations et prescriptions techniques visant à réduire les incidences négatives de l’éclairage nocturne sur la faune et la flore, tout en veillant aux différentes contraintes et attentes sociétales (sécurité, accessibilité, etc.) ».
Des informations complémentaires concernant la réflexion en cours sur le maillage étoilé, sur la gestion de la pollution lumineuse dans les espaces verts gérés par Bruxelles Environnement ainsi que sur des exemples bruxellois de réalisation d’éclairage public tenant compte de la biodiversité nocturne figurent dans la fiche documentée consacrée à la Pollution lumineuse en Région de Bruxelles-Capitale.
A télécharger
Documents :
Fiches documentées
- n°1. Les Mammifères en Région bruxelloise, 2021 (.pdf)
- n°24. La pollution lumineuse en Région de Bruxelles-Capitale, 2022 (.pdf)
- n°26. Les chauves-souris en Région de Bruxelles-Capitale, 2022 (.pdf)
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Les Mammifères en Région bruxelloise, 2021
- Fragmentation des habitats naturels, 2022
- Sites semi-naturels et espaces verts protégés, 2021
- Patrimoine forestier de la forêt de Soignes bruxelloise, 2021
- Qualité biologique des principaux cours d'eau et étangs, 2022
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Les chauves-souris – Connaître et protéger, 2019 (.pdf)
- Rapport sur l’état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale, 2012 (.pdf)
Etudes et rapports
- ADRIAENS P. 2020. “ Actualisatie van de monitoringstrategie voor de evaluatie van de natuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.” Corridor cvba, étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, Nazareth, 38 p. (en néerlandais uniquement)
- AGENCE EUROPEENNE DE L’ENVIRONNEMENT 2013. “European bat population trends – A prototype biodiversity indicator”, EEA Technical report n°196/2013 (en anglais uniquement) (.pdf)
- BRABANT C., NYSSEN P., WEISERBS A. & SAN MARTIN G., 2019. “Analyse des données de monitoring et développement de critères pour l’état de conservation local des Chiroptères en Région de Bruxelles-Capitale”, étude effectuée par Natagora à la demande de Bruxelles environnement
- CONSEILLERS BIODIVERSITE DES CHAMBRES D’AGRICULTURE DE LA REGION CENTRE VAL DE LOIRE. « Les chauves-souris, des insectivores opportunistes », flash biodiversité n°8
- DELORMEAU C. 2020. « Lumière…sur la nuit bruxelloise », Natagora website
- REPUBLIQUE FRANCAISE - MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE ET DE LA MER 2017. « Plan national d’actions en faveur des Chiroptères 2016-2025 »
- REPUBLIQUE FRANCAISE – SITE INTERNET INRAE. « Chauve-souris soit, qui mal y pense ? »
- Sow A., Seye D., Faye E., Benoit L., Galan M., Haran J., Brévault T. 2020. “Birds and bats contribute to natural regulation of the millet head miner in tree-crop agroforestry systems” in Crop Protection, 132:105127, 8 p. (enkel in het Engels)
- Vercayie D., Paquet A., Feys S., Willems W. & PaquET J-Y. 2020. « Zoogdierenatlas van het Brussels Gewest. 2001-2017 », rapport Natuurpunt Studie 2017/39 réalisé pour le compte de Bruxelles Environnement, Mechelen.
Plans et programmes
- Plan régional nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale, 2016 (.pdf)
- Stratégie pour les insectes pollinisateurs et auxiliaires en Région de Bruxelles-Capitale 2023-2030, 2022 (.pdf)
Liens
Les Amphibiens et Reptiles en Région bruxelloise
Focus - Actualisation : janvier 2022
Le premier atlas des Amphibiens et Reptiles (2005) a fait le constat d’un déclin généralisé des espèces indigènes : six espèces auparavant présentes (sur 14) n’avaient pas pu être observées et étaient considérées comme localement éteintes. Le second atlas, réalisé une dizaine d’années plus tard, confirme ce constat, puisque, à une exception près, aucune de ces espèces n’a pu être retrouvée, et ce, malgré une augmentation importante des connaissances. Le phénomène de l’installation d’espèces exotiques ou d’espèces venant du sud de la Belgique, déjà mis en évidence dans le premier atlas, s’est encore amplifié. Par rapport au premier atlas, le nombre d’espèces d’Amphibiens observées par km2 a plus que doublé et de nouveaux sites intéressants ont été identifiés.
Des espèces menacées
Les Amphibiens présents sous nos latitudes sont les grenouilles, crapauds, tritons et salamandres. L’eau est cruciale pour ces espèces car leurs œufs sont dépourvus de coquille et les jeunes larves qui en sortent vivent exclusivement dans l’eau où se déroule leur métamorphose. Les Amphibiens adultes mènent en général une vie surtout terrestre dans des milieux frais et abrités et sont aquatiques au moment de la reproduction.
Ces espèces sont très vulnérables du fait qu’elles dépendent de conditions écologiques variées, en particulier de la présence de milieux aquatiques et terrestres adéquats et proches, voire très proches, l’un de l’autre. Les populations d'Amphibiens connaissent une régression dramatique partout dans le monde en raison notamment de la pollution, de la diffusion de maladies infectieuses (mycoses) et de la raréfaction et fragmentation de leur habitat.
Les Amphibiens jouent pourtant un rôle écologique important dans nos écosystèmes notamment parce qu’ils constituent un maillon important de la chaine alimentaire en tant que prédateurs et/ou proies.
Bon à savoir
Les Amphibiens n’ont pas besoin de boire car l’eau est absorbée directement par leur peau.
En vertu de l ‘ordonnance Nature, toutes les espèces européennes d'Amphibiens et Reptiles sont protégées sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Un nouvel atlas des Amphibiens et Reptiles réalisé avec l’appui des citoyens
Dans le cadre du programme d’information et de surveillance de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). bruxelloise, un premier atlas des Amphibiens et Reptiles portant sur la période 1984-2003 a été réalisé. Au cours des années suivantes, les populations de Grenouilles vertes et de Salamandres terrestres ont fait l’objet d’études spécifiques.
Fin 2016, Bruxelles Environnement a lancé un nouveau grand recensement des Amphibiens et Reptiles sauvages, en collaboration avec les associations naturalistes Natagora et Natuurpunt. Ce projet s’est déroulé sur une période de 3 ans (entre 2016 et 2019) mais a intégré l’ensemble des données collectées entre janvier 2004 et septembre 2019.
L’élaboration de ce nouvel atlas s’est appuyée sur la participation de volontaires qui, en communiquant leurs observations, ont contribué dans une grande mesure à la constitution de la base de données (projet de « sciences citoyennes » ou « citizen science », voir fiche documentée sur les Mammifères et « Collecte de données sur la biodiversité bruxelloise par les citoyens –crowdsourcing »). Différentes actions ont été menées afin de mobiliser et former ces volontaires (page Internet, formations, guides techniques, etc.). Les participants ont été invités à encoder leurs observations et photographies sur le site d’encodage en ligne « Observations.be ». Ces données ont été ensuite validées par plusieurs experts.
De plus amples informations concernant la méthodologie d’inventaire figurent dans la fiche documentée consacrée aux Amphibiens et Reptiles de la Région bruxelloise ainsi que dans l’atlas .
Les espèces exotiques telles que les tortues, introduites délibérément ou non (animaux échappés de captivité) sur le territoire régional, ont également été prises en compte dans l’inventaire si leur présence dans la nature a été constatée durablement, qu’elles s’y reproduisent ou non.
Concernant la problématique des introductions, les auteurs de l’atlas ont distingué :
- Les espèces indigènes dont la présence dans la Région bruxelloise est le résultat de processus naturels, sans intervention humaine.
- Les espèces néo-indigènes qui sont des espèces introduites, délibérément ou non, mais qui sont présentes naturellement au maximum à quelques dizaines de km de Bruxelles. Les espèces éteintes à l’état indigène mais qui sont présentes sur le territoire concerné sous forme de populations introduites non officiellement peuvent rentrer dans cette catégorie.
- Les espèces exotiques qui sont des espèces introduites, délibérément ou non, et dont l’aire d'origine est distincte et éloignée de la Région bruxelloise.
8 espèces indigènes ou néo-indigènes d’Amphibiens ont été observées et 4 espèces sont considérées éteintes en Région bruxelloise
Sur les 12 espèces d’Amphibiens historiquement présentes en Région bruxelloise, 8 sont encore actuellement présentes dont l’une (Alyte accoucheur) sous forme de populations réintroduites (espèce néo-indigène). Les populations de Crapauds calamites, Tritons crêtés, Grenouilles de Lessona et Rainettes vertes ont disparu depuis plus de 30 ans et sont considérées comme régionalement éteintes. Notons que si la présence historique des Crapauds calamites, Tritons crêtés et Rainettes vertes en Région bruxelloise est bien établie, il subsiste un doute quant à celle de la Grenouille de Lessona.
Le tableau ci-dessous reprend les espèces d’Amphibiens indigènes et exotiques observées en Région bruxelloise ainsi que leur statut.
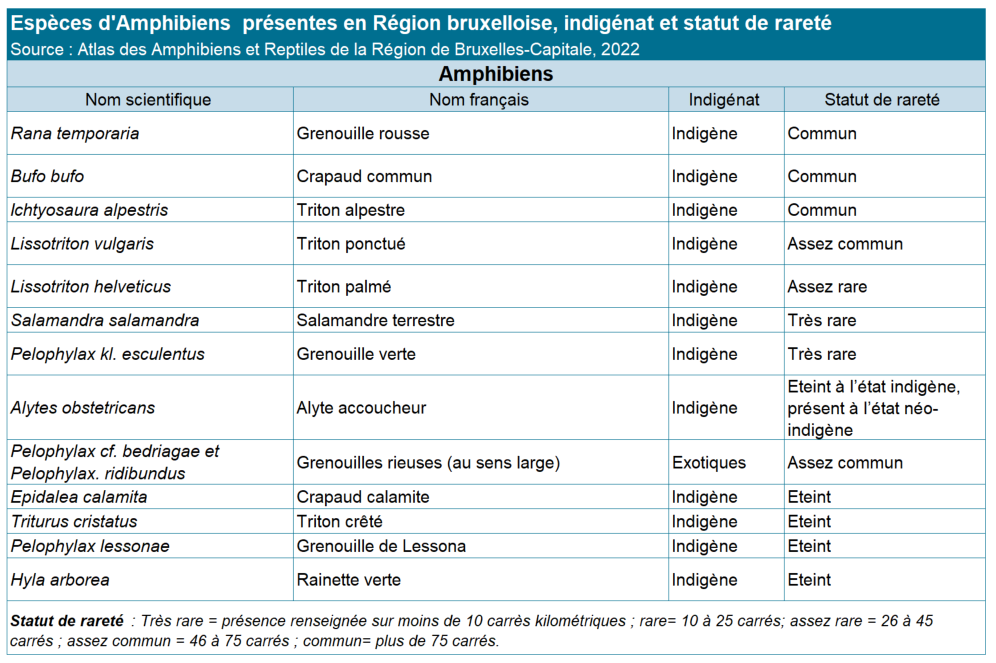
L’atlas des Amphibiens et Reptiles reprend pour chaque espèce inventoriée une fiche descriptive incluant la répartition de l’espèce, son habitat, son abondance et les mesures de gestion nécessaires pour assurer sa conservation. Le lecteur peut aussi se reporter aux info-fiches disponibles dans la bibliothèque en ligne.
Le Crapaud commun et la Grenouille rousse sont les espèces d’Amphibiens les plus souvent observées et les plus répandues
Le Crapaud commun et la Grenouille rousse sont les espèces d’Amphibiens les plus souvent observées au cours de la période 2004-2019. Elles sont suivies par les tritons alpestres et ponctués. En termes de nombre de carrés kilométriques où la présence des espèces a été renseignée, la Grenouille rousse arrive en tête avec 103 carrés (sur un total de 200 carrés couvrant totalement ou en partie la région), suivie par le Crapaud commun (91) ainsi que par les Tritons alpestre (81) et ponctué (56).
La Salamandre terrestre et la Grenouille verte sont des espèces très rares en Région bruxelloise. Les populations de Salamandres sont exclusivement localisées en forêt de Soignes, dans les parties supérieures des vallons du Vuylbeek et du Karregat, où elles forment une population isolée. Leur densité est faible par rapport à d’autres populations de Flandre (Van Doorn, 2020 ). La présence de la salamandre en forêt de Soignes est connue depuis plus d’un siècle mais les observations de l’espèce resteront très rares au cours du 20ème siècle.
Une moyenne de 2,3 espèces d’Amphibiens par carré kilométrique recensées pour la période 2004-2019, soit plus du double que lors de l’atlas précédent
La carte ci-dessous illustre le nombre d’espèces d’Amphibiens observées par carré kilométrique au cours de la période 2004-2019 :
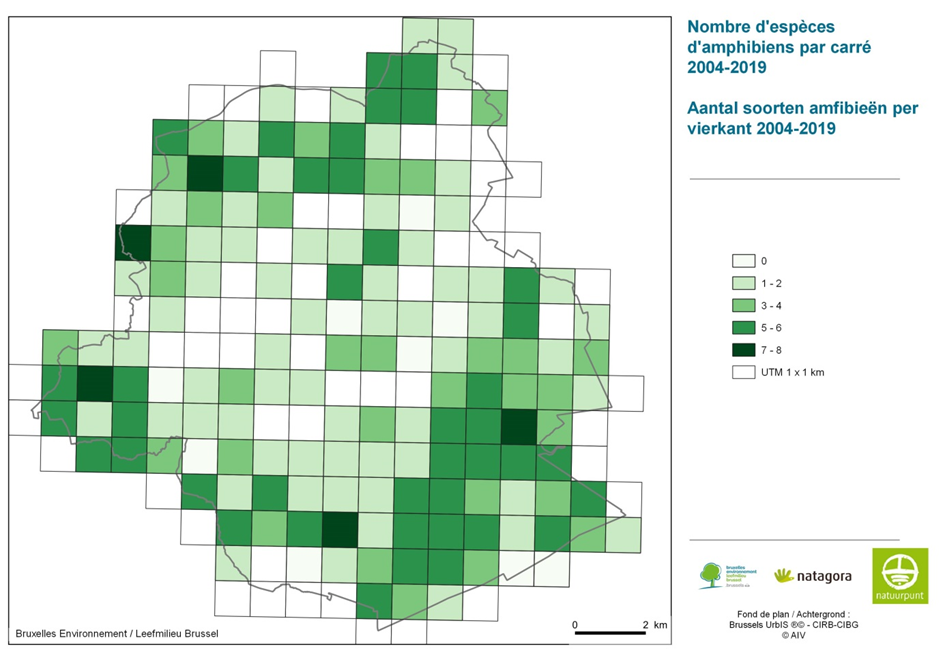
Des Amphibiens ont été trouvés dans 70% des carrés kilométriques. Bien que le nombre d’observations par carrés diminue vers le cœur de la ville, des Amphibiens sont aussi présents dans le centre très bâti. Il s’agit d’espèces indigènes (souvent introduites dans le centre-ville) et d’espèces exotiques (Grenouilles rieuses au sens large).
Les carrés kilométriques les plus riches de la Région (jusqu’à 8 espèces) sont situés en périphérie et correspondent aux étangs et cours d’eau du Rouge cloître, du Geleytsbeek, du Neerpedebeek et du Molenbeek (avec entre autres, le marais de Jette et Ganshoren). D’autres sites se révèlent également très riches notamment le long de la vallée de la Woluwe et de ses affluents, le long du Vogelzangbeek, dans le Domaine Royal ou encore à Neder-Over-Hembeek au-delà de l’hôpital militaire et dans le vallon du Tweebeek.
Par rapport au précédent atlas, on constate une augmentation importante du nombre d’espèces d’Amphibiens renseignées par carré kilométrique. Alors qu’en moyenne une espèce par carré était renseignée pour la période 1984-2003, une moyenne de 2,3 espèces par carré est renseignée pour la période 2004-2019.
Les découvertes les plus notables concernent :
- toute la partie nord de la Région : notamment Neder-Over-Heembeek et vallon du Tweebeek (marécages, zones humides…), Laeken, Jette (parc Roi Baudouin), Molenbeek (Scheutbos) ;
- l’extrême ouest : tout l’ouest de la commune d’Anderlecht mais aussi le parc du Bempt à Forest;
- le tiers sud-est du territoire : différents secteurs de la forêt de Soignes et ses abords, le parc du Bergoje, le parc de Woluwe,…
- quelques carrés du centre-ville qui abritent des sites qui n’avaient pas été prospectés lors du premier atlas tel que le parc Josaphat et le parc du Botanique.
Si cette amélioration s’explique par des efforts de prospection supérieurs lors du second atlas, elle est certainement aussi partiellement liée aux actions menées au niveau régional pour restaurer des milieux plus naturels, notamment via le programme de maillage bleuLe Maillage bleu est un programme mis en œuvre depuis 1999, qui vise plusieurs objectifs : séparer les eaux usées des eaux propres afin de limiter l'apport d'eau aux stations d'épuration, restaurer certains éléments du réseau hydrographique de la Région, réaménager des tronçons de rivières, des étangs et des zones humides pour leur rendre toute leur valeur biologique, et leur faire éventuellement bénéficier de mesures spéciales de protection, et assurer la fonction paysagère et récréative de ces sites. (voir fiche documentée sur le sujet) ainsi qu’à l’amélioration globale de la qualité des eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.).
La Grenouille rieuse : une espèce exotique dont la présence a fortement progressé en Région bruxelloise
Le groupe des Grenouilles « vertes » et « rieuses » (genre Pelophylax) est composé de plusieurs taxons dont certains sont susceptibles de s’hybrider entre eux. La Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) est ainsi un hybride entre la Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae) et la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus). Les deux premières sont indigènes en Belgique, contrairement à la troisième. Leur détermination peut être délicate en raison de la similitude entre certains de ces taxons et du fait de variations au sein d’un même taxon. A ces problèmes de détermination, s’ajoute celui des introductions : le groupe des « Grenouilles rieuses » comprend en fait plusieurs espèces, toutes exotiques, dont plusieurs ont été signalées à Bruxelles et dont la détermination n’est pas aisée sur le terrain. Au moins deux de ces espèces, la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) et la Grenouille rieuse d’Anatolie (Pelophylax cf. bedriagae), sont présentes avec certitude sur le territoire régional.
Au cours de la période couverte par le second atlas, des grenouilles du genre Pelophylax ont été signalées à plusieurs endroits à Bruxelles. Dans la majorité des cas, l’examen des photos a montré qu’il s’agissait de Grenouilles rieuses. Néanmoins, pour la période 2004-2019, la présence de Grenouilles vertes a pu être validée au niveau de deux sites (marais de Jette-Ganshoren et sud d’Anderlecht). Il s’agit d’une bonne nouvelle puisque cette espèce n’avait pas pu être recensée lors du précédent atlas et était considérée comme avoir disparu localement (les dernières observations ayant été faites dans les années ‘90 au Moeraske et dans certains étangs de Boitsfort). Selon les auteurs de l’atlas actuel, il est néanmoins très vraisemblable que les individus observés soient issus de populations indigènes passées inaperçues lors du précédent atlas.
Les Grenouilles rieuses comptent actuellement parmi les Amphibiens les plus répandus à Bruxelles et sont les seuls Amphibiens non-indigènes pour lesquels la naturalisation est établie dans la Région. Elles constituent aussi le groupe d’espèces qui, parmi les Amphibiens et Reptiles, connait la plus forte progression entre les deux atlas. Avant 2004, les Grenouilles rieuses avaient été observées dans 13 carrés kilométriques. Depuis lors, elles ont été répertoriées dans 46 carrés kilométriques couvrant plusieurs communes. Cette augmentation du nombre de sites connus est certainement due en partie à une meilleure connaissance de la répartition mais il est également vraisemblable que les Grenouilles rieuses, dont les premières mentions à Bruxelles remontent seulement à 1992, aient colonisé certains secteurs de la ville au cours des dernières années.
La Grenouille rieuse figure dans la liste des espèces invasives de l’Ordonnance nature. Les craintes liées à sa présence dans nos écosystèmes sont dues à son caractère invasif (plusieurs pontes par an, importante capacité de dispersion, espèce pionnière, taille plus importante que les grenouilles vertes indigènes, sortie hâtive d’hibernation… ) mais aussi au fait que cette espèce est capable de s’hybrider avec les Grenouilles vertes indigènes avec le risque d’un remplacement du génome des Grenouilles vertes locales par celui des Grenouilles rieuses. L’impact de ces grenouilles exotiques sur la faune indigène est cependant peu connu.
4 espèces indigènes ou néo-indigènes de Reptiles ont été observées
La Région bruxelloise compte 2 espèces indigènes de reptiles : l’Orvet fragile et le Lézard vivipare. Ces espèces sont peu répandues et localisées principalement en forêt de Soignes ainsi que sur quelques autres sites.
Le Lézard des murailles et la Couleuvre à collier, présents actuellement dans la Région, sont considérés comme des espèces néo-indigènes dans la mesure où leur aire de répartition naturelle se situe au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Depuis les années 1990, des populations de Lézards des murailles introduites se répandent au nord de ce sillon, le plus souvent le long des voies de chemin de fer. On trouve désormais cette espèce dans toute la Flandre et dans le nord de la Wallonie. En Région bruxelloise, la présence de ce lézard est attestée dans les principales zones ferroviaires et industrielles de la Région qui offrent un habitat lui convenant (présence de milieux ouverts, terrain secs avec présence de pierres, etc.). Notons que le Lézard des murailles est une espèce qui, en vertu du droit européen (directive Habitats), doit faire l’objet d’une protection stricte et qui, à ce titre, fait l’objet d’un suivi spécifique (voir focus Etat local de conservation des espèces couvertes par les directives "Habitats" et "Oiseaux" )
Une seule population de Couleuvres à collier est présente à Bruxelles, dans les marais de Jette-Ganshoren et ses abords. Cette population introduite est totalement isolée, les populations connues les plus proches, également introduites, étant situées à environ 40 km.
Le tableau ci-dessous reprend les espèces de Reptiles indigènes et exotiques observés en Région bruxelloise ainsi que leur statut.
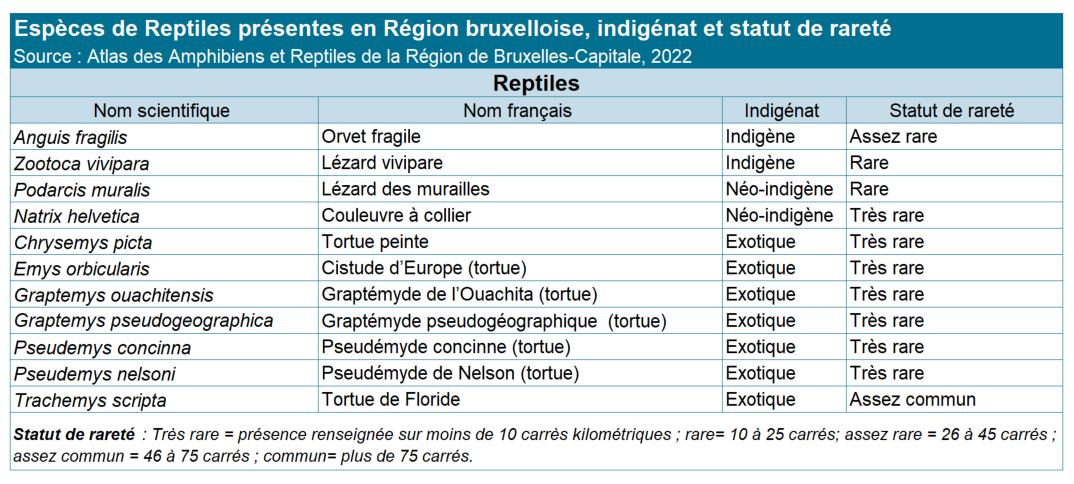
Différentes espèces de tortues résultant d’introduction sont présentes dans la Région et font l’objet de nombreuses observations. Avec de l’ordre de 600 observations sur la période 2004-2019, la Tortue de Floride est ainsi le reptile le plus répandu à Bruxelles. Cette espèce est aujourd’hui présente dans de nombreuses zones humides et étangs bruxellois, y compris en lisière de forêt de Soignes.
Dans les premières années de leur vie, les Tortues de Floride sont de voraces carnivores se nourrissant d’organismes aquatiques. Les adultes sont surtout végétariens mais peuvent également s’attaquer à des poissons, des amphibiens et des poussins d’oiseaux d’eau. Les dégâts que leur présence occasionne dans les milieux biologiquement riches peuvent donc s’avérer problématiques. Le climat prévalant en Région bruxelloise n’est pas (encore) assez chaud pour permettre la réussite de la reproduction mais des cas de reproduction de tortues aquatiques d’Amérique du Nord ont déjà été constatés en France notamment.
Pour plus d’informations concernant la problématique des espèces invasives (y compris des tortues exotiques), voir le sujet « Espèces exotiques envahissantes » de la rubrique « Environnement : état des lieux » du site de Bruxelles Environnement.
Des espèces indigènes d’Amphibiens dont la disparition se confirme
Le premier atlas des Amphibiens et Reptiles faisait le constat d’un déclin généralisé des espèces indigènes. En particulier six espèces indigènes historiquement signalées dans la capitale étaient considérées comme éteintes. Le présent atlas confirme ce constat, puisque, à une exception près (la grenouille verte), aucune des espèces considérée comme éteinte n’a pu être retrouvée, et ce, malgré une augmentation importante des connaissances au cours des 15-20 dernières années.
Et des espèces néo-indigènes ou exotiques de plus en plus nombreuses
Le phénomène de l’installation récente d’espèces étrangères à la faune bruxelloise, déjà mis en évidence dans le premier atlas, s’est récemment amplifié. Il concerne, d’une part, l’apparition récente d’espèces néo-indigènes ainsi que, d’autre part, la multiplication et l’expansion d’espèces exotiques, en particulier de diverses tortues aquatiques non naturalisées ainsi que des Grenouilles rieuses et d’Anatolie.
Des mesures de gestion en faveur des Amphibiens et Reptiles à poursuivre et renforcer
La Région bruxelloise subit la même tendance que d’autres régions d’Europe occidentale : une diminution des populations, tant pour les espèces fortement menacées que pour les espèces plus communes. La raréfaction et la fragmentation des habitats adéquats aquatiques et terrestres, par assèchement ou voûtement, sont les principales causes historiques de cette régression. L’urbanisation croissante, dont la construction intense et une voirie de plus en plus dense, menace aujourd’hui les habitats des Amphibiens et Reptiles. Raison pour laquelle des mesures sont prises afin de protéger et de restaurer les habitats : remise à ciel ouvert de cours d’eau voûtés, aménagement de mares, restauration de zones humides dégradées, réalisation de berges écologiques, reconnexion des zones humides entre elles, retrait des poissons de certains plans d’eau, le maintien de clairières favorables aux Reptiles en forêt, réalisation de crapauducs (encore rares) ou encore, mesures spécifiques en faveur de certaines espèces comme la Salamandre terrestre. Par ailleurs, en période de migration, des associations de protection de la nature organisent des opérations de sauvetage des Amphibiens sur les routes.
À télécharger
Fiches documentées
- 05. Les Amphibiens et Reptiles en Région bruxelloise (.pdf) (2022)
- 18. Etat local de conservation des espèces des directives habitats et oiseaux en Région Bruxelloise (.pdf) (2018)
Fiches de l’Etat de l’Environnement
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Rapport sur l’état de la nature en Région de Bruxelles-capitale (2012) (.pdf)
- Identification des espèces : Amphibiens et Reptiles en Région de Bruxelles-Capitale (.pdf)
- Le Lézard des murailles (info fiche-biodiversité) (.pdf)
- Le Lézard vivipare (info fiche-biodiversité) (.pdf)
- La Grenouille verte (info fiche-biodiversité) (.pdf)
- La Grenouille rousse (info fiche-biodiversité) (.pdf)
- L’Alyte accoucheur (info fiche-biodiversité) (.pdf)
- La Couleuvre à collier (info fiche-biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore).) (.pdf)
- Le Crapaud commun (info fiche-biodiversité) (.pdf)
- La Grenouille rieuse européenne (info fiche-biodiversité) (.pdf)
- L’Orvet (info fiche-biodiversité) (.pdf)
- La Salamandre tachetée (info fiche-biodiversité) (.pdf)
- Le Triton alpestre (info fiche-biodiversité) (.pdf)
- Le Triton palmé (info fiche-biodiversité) (.pdf)
- Le Triton ponctué (info fiche-biodiversité) (.pdf)
Etudes et rapports
- GRAITSON E, PAQUET A. & VERBELEN D. 2022 « Atlas des Amphibiens et Reptiles de la Région de Bruxelles-Capitale », rapport effectué par Natagora, Natuurpunt à la demande et avec Bruxelles Environnement (.pdf)
- JOORIS R. 2007 « Inventarisaite amfibieën en reptielen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", Natuurpunt (.pdf) (uniquement en néerlandais)
- VAN DOORN L. 2020. « The Fire Salamander in the Brussels-Capital Region", monitoring Report 2020
- VAN DOORN L & WELLEKENS B. 2017. « The Fire Salamander in the Brussels-Capital Region - Present and Future", Monitoring Report 2009-2017
- VERBELEN D. & GRAITSON E., 2017. « Handleiding inventarisatie Amfibieën en Reptielen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", Natuurpunt & Natagora
- WEISERBS A. & JACOB J.-P. 2005. « Amphibiens et Reptiles de la Région de Bruxelles-Capitale - Atlas 2005», Aves & Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement
Plans et programmes
Liens utiles
Les abeilles en Région bruxelloise
Focus – Actualisation : février 2023
Plusieurs études ont été menées ces dernières années pour améliorer les connaissance de l’état des populations d’abeilles sauvages et domestiques présentes en Région bruxelloise et identifier les mesures de préservation et de restauration favorables aux insectes pollinisateurs. 206 espèces d’abeilles sauvages ont été observées entre 2010 et 2020, soit un peu plus de la moitié du nombre d’espèces présentes à l’échelle nationale. 40% d’entre elles sont vulnérables ou en danger. L’abeille mellifère (ou domestique) est la 3ème espèce la plus souvent recensée et s’observe dans l’ensemble de la Région. Parmi les facteurs de stress identifiés pour les abeilles sauvages figurent les risques de compétition exercés par les abeilles mellifères ainsi que la présence de résidus de pesticides dans le pollen et le nectar butinés par les abeilles. Les données disponibles suggèrent que l’abeille mellifère n’est pas menacée en Région de Bruxelles-Capitale.
Importance des abeilles pour les écosystèmes naturels et agricoles
Les abeilles sont des insectes pollinisateurs. En visitant des fleurs, principalement pour collecter du pollen (source de protéines) et du nectar (source de sucres), elles transfèrent du pollen entre les parties mâles et femelles des fleurs, assurant ainsi leur fertilisation et la production de graines. Les abeilles ne sont pas les seuls animaux qui transportent du pollen mais leurs comportements de butinage et certaines de leurs caractéristiques morphologiques rendent leur pollinisation particulièrement performante.
En Europe, environ 80% des espèces cultivées et des espèces de plantes à fleurs sauvages dépendent, au moins en partie, de la pollinisation animale prodiguée par des milliers d'espèces d'insectes (Commission européenne, 2023). En pollinisant les espèces de plantes sauvages et cultivées, les insectes participent à la diversité floristique et paysagère ainsi qu’à la production agricole. Concernant ce dernier point, au niveau belge, des chercheurs ont évalué qu’en cas de disparition des pollinisateurs, la valeur de la perte de production (cultures fruitières et oléagineuses en particulier) s’élèverait, pour 2010, à 11,1 % de la valeur totale de la production végétale belge (Jacquemin F. et al., 2017).
Bon à savoir
Les bourdons et certaines espèces d’abeilles solitaires utilisent une technique de pollinisation spéciale : la « buzz-pollinisation » ou pollinisation vibratile. Pour décrocher le pollen de certaines plantes, ces espèces sont capables d'agripper les fleurs et de mouvoir rapidement leurs ailes, faisant vibrer toute la fleur. Ce bourdonnement participe activement à la chute du pollen, qui est plus ou moins fermement retenu par certaines fleurs (tomates, pommes-de-terre, aubergines, poivrons, piments, etc.) et qui tombe notamment sur leur corps.
De l’ordre de 40 % des espèces d’insectes seraient menacées d’extinction à l’échelle globale (Sanchez-Bayo & Wyckhuys, 2019). Le déclin des pollinisateurs - évalué notamment par l’IPBES (2016) - menace directement la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., les paysages, l’alimentation (quantité et qualité de la nourriture produite) ainsi que la qualité de vie et la santé humaine (cf. notamment impacts sur la production de fruits, légumes, fibres, plantes médicinales et aromatiques et sur la qualité de l’environnement naturel, importance culturelle).
Ces constats ont amené différents niveaux de pouvoir à adopter des initiatives ou plans d’action en faveur des pollinisateurs. En Région bruxelloise, une stratégie pour les insectes pollinisateurs et auxiliaires a été adoptée fin 2022. Celle-ci s’appuie notamment sur les connaissances acquises via différentes études menées depuis une dizaine d’années concernant les abeilles sauvages présentes sur le territoire bruxellois, en tenant compte des particularités urbaines et des pressions qui s’y exercent.
Ce focus synthétise les principales conclusions et résultats des travaux menés sur le sujet. Il fait également état des principales données régionales disponibles sur les populations d’abeilles domestiques ou mellifères (Apis mellifera) - c’est-à-dire les abeilles élevées par des apiculteurs -, à l’exclusion des données spécifiquement associées aux compétences fédérales (état sanitaire des colonies, etc.). La question de la cohabitation entre l’abeille mellifère et les abeilles sauvages, sujet de préoccupation récurrent sur le territoire régional, y est également abordée. Enfin, la récente stratégie régionale pour les insectes pollinisateurs et auxiliaires est brièvement présentée.
Un atlas des abeilles sauvages bruxelloises basé sur 42.280 données d’observation validées
Le premier atlas des abeilles sauvages de la Région de Bruxelles-Capitale (projet WildBnB) a été publié en 2022. Différents acteurs de terrain ont contribué à sa réalisation: l’Agroecology Lab de l’ULB, Natuurpunt et Natagora (associations naturalistes) ainsi que l’Institut Royal des Sciences Naturelles (IRScNB.). Le projet s’est s’appuyé sur des observations issues de travaux d’inventaires réalisés par des entomologistes ainsi que sur des données issues des sciences participatives (voir focus Collecte de données sur la biodiversité bruxelloise par les citoyens « crowdsourcing »).
Une base de données centralisée a rassemblé des données historiques digitalisées (1841-1990), des données de l’IRScNB (1991-2018), du site observations.be, de Natuurpunt (2007-2020), de l’ULB (2015-2020) ainsi que du projet WildBnB lui-même (2018-2020). 42.280 données d’observation représentatives de l’ensemble du territoire bruxellois ont pu être validées (pour 112.508 spécimens observés ou récoltés).
Près de 40% des 206 espèces d’abeilles sauvages présentes actuellement en Région bruxelloise sont vulnérables ou en danger
La présence de 248 espèces d’abeilles sauvages sur le territoire régional a pu être documentée (période 1841-2020). La 249ème espèce bruxelloise est constituée par Apis mellifera, l’abeille mellifère, dite domestique.
Parmi ces 248 espèces, 17% (soit 42 espèces) sont considérées comme éteintes à l’échelle régionale. Elles n’ont en effet plus été retrouvées dans les recherches de terrain menées entre 2010 et 2020. Ces espèces régionalement éteintes incluent 15 espèces de bourdons. Ce groupe d’abeilles sociales est particulièrement impacté en Belgique où 60% des espèces de bourdons sont menacées ou quasi menacées et environ 20% éteintes à l’échelle nationale (Drossart et al., 2019).
Distribution des 248 espèces d’abeilles sauvages (excl. Apis mellifera) de la Région de Bruxelles-Capitale selon les catégories de statut de conservation régional (période 1841-2020)
Source : Vereecken et al., 2022
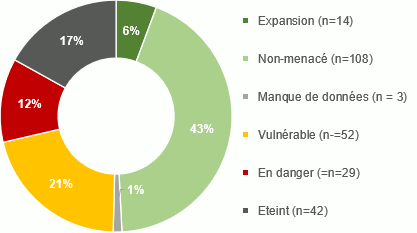 Parmi les 206 espèces encore présentes, 122 sont estimées dans une situation favorable (non menacées ou en expansion) et 81 dans une situation défavorable (vulnérables ou en danger). Les espèces en expansion sont, dans la plupart des cas, des observations isolées d’espèces qui n’avaient jamais été observées dans les données historiques.
Parmi les 206 espèces encore présentes, 122 sont estimées dans une situation favorable (non menacées ou en expansion) et 81 dans une situation défavorable (vulnérables ou en danger). Les espèces en expansion sont, dans la plupart des cas, des observations isolées d’espèces qui n’avaient jamais été observées dans les données historiques.
Les 206 espèces d’abeilles sauvages contemporaines de la Région bruxelloise correspondent à 54% des espèces présentes en Belgique. Les 6 familles d’abeilles présentes en Belgique sont également observées sur le territoire régional.
L’abondance des espèces bruxelloises est très variable: 8 espèces représentent à elles seules 61% des données. Inversement, 38 espèces n’ont été observées qu’une ou deux fois sur l’ensemble de la période étudiée.
Rang d’abondance des espèces d’abeilles observées en Région bruxelloise et illustration du « top 8 » (nombre de spécimens observés, base de données WildBnB, données 1841-2020)
Source : Vereecken et al., 2022
Lire le texte de transcription
Les 8 espèces d’abeilles qui ont été le plus observées dans le cadre de la réalisation de l’atlas, par ordre de nombre de spécimens observés, sont : Andrena vaga (Andrène vague), Colletes hederae (Collète du lierre), Apis mellifera (Apis mellifère), Bombus pascuorum (Bourdon des champs), Colletes cunicularius (Collète lapin), Bombus lapidarius (Bourdon des pierres), Andrena flavipes (Andrène à pattes jaunes), Andrena bicolor (Andrène bicolore)
Cette importante diversité des espèces d’abeilles combinée à une abondance souvent faible des populations pourrait s’expliquer par l’importante variété d’habitats de taille réduite qui caractérise la Région bruxelloise.
L’abeille mellifère est la 3ème espèce la plus souvent recensée et la 249ème espèce d’abeille bruxelloise. Cette espèce est observée dans l’ensemble de la Région, tant dans le centre-ville que dans des zones plus sensibles comme des zones Natura 2000. Le nombre et la localisation exacts des ruchers et des colonies de production restent à ce jour méconnus. Les estimations annuelles disponibles grâce aux apiculteurs suggèrent cependant que l’abeille mellifère ne représente pas d’enjeu de conservation pour la Région de Bruxelles-Capitale. A contrario, plusieurs études soulignent l’intérêt de préserver sa sous-espèce indigèneDésigne une espèce originaire de la région où elle se trouve depuis des décennies., l’abeille noire (Apis mellifera mellifera).
La friche Josaphat, l’un des sites de Belgique le plus riche en espèces d’abeilles
Des inventaires plus détaillés ont été effectués sur 3 sites dont la fricheZone de terrain laissée à l'abandon et progressivement colonisée par la végétation spontanée. Josaphat (Schaerbeek-Evere). 127 espèces d’abeilles sauvages y ont été inventoriées. Parmi ces espèces observées, 9 sont menacées d’extinction à l’échelle nationale (Drossart et al., 2019) ou européenne (Nieto et al., 2004). Pour le territoire bruxellois, 4 d’entre elles sont également exclusives de la friche et ne se retrouvent dans aucun autre site inventorié. L’intérêt écologique du site pour les abeilles sauvages est donc similaire à celui pour les Odonates (voir le focus Libellules et demoiselles en Région bruxelloise). Pour de plus amples informations, voir l’article de Vereecken et al. 2021 sur le sujet.
Une étude spécifique pour la préservation des abeilles du Kauwberg
Le site Natura 2000 du Kauwberg (Uccle), repris en gestion il y a quelques années par Bruxelles Environnement, est lui aussi réputé pour être riche en abeilles sauvages.
Différentes études y ont été menées pour caractériser les mesures à mettre en place afin de concilier au mieux préoccupations écologiques, développement des activités agricoles et accueil récréatif. Parmi celles-ci, une étude d’identification des espèces d’abeilles sauvages présentes sur le site a été réalisée. 95 espèces d’abeilles sauvages y ont été recensées (2020-2021) dont 15 espèces ayant des statuts de conservation menacés (Liste rouge établie au niveau national). Par ailleurs des recommandations de gestion en faveur des abeilles sauvages ont été formulées : flore spécifique à privilégier, ouverture du milieu, mise en défens d’une sablière permettant de faire cohabiter les abeilles terricoles qui y nichent et des activités ludo-sportives (glissades, VTT, etc.). …
Des trottoirs accueillants pour les abeilles et autres pollinisateurs
En ville, il n’est pas rare de trouver des nids d’abeilles sauvages, voire des bourgades de nids (regroupements de nids individuels), dans les trottoirs et allées pavées (Pauly, 2019).
Le centre de recherches routières s’est associé avec un service universitaire pour déterminer les conditions favorables à la nidification des abeilles en voirie. Cette étude a notamment permis de répertorier 11 espèces d’abeilles solitaires, 10 espèces de guêpes et 2 espèces de chrysides. L’étude a également mis en évidence une divergence entre les préférences des abeilles sauvages nidifiant dans les trottoirs (non jointoyés, souvent anciens et dégradés) et les exigences de confort piéton fixées par le plan régional Good Move. L’étude propose cependant des mesures qui permettraient de concilier ces exigences sociétales et la conservation de ces insectes pollinisateurs.
Des résidus de pesticides dans le pollen…
Dans le cadre du projet URBEESTRESS visant à étudier différents facteurs de stress susceptibles d’impacter les populations d’abeilles sauvages en Région bruxelloise, les traces de pesticides (fongicides, herbicides, insecticides) présentes dans les mélanges de pollen rassemblés par les femelles d’osmies (espèces d’abeilles au comportement alimentaire généraliste et bien adaptées au milieu urbain) au niveau d‘une cinquantaine de sites ont été analysées. Il en ressort notamment que près de 90% des échantillons de pollen analysés contiennent un ou plusieurs pesticides. 9 pesticides différents ont été identifiés dont 3 désormais interdits. Les pesticides dominants sont le fongicide Boscalid et l’insecticide/acaricide Chlorpyrifos qui, à eux seuls, représentent près de 75 % des pesticides retrouvés dans les échantillons.
La présence de ces pesticides, dont certains sont connus pour leur très forte rémanence notamment dans les sols et leur toxicité sur un large spectre d’animaux et de plantes, pose question par rapport à leurs impacts sur les abeilles - et, plus généralement, sur les écosystèmes - et la santé des Bruxellois.
Et dans les plantes ornementales vendues en jardinerie
L’étude Toxiflore a caractérisé et quantifié les résidus de pesticides se trouvant dans les plantes ornementales. Les plantes étudiées sont largement utilisées pour fleurir jardins et espaces publics et réputées attractives pour les abeilles.
Il en ressort que :
- 100 % des échantillons prélevés dans les feuilles, les fleurs ou le pollen de muscaris et bruyères issus de 4 jardineries distinctes étaient contaminés par au moins un résidu de pesticide, avec en moyenne 3 à 4 substances différentes par échantillon pour un total de 28 substances actives différentes, dont 7 interdites pendant la phase d’étude et 4 autres interdites depuis (dispositif expérimental avec 4 serres fermées contenant chacune des plantes issues des mêmes jardineries et des hôtels à abeilles);
- 36 substances actives différentes, dont 2 interdites, ont été identifiées dans les échantillons prélevés directement dans des plantes horticoles installées dans des espaces verts bruxellois (situation réelle).
Ces résultats suggèrent que les plantes horticoles installées dans les espaces verts publics et privés constituent potentiellement une source importante d’exposition des insectes pollinisateurs, en particulier des abeilles, à des cocktails de pesticides. Bien que moins contaminées, les plantes issues de pépinières écologiques ne sont pas exemptes de substances, probablement liées à l’origine des bulbes mis en culture. Compte tenu de ces résultats, l’étude préconise de favoriser les plantations issues de filières de production durables et écologiques.
L’abeille domestique est une espèce particulièrement compétitive
Le projet URBEESTRESS a également analysé les réseaux d’interaction plantes-pollinisateurs et la compétition entre espèces pollinisatrices d’abeilles. Les résultats indiquent que l’abeille domestique ou mellifère (Apis mellifera) est omniprésente dans les réseaux abeilles-fleurs sur tout le territoire régional, avec une intensité et une compétition apparente pour les ressources (pollen et nectar) plus forte dans certains sites, notamment dans les zones les plus urbanisées.
Par ailleurs, les données à l’échelle régionale indiquent que les abeilles sociales et généralistes (abeilles domestiques et, dans une moindre mesure, bourdons), sont les espèces qui imposent le plus de compétition aux autres pollinisateurs, et qui en subissent en retour relativement peu de la part des espèces solitaires. Ces résultats permettent raisonnablement d’estimer que la pratique de l’apiculture urbaine induit effectivement une compétition apparente en Région bruxelloise et impacte les réseaux de pollinisation sur tout le territoire régional (voir ci-dessous).
Une forte abondance d’abeilles domestiques peut représenter une pression environnementale supplémentaire pour les abeilles
Pour les abeilles sauvages, le milieu urbain cristallise différents problèmes. Tout d’abord, la collecte du pollen et du nectar y nécessite souvent une plus grande dépense énergétique que dans les territoires ruraux. Les ressources alimentaires, en plus d’être globalement limitées en quantité, y sont spatialement fragmentées (y compris via des obstacles bâtis à contourner). En outre, la rareté des habitats (sols meubles, bois, tiges végétales, coquilles vides, anfractuosités diverses, etc.) accroît également les distances habitats-ressources. La plupart des espèces d’abeilles sauvages sont par ailleurs actives à des périodes limitées de l’année ce qui leur est préjudiciable lorsque cette période de butinage n’est pas synchronisée avec la disponibilité des ressources alimentaires dont elles dépendent.
Ces problèmes impactent considérablement moins les abeilles mellifères qui sont des espèces généralistes (butinent de nombreuses espèces de fleurs différentes contrairement à de nombreuses espèces d’abeilles sauvages qui se limitent à une ou quelques espèces), bénéficient d’une autonomie de vol inégalée chez la plupart des autres espèces et sont des insectes sociaux contrairement à la plupart des espèces d’abeilles sauvages. Leurs colonies (ruches) sont constituées de plusieurs dizaines de milliers d’individus avec des fonctions spécialisées (reine, ouvrières, mâles reproducteurs), capables de survivre en hiver (reine et une partie des ouvrières). Avec des habitats artificiels (ruches), de la sélection génétique, de l’apport d’eau en été, du nourrissement éventuel (sucres divers) et des soins vétérinaires (acaricides notamment), l’abeille mellifère est d’autant plus avantagée face aux aléas climatiques et au manque de ressources alimentaires. Cane & Tepedino (2016) estiment que 40 ruches représentent, sur 3 mois, l’équivalent de 4 millions d’abeilles sauvages, une seule ruche pouvant prélever le pollen nécessaire au nourrissement de 100.000 larves d’abeilles sauvages.
Par ailleurs, l’abeille mellifère souffre d’une série de pathogènes (virus, champignons). La transmission de ces maladies et parasites de l’espèce mellifère vers les espèces sauvages est un second sujet de préoccupation, en particulier pour les autres espèces sociales comme les bourdons.
En maintenant artificiellement une abondance élevée d’abeilles mellifères très compétitives et très demandeuses en ressources, l’apiculture peut dès lors représenter une pression environnementale supplémentaire sur les populations sauvages fragilisées.
La Région bruxelloise abrite plusieurs centaines de ruchers, installés un peu partout sur le territoire. Plus qu’aux composantes paysagères, le choix de leur implantation apparaît essentiellement lié aux opportunités d’accès à un emplacement. Deux grandes tendances sont constatées : les petites installations plus centrales, dans le Pentagone et en première couronne (y compris dans des quartiers pauvres en ressources alimentaires), souvent liées à des projets d’entreprise et d’apiculture en toiture, d’une part, et, d’autre part, les installations plus classiques en seconde couronne, au pourtour des réserves et sites Natura 2000, avec les plus gros ruchers de la région.
Les communautés végétales sont étroitement liées aux espèces d’abeilles présentes localement
Source : www.vivelesabeilles.be
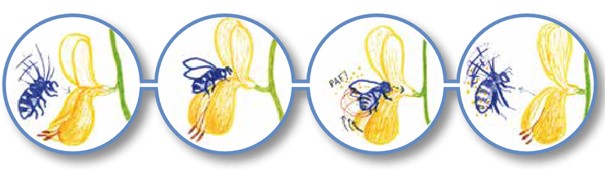
Les fleurs et les abeilles entretiennent des relations d’échange : les fleurs offrent de la nourriture aux abeilles et, en butinant, celles-ci transportent à leur insu des grains de pollens d’une fleur à l’autre. Ces organismes ont évolué ensemble et se sont progressivement adaptés les uns aux autres par mutation et sélection :
- L’adaptation des abeilles porte notamment sur les dispositifs de récolte du pollen (sur les pattes et l’abdomen) ainsi que sur la morphologie des pièces buccales (langue) permettant d’atteindre le nectar ;
- L’adaptation des fleurs porte sur les signaux permettant d’attirer les pollinisateurs (couleurs, formes, odeurs, etc.), la qualité nutritive et la quantité de nectar, le moment d’ouverture de la fleur ou encore, les caractéristiques des grains de pollen qui permettent d’augmenter leur adhérence aux poils des abeilles.
Certaines fleurs ne peuvent être pollinisées que par les espèces d’abeilles qui ont le comportement adéquat ou les traits morphologiques fonctionnels permettant au pollen de se libérer ou de se fixer. Par ailleurs, plus l’abeille est spécialisée, plus rapide est la vitesse de butinage et plus grand sera le nombre de fleurs visitées (Coppée I. 2014) et donc aussi les chances de fécondation.
L’interaction entre les plantes à fleurs et les pollinisateurs est donc très forte, si bien que des modifications des populations d’abeilles – par exemple suite à l’introduction de ruches – peuvent engendrer des perturbations sur le fonctionnement des écosystèmes et les communautés plantes-pollinisateurs. De même, la disparition locale de certaines plantes peut entraîner la disparition des espèces d’abeilles sauvages qui leur sont exclusivement inféodées. Selon leur présence et leur abondance, les abeilles sauvages sont les témoins de la préservation de leurs habitats.
Les questionnements sur les effets de la compétition alimentaire (en particulier sur les bourdons), sur la transmission de maladies ou sur la modification des communautés végétales restent vifs dans la communauté scientifique. Cependant, un nombre sans cesse croissant d’études publiées ces dernières années tend à confirmer ces effets. Des informations plus détaillées concernant ces champs de recherches figurent dans la fiche documentée sur les abeilles en Région bruxelloise.
Bon à savoir
Compte tenu des différents éléments exposés ci-dessus, la cohabitation des espèces de pollinisateurs, le renforcement des ressources alimentaires au bénéfice de toutes ainsi que le maintien d’une apiculture familiale patrimoniale à des niveaux compatibles avec les équilibres écologiques et les ambitions des stratégies de conservation de tous les pollinisateurs constituent certainement des enjeux régionaux.
Une stratégie bruxelloise pour les insectes pollinisateurs
Une stratégie bruxelloise en faveur des insectes pollinisateurs et auxiliaires (terme désignant ici les insectes
prédateurs et parasitoïdes ennemis des organismes nuisibles) a été adoptée par le gouvernement régional pour la période 2022-2030. Celle-ci s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie nationale belge 2021-2030. Son principal objectif est de réduire de 50% le nombre d’espèces menacées et d’augmenter de 50% le nombre d’espèces présentant une évolution positive.
Cette stratégie compte une cinquantaine de mesures. Le premier axe vise notamment à renforcer les connaissances sur l’état des différentes espèces d’insectes pollinisateurs (y compris abeilles mellifères), auxiliaires et exotiques envahissantes (espèces présentes, répartition, abondance, qualité et quantité de ressources alimentaires disponibles, dynamiques sous-jacentes aux constats, etc.). Cet axe porte aussi sur l’évaluation de l’incidence des apports de pollinisateurs et auxiliaires gérés et la formulation de recommandations ainsi que sur les interactions et interdépendances entre l’agriculture régionale et les pollinisateurs et auxiliaires.
Un deuxième axe décline de nombreuses mesures concrètes pour protéger certaines espèces d’insectes ou de plantes et créer un habitat propice à des espèces variées de pollinisateurs (végétalisation du bâti, renforcement des qualités écologiques des espaces ouverts, réduction de l’utilisation des pesticides, diversification et meilleure gestion des plantations, stimulation de la production écologique et locale de plantes, renforcement de la pollinisation et du contrôle biologique naturels en agriculture, etc.). Il vise aussi à encadrer l’apport de pollinisateurs et d’auxiliaires gérés et à mettre en œuvre une gestion intégrée des espèces exotiques envahissantes (frelon asiatique entre autres). Le développement d’un maillage étoilé y est également prévu (voir focus sur les chauves-souris et fiche sur la pollution lumineuse)
L’axe 3 porte sur la communication et formation d’un public varié (citoyen-ne-s, naturalistes, apiculteur-trice-s, gestionnaires, professionnel-le-s des jardins, etc.).
À télécharger
Fiches documentées
- n°9. Invertébrés, 2017 (.pdf)
- n°15. Miellées, origine botanique et qualité du miel en Région de Bruxelles-Capitale, 2016 (.pdf)
- n°25. Les abeilles en Région de Bruxelles-Capitale, 2022 (.pdf)
Fiches de l’Etat de l’Environnement
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Rapport sur l’état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale, 2022 (.pdf)
- Identification des espèces : Les abeilles sauvages en Région de Bruxelles-Capitale, 2018 (.pdf)
- Potagers - Des abeilles dans mon jardin, 2018 (.pdf)
Etudes et rapports
- COPPEE I., PEETERS M. 2014. « La biodiversité en Belgique – Zzzoom sur les abeilles – Pour les protéger, il faut apprendre à les connaître ! » , Société royale belge d’Entomologie et Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, pp.20. (.pdf)
- COMMISSION EUROPEENNE 2023. “Questions et réponses sur le nouveau pacte en faveur des pollinisateurs”, site Internet consulté le 01/02/2023 (.pdf)
- COSSERAT P.H. 2016. « Caractérisation et analyse de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). spécifique et fonctionnelle des communautés d’abeilles sauvages au sein des différents espaces verts de la Région de Bruxelles-Capitale ; expérience complémentaire du service écosystémique de pollinisation associé à cette diversité », Bruxelles : Université Libre de Bruxelles - service Ecologie du paysage et systèmes de production végétale (Mémoire de fin d’études ; promoteur N.J. VEREECKEN)
- DROSSART, M., RASMONT, P., VANORMELINGEN, P., DUFRÊNE, M., FOLSCHWEILLER, M., PAULY, A., VEREECKEN, N. J., VRAY, S., ZAMBRA, E., D'HAESELEER, J. & MICHEZ, D. 2019. “ Belgian Red List of bees”, . Belgian Science Policy 2018 (BRAIN-be - Mons: Presse universitaire de l’Université de Mons. 140 p. (.pdf) (en anglais uniquement)
- ESPOSITO, F., HAINAUT, H., HAUTIER, L., SAN MARTIN, G., CLAUS, G., SPANOGHE, P., MOLENBERG, J.-M., VEREECKEN, N.J. 2022. « Toxiflore - Evaluation de la contamination par les pesticides des plantes
ornementales attractives pour les abeilles en Région de Bruxelles-Capitale », rapport final, étude réalisée à la demande de Bruxelles Environnement. - GARIBALDI L.A., GOMEZ CARELLA D.S., NABAES JODAR D.N., SMITH M.R., TIMBERLAKE T.P., MYERS, S.S. 2022. “Exploring connections between pollinator health and human health”, Philosophical transactions of the royal society, 377 (1853). (.pdf) (en anglais uniquement)
- INTERGOVERNMENTAL SCIENCE-POLICY PLATFORM ON BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES [IPBES] 2016. “Assessment Report on Pollinators, Pollination and Food Production”, Potts, S.G., Imperatriz-Fonseca, V.L., & Ngo, H.T. (eds). Bonn: Secretariat of the IPBES. 552pp. (.pdf) (en anglais uniquement)
- Jacquemin F., Violle C., Rasmont P., Dufrêne M. 2017. « Mapping the dependency of crops on pollinators in Belgium”, ‡ Gembloux Agro-Bio Tech (ULg), Gembloux, Belgium § Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, Montpellier, France| Université de Mons, Mons, Belgium. (.pdf) (en anglais uniquement)
- Leclercq, N. 2017. « Etude des réseaux d’interactions plantes à fleurs-abeilles en Région de Bruxelles-Capitale », Bruxelles : Université Libre de Bruxelles - service Ecologie du paysage et systèmes de production végétale (mémoire de fin d’études ; promoteur VEREECKEN N.J.).
- Nieto A., Roberts S.P.M., Kemp J., Rasmont, P., Kuhlmann M., García Criado M., BIESMEIJER J.C., BOGUSCH P., DATHE H.H., DE LA RÚA P., DE MEULEMEESTER T., DEHON M., DEWULF A., ORTIZ-SÁNCHEZ F.J., LHOMME P., PAULY A., POTTS S.G., PRAZ C., QUARANTA M., RADCHENKO V.G., SCHEUCHL E., SMIT J., STRAKA J., TERZO M., TOMOZII B., WINDOW J., & MICHEZ D. 2014. « European Red List Of Bees », Luxembourg:Publication Office Of The European Union. 84 pp. (.pdf) (en anglais uniquement)
- Noël G., Bideau A., Flamion E., Lamarre M., Crasson P., Bonnet J., & Francis F. 2022. « Kauwbees : étude sur la préservation des abeilles sauvages du Kauwberg (Uccle, Belgique) dans une perspective de développement agricole et ludo-sportif du site », rapport final, Bruxelles Environnement. (.pdf)
- NOËL G., VAN KEYMEULEN V., VAN DAMME O., SMETS S., RUELLE, J., & FRANCIS F. 2022. « Streetbees –
Clauses techniques pour l’aménagement de trottoirs et revêtements permettant l’accueil d’abeilles
sauvages terricoles », étude réalisée à la demande de Bruxelles Environnement. - PAULY A. 2019. « Contribution à l’inventaire des abeilles sauvages de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Forêt de Soignes » (Hymenoptera : Apoidea), Belgian Journal of Entomology, 79: 1-160. (.pdf)
- PAULY, A. 2019. « Les abeilles sauvages du Jardin Botanique "Jean Massart" à Bruxelles (Hymenoptera : Apoidea) », Belgian Journal of Entomology, 78: 1-86.
- RUELLE J. 2022. « Stratégie pour les insectes pollinisateurs et auxiliaires en Région de Bruxelles-Capitale 2023-2030 », Bruxelles Environnement, pp.22. (.pdf)
- SMETS S., VAN DAMME O. 2021. « Le CRR étudie la nidification des abeilles sauvages terricoles dans les revêtements des trottoirs bruxellois via le projet Streetbees », article d’une publication du Centre de recherches routières. (.pdf)
- Vereecken N.J., De Greef S., Vertommen W., Pauly A., Molenberg J.-M., Ruelle J., Cuypers M., & D’Haeseleer J. 2022. “WildBnB - Atlas des abeilles sauvages de la Région de Bruxelles-Capitale », rapport final, étude réalisée à la demande de Bruxelles Environnement (.pdf)
- VEREECKEN N., WEEKERS T., MARSHALL L., D’HAESELEER J., CUYPERS M., PAULY A., PASAU B., LECLERCQ N., TSHIBUNGU A., MOLENBERG J.-M. & DE GREEF S. 2021. “Five years of citizen science and standardised field surveys in an informal urban green space reveal a threatened Eden for wild bees in Brussels, Belgium”, in“Insect Conservation and Diversity, doi : 10.1111/icad.12514 (.pdf) (en anglais uniquement)
- Vereecken N.J., Dufrêne E., & Aubert M. 2015. « Sur la coexistence entre l’abeille domestique et les abeilles sauvages : rapport de synthèse sur les risques liés à l’introduction de ruches de l’abeille domestique (Apis mellifera) vis-à-vis des abeilles sauvages et de la flore », Observatoire des abeilles. (.pdf)
- Weekers, T., Esposito, F., Leclercq, N., Stock, M., Piot, N., Hautier, L., San Martin, G., Claus, G.,Spanoghe, P., Molenberg, J.-M., & Vereecken, N.J.2022. “URBEESTRESS - Evaluation des stresseurs des abeilles sauvages urbaines en Région de Bruxelles-Capitale », rapport final, étude réalisée à la demande de Bruxelles Environnement.
Plans et programmes
- Plan régional nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale, 2016 (.pdf)
- Stratégie pour les insectes pollinisateurs et auxiliaires en Région de Bruxelles-Capitale 2023-2030, 2022 (.pdf)
Liens
Libellules et demoiselles en Région bruxelloise
L’atlas des libellules de la Région de Bruxelles-Capitale a montré que, sur approximativement 69 espèces d’Odonates répertoriées en Belgique entre 2015 et 2019, 49 espèces ont été observées avec certitude au cours de cette même période sur le territoire régional, parmi lesquelles 34 semblent bien installées. Bruxelles abrite donc, malgré sa superficie limitée à 162 km², l’importante densité de son bâti et sa population comptant plus de 1,2 million d’habitants, une proportion étonnamment élevée des espèces de libellules présentes en Belgique. L’état général des populations et le statut de conservation de la plupart des espèces se sont fortement améliorés depuis le début du siècle.

Les Odonates, espèces indicatrices de la qualité des milieux
Les libellules (Anisoptères) et demoiselles (Zygoptères) appartiennent à l’ordre des Odonates. La présence de ces insectes est étroitement liée à celle d’eau libre dans la mesure où leurs larves présentent un mode de vie aquatique. Leur longue durée de vie à l’état larvaire, leur position élevée dans la chaîne trophique ainsi que leur sensibilité à la qualité chimique de l’eau sont autant de caractères qui en font de bons bioindicateurs de l’état des écosystèmes aquatiques et des zones semi-naturelles qui les entourent (Lafontaine et al. 2019). La superficie des plans d’eau, ainsi que la longueur et la naturalité des rives influencent également la richesse en Odonates, de même que la présence de zones ensoleillées au niveau des berges (Lafontaine et al. 2013). La présence simultanée dans un site ou dans une région de nombreuses espèces d’Odonates est un signe clair que les conditions de leur survie, et donc que la qualité et la diversité des écosystèmes sont respectées. Certaines espèces sont aussi inféodées à des milieux bien spécifiques (p. ex. présence d’eau stagnante ou de plantes spécifiques). Les libellules et demoiselles bénéficient en outre d’un attrait important auprès du public, et d’une relative facilité d’observation et d’identification.
Un atlas réalisé avec l’appui des sciences participatives
Un premier travail d’inventorisation des différentes espèces d’Odonates présentes en Région bruxelloise a été réalisé par des chercheurs de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB) et a fait l’objet d’une synthèse publiée en 2013 (LAFONTAINE et al., 2013). Cette publication a été suivie par l’encodage sur la plateforme de sciences participatives observations.be d’un nombre croissant de données sur ces insectes par des observateurs bénévoles. Ceci constitue le point de départ de l’atlas, le premier réalisé pour la Région de Bruxelles-Capitale (un atlas national avait été réalisé en 2006). Cet atlas sera réalisé grâce à ces observateurs bénévoles, encadrés par l’IRSNB et avec le soutien de Bruxelles Environnement. Les données ayant permis de constituer l’atlas ont été collectées sur une période de 5 ans, de 2015 à 2019. Des données plus anciennes ont également été prises en compte pour les analyses.
Plus de 23.000 observations encodées durant la période 1989-2019
Les données ont été collectées par mailles de 1 km² (correspondant aux carrés UTM ou Transverse Universelle de Mercator). La Région en compte 200 (dont certaines ne se situent que très partiellement dans le périmètre régional). Parmi celles-ci, respectivement 154 et 144 mailles ont été prospectées au moins une fois entre 1989 et 2019 (période couverte par l’atlas) et entre 2015 et 2019 (période de réalisation de l’atlas). Un certain nombre de mailles n’ont pas été prospectées, dans la plupart des cas parce qu’elles concernent un territoire ne comportant pas d’habitats potentiels pour les Odonates et/ou parce qu’elles sont situées trop en marge de la Région et ne couvrent que très partiellement le territoire bruxellois. Une maille a été considérée comme suffisamment prospectée si on y a fait au moins 3 observations (cas de 117 mailles) ou mieux, si l’on a détecté au moins 3 espèces (cas de 111 mailles).
Les observations ont été encodées par les observateurs dans la base de données observations.be (voir Collecte de données sur la biodiversité bruxelloise par les citoyens), avec des coordonnées X et Y précises. Parmi les données collectées pendant cette période, les plus inattendues ont fait l’objet d’un processus de validation par des experts sur base de photos, voire parfois directement sur le terrain.
Différents statuts d’observation ont été proposés aux observateurs, statuts allant de la simple observation de présence jusqu’à l’observation d’indices de reproduction (nombre d’individus observés sur un site, accouplement, ponte, exuvie, larve, etc.). Ces statuts ont permis d’établir le statut de reproduction des espèces.
Au total, plus de 23.000 observations d’Odonates ont été encodées sur le site observations.be entre 1989 et 2019. Le nombre d’observations n’a fait que croître au fil des années et en particulier pendant la période de l’atlas (17.500 nouvelles données).
Depuis une quinzaine d’années, le nombre d’espèces d’Odonates en Région bruxelloise a pratiquement doublé, notamment à la suite de l’arrivée d’espèces méridionales
A ce jour, au total 59 espèces ont été observées au moins une fois en Région de Bruxelles-Capitale (72 à l’échelle de la Belgique), certaines ne l’ayant été qu’au 19ème siècle. Au tournant du 21ème siècle, le nombre d’Odonates avait chuté et on ne trouvait plus que 27 espèces sur le territoire de la Région. La tendance s’est inversée depuis et dans le cadre des prospections réalisées pour l’atlas, on a observé pas moins de 49 espèces entre 2015 et 2019.
Les données encodées pendant la période 2020 -2021 pour la Région bruxelloise sur observations.be font état de 45 espèces d’Odonates notées pour cette période, dont une nouvelle espèce, la Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia caudalis), qui s’est récemment ajoutée à la liste des espèces régionales et au moins deux espèces qui s’y sont reproduites pour la première fois (Ceriagrion tenellum et Aeshna affinis). Ces deux dernières espèces avaient déjà été observées durant la période de l’Atlas mais il n’y avait pas encore eu de preuve de leur reproduction locale.
Cette richesse en espèces assez exceptionnelle en milieu urbain peut s’expliquer par la juxtaposition de milieux boisés de bonne qualité et d’un réseau hydrographique encore important, pour lequel d’énergiques mesures de gestion ont, ces dernières années, considérablement amélioré la qualité des eaux (Lafontaine et al., 2013).
Le nombre d’espèces observées régulièrement dans la Région s’est donc considérablement accru au cours de ces dernières années. Ceci est lié en partie au fait que des espèces qui n’avaient plus été observées depuis le 19ème siècle sont réapparues, mais aussi à l’arrivée d’espèces tout à fait nouvelles. En particulier, en liaison très probable avec le réchauffement climatique, de nombreuses espèces méridionales ont été découvertes depuis le début du 21ème siècle et viennent augmenter le nombre d‘espèces d’Odonates présentes en Belgique et dans la Région bruxelloise.
Plus de 65% des espèces d’Odonates historiquement connues en Région bruxelloise sont en augmentation ou présentes avec des populations abondantes et stables
Comme le montre le tableau ci-dessous, parmi les 49 espèces observées entre 2015 et 2019 :
- 21 sont des reproducteurs non menacés ;
- 4 sont des reproducteurs rares/très rares ;
- 3 sont des reproducteurs vulnérables ;
- 5 sont des visiteurs rares/très rares et reproducteurs rares/très rares ;
- 1 est un visiteur rare et nouveau reproducteur ;
- 1 est un reproducteur irrégulier et invasif ;
- 14 sont des visiteurs rares/très rares.
Près de deux tiers des espèces d’Odonates présentes en Région bruxelloise s’y reproduisent donc. Parmi ces espèces, environ un quart sont rares, très rares ou vulnérables.
L’atlas a permis de préciser le statut des espèces, notamment en ce qui concerne la reproduction sur le territoire de la Région.
Evolution du statut des espèces d’Odonates historiquement présentes en Région bruxelloise (59 espèces)
Sources : Lafontaine et al. 2019 et Lafontaine 2022 (com personnelle), observations.be (données d’observation 2020-2021)
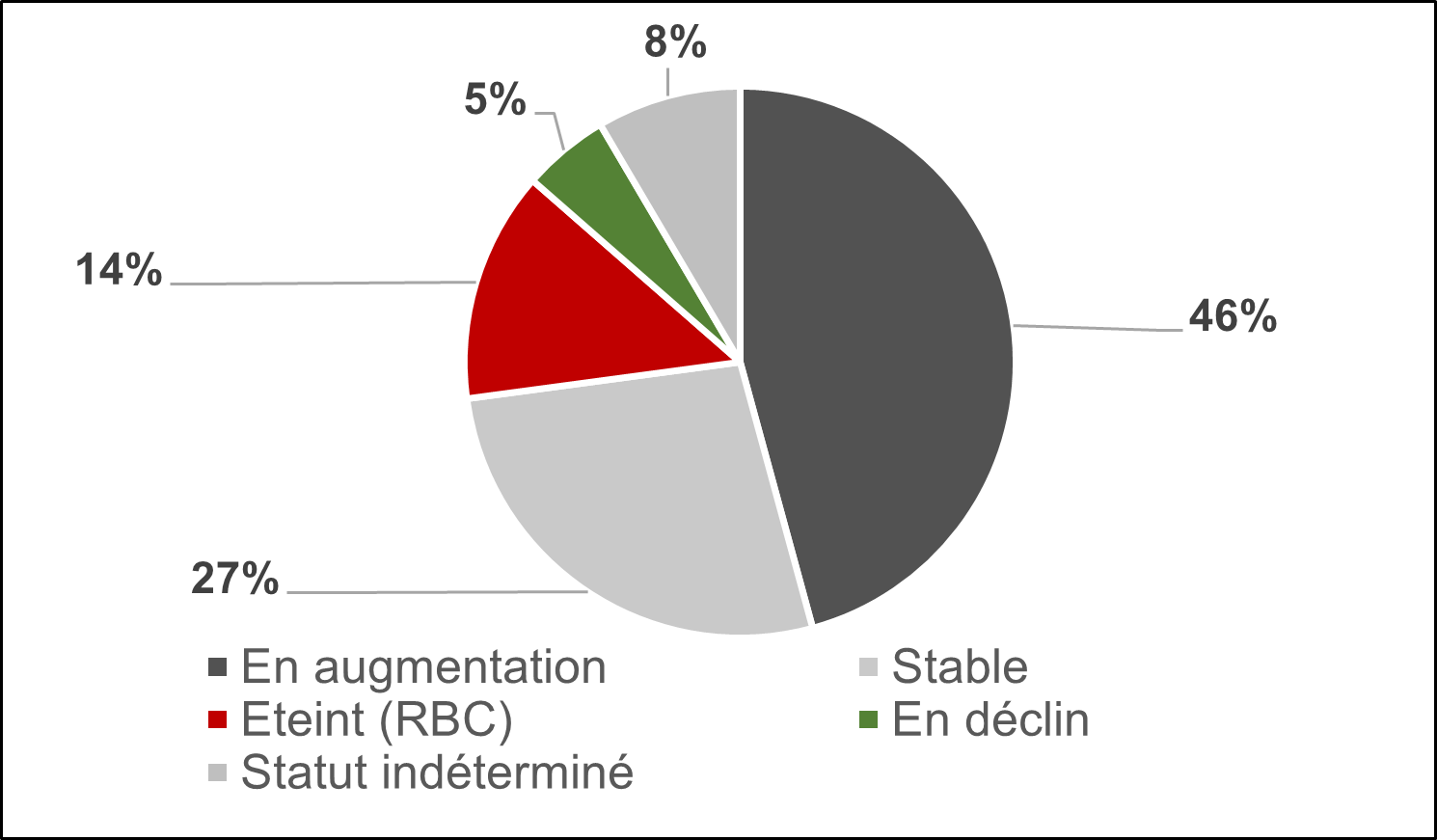
*Eteint (RBC) : espèce documentée en RBC par des données anciennes (souvent antérieures à 1900) mais qui n'a plus été observée après 1980
Au cours de la période d’observation 2020-2021, le statut de quelques espèces a évolué de manière favorable ou défavorable (voir tableau).
Sur les 59 espèces observées en Région bruxelloise (parfois avant 1900), 8 sont considérées comme régionalement éteintes et 3 en situation plus défavorable que dans le passé. Près de la moitié d’entre elles sont par contre dans une meilleure situation et un peu moins d’un quart sont considérées comme en situation stable avec des effectifs reproducteurs importants.
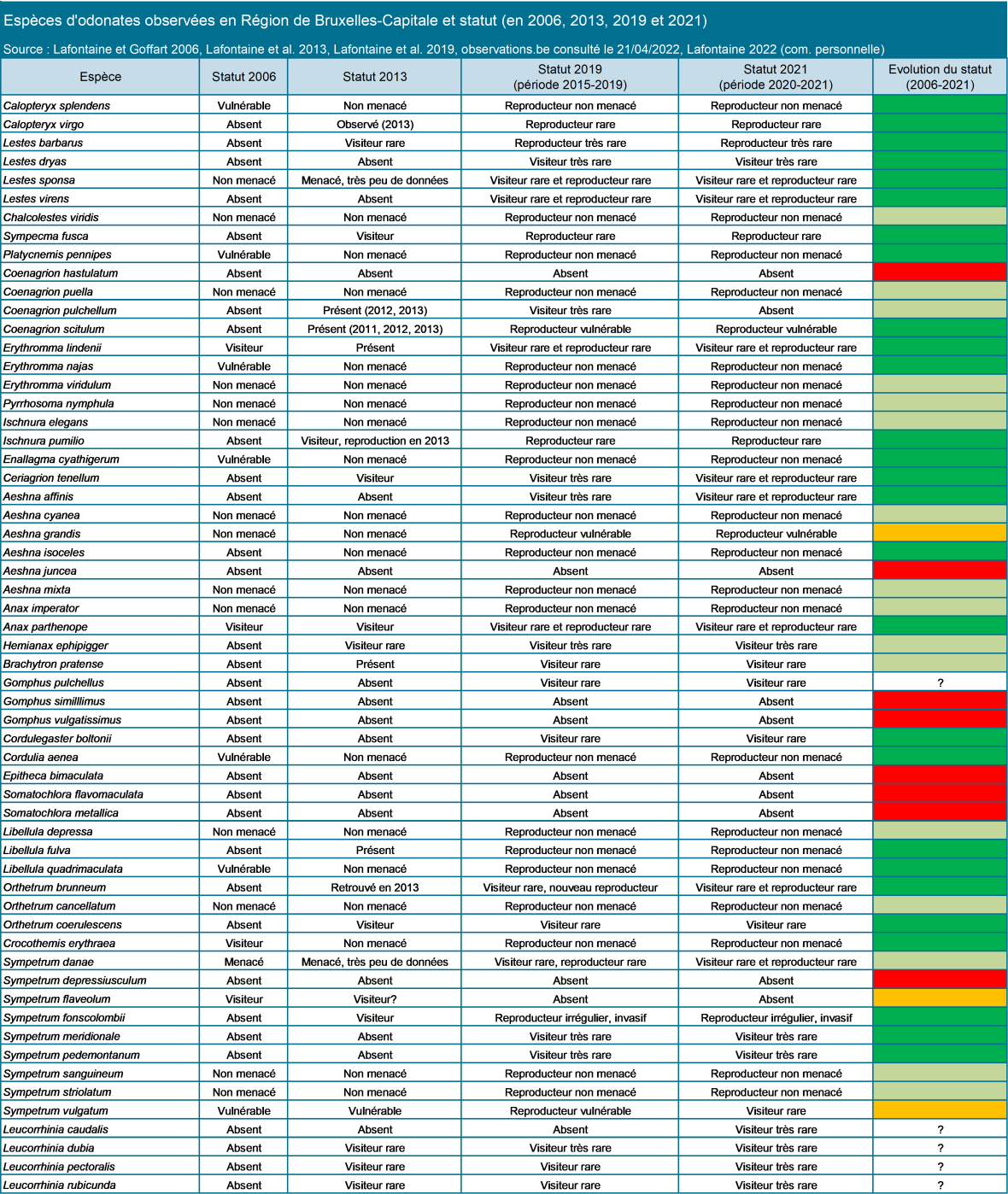
Vert foncé = évolution favorable
Vert clair = statut non modifié
Orange = évolution défavorable
Rouge = éteint en Région de Bruxelles-Capitale
? =visiteur occasionnel, statut non défini
En moins de 2 décennies, l’état des populations d’Odonates s’est fortement amélioré tant au niveau du nombre d’espèces observées que de leur statut de conservation.
Cette tendance positive serait due principalement à une meilleure gestion des écosystèmes dulcicoles (eaux douces) à Bruxelles auxquels les Odonates sont fortement liés.
Le programme de maillage bleuLe Maillage bleu est un programme mis en œuvre depuis 1999, qui vise plusieurs objectifs : séparer les eaux usées des eaux propres afin de limiter l'apport d'eau aux stations d'épuration, restaurer certains éléments du réseau hydrographique de la Région, réaménager des tronçons de rivières, des étangs et des zones humides pour leur rendre toute leur valeur biologique, et leur faire éventuellement bénéficier de mesures spéciales de protection, et assurer la fonction paysagère et récréative de ces sites. s’est notamment traduit par une amélioration générale de la qualité des eaux et de la gestion des berges, une remise à ciel ouvert de certains tronçons de cours d’eau, une augmentation des débits, ainsi que par une meilleure gestion des populations de poissons avec notamment une diminution des stocks (les poissons sont des prédateurs des Odonates). Ceci démontre qu’une gestion adaptée peut très rapidement se traduire par des répercussions bénéfiques en termes de biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)..
Il convient de noter que la pression d’observation s’est aussi accrue, donnant lieu à de plus en plus d’observations encodées, surtout pendant la période de l’atlas.
320 sites favorables aux Odonates identifiés
Un total de 546 sites potentiels a pu être identifié dans la Région de Bruxelles Capitale entre 2010 et 2019. Ces sites comprennent aussi bien des milieux lotiques (écosystèmes d’eaux courantes) que des milieux lentiques (écosystèmes d’eaux calmes à renouvellement lent, comme des lacs, marécages, étangs ou mares) qui conviennent particulièrement aux Odonates. Parmi ces 546 sites, 320 d’entre eux ont donné lieu à l’observation d’au moins une espèce de libellule entre 2010 et 2019.
On constate cependant que seuls 20 sites de la Région abritent au moins 20 espèces différentes d’Odonates (Lafontaine et al., 2019).
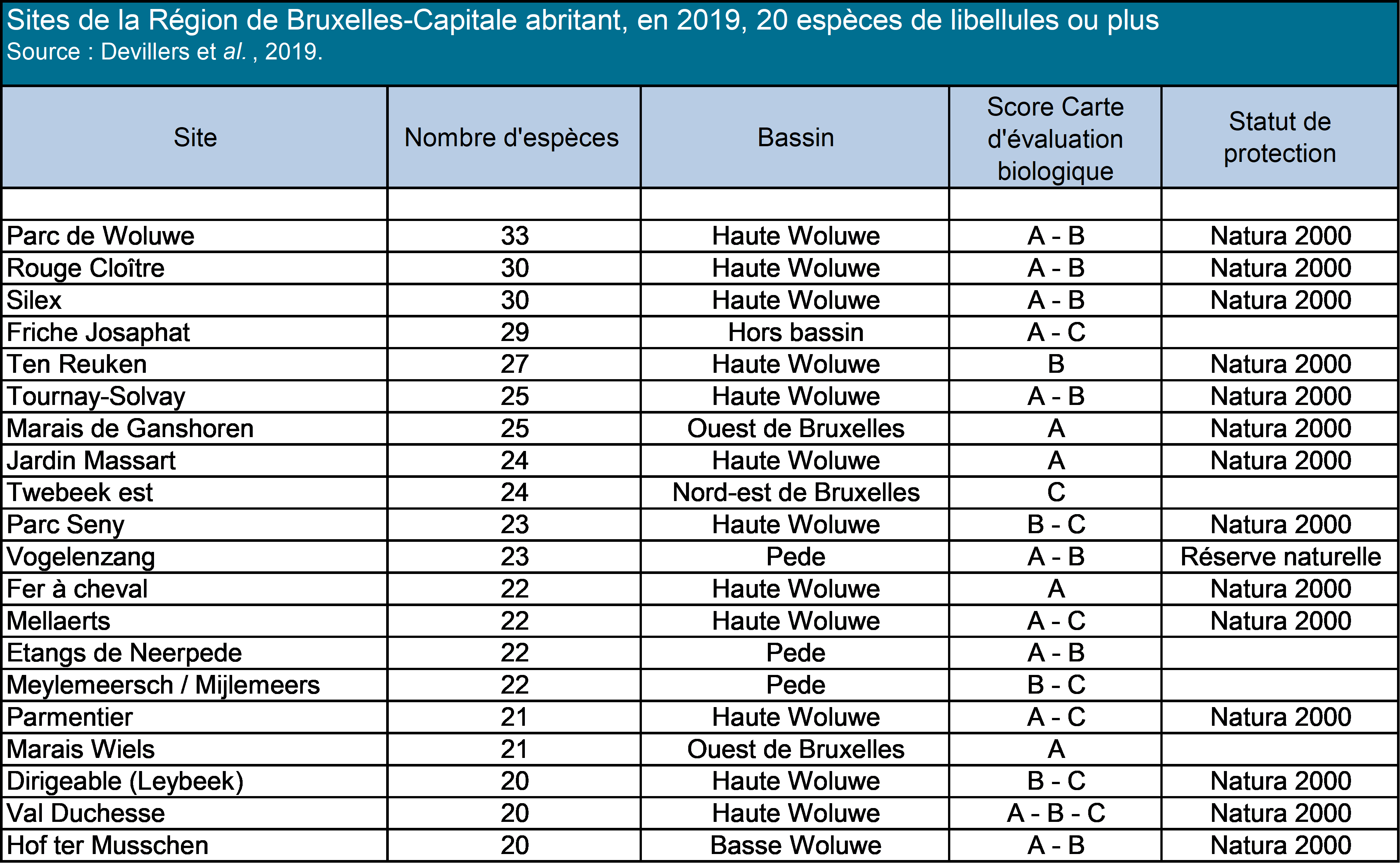

Lire le texte de transcription
Vue du parc de Woluwe et d'un de ses étangs
Douze de ces 20 sites se trouvent dans le bassin de la Haute-Woluwe, qui conjugue proximité de la forêt de Soignes et présence d’étangs de très bonne qualité, bien connectés entre eux. Sept sites sont dispersés dans de petits bassins qui combinent boisements, ruisseaux, étangs et parfois marais. La fricheZone de terrain laissée à l'abandon et progressivement colonisée par la végétation spontanée. Josaphat est unique par sa situation à l’écart du réseau hydrographique et par l’absence d’étangs (voir encadré ci-dessous). Avec 29 espèces, elle constitue néanmoins le quatrième site de la Région et le seul en dehors de la Haute-Woluwe à accueillir plus de 25 espèces, c’est à dire plus de la moitié des espèces régionales.
Des menaces qui persistent cependant sur les espèces
Le statut global des espèces bruxelloises s’est donc nettement amélioré depuis le début du 21ème siècle. Néanmoins, certaines menaces pèsent toujours sur les populations d’Odonates, en particulier le risque de disparition progressive de certains sites. Des milieux - comme les friches, surtout si elles sont partiellement humides, les clairières, les lisières forestières (dont la restauration est prévue au Plan de gestion de la forêt de Soignes, mais dont une partie a été perdue par le passé), les prairies naturelles -, qui offrent des opportunités pour toute une série d’espèces particulières, sont de moins en moins présents à Bruxelles. Certaines espèces se reproduisent en effet dans des mares temporaires que l’on peut par exemple retrouver dans des friches comme la friche Josaphat, particulièrement riche en espèces d’Odonates.
La friche Josaphat, un des sites les plus riches en Odonates de la Région
Des inventaires réguliers d’Odonates ont été effectués sur le site de l'ancienne gare de Schaerbeek-Josaphat, dit « friche Josaphat », de 2012 à 2022. Il s’agit d’une friche post-industrielle d’environ 24 ha, enclavée dans le tissu urbain du nord-est de Bruxelles. Le site est actuellement catégorisé majoritairement en A (très haute valeur biologiqueValeur reconnue d'un site coté sur base d'une série de critères tels que : la présence d'éléments hydrologiques peu perturbés (sources), la diversité et la rareté des espèces locales de plantes et d'animaux, la présence d'espèces rares, la maturité des végétations (site irremplaçable sauf à très long terme, ex. une forêt séculaire), etc.) sur la carte d’évaluation biologique. La végétation est très diversifiée sur le site et celui-ci présente deux mares peu profondes. Il est particulièrement riche en Hyménoptères et en Odonates.
En 2019, on avait déjà recensé 29 espèces d’Odonates sur le site, soit plus de la moitié des espèces régionales. Depuis lors, 5 espèces supplémentaires y ont encore été découvertes, dont la dernière, la Cordulie bronzée (Cordulia aenea), en avril et mai 2022. La friche est par ailleurs le seul site de la Région où la reproduction du Leste sauvage (Lestes barbarus) et du Leste verdoyant (Lestes virens) est attestée par l’observation de tandems (couples en accouplement) et de pontes en août et septembre 2019. Le Sympétrum noir (Sympetrum danae) s’est reproduit dans la friche en août 2014, à la faveur de l’apparition de mares. Ces mares ont été détruites peu après par l’épandage de terres rapportées. Depuis, aucune population reproductrice de cette espèce n’a été trouvée dans la Région, même si des individus errants ont été observés. Le site semble aussi être le plus important pour la reproduction du rare Agrion nain (Ischnura pumilio) et de l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum). Le Leste brun (Sympecma fusca) y est observé plus que partout ailleurs à Bruxelles.
La richesse exceptionnelle en libellules de la friche Josaphat, site atypique étant donné son éloignement du réseau hydrographique et des étangs, tient vraisemblablement à trois facteurs :
- par son étendue, sa diversité floristique et entomologique, l’absence de coupures et de cloisonnements, la friche constitue un terrain de chasse privilégié pour les adultes de nombreuses espèces;
- les mares peu profondes, très ensoleillées et entourées de végétation palustre, qui se sont développées naturellement après des travaux en 2012 et qui ont été recréées grâce à une gestion raisonnée ces dernières années, offrent des milieux de reproduction extrêmement favorables, dotés d’un accès proche et aisé aux sites de gagnage (où les Odonates s’alimentent);
- la plaine de Dieghem, dans laquelle s’inscrit le site, est par sa topographie, une voie d’accès migratoire importante vers la ville, comme le montrent notamment les nombreuses observations d’oiseaux de passage ou en halte.
À télécharger
Fiches de l’Etat de l’environnement
- Focus : Surveillance des espèces (février 2020)
- Focus : Qualité biologique des principaux cours d’eau et étangs (février 2020)
Autres publications de Bruxelles Environnement
Etudes et rapports
- LAFONTAINE, R-M., CARPENTIER, C., GOFFETTE, J., OGER, M., MAREE S., PASAU, B., DAEMS, V., DE BOECK, B., BOECKX, A., BOON, L. & DEVILLERS, P. 2019. Atlas des libellules de la Région de Bruxelles Capitale. Rapport final à la subvention SUB/2018/IRSNB - Bruxelles Environnement
- DEVILLERS P., LAFONTAINE R.-M, PASAU B., DAEMS V., DE BOECK B., BOECKX A., BOON L., DEVILLERS-TERSCHUREN J., 2019, « La friche Josaphat à Bruxelles, Schaerbeek. Un site urbain enclavé d’une richesse odonatologique exceptionnelle », Les Naturalistes belges 100, 3 (2019) : 1-22, 22p. (.PDF)
- LAFONTAINE, R.-M., DELSINNE, T., DEVILLERS, P., 2013, « Évolution des populations de libellules de la Région de Bruxelles-Capitale - leurs récentes augmentations - importance de la gestion des étangs », Les Naturalistes belges, 2013, 94, 2-3-4 : 33-70, 44 p. (.PDF)
- LAFONTAINE R.-M., communication personnelle, 2022.
Plans et programmes
Biodiversité : les papillons de jour
Focus - Actualisation : décembre 2009
Malgré son caractère urbain, la Région bruxelloise recèle une importante richesse floristique et faunistique. Plus de 14% de son territoire a été retenu comme « Zones spéciales de conservation » dans le cadre du réseau européen Natura 2000. Ces zones abritent en effet des habitats naturels et des espèces animales particulièrement rares à l’échelle européenne : certaines espèces de chauves-souris (barbastelle, grand murin,…), le Lucane cerf-volant (le plus grand insecte d’Europe), certains habitats forestiers (forêts alluviales à aulnes et frênes par exemple),…
La biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). repose sur un équilibre écologique délicat et est soumise à de fortes et multiples pressions. En Région bruxelloise, celles-ci résultent essentiellement de la poursuite de l’urbanisation au détriment d’espaces verts souvent riches (friches, espaces semi-naturels), de la pression récréative et de la présence d’espèces exotiques envahissantes (voir fiche Espèces exotiques envahissantes) .
Pour assurer la gestion de ce patrimoine naturel, Bruxelles -Environnement s’appuie, entre autres, sur les données collectées dans le cadre d’études thématiques visant à assurer un suivi scientifique et systématique de la faune, de la flore et des écosystèmes présents localement.
Un inventaire des papillons de jour a ainsi été réalisé au cours de la période 2006-2008. La base de données constituée comporte plus de 6600 observations couvrant la période 1830-2008 et provenant d’observations de terrain (71%), de collections de particuliers et musées (21%) ainsi que de la littérature scientifique (8%). La participation du public à la collecte de données d’observation a été encouragée notamment via la publication et la diffusion d’un guide d’identification des papillons et l’organisation de promenades et week-end de recensement .
69 espèces de papillons de jour figurent dans la base de données dont 46 espèces pour lesquelles il est établi qu’elles se sont reproduites durant une longue période en Région bruxelloise (papillons « résidents »). Sur base des observations réalisées depuis 1997, on estime que parmi ces 46 espèces, 18 (39%) sont actuellement éteintes au niveau régional et 8 (17%) sont devenues très rares.
Répartition de 46 espèces « résidentes » de papillons de jour selon leur degré de rareté en RBC (période 1997-2008)
Source : Bruxelles- Environnement, département biodiversité
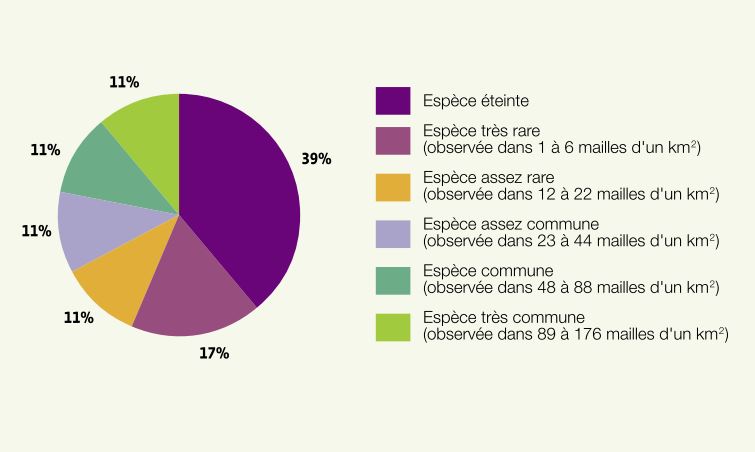
La Région accueille aujourd’hui 28 papillons « résidents » différents dont l'Azuré commun, le Citron, la Carte géographique, la Piéride du chou, le Machaon, la Petite tortue et le Paon du jour. Trois espèces sont classées parmi les espèces menacées (le Grand mars changeant, la Thècle du bouleau et la Thècle de l'orme).
Auparavant, 5 communes (Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem, Bruxelles-ville et Anderlecht) abritaient chacune plus de 25 espèces de papillons « résidents». Seule la commune d’Uccle accueille actuellement encore une telle diversité.
Relativement à d’autres groupes taxonomiques, les populations de papillons de jour apparaissent avoir particulièrement souffert des modifications de biotopes (raréfaction des milieux ouverts et des zones humides, morcellement,…) occasionnées par l’urbanisation massive de la Région au cours de ces dernières décennies. Certains groupes inféodés aux zones humides, tels que les amphibiens et les libellules, sont par ailleurs également fortement menacés.
Evolution de la diversité en espèces de papillons de jour par commune (comparaison des observations réalisées sur les périodes 1830-1996 et 1997-2008)
Source : Bruxelles- Environnement, département biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore).
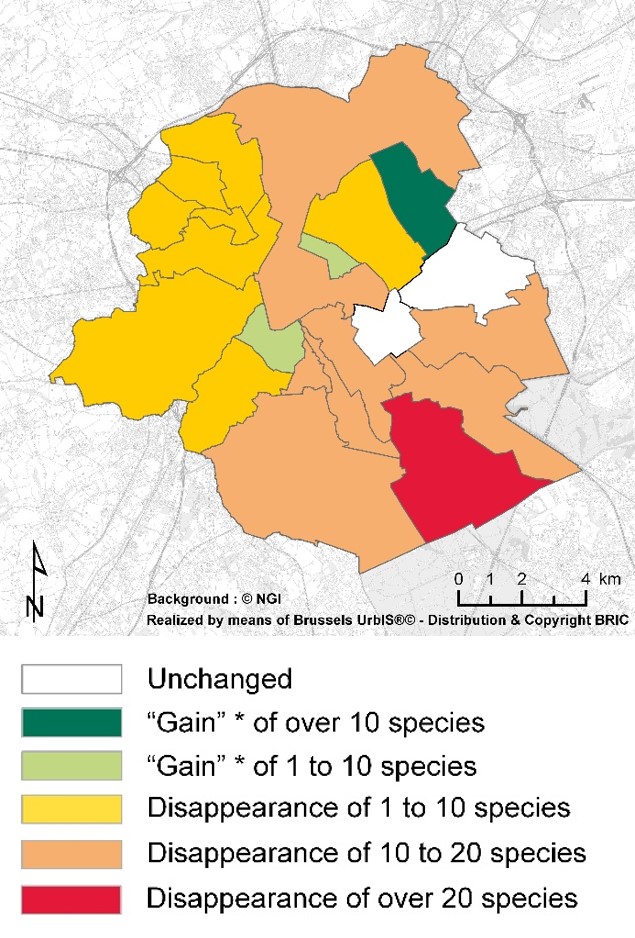
*L’accroissement apparent du nombre d’espèces pourrait résulter d’un biais lié à une insuffisance des observations réalisées durant la période 1830-1996"
- (Accédez à la carte interactive)
Le chevreuil en Région bruxelloise
Focus - Actualisation : juin 2020
Un programme de surveillance des populations de chevreuils en forêt de Soignes est mené conjointement par les trois Régions. Après une période de relative stabilité entre 2008 et 2013, les observations effectuées indiquent une réduction des populations de chevreuils depuis 2014. Plusieurs hypothèses sont avancées : collisions avec les voitures, braconnage, prédation par des chiens (errants ou non tenus en laisse) et par les renards, changements dans la capacité d’accueil de la zone, pression croissante des loisirs, présence de sangliers ou encore, maladies. Les facteurs explicatifs ne sont actuellement pas clairement identifiés et sont probablement multiples.
Une espèce surtout présente en forêt de Soignes… mais pas uniquement
Avec le sanglier, discrètement présent en forêt de Soignes bruxelloise, le chevreuil est le dernier grand mammifère herbivore sauvage vivant encore dans la Région (des réintroductions ont cependant été effectuées au 19ème siècle).
Le chevreuil est une espèce vivant en forêt et dans les bosquets mais qui a besoin d’espaces dégagés. On la trouve principalement à la transition entre différents biotopes (lisières, prairies avec bosquets, etc.).. A Bruxelles, l’espèce est principalement présente en forêt de Soignes avec des densités très variables selon les secteurs. Depuis 2001, des observations ont également été faites dans d’autres espaces semi-naturels comme par exemple dans le nord-ouest autour de Jette-Ganshoren ou dans le parc du Scheutbos à Molenbeek.
En tant qu’herbivore, le chevreuil contribue au contrôle de la végétation au sein de son écosystèmeC'est l'ensemble des êtres vivants (faune et flore) et des éléments non vivants (eau, air, matières solides), aux nombreuses interactions, d'un milieu naturel (forêt, champ, etc.). L'écosystème se caractérise essentiellement par des relations d'ordre bio-physico-chimique. par broutage de jeunes arbres. Il participe ainsi à l’entretien de zones de clairières ou de milieux semi-ouverts mais peut parfois aussi contrecarrer les efforts de reboisement en allant s’alimenter dans les jeunes plantations. Comme pour d’autres animaux, son piétinement permet l’enfouissement dans le sol des graines ou, au contraire, de mettre à jour d’autres graines.
Observations de chevreuils en Région bruxelloise
Source : Bruxelles Environnement, Atlas des mammifères 2001-2017 (2020)
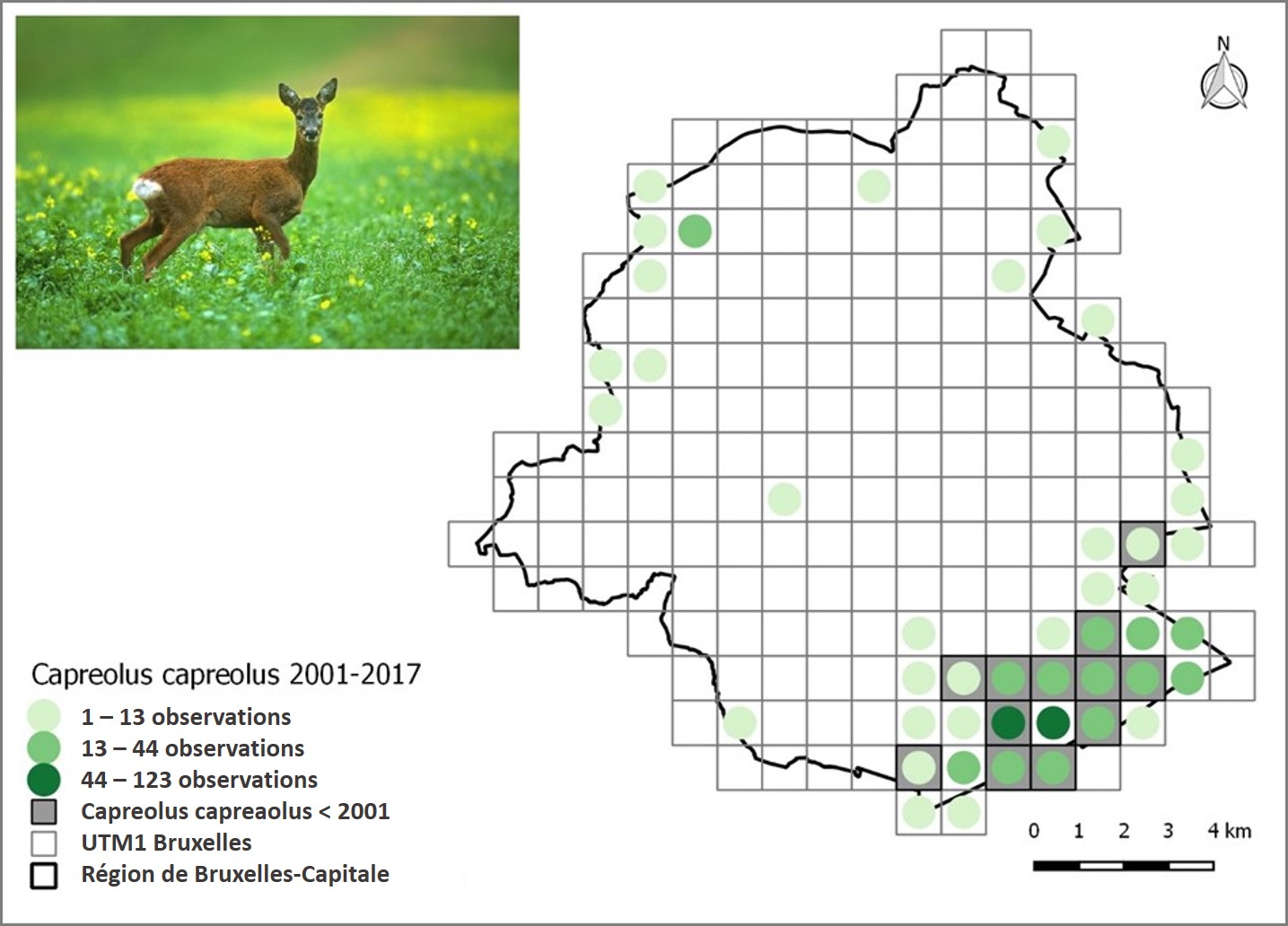
Une collaboration des 3 Régions pour suivre les populations de chevreuils en forêt de Soignes
Un programme de surveillance des populations de chevreuils dans le massif sonien est mené conjointement par les trois Régions depuis 2008 avec l’appui de l’asbl Wildlife & Man.
La méthode de suivi utilisée est celle de l’Indice Kilométrique d’Abondance (IKA) qui permet d’évaluer les tendances évolutives de la population de chevreuils sans pour autant en déterminer la densité exacte.
Chaque année des circuits prédéfinis de 3 à 5 km sont parcourus à pied, simultanément et selon un protocole stricte, par le personnel forestier et par des volontaires entraînés. Depuis 2009, les comptages ont lieu à quatre reprises durant un mois donné, le long de 24 parcours qui, mis bout à bout, mesurent 118,5 km (le parcours 1 n’a été parcouru qu’en 2008). 474 km sont ainsi normalement parcourus tous les ans pour y dénombrer les chevreuils dans l’ensemble du massif.
Parcours de suivi des populations de chevreuils en forêt de Soignes sur base des indice kilométriques d’abondance
Source : Bruxelles Environnement 2019
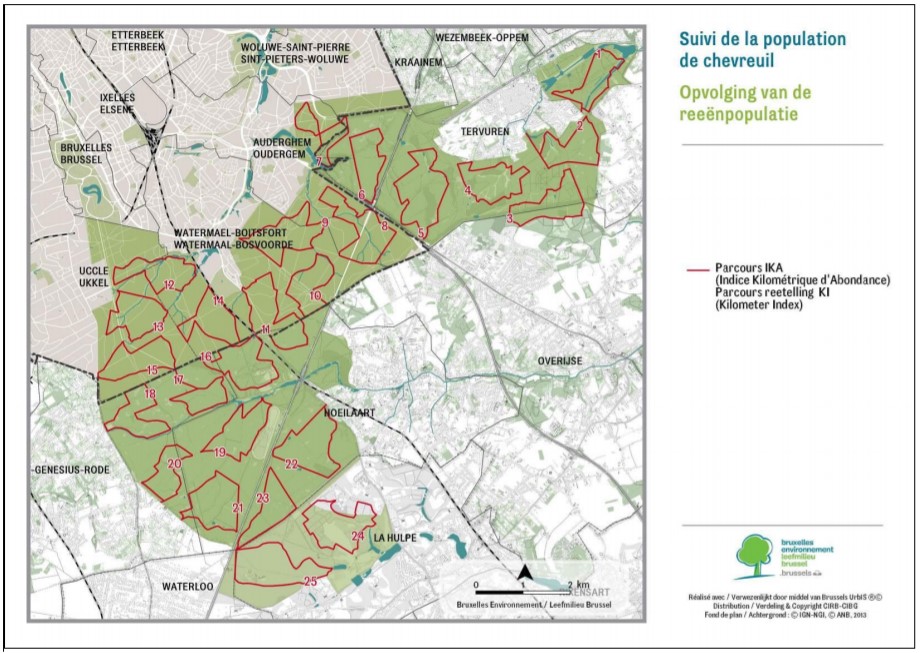
Le nombre total de chevreuils observés est ensuite divisé par le nombre de kilomètres parcourus et traduit en indice kilométrique (nombre de chevreuils observés par kilomètre). Cette valeur, statistiquement significative compte tenu du protocole utilisé, est comparable d’une année à l’autre. Elle sert à détecter les variations de population (croissance, stabilité ou régression) et permet aux gestionnaires forestiers d’intervenir si nécessaire.
Une population de chevreuils qui diminue en forêt de Soignes depuis quelques années
Durant la période 2008-2013, la population de chevreuils était globalement estimée à au moins 150 individus répartis sur les 5.000 hectares du massif sonien, soit, en moyenne, à plus de 3 individus par 100 hectares (ou km2) (HUYSENTRUYT et al., 2016). Cette faible densité est à mettre en relation avec, d’une part, le milieu « hêtraie cathédraleForêt de hêtres ou riche en hêtres qui ne laissent filtrer que très peu de lumière, à la façon des vitraux d'une cathédrale. » fortement représenté (forêt équienne, monospécifique, pauvre en ressources nutritives pour le chevreuil) et, d’autre part, une régulation de la population de chevreuils par le trafic routier et les chiens errants ou non maîtrisés (en l’absence de chasse, interdite en forêt de Soignes). La forte fréquentation de la forêt de Soignes et les dérangements qui y sont liés contribuent certainement aussi à limiter les populations de chevreuils.
Les tableaux et figures suivantes reprennent les principaux résultats du recensement :
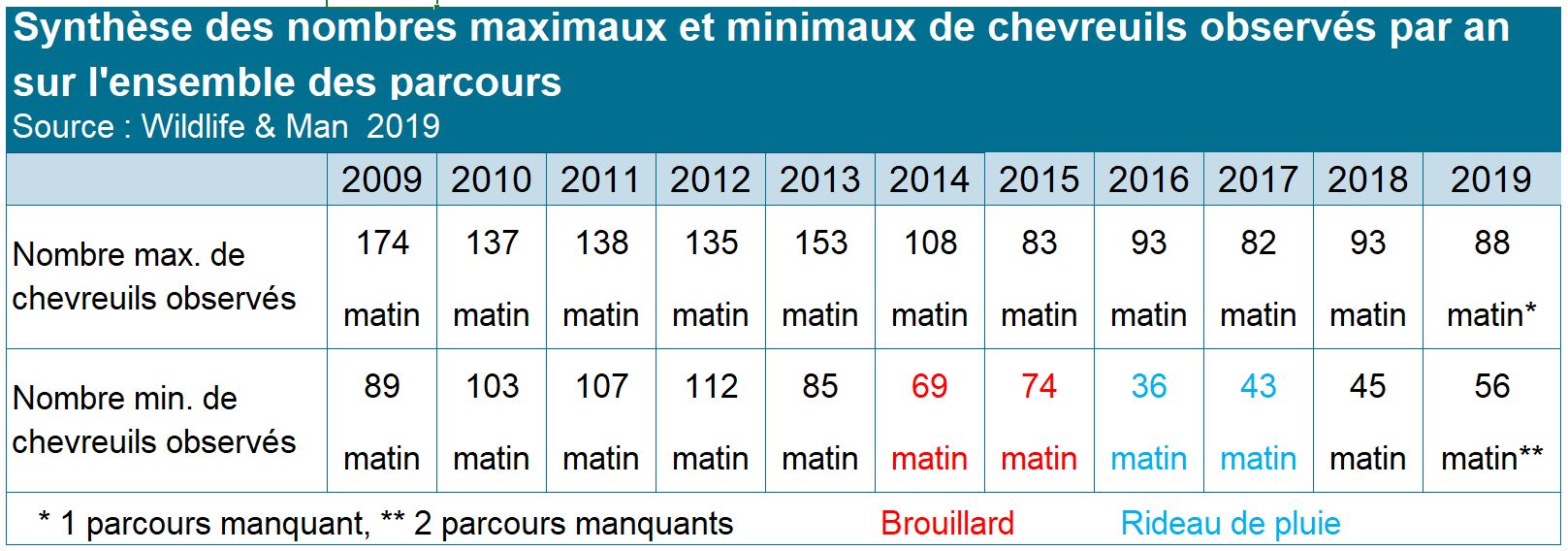
Evolution annuelle des valeurs d’indices kilométriques moyens et intervalles de confiance (à 95%) sur les différents parcours en forêt de Soignes
Source : Wildlife & Man 2019
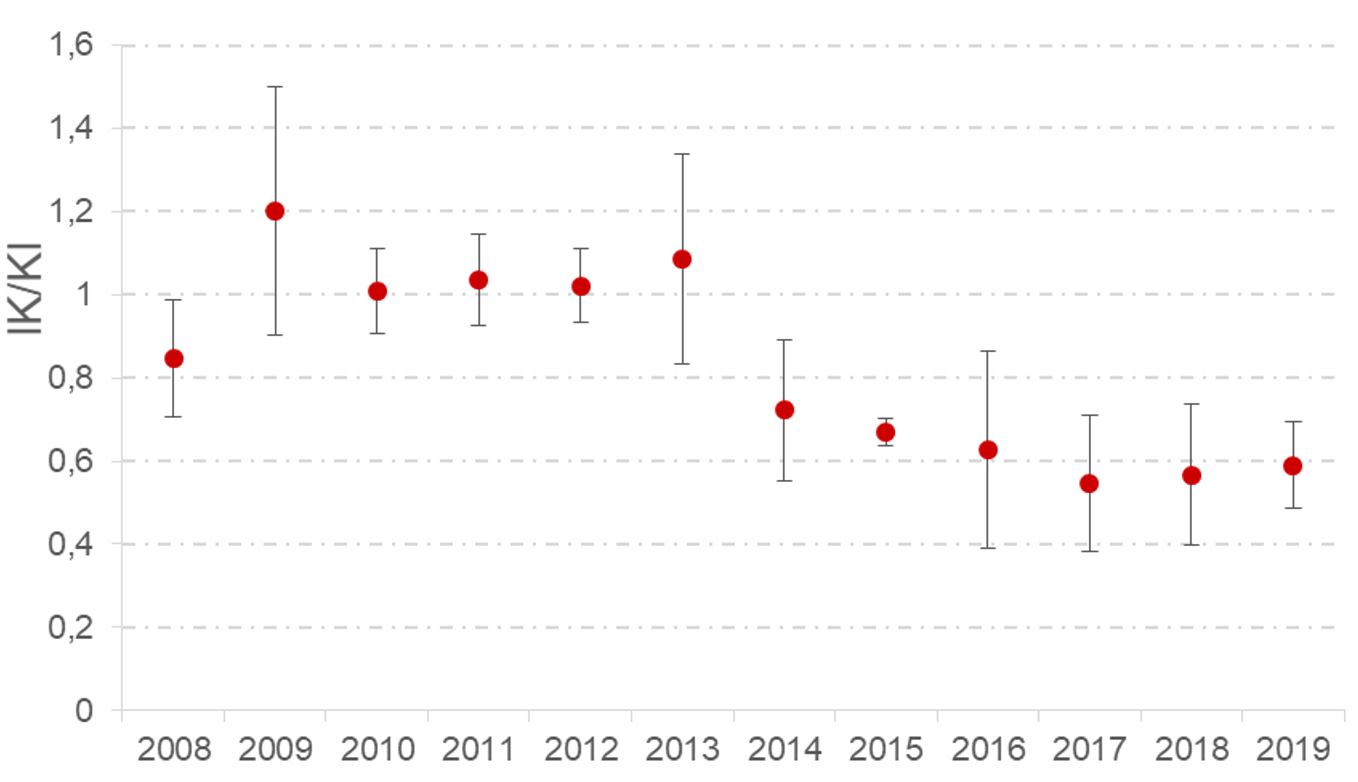
Alors que pendant la période 2008-2013, l’indice kilométrique était en moyenne de 1 chevreuil observé par kilomètre, il ne dépasse plus 0,75 depuis 2014 et est même passé en-dessous de la barre de 0,60 depuis 2017.
Partant de l’hypothèse que l’abondante régénérationEn sylviculture, opération consistant à remplacer un peuplement mûr soit par voie naturelle, soit par voie artificielle. naturelle du hêtre observée ces dernières années pourrait être à l’origine d’une moindre détectabilité des animaux lors des recensements (fermeture du couvert forestier), les partenaires scientifiques ont adapté la méthodologie de suivi en 2017.
Depuis lors, l’indice n’a cependant pas augmenté. La cause exacte de cette diminution n'est pas claire. Différentes hypothèses sont émises et peuvent se superposer: collisions avec les voitures, braconnage, impact des chiens errants, prédation par le renard (principalement sur les faons), changements dans la capacité d’accueil de la zone, pression croissante des loisirs (des dérangements répétitifs occasionnent d’importantes dépenses d’énergie), présence de sangliers ou encore, maladies. Seule une recherche plus approfondie pourrait apporter une réponse définitive.
Dans l’attente, les gestionnaires forestiers restent vigilants concernant le phénomène en augmentation de prédation par les chiens, l’état de santé des chevreuils observés et les signes d’un possible braconnage de la population de cervidés.
Par ailleurs, dans le cadre de la collaboration interrégionale, les Régions œuvrent à remédier au morcellement de la forêt en aménageant des reconnexions (écoponts, écobuses, ponts suspendus…). Deux écoponts ont déjà été aménagés. L’un au niveau de la partie bruxelloise au-dessus de la ligne 161 (dans le cadre des compensations au projet de développement du RER), l’autre au niveau de la partie flamande dans le cadre du projet européen Life+ OZON au-dessus du Ring 0. Ces aménagements devraient améliorer la connectivité au sein du massif sonien et diminuer la mortalité de la faune forestière le long de ces axes routiers.
Une étude menée en 2019-2020 par la Région flamande a évalué l’impact de 3 dispositifs de reconnexion de la forêt de Soignes. Il en ressort notamment que l’écopont au niveau du Ring est fréquemment utilisée par la faune, dont en particulier renards et chevreuils (Natuurpuntstudie 2020). En outre, le nombre de victimes de la route a également diminué grâce aux barrières aménagées le long du ring. D’autres projets de reconnexion sont actuellement à l’étude.
À télécharger
Fiches documentées
- 01. Les mammifères en Région de Bruxelles-Capitale (.pdf) (en cours de mise à jour)
- 10. Habitats naturels dans les espaces verts bruxellois (.pdf)
- 19. Le chevreuil en Région bruxelloise (.pdf)
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Focus : Les mammifères en Région bruxelloise (édition 2019-2020) à paraître
- Focus : Habitat naturels dans les espaces verts bruxellois (édition 2007-2010)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Les mammifères en Région de Bruxelles-Capitale
- Carte « Fragmentation des espaces verts »
- Carte « Fragmentation des milieux ouverts et des milieux fermés »
Etudes et rapport
- ANONYME 2014. « La biodiversité en Wallonie - Evolution des populations - Grand gibier ». Accessed 28/05/2020, page web
- BRUXELLES ENVIRONNEMENT 2020. "Zoogdierenatlas van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", en attente de publication.
- CASAER, J., HUYSENTRUYT, VERCAMMEN, J, MALENGREAUX, C. & LICOPPE, A. 2018. “Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2017 (47) ». Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel (.pdf)
- HUYSENTRUYT F., VERCAMMEN J., MALENGREAUX C., LICOPPE A. , CASAER J. 2016. « Mission d’appui pour le recensement du chevreuil dans le massif sonien. Rapport annuel. Période de référence: 2008-2016 ». Wildlife and Man, ANB, SPW, BE-IBGE, 34pp. (.pdf)
- MALENGREAUX C., CASAER J. 2008. « Mission d’appui pour la mise en place d’un recensement chevreuil dans le massif sonien », étude effectuée par Wildlife & Man en partenariat avec l’INBO à la demande de Bruxelles Environnement (RBC), Agentschap Natuur & Bos (Rfl) et SPW (RW), 41 pp. (.pdf)
- NATUURPUNT 2020. « Van dwergspitsmuis tot wild zwijn: deze soorten profiteren van faunapassages in Zoniënwoud", in Natuurbericht, juni 2020. (en néerlandais uniquement)
- SPW - DIRECTION DE L’ETAT ENVIRONNEMENTAL 2017. « Rapport sur l’état de l’environnement wallon 2017 », 365 pp. (.pdf)
- WILDLIFE & MAN, INBO 2019. « IK en Forêt de Soignes - KI in Zoniënwoud - Résultats 2008-2019 /Resultaten 2008-2019 », étude effectuée à la demande de Bruxelles Environnement (RBC), Agentschap Natuur & Bos (Rfl) et SPW (RW). (.ppt)
Plans et programmes
Champignons et lichens
Focus - Actualisation : janvier 2014
Champignons et lichens remplissent des fonctions capitales au niveau des écosystèmes et constituent de ce fait des éléments importants de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). présente en Région bruxelloise. Ces deux groupes ont récemment fait l’objet d’un inventaire au niveau régional. L’atlas des champignons, couvrant la période 1980-2009, a permis d’inventorier 1038 espèces de basidiomycètes (champignons à chapeau notamment), soit près de 60 % des espèces recensées dans le Brabant flamand. Une dizaine de sites bruxellois, dont en particulier la forêt de Soignes, hébergent une biodiversité fongique importante. Cette étude a également mis en évidence une régression des champignons symbiotiques. L’inventaire des lichens, réalisé en 2011, a identifié 130 lichens épiphytes ce qui représente 65% de la flore de lichens épiphytes de la Région flamande. De manière générale, une évolution positive de la flore lichénique - à mettre en relation avec une réduction des émissions de polluants acidifiants - a également été observée.
Champignons et lichens : des organismes essentiels pour les écosystèmes
Tant les champignons que les lichens remplissent des fonctions importantes au niveau des écosystèmes : décomposition de la matière organique (champignons saprophytes), symbiose avec des plantes supérieures via les mycorhizes (champignons symbiotiques), parasitisme (certains champignons), ressources alimentaires et refuges pour de nombreux petits ou microscopiques organismes vivants (champignons et lichens), colonisation de nouveaux milieux (lichens), matériaux pour la construction de nids (lichens), etc. Par ailleurs, les champignons et les lichens sont de manière générale très sensibles à toute modification de leur environnement et constituent de ce fait de très bons bio-indicateurs. A cet égard, les lichens sont particulièrement sensibles à la pollution atmosphérique. De manière générale, plus l’air est pollué, moins grande est la variété d’espèces. En outre, les différentes espèces de lichens ne réagissent pas de la même manière à différents types de polluants.
Atlas des champignons
L’atlas des champignons du Brabant flamand et de la Région de Bruxelles-capitale a été réalisé par l’asbl Natuurpunt avec, entre autres, le soutien de Bruxelles Environnement. Il couvre la période 1980-2009 et englobe les basidiomycètes (champignons à chapeau notamment) et les myxomycètes (organismes qui, bien qu’ils ne soient plus actuellement considérés comme des champignons, sont toujours étudiés par les mycologues). Les ascomycètes (levures, moisissures, truffes, morilles, etc.) sont par contre exclus de l’inventaire.
Les observations réalisées au niveau bruxellois ont permis d’inventorier 1038 espèces de basidiomycètes soit près de 60 % des espèces recensées dans le Brabant flamand. 35 espèces de myxomycètes et 217 espèces d’ascomycètes ont également été observées en Région bruxelloise.
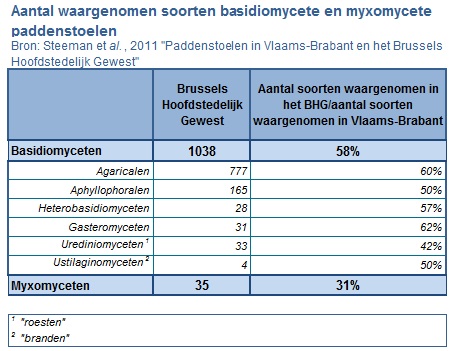
Une dizaine de sites bruxellois hébergent une biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). fongique importante. Celle-ci est particulièrement marquée en forêt de Soignes, refuge de très nombreuses espèces, y compris d’espèces rares et menacées. Cette diversité s’explique notamment par la variété des sols, des biotopes et des essences présentes ainsi que par l’étendue du massif. Le caractère historique de cette forêt ancienne, la protection dont elle bénéficie, la présence locale de nombreux arbres âgés ainsi que d’un volume relativement important de bois mort concourent également à expliquer cette richesse. Si l’on tient compte de données historiques antérieures à 1980, les auteurs de l’atlas estiment que plus de 1000 espèces différentes de champignons y ont été inventoriées. Cette diversité apparaît cependant inégalement répartie à l’intérieur du massif sonien, les zones les plus riches se trouvant principalement dans les réserves naturelles. Les champignons sont également particulièrement présents au niveau des terrains humides et des zones riches en calcaire.
De manière générale, les auteurs de l’atlas ont constaté une régression des espèces symbiotiques (phénomène également observé en Brabant flamand et aux Pays-Bas) et des myxomycètes alors que la tendance est inverse pour les saprophytes. Les champignons symbiotiques ectomycorhiziques (c’est-à-dire ceux dont les filaments ne pénètrent pas dans les cellules du végétal), très répandus chez les macromycètes (« grands champignons »), sont les plus menacés. Cette évolution est liée à la perte de leurs habitats naturels, à la sur fréquentation de certains espaces verts (tassement du sol) ainsi qu’à des phénomènes d’eutrophisationApport excessif d'éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème. (évacuation insuffisante des produits de tonte et des feuilles mortes, pollution atmosphérique, apport azotés). Le recul apparent des myxomycètes pourrait par contre être attribué au fait qu’ils sont plus difficilement observables et connus pas un nombre restreint de spécialistes.
Inventaires des lichens épiphytes
Les lichens résultent d’une association symbiotique entre un champignon et une algue. Les lichens épiphytes sont ceux qui utilisent comme support les troncs, branches ou feuilles des arbres.
Les données ci-dessous fournissent un aperçu de la richesse en lichens épiphytes observée en Région bruxelloise à différentes périodes. Lors de l’inventaire de 2011, 130 lichens épiphytes ont été recensés en Région bruxelloise ce qui représente 65% de la flore de lichens épiphytes de la Région flamande.
Même si ces données ne sont pas vraiment comparables entre elles (notamment parce que dans le cadre de l’inventaire de 2011 pratiquement 2 fois plus d’arbres ont été investigués que lors de l’inventaire précédant), elles mettent néanmoins en évidence le fait qu’après une période de net déclin, la tendance s’est inversée au cours de la dernière décennie.
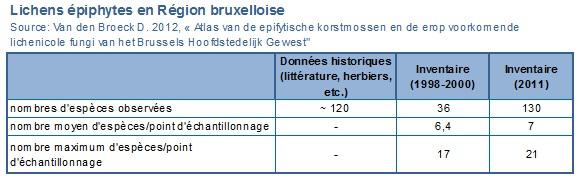
Cette évolution positive est à mettre en relation avec une réduction des émissions de polluants acidifiants et, plus particulièrement, d’oxydes de soufre. Les recherches menées dans le cadre de l’inventaire ont aussi permis de mettre en évidence le fait que dans les conditions environnementales prévalant actuellement en Région bruxelloise, les facteurs ayant le plus d’impacts sur la richesse en espèces et le type de lichens présents au niveau local sont la circonférence des arbres ainsi que les concentrations en dioxydes d’azote et en particules fines. Là où ces concentrations sont élevées, la diversité et la croissance des lichens est moindre.
Mesures en faveur de la biodiversité fongique et lichénique
Les dispositions prises par la Région en faveur de la conservation des espaces verts, de l’amélioration des habitats naturels et de la réduction des pollutions - de l’air en particulier - participent également à la protection de la flore fongique et lichénique.
Plus spécifiquement, pour les champignons, on peut notamment citer le maintien de la diversité des milieux, la restauration des zones humides, la conservation d’arbres âgés et de bois mort, la non évacuation systématique des cadavres d’animaux sauvages, la restriction de l’accès du public à certaines zones, la création de réserves naturelles intégrales, le choix des engins utilisés pour les travaux forestiers ou encore, la limitation de l’enrichissement du milieu en éléments nutritifs (par exemple, en évacuant les tontes et feuilles mortes dans les parcs). Par ailleurs, la cueillette des champignons est totalement interdite en Région bruxelloise depuis 2002 (sauf dérogations d’ordre scientifique ou pédagogique).
En ce qui concerne les lichens, certaines mesures de gestion plus spécifiques peuvent également être prises : maintien de zones plus sauvages dans les parcs, plantations d’arbres tenant compte de leur attractivité pour les lichens (écorce acide pour les lichens acidophiles, écorces rugueuses, etc.), préservation de gros arbres, etc...
Sources principales :
- STEEMAN R., ASPERGES M., BUELENS G., DE CEUSTER R., DECLERCQ B., KISZKA A., LEYSEN R.,MEUWIS T., MONNENS J.,ROBIJNS J., VAN DEN WIJNGAERT M., VAN ROY J., VERAGHTERT W. & VERSTRAETEN P. 2011. “Paddenstoelen in Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 1980-2009. Verspreiding en ecologie”, Natuurpunt Studie, étude réalisée notamment avec le soutien de Bruxelles Environnement.
- VAN DEN BROECK D. 2012. « Atlas van de epifytische korstmossen en de erop voorkomende lichenicole fungi van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, étude effectuée à la demande de Bruxelles Environnement, Jardin Botanique National de Belgique, 161 pp.
À télécharger
Espèces exotiques envahissantes
Indicateur - Actualisation : juin 2023
La propagation d’espèces exotiques envahissantes dans l’environnement constitue l’une des causes majeures d’atteinte à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore).. Les espèces envahissantes peuvent également avoir des impacts économiques et sanitaires importants.
Parmi les 88 espèces de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes adoptée au niveau de l'Union européenne, 20 espèces ont été observées en Région bruxelloise. Plusieurs dizaines d’autres espèces, non ciblées par la liste européenne mais figurant dans l’annexe de l’ordonnance nature sur les espèces invasives et/ou dans la base de données du forum belge sur les espèces invasives, sont également présentes en Région bruxelloise.
Des impacts sur les écosystèmes mais aussi parfois sur la santé humaine et sur l’économie
Depuis des siècles, l’homme a introduit, volontairement ou accidentellement, des espèces animales et végétales ainsi que des champignons et microorganismes en dehors de leur aire naturelle de distribution. Certaines d’entre elles s’acclimatent aux conditions locales, parviennent à se reproduire et se dispersent parfois largement en colonisant notamment des habitats semi-naturels. Ces espèces sont de plus en plus nombreuses en raison de la mondialisation croissante de l’économie et de l’explosion du tourisme.
La propagation de certaines de ces espèces exotiques dans notre environnement est susceptible d’entraîner la disparition d’espèces indigènes et d'altérer fortement le fonctionnement des écosystèmes (compétition avec les espèces locales pour la nourriture ou les lieux de reproduction, comportement envahissant en l’absence ou en présence réduite d’ennemis naturels, prédation excessive, envahissement des plans d’eau, transmission de pathologies…). La présence de ces espèces exotiques, qualifiées d’invasives ou envahissantes, constitue une pression majeure sur la biodiversité et les écosystèmes.
Elles peuvent également avoir des impacts économiques (dégâts aux cultures, restriction d’activités telles que la navigation ou les loisirs aquatiques, mesures de régulation et mesures de restauration de la biodiversité,...) et sanitaires (maladies infectieuses, allergies, brûlures de la peau,…) non négligeables. Dans un article publié dans la revue Nature, une équipe de recherche internationale (Diagne et al. 2021) a estimé que la présence de ces espèces exotiques a coûté au moins 1 288 milliards de dollars US entre 1970 et 2017 à l’échelle planétaire. Le coût annuel moyen a triplé à chaque décennie, jusqu'à atteindre 162,7 milliards de dollars pour la seule année 2017. Cette somme est 20 fois supérieure aux budgets combinés de l'OMS et du Secrétariat de l'ONU de la même année.
Compte tenu de ces différents impacts, les espèces exotiques envahissantes font l’objet d’études qui s’attachent à observer leur présence et leur progression, à caractériser leur écologie et leurs effets possibles ainsi qu’à identifier les mesures de gestion à mettre en œuvre afin de limiter ceux-ci.
Un cadre légal européen concernant les espèces exotiques envahissantes
Un règlement européen relatif aux espèces exotiques envahissantes est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il a pour objectif de prévenir et de limiter autant que possible l'impact négatif de l’introduction et de la propagation au sein de l’Union européenne d’espèces exotiques envahissantes en apportant une réponse globale et coordonnée entre les Etats membres.
Le règlement s’applique à un certain nombre d’espèces reprises dans une liste établie sur base de différents critères incluant notamment la capacité des espèces à se propager dans l’environnement et leur impact négatif important sur la biodiversité, la santé humaine ou l’économie. L’inclusion dans la liste tient également compte de la nécessité de mener une action concertée au niveau de l’Union européenne et de l’efficacité présumée des mesures qui seront prises. L’évaluation scientifique des risques est contrôlée par une plate-forme scientifique rassemblant des experts des 27 Etats membres.
Cette liste doit faire l’objet de mises à jour régulières ainsi que d’un réexamen complet au moins tous les 6 ans. Adoptée en 2016, elle a été actualisée à trois reprises (2017, 2019 et 2022) et comporte actuellement 88 espèces préoccupantes pour l'Union européenne. La plupart d’entre elles sont encore très peu présentes en Europe, mais leur prolifération pourrait causer d’importantes nuisances à l’environnement. Leur impact peut toutefois être atténué au travers d’une action concertée en Europe.
Les mesures applicables à ces 88 espèces incluent :
- des mesures de prévention (interdiction de détention, commerce, transport, élevage et mise en liberté) ;
- la mise en place d’un système de surveillance permettant de détecter le plus rapidement possible la présence des espèces exotiques envahissantes ;
- l’éradication rapide des espèces ciblées observées pour la première fois (responsabilité partagée entre les pouvoirs publics et les propriétaires des terrains concernés) ;
- le contrôle optimal des espèces ciblées qui sont déjà largement répandues (idem).
Selon le règlement, les Etats membres peuvent par ailleurs établir leur propre liste nationale des espèces envahissantes qui nécessitent une coopération régionale renforcée.
Et un cadre légal régional et national
En Région bruxelloise, l’ordonnance nature adoptée en 2012 prévoit la mise en œuvre de mesures visant à prévenir l'apparition de nouvelles espèces invasives sur le territoire régional et à atténuer l'impact, y compris éventuellement par des mesures d’éradication, des espèces invasives qui y sont déjà présentes. Elle interdit également la plantation d’espèces non indigènes dans les réserves naturelles. Elle comporte dans son annexe IV une liste d’espèces considérées comme invasives par la législation bruxelloise (28 espèces animales et 46 espèces végétales, 21 de ces espèces sont également incluses dans la liste européenne).
Pour tenir compte des nouvelles dispositions européennes et assurer une cohérence entre les législations européennes et bruxelloises, une adaptation du cadre légal régional s’avère nécessaire. Dans ce contexte, un avant-projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes est en cours d’adoption. Ce projet consacre notamment un système de trois listes adoptées respectivement au niveau européen (voir ci-dessus), belge et bruxellois et exclusives l’une de l’autre. Une quatrième liste, la liste d’alerte, reprend les espèces exotiques non encore largement répandues mais dont il apparaît opportun d’assurer un suivi.
Ce système tient compte du fait que de nombreuses espèces exotiques présentes en Région bruxelloise et/ou en Flandre et en Wallonie ne sont pas reprises dans la liste européenne bien qu’elles soient également problématiques.
Par ailleurs, compte tenu du caractère transfrontalier de cet enjeu, un accord de coopération visant à coordonner les actions entreprises au niveau régional, communautaire et fédéral a été adopté (voir ci-dessous). La liste nationale, prévue dans cet accord, n’a pas encore été constituée.
Dans l’attente d’une telle liste, la base de données « Harmonia » sur les espèces invasives menaçant la biodiversité indigène, élaborée et mise à jour par le forum belge sur les espèces invasives, constitue une référence en la matière. Cette base de données comporte actuellement 102 espèces présentes en Belgique dont 44 appartenant à la liste noire (espèces ayant un impact environnemental élevé). Près de deux tiers de ces espèces envahissantes sont des plantes vasculaires (base de données consultée en juin 2023).
20 espèces exotiques envahissantes de la liste européenne observées
20 espèces de la liste européenne des espèces exotiques envahissantes ont été observées en Région bruxelloise. 13 d’entre elles figurent aussi dans la liste bruxelloise des espèces invasives figurant dans l’ordonnance Nature. Un tiers de ces 20 espèces constitue des plantes terrestres ou aquatiques. Le reste se répartit entre 4 espèces d’invertébrés et 9 espèces de vertébrés (1 reptile, 2 poissons, 2 oiseaux, 4 mammifères).
Notons que pour certaines espèces, telles que le ragondin, le nombre d’observations est extrêmement limité (2 dans l’exemple mentionné). Par ailleurs, une de ces espèces n’a plus été inventoriée depuis 2004.
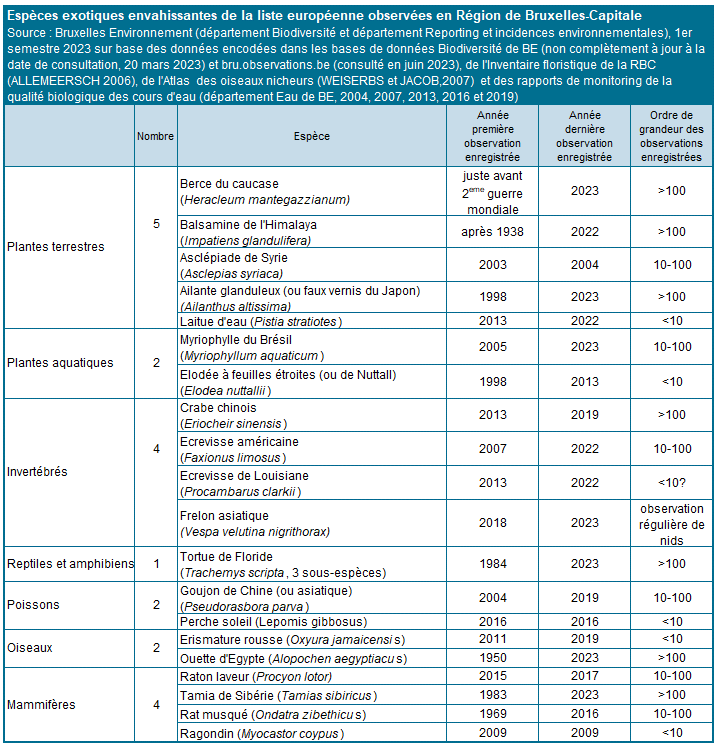
Un muntjac de Reeves (Muntiacus reevesi), espèce figurant sur la liste europenne des espèces exotiques envahissantes, a également été observé en juillet 2016. Il s’agissait d’un individu captif échappé accidentellement et qui a pu être attrapé. Compte tenu de ces circonstances, l’espèce n’est pas reprise dans le tableau ci-dessus.
Lien vers la carte interactive des espèces exotiques envahissantes de l’Atlas Geodata (Bruxelles Environnement).
Et 39 autres espèces reprises sur la liste bruxelloise également observées
53 espèces de la liste bruxelloise des espèces invasives (annexe IV de l’Ordonnance nature) ont été observées sur le territoire régional dont 39 ne figurant pas dans la liste européenne. Il s’agit par exemple du canard mandarin (Aix galericulata), de la bernache du Canada (Branta canadensis), de la coccinelle asiatique (Harmonia axyridis), des 3 espèces de perruches présentes en Région bruxelloise (Myiopsitta monachus, Psittacula eupatria, Psittaculka krameri), de la grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) ou encore, parmi les plantes, de la renouée du Japon (Fallopia japonica), de l’Ambroisie annuelle (Ambrosia artemisiifolia), du rhododendron pontique (Rhododendron ponticum), du robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ou du cerisier tardif (Prunus serotina).
De nombreuses espèces exotiques envahissantes présentes en forêt de Soignes et dans d’autres espaces semi naturels
Les nombreuses observations d’espèces exotiques envahissantes de la liste européenne en forêt de Soignes sont notamment liées au fait que le tamia de Sibérie (Tamias sibiricus), communément désigné sous le nom d’écureuil de Corée et qui figure dans la liste européenne, y est très commun.
La population d’écureuils de Corée s’y est établie à partir d’individus d’élevage échappés ou relâchés dans les années ’60-’70. En l’absence de prédateurs naturels, ils se sont multipliés et ont connu en peu de temps une croissance exponentielle. Ces écureuils sont maintenant très largement présents, essentiellement en forêt de Soignes et ses abords. Moins craintif et moins arboricole que l’écureuil roux (Sciurus vulgaris), l’écureuil de Corée est facilement observable. Dans la mesure où les deux espèces occupent des niches écologiques différentes, elles ne devraient en principe pas se faire de concurrence. Cependant, du fait que l’écureuil de Corée se constitue des réserves de nourriture très importantes et que le nombre d’individus est très élevé, une concurrence alimentaire avec l’écureuil roux et autres mammifères ainsi qu’avec les oiseaux granivores n’est pas à exclure, en particulier durant les années pauvres en graines. Les données disponibles sur le sujet n’ont néanmoins pas permis de détecter d’impacts de cette espèce sur la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). en forêt de Soignes.
D’autres animaux exotiques envahissants s’observent également fréquemment en forêt de Soignes, par exemple, la perruche à collier (Psittacula krameri) (surtout en lisière), le canard mandarin (Aix galericulata), le canard carolin (Aix sponsa), la tortue de Floride (Trachemys scripta) ou encore, la grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus).
En ce qui concerne les plantes, certaines espèces exotiques comme la renouée du Japon (Fallopia japonica), la balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) et le cerisier tardif (Prunus serotina) peuvent se montrer très envahissantes et provoquer localement un appauvrissement important de la flore. Leur présence nécessite, dans certains cas, une gestion adaptée pour enrayer leur progression. Outre son potentiel envahissant, la berce du Caucase contient des substances chimiques "photo-sensibilisantes" susceptibles d’occasionner de sévères brûlures au contact avec la peau.
Plusieurs espèces de tortues présentes dans les étangs bruxellois
A Bruxelles, la tortue de Floride (Trachemys scripta) est présente dans de nombreux parcs présentant des zones humides et, notamment, dans le parc Josaphat (Schaerbeek), le parc Osseghem (Laeken), les étangs d’Ixelles, le Jardin Botanique (Saint-Josse-ten-Node), le parc des Etangs (Anderlecht), le parc de la Pede (Anderlecht), le Parc Roi Baudouin (Jette), le parc de Woluwe (Woluwe-Saint-Pierre). Elle est aussi présente en forêt de Soignes ou à sa lisière, par exemple, au niveau du site du Rouge-Cloître à Auderghem, aux étangs du Fer à cheval, des Enfants noyés ou encore, du parc Solvay à Watermael-Boitsfort. Beaucoup de ces tortues aquatiques ont été achetées dans les animaleries comme tortues d’agréments et relâchées ensuite par leur propriétaire dans les mares et les étangs des parcs et des forêts bruxelloises.
Plus marginalement, d’autres tortues nord-américaines ont été observées : Chrysemys picta bellii, Graptemys ouachitensis, G. pseudogeographica, Pseudemys concinna et P. nelsoni. La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est quant à elle régulièrement observée sur un site.
La tortue de Floride est originaire d’Amérique. Elle comprend de nombreuses sous-espèces dont 3 ont été identifiées à Bruxelles. L’espèce affectionne toutes les eaux stagnantes, même relativement polluées. Elle aime les marais et étangs à fond boueux, avec une abondante végétation. Dans les premières années de leur vie, les tortues de Floride sont de voraces carnivores se nourrissant d’organismes aquatiques : alevins, petits poissons, larves d’amphibiens et d’amphibiens eux-mêmes, d’insectes... Les adultes sont surtout végétariens mais peuvent également s’attaquer à des poissons, des amphibiens et des poussins d’oiseaux d’eau. Les dégâts que leur présence occasionne dans les milieux biologiquement riches peuvent donc s’avérer problématiques. En outre, les dommages que peuvent infliger ces tortues aux plantes aquatiques placées par les gestionnaires d’espaces verts représentent une perte économique. Enfin, les tortues importées peuvent constituer des vecteurs de maladies.
L’hibernation a lieu sous l’eau. Le climat prévalant en Région bruxelloise n’est pas (encore) assez chaud pour permettre la réussite de la reproduction mais des cas de reproduction de tortues aquatiques d’Amérique du Nord ont déjà été constatés en France, en Espagne, en Slovénie et en Italie. Les individus relâchés peuvent vivre plusieurs années dans la nature et même survivre à des hivers relativement durs.
Les cartes ci-dessous mettent en évidence l’expansion de la présence des tortues de Floride au cours de la dernière décennie dans la partie nord et centrale du pays. Notons que ces cartes ne sont pas établies à partir d’inventaires systématiques mais reposent en grande partie sur des données d’observations de type « crowdsourcing ». Leur interprétation doit aussi être nuancée dans la mesure où de plus en plus d’observateurs encodent des données sur la plateforme www.observations.be.
Observations de tortues à tempes rouges (Trachemys scripta elegans) dans et autour de la Région bruxelloise durant les périodes 2006-2009 et 2019-2022 (sur base des observations validées mentionnées sur le site observations.be)
Source: www.observations.be, consulté le 27/06/2023
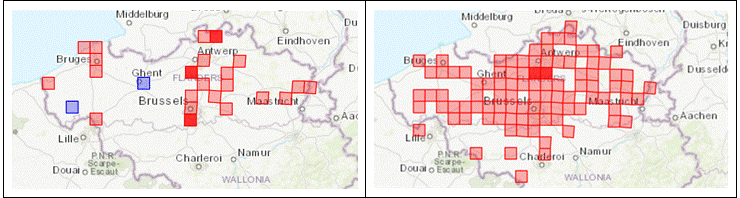
Un nouvel Atlas des Amphibiens et Reptiles couvre la période 2004-2019. La tortue de Floride est devenue l’espèce de reptile la plus répandue dans la Région (voir Focus Les amphibiens et reptiles de la Région bruxelloise).Elle y est observée dans de nombreuses zones humides de la Région.
En vertu du règlement européen sur les espèces exotiques invasives entré en vigueur en 2015, les tortues de Floride sont soumises à une interdiction totale d’importation, de détention, de commerce, de transport, d’élevage et de libération dans la nature.
Du côté des amphibiens, au moins deux espèces introduites naturalisées de grenouilles rieuses (la grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) et la grenouille rieuse d’Anatolie (Pelophylax cf. bedriagae)) sont présentes à Bruxelles. D’autres espèces de « grenouilles rieuses » (au sens large) sont susceptibles d’être présentes. Ce groupe des « grenouilles rieuses » est celui qui a connu la plus forte progression depuis l’atlas 1984-2003. Sa présence est préoccupante dans la mesure où les espèces concernées réalisent plusieurs pontes par an, ont une grande capacité de dispersion et peuvent s’hybrider avec la grenouille verte indigène. La grenouille rieuse figure dans la liste des espèces invasives de l’Ordonnance nature.
Des actions sont entreprises au niveau régional et national
De nombreuses actions sont déjà menées dont notamment:
- l’information et sensibilisation du grand public aux problèmes causés par certaines espèces envahissantes et aux actions qu’ils peuvent entreprendre pour les minimiser, y compris en ce qui concerne le nourrissage (info-fiches, brochures et dépliants, site Internet, etc.) ;
- l’information et sensibilisation des professionnels du secteur de l’horticulture visant à réduire la culture et la vente de plantes envahissantes et à encourager le recours à des espèces alternatives indigènes (via le co-financement du projet national LIFE+ « AlterIAS » mené entre 2010 et 2013) ;
- la diffusion d’informations (fiches techniques) et formation du personnel de terrain à la gestion de certaines plantes envahissantes ;
- la gestion sur le terrain d’espèces envahissantes particulièrement problématiques telles que par ex. le cerisier tardif (Prunus serotina), la renouée du Japon (Fallopia japonica), la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ou encore, les bernaches du Canada (Branta canadensis) ;
- le financement, via des marchés public ou des subventions, de projets visant à étudier l’impact potentiel de certaines espèces exotiques présentes en Région bruxelloise.
Compte tenu du caractère transrégional de la problématique, Bruxelles Environnement participe également à des groupes de travail, conseils d’experts ou comités d’accompagnement d’études qui sont organisés aux niveaux suprarégional et international.
A l’échelle nationale, comme explicité ci-dessus, un accord de coopération entre l’état fédéral et les trois régions a été adopté afin de coordonner certaines actions. Parmi les actions réalisées, on peut notamment citer la mise en place d’un site Web ainsi que l’élaboration d’un plan d'action relatif aux voies d’entrée et de déplacement des espèces exotiques envahissantes. Ce dernier a été approuvé en Commission interministérielle environnement le 22 juin 2022. Pour la Belgique, les voies d’entrées considérées comme les plus problématiques concernant l’introduction d’espèces invasives sont l’eau, le déplacement de terres ainsi que le commerce des nouveaux animaux de compagnie. Un rapport concernant la faisabilité de mise en œuvre de mesures d’éradication ou de limitation de dispersion pour une quarantaine d’espèces exotiques envahissantes visées par la règlementation européenne a également été réalisé via la collaboration de dizaines de gestionnaires et scientifiques issus des trois Régions du pays.
LIFE RIPARIAS, un projet interrégional qui cible des espèces exotiques envahissantes présentes notamment dans le bassins de la Senne
Lancé en 2021, le projet LIFE RIPARIAS (« Reaching Integrated and Prompt Action in Response to Invasive Alien Species »),co-financé par l’Union européenne et coordonné par Bruxelles Environnement, vise à optimiser la gestion de certaines espèces exotiques envahissantes en Belgique sur la période 2021-2026.
Ce projet qui rassemble dix partenaires des trois régions du pays, cible plusieurs espèces de plantes et écrevisses présentes en bordure de rivières et dans les étangs dans une zone pilote comprenant les bassins de rivière de la Dyle, Senne et Marcq. La continuité et la connexion des milieux aquatiques, qui facilitent les invasions et ré-invasions, rendent les efforts de gestion des espèces envahissantes liées à ces milieux particulièrement difficiles.
Le projet RIPARIAS inclut des actions de surveillance, de gestion des espèces exotiques envahissantes et de partage des connaissances (sélection des mesures adéquates à chaque situation, identification des espèces prioritaires et des sites prioritaires, etc.).
Les espèces ciblées par le projet sont des espèces qui perturbent fortement l’équilibre naturel des écosystèmes ripariens (à l’interface des écosystèmes terrestres et aquatiques) et aquatiques. Par exemple, les écrevisses exotiques sont capables de s’établir en forte densité dans diverses conditions environnementales. Omnivores, elles nuisent aux plantes indigènes, aux macro-invertébrés, aux amphibiens et aux poissons notamment en raison de la compétition et la prédation qu’elles exercent ainsi que de la transmission de maladies.
Certaines de ces espèces ciblées sont déjà répandues et abondantes dans la zone pilote tandis que d'autres sont des espèces émergentes avec une aire de répartition encore assez restreinte. D'autres sont actuellement absentes de la zone pilote du projet.
Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site Internet du projet.
À télécharger
Fiches méthodologiques
Fiches documentées
Fiches de l’Etat de l’Environnement
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Rapport sur l’état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale - synthèse, 2022 (.pdf)
- Carte “Espèces exotiques envahissantes”
- Amphibiens et reptiles en Région de Bruxelles-Capitale, 2017 (.pdf)
- Animaux sauvages : Ne les nourrissez pas, observez les !, 2017 (.pdf)
- Info-fiche : « La coccinelle asiatique – Harmonia axyridis» (.pdf)
- Info-fiche : « La perruche à collier et la perruche Alexandre – Psittacula krameri et Psittacula eupatria» (.pdf)
- Info-fiche « La conure veuve – Myiopsitta monachus» (.pdf)
- Info-fiche : « Plantes invasives de la Région de Bruxelles-Capitale - La Berce du Caucase – Heracleum mantegazzianum» (.pdf)
- Info-fiche : « Plantes invasives de la Région de Bruxelles-Capitale - La Renouée du Japon – Fallopia japonica» (.pdf)
- Info-fiche : « Plantes invasives de la Région de Bruxelles-Capitale - Le cerisier tardif – Prunus serotina» (.pdf)
- Info-fiche : « Plantes invasives de la Région de Bruxelles-Capitale - L’ambroisie annuelle – Ambrosia artemisiifolia» (.pdf)
Etudes et rapports
- ADRIAENS, T., BRANQUART, E., GOSSE, D., RENIERS, J., VANDERHOEVEN, S. 2019. “Feasibility of eradication and spread limitation for species of Union concern sensu the EU lAS Regulation (EU 1143/2014) in Belgium”. Report prepared in support of implementing the lAS Regulation in Belgium. Institute for Nature and Forest Research, Service Public de Wallonie, National Scientific Secretariat on Invasive Alien Species, Belgian Biodiversity Platform (.pdf). (anglais uniquement)
- DIAGNE, C., LEROY, B., VAISSIÈRE, AC. et Author Correction: “High and rising economic costs of biological invasions worldwide”. Nature 608, E35 (2022). (.pdf). (anglais uniquement)
- IPBES 2018. “The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia”, 892 pages (.pdf) (en anglais uniquement)
- Riegel , J., Lafontaine, R.-M., Pasteels, J. & Devillers, P. 2001. « Potential influence of the Siberian Chipmunk Tamias sibiricus (Laxmann) on the regression of the bird fauna of the Forêt de Soignes”, Brussels. Summary Cahiers d'Éthologie (.pdf)
Plans et programmes
Liens utiles
Surveillance des habitats naturels en Région bruxelloise
Focus - Actualisation : Décembre 2020
Les habitats d’intérêt communautaire (Natura 2000) ainsi que les habitats d’intérêt régional font l’objet d’un suivi scientifique. Celui-ci permet d’évaluer l’état de ces habitats et d’orienter les mesures de gestion. Pour la plupart des habitats, le nombre d’espèces clé de la strate herbacée et leur couverture s’avèrent insuffisants sur les zones échantillonnées. Les indicateurs liés à la perturbation et à la structure des habitats forestiers bénéficient très souvent d’une évaluation positive. Par contre, la présence de bois mort est le plus souvent insuffisante. Pour les milieux autres que forestiers, le suivi met notamment en évidence l’eutrophisationApport excessif d'éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème. de plusieurs habitats ainsi que l’excès de boues et le manque de structure horizontale dans les étangs suivis. Du côté des points positifs, on relève une présence non significative d’espèces invasives et une rudéralisation limitée ou inexistante.
Des habitats naturels protégés en Région bruxelloise
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels (zones spéciales de conservation) qui font l’objet d’un statut spécial de protection en raison des habitats ou des espèces qu’ils contiennent. La Région bruxelloise compte 10 types d’habitats naturels dits d’intérêt communautaire. Ceux-ci figurent dans l’annexe 1 de la directive Habitat reprenant notamment des habitats en danger de disparition ou dont l’aire de répartition est réduite.
De plus amples informations concernant la directive Habitats, les habitats d’intérêt communautaire présents et le suivi des espèces et habitats protégés par la législation européenne en Région bruxelloise sont disponibles dans les fiches documentées consacrées respectivement à l’état local de conservation des espèces des directives Habitats et Oiseaux, à la surveillance des habitats naturels, aux espaces semi-naturels et espaces verts bénéficiant d’un statut de protection ainsi que sur le site de Bruxelles Environnement (description des habitats d’intérêt communautaire présents en Région bruxelloise).
La législation bruxelloise introduit, via l’ordonnance nature, le concept d’habitats naturels d'intérêt régional (HIR). Ces derniers sont définis comme des «habitats naturels (…) pour la conservation desquels la Région a une responsabilité particulière en raison de leur importance pour le patrimoine naturel régional et/ou de leur état de conservation défavorable». Ces HIR se rapportent en grande partie à des habitats ouverts (prairies, roselières, etc.) qui tendent à se raréfier en Région bruxelloise de même que la flore et la faune qui leur sont inféodés. De plus amples informations concernant les HIR sont disponibles dans la fiche documentée consacrée aux espaces semi-naturels et espaces verts bénéficiant d’un statut de protection.
Les habitats d’intérêt communautaire et les HIR inclus en zone Natura 2000 ou dans des réserves naturelles font l’objet d’objectifs qui doivent permettre d’atteindre un « état de conservation favorable » et de mesures de gestion visant à atteindre ces objectifs.
Un suivi scientifique des habitats protégés
La directive Habitats impose d’effectuer un monitoring et un rapportage concernant l’état des habitats et espèces à l’échelle de la région biogéographique (région biogéographique atlantique en ce qui concerne la Région bruxelloise) et à l’échelle de la zone spéciale de conservation.
Au-delà de ces obligations, la Région bruxelloise, tout comme la Flandre et d’autres Etats membres, a souhaité développer un instrument permettant de déterminer l’état de conservation des espèces ou habitats au niveau local. Ceci répond à un besoin de disposer d’un instrument concret pouvant servir de base pour évaluer l’état de conservation aux niveaux supérieurs mais, également, de disposer d’un outil de suivi et d’évaluation permettant d’orienter les mesures de gestion sur le terrain.
Ce focus présente les résultats de la surveillance de l’état de conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire et d’intérêt régional à l’échelle locale effectuée en Région bruxelloise depuis 2011 (2011, 2012, 2016, 2018 et 2019).
La méthodologie d’évaluation se fonde sur des études scientifiques réalisées par l’Instituut voor Natuur- en Bos Onderzoek (centre flamand de recherche et de connaissances pour la gestion durable de la nature) et qui s’appuient notamment sur des documents de référence établis au niveau européen.
Cette méthode se base sur des paramètres définis pour chaque habitat et qui permettent de décrire son état de conservation. Ces paramètres ont été déclinés en un ou plusieurs indicateurs reflétant la perturbation de l’habitat, sa qualité et sa structure (composantes physiques d’un type d’habitat, dimensions, relations spatiales, etc.). Pour chaque indicateur, on compare la valeur observée à des valeurs de référence, ce qui détermine une note par indicateur.
Les protocoles d’échantillonnage, de travail de terrain et d’évaluation ont été progressivement améliorés d’une campagne à l’autre. L'objectif principal étant d’arriver à une standardisation de l’échantillonnage et de la méthodologie d’évaluation afin de pouvoir comparer les données entre elles (d’un site à l’autre ou d’une campagne à l’autre). La méthodologie d’évaluation est décrite de manière détaillée dans la fiche documentée consacrée à la surveillance des habitats naturels en Région bruxelloise.
Les résultats sont présentés pour les habitats forestiers, d’une part, et pour les autres habitats, d’autre part. Notons que certains habitats Natura 2000 sont assez hétérogènes d’un point de vue écologique. De ce fait, certains d’entre eux ont fait l’objet d’une subdivision en sous-types plus pertinents.
La plupart des habitats forestiers suivis ont une bonne structure mais insuffisamment de bois mort
Pour chaque habitat et chaque indicateur évalués, les tableaux indiquent le pourcentage de zones d’échantillonnage visitées qui se trouvaient dans un état de conservation favorable pour l’indicateur considéré.
Le tableau ci-dessous se rapporte aux habitats forestiers d’intérêt communautaire présents en Région bruxelloise :
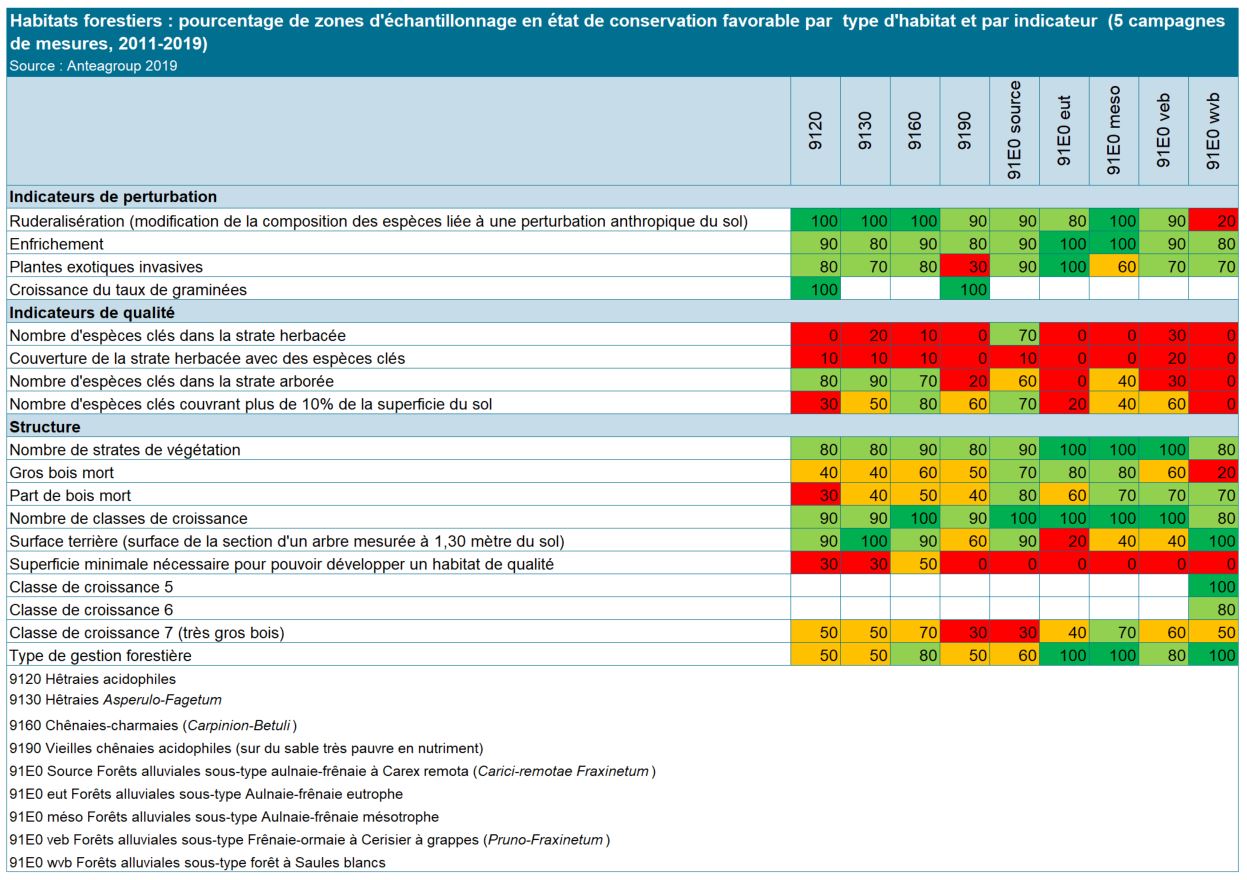
Les résultats obtenus lors de l’évaluation 2019 suivent dans les grandes lignes les mêmes tendances que celles qui ressortent des 5 évaluations effectuées sur la période 2011-2019.
En ce qui concerne les indicateurs de perturbation, les habitats forestiers échantillonnés obtiennent généralement de bons résultats. Les principales perturbations se rapportent à la présence, en proportion importante, d’espèces exotiques invasives au niveau de l’habitat 9190 (vieilles chênaies acidophiles où l’on retrouve du Chêne d’amérique, du Robinier faux-acacia, du Laurier-cerise, etc.) et, dans une moindre mesure, de l’habitat 91E0 sous-type Aulnaie-Frênaie mésotrophe. L’habitat 91E0 Forêts alluviales sous-type forêt à Saules blancs apparaît quant à lui fortement impacté par une rudéralisation (perturbation du sol liée à l’intervention humaine) marquée par une forte présence d’orties et de gaillets gratteron. Cette évolution pourrait être liée à un assèchement du milieu.
De manière générale, on observe un manque d’espèces clés sur les zones échantillonnées, surtout au niveau de la strate herbacée. La présence limitée d'espèces clés dans les placettes d’échantillonnage apparaît comme l’une des contraintes principales dans la réalisation d’un état de conservation favorable de ces habitats. Néanmoins, si l’on considère l’ensemble du massif forestier, les espèces clés sont présentes en grande partie dans les 5 types d’habitats forestiers. Ceci signifie qu’il existe un potentiel de développement qualitatif particulièrement bon mais que de nombreuses espèces clés sont relativement rares et trouvent un nombre limité d'endroits où les conditions de croissance sont favorables. Par ailleurs, les parcelles visitées ne sont pas pauvres en espèces mais, dans la plupart des cas, les espèces clés différenciant les habitats sont absentes ou sous-représentées.
Les habitats forestiers obtiennent de bons résultats pour les paramètres structurels tels que le nombre de strates de végétation et le nombre de classes de croissance. En plus d'une strate de mousses, d'herbes, d'arbustes et d'arbres, les habitats forestiers présentent également une strate arborée comportant différentes hauteurs. Notons que la classe de croissance 7, correspondant à des troncs très épais, n'a pas été trouvée dans tous les habitats forestiers. Néanmoins, le respect de ce critère n’est pas indispensable pour que la structure horizontale soit évaluée comme étant dans un état de conservation favorable.
La “surface structurelle minimale” est la surface minimale nécessaire pour que tous les stades de développement de la forêt soient continuellement présents côte à côte, sans intervention humaine. Sa taille dépend du type de forêt. La plupart des habitats forestiers obtiennent de mauvais résultats pour ce paramètre de structure, ce qui est à mettre en relation avec la fragmentation du massif forestier sonien. Ces résultats doivent cependant être interprétés avec prudence en particulier du fait que seules les surfaces présentes en Région bruxelloise ont été prises en compte pour l’évaluation de ce paramètre, sans tenir compte des superficies d’habitats à cheval avec la Région flamande. La méthode et l’interprétation actuellement utilisées pour évaluer cet indicateur sont sujettes à caution et pourraient être revues dans le futur.
Excepté pour certains sous type de forêts alluviales, la présence de bois mort est insuffisante (trop peu de bois mort de grande dimension et proportion trop faible de bois mort).
Généralement de bons scores pour les indicateurs liés à la perturbation des prairies et milieux humides suivis
Le tableau ci-dessous se rapporte aux habitats, autres que forestiers, d’intérêt communautaire ou régional de la Région bruxelloise :
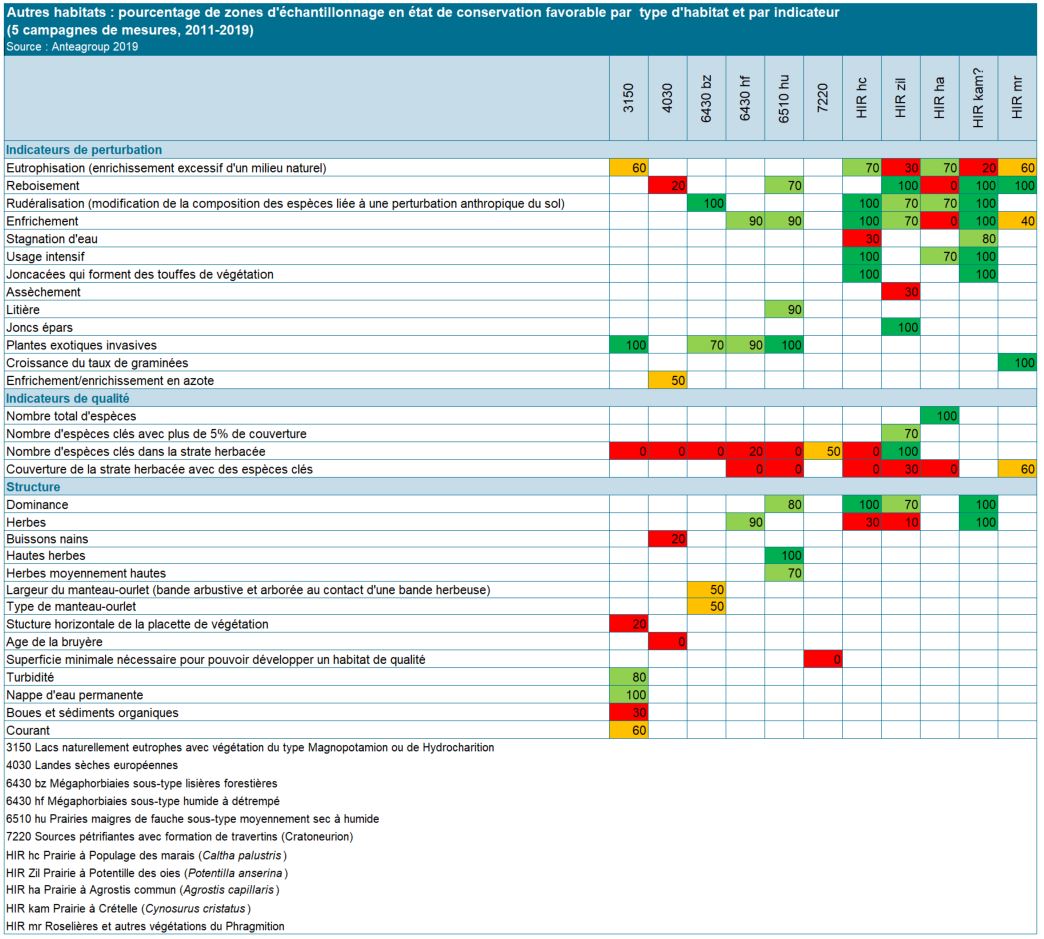
Parmi les indicateurs ayant des mauvais scores sur la majorité des sites échantillonnés, on peut notamment citer :
- La fréquente insuffisance d’espèces clés et ou de couverture par les espèces clés dans la strate herbacée ;
- L’eutrophisationApport excessif d'éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème. ou l’enrichissement excessif en azote de certains milieux (étangs, roselières, landes sèches, prairies à Potentille des oies, prairies à Crételle) ;
- L’excès de boues et de sédiments et l’insuffisance de structure horizontale dans les étangs suivis.
De plus amples informations sont disponibles dans la fiche documentée consacrée à la surveillance des habitats naturels en Région bruxelloise.
Du côté des éléments positifs, relevons les bons scores associés à certains critères dont, en particulier, la présence non significative d’espèces invasives et une rudéralisation limitée ou inexistante.
La plupart des habitats de bruyère sont dans un état défavorable
En forêt de Soignes, les landes sèches constituent un habitat relictuel subsistant avec une superficie limitée sur certains sites. Ce type d'habitat, dans le contexte du massif sonien, est dès lors davantage considéré comme un élément de qualité structurel des habitats forestiers acidophiles. Il joue un rôle important et efficace en tant qu'habitat pour des espèces d'intérêt européen et régional telles que des Chauves-souris, l'Orvet fragile (Anguis fragilis), le Lézard vivipare (Lacerta vivipara), etc.
Lorsque l'on examine les évaluations faites sur les habitats européens “lande sèche” durant la période d’évaluation 2011-2019, on constate que la plupart des points d’échantillonnage présentent quelques lacunes. Soit l'habitat est absent et correspond plutôt à une situation boisée, soit l'habitat est complètement dégradé. Le tableau montre donc que les habitats de bruyère sont dans un état défavorable en raison notamment des critères “ reboisement” et “présence d'espèces clés”.
À télécharger
Fiches documentées
- 10. Habitats naturels dans les espaces verts bruxellois (.pdf)
- 18. Etat local de conservation des espèces des directives habitats et oiseaux en Région bruxelloise (.pdf)
Thème « Occupation des sols et paysages bruxellois »
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Sites semi-naturels et espaces verts protégés
- Focus : Etat local de conservation des espèces couvertes par les directives "Habitats" et "Oiseaux" (édition 2015-2016)
- Focus : Habitat naturels dans les espaces verts bruxellois (édition 2007-2010)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Rapport sur l’état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale, 2012 (.pdf)
- Carte « Habitats Natura 2000 »
- Carte « Sites Nature »
Etudes et rapports
- ANTEA GROUP 2019 « Opvolging van de lokale staat van instandhouding van de habitattypes van communautair en gewestelijk belang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gegevensverzameling 2019 », rapport effectué pour le compte de Bruxelles Environnement. (.pdf)
- BOSCH H., HOFFMANN M., VAN DEN BERGH E., VANDEVOORDE B., PROVOOST S. 2009. "Criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000-habitattypen. Versie 2.0", rapport de l’Instituut voor natuur- en Bosonderzoek 2009 (46) , INBO, Brussel. (.pdf)
- BRUXELLES ENVIRONNEMENT (VANWIJNSBERGHE S., REINBOLD G., VAES F., ENGELBEEN M., VAN DER WIJDEN B., BECK O., ROTSAERT G., DO U.) 2019. « Plan de gestion de la Forêt de Soignes bruxelloise Livre I - Etat des connaissances », Bruxelles. (.pdf)
- DE BIE E., WOUTERS J., OOSTERLYNCK P., DE SAEGER S., DENYS L., VANDEKERKHOVE K., THOMAES A., DE KEERSMAEKER L., VANDENBORRE J. & PAELINCKX D. 2018. "Beoordelingskader voor ‘regionaal belangrijke biotopen’ (rbb) en andere natuurstreefbeelden", rapport final, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018, Brussel. (.pdf)
Plans et Programmes
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre I, Etat des connaissances, 2019 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre II, Objectifs et mesures de gestion, 2019 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre III, Plans de gestion des réserves archéologiques, naturelles et forestières, 2019 (.pdf)
- Plan régional nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale (.pdf)
Habitats naturels dans les espaces verts bruxellois
Focus - Actualisation : décembre 2011
Malgré son caractère urbain et sa superficie limitée (16 138 hectares), le territoire bruxellois abrite une diversité importante d’habitats naturels.
Superficies des habitats forestiers, herbeux et humides en Région de Bruxelles-Capitale
Source: Bruxelles Environnement, département Stratégie Espaces Verts (2012)
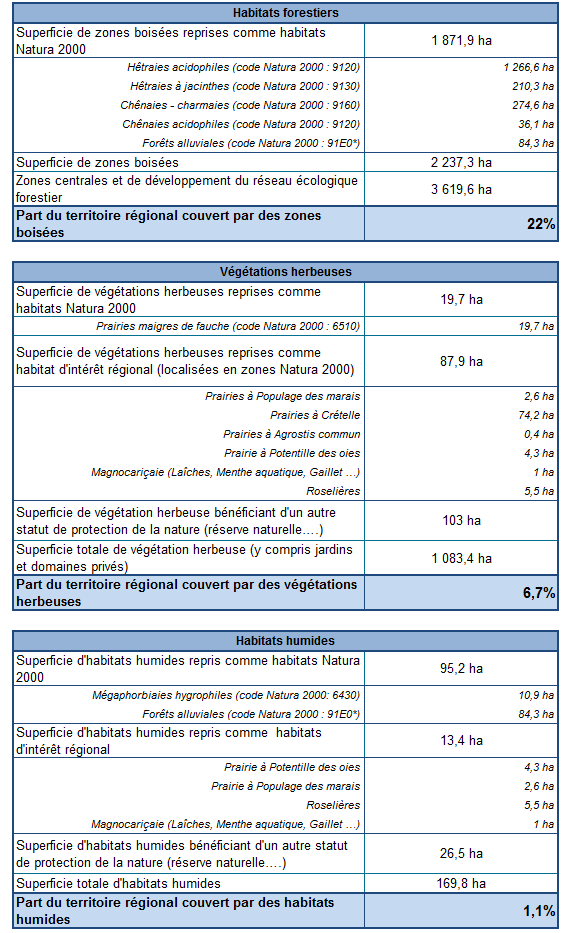
Habitats forestiers
Du fait de la présence de la forêt de Soignes (1 657 ha en Région bruxelloise), les habitats forestiers sont largement représentés puisqu’ils couvrent près de 3 620 ha soit 22% du territoire. Ce chiffre inclut des « zones centrales » (grands domaines boisés) - c’est-à-dire des sites de haute valeur biologiqueValeur reconnue d'un site coté sur base d'une série de critères tels que : la présence d'éléments hydrologiques peu perturbés (sources), la diversité et la rareté des espèces locales de plantes et d'animaux, la présence d'espèces rares, la maturité des végétations (site irremplaçable sauf à très long terme, ex. une forêt séculaire), etc. (avérée ou potentielle) d’importance majeure pour le fonctionnement du réseau écologique bruxellois (ensemble de zones dont la gestion doit contribuer à préserver ou restaurer un état de conservation favorable d’espèces et d’habitats) - ainsi que des « zones de développement » qui sont également des zones intéressantes en terme de biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). mais qui peuvent être davantage imbriquées dans le tissu urbain (jardins résidentiels, parcs urbains, etc .).
La plupart des habitats forestiers ont une haute valeur biologique s’expliquant notamment par la moyenne d’âge élevée des arbres, la diversité du relief et des sols et l’ancienneté de l’occupation par la forêt. La présence de certains types d’habitats forestiers considérés comme rares et/ou typiques au niveau européen a d’ailleurs permis à 1 872 ha de bois et forêts, essentiellement publics, d’être intégrés dans le réseau des habitats d’intérêt communautaire « Natura 2000 » faisant l’objet d’un statut de protection particulier. Dans la partie bruxelloise de la Forêt de Soignes, 112 ha sont en outre protégés en tant que réserve forestièreLa réserve forestière est une forêt ou une partie de celle-ci, protégée dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables, ou des peuplements d'essence indigène, et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu., dont 36 ha en réserve intégrale.
Selon une première évaluation de l’état de conservation des habitats naturels bruxellois (encore partielle au niveau de la forêt de Soignes et réalisée selon les critères très sévères imposés par la directive « Habitats » 92/43/CEE), seule une part limitée des habitats forestiers se trouve actuellement en état de conservation favorable. Cependant différents critères et indicateurs donnent de relativement bons résultats. En outre, la présence observée de plus de 90% des espèces caractéristiques de ces types d’habitats revèle qu’il existe un bon potentiel d’amélioration qualitative de ces milieux.
L’amélioration de l’état de conservation de ces habitats repose avant tout sur des modifications de la structure (répartition verticale et horizontale des arbres) et de la composition de la végétation ainsi que sur une présence accrue de bois mort. Dans certaines stations forestières, les perturbations liées aux activités récréatives ou à des rejets d’eaux polluées constituent également une priorité. Localement, la présence d’espèces exotiques envahissantes s’avère aussi problèmatique.
Habitats de prairies et végétations herbeuses
En Région bruxelloise, les formations herbeuses sont surtout localisées dans les zones rurales relictuelles et, dans leurs formes ornementales ou récréatives, dans les parcs et jardins. Avec une superficie de 1 083 ha, ces habitats couvrent près de 7% du territoire et sont gérés par des acteurs très variés.
Seule une faible part (20 ha) des végétations herbeuses présentes en Région bruxelloise relève des habitats d’interêt communautaire. Cependant, près de 90 ha de prairies, roselières et magnocariçaies se trouvent en zone Natura 2000 et sont considérés par la nouvelle ordonnance relative à la conservation de la nature comme des « habitats naturels d’intérêt régional » en raison de leur importance pour le patrimoine naturel régional et/ou de leur état de conservation défavorable. Par ailleurs, plus de 100 ha de formations herbeuses bénéficient du statut de réserve naturelleZone constituée par un organisme public ou privé en vue de préserver un spécimen représentatif d'une communauté végétale et animale (biocénose) donnée, principalement dans un but d'ordre scientifique et éducatif. . Il n’en reste pas moins que 80% des prairies et autres végétations herbeuses présentes sur le territoire régional - et incluant parfois des biotopes très intéressants - ne bénéficient pas de statut de protection de la nature. De manière générale, la majeure partie de ces espaces verts ne font pas l’objet d’une gestion écologique adéquate.
Habitats humides
Les vallées de la Senne et de la Woluwe ont doté la Région de nombreuses zones humides. Sous la pression de l’urbanisation, ces milieux ont progressivement disparus et couvrent actuellement de l’ordre de 170 ha, pour moitié localisée en forêt (notons que certains certains types d’habitats forestiers et herbeux sont également des habitats humides). Ces habitats jouent pourtant un rôle considérable au niveau de l’environnement urbain : épuration naturelle des eaux, protection contre les inondations, support à la biodiversité, stockage de CO2, valeur paysagère et pédagogique, ... .
80% des milieux humides bénéficient d’un statut de protection en tant qu’habitat d’intérêt communautaire ou régional et/ou comme réserve naturelle ou forestière. Néanmoins, malgré cette protection, les milieux humides subissent des pressions dont les plus importantes sont l’eutrophisationApport excessif d'éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème., la rudéralisation (transformation importante d’un site par des activités humaines désordonnées par ex. accumulation de décombres) et l’assèchement.
Habitats aquatiques
Si, à l’origine, Bruxelles était une ville d’eau établie dans un réseau hydrographique relativement dense, celui-ci est aujourd’hui extrêmement réduit et discontinu en surface. La Région compte actuellement environ 91 km de cours d’eau - dont 60 km à ciel ouvert - ainsi qu’un canal qui la traverse sur une longeur de 14,5 km. En terme de superficie, les étangs occupent 101,4 ha et le canal 81,6 ha ce qui au total représente un peu plus de 1% de la superficie régionale.
Les étangs sont petits, de type eutropheSe dit des eaux enrichies en éléments nutritifs, notamment de composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures, qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question. voire hypereutrophe (c’est-à-dire riches ou très riches en nutriments) et peu profonds. Vu leur potentiel, certains pourraient évoluer vers l’habitat européen 3150 «lacs naturellement eutrophes (Magnopotamion – Hydrocharition)».
L’amélioration des habitats aquatiques les plus dégradés repose avant tout sur la poursuite de l’amélioration de la qualité physico-chimique et chimique des eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) .
Friches
Cette catégorie peut difficilement faire l’objet d’une description précise et peut chevaucher les autres types d’habitats. Il s’agit le plus souvent de « terrains vagues » correspondant à des terrains à l’abandon comprenant ou non des bâtiments. Ce sont des zones où une végétation spontanée peut se développer librement. De plus, dans la mesure où les villes bénéficient d’influences abiotiques différentes de celles de la campagne (en particulier climat plus chaud et sec), on trouve dans les friches urbaines des microhabitats spécifiques pour de nombreuses espèces. Il en résulte que les friches présentent souvent un intérêt biologique particulièrement élevé. Par ailleurs, elles ont aussi fréquemment une fonction récréative non officielle et, pour certaines d’entre elles, représentent les seules possibilités de créer de nouveaux parcs publics d’une taille suffisante dans les quartiers centraux.
On estime approximativement que 20 à 25% des superficies en fricheZone de terrain laissée à l'abandon et progressivement colonisée par la végétation spontanée. ont été bâties entre 1998 et 2008. Cette évolution est liée à l’importance de la pression immobilière que subissent ces espaces majoritairement non affectés en zones vertes au PRASLe Plan régional d'Affectation des Sols est l'un des outils majeurs de la politique d'aménagement du territoire régional. Il comprend des prescriptions générales pour l'affectation des sols, des cartes délimitant des zones d'affectation et des prescriptions particulières par zone (notamment pour la protection des espaces verts). Il constitue en outre la référence légale pour l'octroi des permis d'urbanisme, de primes à la rénovation, etc. Il transcrit par ailleurs les objectifs opérationnels du PRD en carte. (département Stratégie Espaces verts 2012 sur base de différentes sources). L’envahissement des friches urbaines par des espèces exotiques invasives est également préoccupante.
Jardins, parcs et domaines privés
Les parcs, jardins et domaines privés représentent de l’ordre de 50 à 60% des espaces verts bruxellois. Outre leurs fonctions sociale et patrimoniale, les parcs et jardins remplissent aussi d’importantes fonctions hydrologiques (rétention et/ou infiltration des précipitations) et écologiques (pour certains comme espaces de grande richesse écologique mais également, pour d’autres, comme zones de liaison entre espaces verts). La diversité de ces espaces, leur multifonctionnalité, leur éventuel classement ou encore, leur caractère privé, rendent cependant souvent difficile d’intégrer la protection de la biodiversité dans leur gestion.
À télécharger
Fiche(s) documentée(s)
Rapport(s) de Bruxelles Environnement
Fiche(s) de la Synthèse 2007-2008 de l'Etat de l'Environnement
Etude(s)
- Grontmij Vlaanderen 2011. "Opstellen van een structuurvisie voor het Brussels Ecologisch Netwerk », étude IBGE, 531 pages.
Plan(s) et programme(s)
Etat sanitaire des hêtres et chênes en forêt de Soignes
Indicateur - Actualisation : mars 2023
Des campagnes de surveillance de la vitalité des hêtres et chênes indigènes sont menées en forêt de Soignes bruxelloise depuis 2009. Une proportion élevée de hêtres présente des symptômes de dépérissement tandis que le chêne - et, en particulier, le chêne sessile - semble se porter mieux. Pour les années 2018 à 2022, entre 55 et 69% des hêtres observés présentaient une défoliation supérieure à 25%, pourcentage considéré comme un seuil de vigilance. Jusqu’à présent, les observations ne permettent toutefois pas de mettre clairement en évidence d’impacts significatifs des sécheresses et chaleurs extrêmes successives de ces dernières années sur l’état sanitaire des hêtres soniens (contrairement à ce qui est observé pour leur croissance). Un suivi reste néanmoins nécessaire car la situation pourrait évoluer rapidement et des effets à long terme des sécheresses ne sont pas exclus.
Une forêt fragile
Couvrant près de 10% du territoire bruxellois, la forêt de Soignes représente un patrimoine naturel, social et culturel de la plus haute importance pour la Région bruxelloise.

Plusieurs facteurs contribuent néanmoins à rendre celle-ci vulnérable : fréquentation importante, nature du sol (sécheresse relative d’une partie des sols des versants, compaction superficielle, présence fréquente d’un horizon de sol induré à faible profondeur…), prédominance de peuplements de hêtres souvent vieillissants, déséquilibre de la structure des âges des peuplements, pollution atmosphérique, … Les changements climatiques en cours sont également susceptibles d’altérer le fonctionnement des écosystèmes forestiers, par exemple en ce qui concerne la croissance des peuplements ou le développement des populations de ravageurs. Une étude prospective (Daise et al, 2009) a mis en évidence le fait qu’en forêt de Soignes, dans l’hypothèse d’un changement climatiqueDésigne de lentes variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l'air, résultant d'activités humaines, menacent de modifier sensiblement les climats, dans le sens d'un réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants : élévation du niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones, etc.), déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d'eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales, etc. qui correspondrait à un scénario intermédiaire parmi ceux développés par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le hêtre et le chêne pédonculé risquaient d’être fortement touchés par ces modifications (voir Synthèse 2007-2008, focus « Forêt de Soignes et risques associés au changement climatique »). Une recherche portant sur l’analyse de l’impact de variables climatiques sur la croissance de hêtres localisés notamment en forêt de Soignes a également conclu que les changements climatiques attendus au niveau régional pour la fin du 21ème siècle - et déjà en cours - pourraient mettre en péril la survie à long terme des hêtraies (Latte N, Claessens H. 2015, voir focus « Changement climatique et croissance du hêtre en forêt de Soignes »). Cette même recherche a par ailleurs mis en évidence une réduction de la croissance des hêtres soniens depuis les années ’90.
Plus généralement, depuis une trentaine d’années, des phénomènes de dépérissement des forêts, dont les causes sont multiples, s’observent de façon plus ou moins marquée un peu partout dans le monde.
Un suivi annuel de l’état sanitaire des hêtres et chênes indigènes
La Région bruxelloise s’est dotée depuis 2009 d’’un système d’observation permanent de l’état sanitaire des trois principales essences de la forêt de Soignes. Celui-ci concerne le hêtre (Fagus sylvatica) et les chênes indigènes (chêne sessile Quercus petraea et chêne pédonculé Quercus robur). Ces essences, pures ou en mélange, couvrent environ 70% de la superficie de la forêt de Soignes bruxelloise. La méthode suit un protocole scientifique international (ICP Forests) et repose sur l’observation visuelle, en été, d’arbres localisés dans des placettes de suivi (mailles de 400 m x 400 m) dont le nombre et la répartition dans le massif forestier ont été choisis pour assurer une bonne représentativité de l’échantillon. L’observation fait appel à divers critères tels que la défoliation, la décoloration, la fructification ou encore, les dommages et symptômes qui permettent d’estimer la vitalité des arbres. Elle s’applique à des arbres suffisamment grands (sur base du diamètre) et hauts (couronne captant la lumière, arbres majoritairement dominants ou co-dominants). La méthode a été revue à partir de la campagne d’observation 2022 : le protocole ICP est dorénavant appliqué par l’équipe de recherche à un échantillon d’arbres plus restreint. Il est complété par un protocole simplifié, élaboré par les forestiers français, basé sur les critères de défoliation, mortalité de branches et manque de ramification. Celui-ci, plus rapide, est mis en œuvre par des agents forestiers pour l’ensemble de l’échantillon. Cette nouvelle méthodologie a été élaborée de manière à permettre une comparaison temporelle des résultats obtenus. A partir de la campagne 2023, l’échantillon sera aussi élargi à de nouvelles essences.
Plus d’informations concernant les méthodologies utilisées pour les différentes évaluations sont disponibles dans les rapports en ligne.
Une défoliation moyenne des hêtres assez importante, de l’ordre de 30%, entre 2018 et 2022
La défoliation - définie comme la perte de feuilles dans la partie supérieure de la couronne par rapport à un arbre sain - est un critère intégrateur qui reflète notamment l’influence des fluctuations climatiques (sécheresses en particulier), de la qualité du sol, des attaques parasitaires ou encore, de l’âge de l’arbre.
Pour une année donnée, la défoliation d’un peuplement est également susceptible de varier, plus ou moins fortement selon les essences, en fonction de l’importance de la fructification de ce peuplement cette année-là. En effet, la production de fruits (faînes et glands dans le cas présent) mobilise une part importante des réserves de l’arbre au détriment du développement du feuillage. L’analyse statistique a permis de mettre en évidence un effet significatif de la fructification annuelle moyenne des hêtres sur la défoliation. Cette corrélation n’est pas significative pour les chênes.
Depuis 2022, les données font l’objet d’ajustements statistiques permettant de mieux rendre compte des fluctuations de la défoliation d’une année à l’autre :
- La « défoliation corrigée » est une variable obtenue à partir d’un traitement statistique permettant de corriger un éventuel biais lié au fait que l’échantillon varie chaque année (certains hêtres ne sont évalués qu’une année sur deux, quelques arbres ont été rajoutés ou ont disparu de l’échantillon au cours du temps), ce traitement conduit à de légers ajustements;
- La « défoliation sans fructification » (pour les hêtres uniquement) est une variable obtenue à partir d’un traitement statistique permettant de supprimer l’effet de la fructification sur la défoliation (la variable reflète une situation fictive où aucune fructification n’aurait lieu durant toute la période d’observation).
En 2022, la défoliation corrigée moyenne était de 35% pour les hêtres (32% avec soustraction de l’effet de la fructification), de 22% pour les chênes pédonculés et de 25% pour les chênes sessiles.
Une défoliation moyenne des chênes, et en particulier des chênes sessiles, généralement inférieure à celle des hêtres
Source : Earth and Life Institute Environmental Sciences (UCL), 2022
L’importance de la défoliation moyenne des hêtres s’explique en partie, pour certaines années, par une production importante de faînes
Source : Earth and Life Institute Environmental Sciences (UCL), 2022
La défoliation des hêtres présente de fortes fluctuations interannuelles. Ces dernières sont en grande partie liées à l’impact de la production de fruits (faînes) sur la production de feuilles.
Si l’on excepte l’année 2017, les 7 dernières années sont caractérisées par une défoliation moyenne des hêtres assez importante, souvent supérieure ou égale à 30%.Pour certaines années, ce constat peut s’expliquer, au moins en partie, par l’abondante fructification des hêtres. La production abondante et récurrente de faînes peut aussi affecter la structure et donc la défoliation à long terme, car les bourgeons floraux sont produits au détriment de bourgeons à l’origine de nouveaux rameaux. Selon les chercheurs, cette évolution pourrait également être liée au vieillissement des peuplements de hêtres (une corrélation positive entre circonférence et défoliation a été mise en évidence pour les hêtres).
Entre 2021 et 2022, la défoliation des hêtres a augmenté significativement (+ 6%). Cette évolution ne peut être expliquée par l’impact de la fructification (celle-ci ayant été limitée en 2022), ni par les effets de la sécheresse de 2022 (les observations ayant été effectuées avant le pic de déficit hydrique). La mortalité de branches fines, qui pourrait par ailleurs être une conséquence des sécheresses de 2018 et/ou 2022, est l’explication avancée par les chercheurs.
La défoliation moyenne pour les chênes pédonculés présente des fluctuations mais aucune évolution linéaire n’est constatée. La défoliation moyenne est de 22% en 2022. Cette moyenne ne varie pas significativement depuis 2018. En ce qui concerne les chênes sessiles, pour lesquels le nombre d’observations est limité, la valeur moyenne cette même année est de 25% et ne varie pas non plus significativement depuis 2018. Jusqu’à présent les chercheurs n’ont pas été en mesure de mettre en évidence l’origine des fluctuations interannuelles observées pour les chênes.
Il convient de rester prudent dans l’interprétation des résultats dans la mesure où l’évaluation visuelle de la défoliation présente certaines faiblesses (part de subjectivité dans l’évaluation même si des séances de formation et d’inter-calibration entre observateurs sont organisées, visibilité parfois limitée des cimes et évoluant dans le temps notamment suite aux coupes qui peuvent être réalisées au sein des placettes…). Par ailleurs, si elle donne une idée globale de la perte de vitalité de l’arbre, l’intensité de la défoliation seule ne suffit pas à établir un diagnostic complet de son état sanitaire. La réduction de la biomasseEnsemble des végétaux et des animaux, ainsi que des déchets organiques qui leur sont associés. La biomasse végétale provient de la photosynthèse et constitue une source d'énergie renouvelable. foliaire peut également constituer un mécanisme de régulation temporaire d’un arbre face à un stress auquel il est soumis. C’est pourquoi, le suivi sanitaire prend également en compte d’autres critères reflétant la vitalité des arbres.
Pas de tendance claire concernant l’évolution des proportions de chênes et de hêtres avec une défoliation forte à sévère
Le taux de défoliation est un indicateur communément utilisé, notamment au niveau européen, pour quantifier l’intensité du dépérissement. Une défoliation supérieure à 25% est considérée par le groupe d’experts d’ICP-forest comme un seuil de vigilance, la dégradation étant considérée comme forte à partir de 41% de défoliation et comme sévère à partir de 61%.
Une défoliation supérieure au seuil de vigilance (25%) pour 55 à 69% des hêtres entre 2018 et 2022, cette proportion est moindre pour les chênes
Source : Earth and Life Institute Environmental Sciences (UCL), 2022
Pas de tendance claire concernant l’évolution des proportions de chênes et hêtres avec une défoliation forte à sévère (>40%)
Source : Earth and Life Institute Environmental Sciences (UCL), 2022
En 2022, 69% des hêtres présentaient une défoliation supérieure à 25% (modérée, forte ou sévère) mais seuls 29% affichaient une dégradation supérieure à 40% (dégradation forte ou sévère). Ces proportions sont nettement plus élevées que celles observées les années précédentes et sont proches de celles observées en 2009 et 2016, années marquées par une très forte fructification. En 2022, la production de faînes n’a pas été élevée et ne peut donc pas expliquer la dégradation observée. La proportion de hêtres présentant une dégradation sévère (soit plus de 61% de défoliation) reste très limitée (<4%) tout au long de la période d’observation et aucun arbre mort sur pied n’a été observé.
Cette même année, 32% des chênes pédonculés présentaient une défoliation supérieure à 25% dont 2% avec dégradation sévère. Tout comme pour le hêtre, ces proportions ne présentent pas d’évolution claire mais certaines années sont caractérisées par une large dominance d’arbres faiblement dégradés.
La proportion de chênes sessiles avec une défoliation supérieure au seuil de vigilance est de 32% en 2022 alors qu’elle s’élevait à 68% en 2021. En revanche, la proportion d’arbres fortement dégradés est passée de 11 à 27% de 2021 à 2022.
D’autres critères d‘évaluation, dont la structure de la couronne et la coloration du feuillage, sont utilisés dans le protocole « ICP forest »
La couronne d’un arbre, également appelé houppier, correspond à l’ensemble des ramifications et du feuillage allant de la première branche verte à la pousse terminale de l'arbre. Sa structure varie en fonction du stade de développement atteint par l’arbre et des stress subis au cours du temps.
Afin d’évaluer la vitalité des couronnes des arbres, le protocole de suivi se réfère à 4 classes distinctes (correspondant à des formes de houppiers plus ou moins denses) pour les chênes et à 8 classes pour les hêtres (4 avant 2013).
Une large dominance de chênes avec des formes bien ramifiées ou légèrement simplifiées
Source : Earth and Life Institute Environmental Sciences (UCL), 2022
Les chênes observés présentent une large dominance de formes bien ramifiées ou légèrement simplifiées.
Après une dégradation de la structure de la couronne des chênes pédonculés entre 2018 et 2021, une amélioration s’observe. En 2022, la classe « simplification importante » n’est plus représentée ce qui indique une amélioration. Dans le cas du chêne sessile on constate aussi une augmentation de la simplification de la couronne à partir de 2018, moins prononcée en 2022. Notons que la représentativité de l’échantillon 2022 est problématique pour les chênes sessiles.
L’architecture des cimes des hêtres semble se reconstruire en 2021 et 2022
Source : Earth and Life Institute Environmental Sciences (UCL), 2022
En raison de l’instauration de nouvelles classes pour le hêtre en 2013, les résultats antérieurs ne sont pas présentés. Les variations interannuelles s’expliquent en partie par l’alternance bisannuelle des placettes visitées. Une nette augmentation de la fréquence de classe 4 (moindre croissance des rameaux latéraux) s’observe néanmoins entre 2013 et 2020 au détriment des classes 1 et 2 (ramification optimale ou quasi optimale). En 2021 et 2022, on assiste par contre à une progression sensible de la fréquence cumulée des classes 1 à 3 ce qui suggère un processus de reconstruction de l’architecture des cimes. La fréquence cumulée des classes les plus dégradées (5 à 7) ne présente pas de tendance claire.
Une décoloration des feuilles absente ou rare chez les chênes sessiles
Les causes les plus fréquentes de décoloration des feuilles sont les carences minérales, la pollution atmosphérique, les attaques parasitaires ou les épisodes de sécheresse en été ou printemps. Aucune tendance claire ne peut être dégagée concernant ce paramètre. La fréquence des hêtres décolorés ainsi que l’intensité de ce phénomène ont fortement diminué entre 2019 et 2022. Les chênes - et en particulier les chênes sessiles - sont généralement faiblement décolorés. Chez les chênes, la décoloration est souvent associée au développement de l’oïdium (maladie causée par certains champignons).
Un suivi photographique de la couronne de certains arbres mis en place depuis 2015
Pour essayer de mieux comprendre les évolutions de la défoliation et de la structure de la couronne dont les causes sont encore mal identifiées (chute de branches mortes, différence d’appréciation entre observateurs, …), un suivi photographique de la couronne d’un sous-échantillon de hêtres et de chênes a été intégré au système d’observation depuis la campagne 2015. Il a notamment permis de confirmer le lien entre fructification et défoliation. Le traitement automatique des images fait l’objet d’une recherche méthodologique en cours.
Un indice synthétique pour évaluer le dépérissement des peuplements
La mortalité de branches et le manque de ramifications sont les critères de base combinés pour calculer l’indice de dépérissement. Ils sont chacun notés sur une échelle de 0 à 6 sur base de définitions semi-quantitatives. Ce protocole simplifié, plus rapide que celui développé par l’ICP, permet le suivi annuel de l’ensemble des arbres de l’échantillon complet par les agents forestiers. Un arbre est qualifié de « dégradé » si son indice de dépérissement correspond à D, E ou F. Le peuplement est qualifié de « dépérissant » si plus de 20% des arbres sont dégradés.
En ce qui concerne le critère « Mortalité de branches », la grande majorité des chênes et hêtres observés se situent dans la classe 0, les classes 3 et supérieures ne comportant aucun arbre. Concernant le critère « Manque de ramifications », la classe 1 est majoritaire pour les chênes et les classes 1 et 2 dominent pour les hêtres. Pour cette essence, 15% des arbres échantillonnés se situent dans la classe 3, mais aucun dans les classes 4 et 5. En combinant ces 2 critères, on obtient un indice de dépérissement pour chaque arbre.
Selon l’indice de dépérissement, 16% des hêtres et 3% des chênes pédonculés échantillonnés sont dégradés (indice D, E ou F)
Source : Earth and Life Institute Environmental Sciences (UCL), 2022
Selon le critère utilisé par les concepteurs de ce protocole d’évaluation, la hêtraie ne peut être qualifiée de dépérissante mais n’en est pas loin. Cette observation relativement inquiétante doit toutefois être nuancée. En effet, le paramètre le plus défavorable est le « Manque de branches ». Or, celui-ci est partiellement influencé par des perturbations anciennes (branches mortes disparues). Par ailleurs, le fait qu'aucun arbre ne se situe dans les classes E et F est plutôt rassurant ; la dégradation des hêtres est relativement étendue, mais pas extrême. Enfin, le « contrôle qualité » effectué par l’équipe de recherche a révélé que pour cette campagne effectuée avec un nouveau protocole un biais d’évaluation de ce critère n’était pas à exclure.
Des résultats difficiles à interpréter et à comparer avec ceux des régions voisines
Cette évolution, sur un laps de temps encore relativement limité, s’avère difficile à interpréter compte tenu du nombre de facteurs susceptibles d’influencer le taux de défoliation d’un arbre (qualité du sol, caractéristiques individuelles des arbres, conditions météorologiques, fructification, circonférence du tronc, position par rapport aux arbres environnants, forme des branches à la cime, déprédateurs …). Le protocole de suivi lui-même présente en outre certaines limitations (arbres étudiés variables d’une année à l’autre, taille limitée de l’échantillon pour les chênes sessiles, subjectivité liée à l’observateur, difficulté d’observation des arbres non dominés, etc.).
Il est par ailleurs délicat de comparer ces observations avec celles des régions voisines dans la mesure où les peuplements décrits sont différents (âge et densité des peuplements, conditions de sols, de (micro)climat, de relief, etc.) et que la qualité des observations peut varier d’un réseau à l’autre (effet « observateur »). Si en Wallonie le protocole de suivi est identique à celui de la Région bruxelloise et la calibration effectuée par la même équipe universitaire, la méthode de cotation appliquée en Région flamande diffère légèrement de celle qui est appliquée dans les 2 autres régions et dans la plupart des pays partenaires du projet. Pour les hêtres, ceci peut conduire à une cotation moins forte par rapport au protocole standard alors qu’une faible surestimation est possible dans le cas des chênes. Les valeurs de défoliation recueillies dans les pays ou régions voisines permettent néanmoins de fixer des ordres de grandeur.
En 2020, l’évolution de la défoliation moyenne des arbres étudiés en forêt de Soignes bruxelloise a été comparée avec celle des arbres suivis en Régions wallonne (en Ardenne essentiellement) et flamande.
L’évolution des défoliations moyennes des hêtres et, dans une moindre mesure, des chênes, suit globalement les mêmes tendances en forêt de Soignes bruxelloise, en Wallonie et en Flandre
Source : Earth and Life Institute Environmental Sciences (UCL), 2020 (sur base de données Région flamande - Bosvitaliteitsinventaris et de données Région wallonne - Suivi de l’état sanitaire des peuplements, intégré à l’Inventaire Permanent des Ressources Forestières de Wallonie)
Les défoliations moyennes des hêtres en forêt de Soignes bruxelloise sont environ 10% inférieures à celles observées en Wallonie et 10% supérieures à celles observées en Flandre. D’après les chercheurs l’écart entre les placettes de la forêt de Soignes bruxelloise et celles de haute Ardenne peut être mis en relation avec une dégradation antérieure au début du suivi (2010) qui pourrait être liée à des épisodes d’engorgement des sols. L’écart avec la Région flamande peut s’expliquer par des différences méthodologiques. Les tendances suivent néanmoins des évolutions assez semblables dans les 3 régions.
En ce qui concerne les chênes, les valeurs de défoliation observées ces dernières années apparaissent relativement similaires en Wallonie, Flandre et Région bruxelloise. Le pic constaté en 2012 en Wallonie est lié à une forte attaque de chenilles parasitaires qui a touché l’Ardenne alors que les régions de plaine ont été épargnées.
En 2021, en Région flamande, selon les données de l’INBO (2022), 20,9% des hêtres et 27,4% des chênes pédonculés présentaient plus de 25% de défoliation soit sensiblement moins qu’en Région bruxelloise.
Depuis 1996, la Région flamande effectue également un monitoring de la croissance et de la vitalité du hêtre en forêt de Soignes. Selon les placettes échantillonnées et les années, le taux de défoliation oscille entre 10 et 30% environ. Pour deux des trois sites d’échantillonnage les chercheurs ne relèvent pas de tendance significative. Au niveau du troisième site une légère tendance à l’augmentation de la perte foliaire s’observe depuis 2013 (Roskams P., Sioen G. 2017).
Au niveau européen (26 pays), la défoliation moyenne des hêtres était de 20,9% en 2021 et de 22,6 en 2020. Celle relative à toutes les espèces de chênes tempérés à feuilles caduques était de 27,3% en 2021 et de 25,9% en 2020 (ICP Forest 2022).
Jusqu’à présent, les effets des sécheresses et chaleurs extrêmes successives de ces dernières années ne sont pas flagrants mais restent à envisager
L’analyse des évolutions sur l’ensemble de la période 2009-2022 a mis en évidence une augmentation faible (0,2% par an entre 2009 et 2020) mais significative de la défoliation pour les hêtres. Celle-ci pourrait être liée à l’accroissement de l’âge des arbres au cours de cette période.Pour les chênes, aucune tendance linéaire significative n’a été détectée.
Globalement, les observations basées sur les signes extérieurs de dépérissement suggèrent que, dans le contexte de la forêt de Soignes, les 3 essences résistent bien aux sécheresses et aux chaleurs extrêmes de ces dernières années. Dans le cas du hêtre, l’état sanitaire est plutôt mauvais depuis le début de la période de suivi et il ne devrait pas s’améliorer avec l’augmentation de l’âge des arbres échantillonnés. Aucun paramètre ne suggère cependant une accélération de cette dégradation au cours de ces dernières années.
Cette résistance des hêtres pourrait être liée à leur capacité à utiliser les réserves d’eau dans les couches profondes du sol. L’étude dendrochronologique précitée (voir focus sur le sujet) a mis en évidence une réduction de la croissance des hêtres soniens depuis les années ’90. Cette évolution apparaît davantage liée à l’évolution du climat qu’au vieillissement des peuplements. Outre l’effet des sécheresses et canicules et du vieillissement des peuplements, d’autres mécanismes - tels que l’asphyxie des racines fines lors de printemps humides - pourraient aussi expliquer l’état sanitaire peu favorable des hêtres. Ces épisodes d’asphyxie sont favorisés par le tassement des sols, important en forêt de Soignes.
Une poursuite du suivi s’avère nécessaire pour détecter un éventuel effet différé des épisodes climatiques extrêmes de ces dernières années sur l’état sanitaire des hêtres et d’identifier les causes des fluctuations chez les chênes.
Une gestion forestière orientée vers le futur
Le plan régional de gestion de la forêt de Soignes a été adapté afin de tenir compte de nouveaux éléments apparus au cours de cette dernière décennie dont, entre autres, les risques de dépérissement de certaines essences (plus particulièrement le hêtre et le chêne pédonculé) induits par les changements climatiques en cours et le vieillissement des peuplements de hêtres.
Pour les peuplements de hêtres existants, ce plan prévoit notamment de réaliser des éclaircies plus fortes et fréquentes afin de limiter la concurrence entre les arbres et d’accélérer leur croissance ce qui permettra de diminuer l’âge d’exploitation et donc les risques, en particulier de chablis (chute d’arbres). La gestion devra aussi privilégier les hêtres les plus vigoureux car ceux-ci sont susceptibles de posséder des prédispositions génétiques à mieux surmonter le stress et leur descendance pourrait se révéler d’un grand intérêt. L’objectif de maintien du faciès paysager de hêtraie cathédraleForêt de hêtres ou riche en hêtres qui ne laissent filtrer que très peu de lumière, à la façon des vitraux d'une cathédrale., qui concernait 50% de la superficie de la forêt de Soignes bruxelloise dans le plan de gestion adopté en 2003, a été revu à la baisse et concerne actuellement 20% de la forêt. Compte tenu des qualités paysagères du faciès cathédral, le nouveau plan de gestion prévoit par ailleurs de développer des chênaies équiennes - c’est-à-dire constituées d’arbres du même âge - à objectif cathédrale à partir de jeunes plantations de chênes sessiles (9% de la forêt). Pour les superficies restantes, la gestion s’orientera vers une mise en place progressive d’une structure plus étagée et moins dense, issue de mélanges d’essences. Les espèces les plus tolérantes aux conditions climatiques attendues à la fin du siècle (chêne sessile, tilleul à petites feuilles, etc.) seront privilégiées. La diversification est par ailleurs favorable à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). et permet d’augmenter la capacité des écosystèmes forestiers à résister aux perturbations du milieu, aux maladies ainsi qu’aux vents violents (résilience).
À télécharger
Fiche méthodologique :
Tableaux reprenant les données :
- Evolution de la défoliation moyenne de l’ensemble des hêtres et chênes inclus dans les suivis (% de défoliation) (2009-2022) (.xls)
- % d'arbres inclus dans les suivis présentant une défoliation supérieure à 25% (2009-2022) (xls)
- % d'arbres inclus dans les suivis présentant une défoliation supérieure à 40% (2009-2022) (xls)
- Distribution des chênes pédonculés et des chênes sessiles selon la structure de la couronne (2012-2022) (xls)
- Distribution des hêtres selon la structure de la couronne (2013-2022) (xls)
- Distribution des hêtres et chênes inclus dans les suivis selon l’indice synthétique de dépérissement (2022) (xls)
Fiches documentées :
- 21. Inventaire du patrimoine forestier de la forêt de Soignes bruxelloise (.pdf) (publication à venir - site de Bruxelles Environnement)
- 22. Prélèvements de bois, accroissement et régénération en forêt de Soignes bruxelloise (.pdf) (publication à venir - site de Bruxelles Environnement)
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Focus : Patrimoine forestier de la forêt de Soignes bruxelloise (2021)
- Focus : Prélèvements de bois, accroissement et régénération en forêt de Soignes bruxelloise (2021)
- Focus : Changement climatique et croissance du hêtre en forêt de Soignes (2018)
- Focus : Evolution future du climat en Région de Bruxelles-Capitale et adaptations possibles (2021)
- Forêt de Soignes et risques associés au changement climatique (2009)
- Chapitre « Environnement semi-naturel et espaces verts publics » (2007) (.pdf)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Rapport sur l’état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale, septembre 2022 (.pdf)
- Carte « Potentialités sylvicoles actuelles et à l'horizon 2100 du hêtre en Forêt de Soignes »
Etudes et rapports
- Earth & Life Institute Environmental Sciences (UCL) 2022. « Suivi de l’état sanitaire des arbres en forêt de soignes bruxelloise 2022 ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 57 pp. (.pdf)
- Les inventaires de l’état sanitaire des arbres soniens relatifs aux années 2009-2021 sont également disponibles dans le centre de documentation en ligne de Bruxelles Environnement
- GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES (ULg-Gembloux Agro-Bio Tech) 2015 « Analyse de l’influence du changement climatique du hêtre en forêt de Soignes ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 14 pp.+ annexes (.pdf)
- INSTITUUT voor NATUUR EN BOSONDERZOEK, “Natuurindicatoren - Aandeel beschadigde bosbomen” (html) (en néerlandais uniquement)
- IPBES 2018. “The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia”, 892 pages (.pdf) (en anglais uniquement).
- LATTE N. et 2015. “Dendroécologie du hêtre en forêt de Soignes – Les cernes des arbres nous renseignent sur les changements récents et futurs », in Forêt. Nature n°137, recherche financée par Bruxelles Environnement et l’Accord-cadre de recherches et de vulgarisation forestières (SPW, DGO3, DNF), pp.25-37. (.pdf)
- MICHEL A, KIRCHNER T, PRESCHER A-K, SCHWÄRZEL K, editors 2022. “Forest Condition in Europe :The 2022 Assessment”. ICP Forests Technical Report under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Air Convention). Eberswalde: Thünen Institute. (.pdf) (en anglais uniquement).
- ROSKAMS P., SIOEN 2017. “De toestand van de beuk in de monitoringproefvlakken in het Zoniënwoud – anno 2017”, document interne de l’Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) (communication personnelle).
- SERVICE PUBLIC WALLON, DIRECTION DE L’ETAT ENVIRONNEMENTAL. « Rapport sur l’état de l’environnement wallon 2017 » (html), voir Etat de santé des forêts
- SIOEN , VERSCHELDE P., ROSKAMS P. 2022. “Bosvitaliteitsinventaris 2021. Resultaten uit het bosvitaliteitsmeetnet (Level 1)”, Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2022, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 112 pp. (pdfl) (néerlandais uniquement)
- TITEUX et al. 2021. « Bilan de douze années de suivi sanitaire des hêtres et chênes de la forêt de Soignes », tiré à part du Forêt Nature n°159, p.40-49 (.pdf)
- Unité de gestion des ressources forestières et des milieux naturels (Fac. De Gembloux Agro-Bio Tech – ulg) 2009. « Etude de l’adéquation des essences aux stations forestières de la forêt de Soignes (zone bruxelloise) dans le contexte du changement climatique». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 368 pp.+ annexes. (.pdf)
Plans et programmes
- Plan régional nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale, 2016 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre I - Etat des connaissances, 2018 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre II - Objectifs et mesures de gestion, 2018 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre III - Plans de gestion des réserves archéologiques, naturelles et forestières, 2018 (.pdf)
Patrimoine forestier de la forêt de Soignes bruxelloise
Focus – Actualisation : janvier 2021
L’inventaire annuel du patrimoine forestier contribue, avec d’autres études et observations de terrain, à améliorer les connaissances sur le massif sonien. Il fournit ainsi des données indispensables à une gestion sylvicole de qualité. Parmi les enseignements issus de l’inventaire on peut notamment citer les points suivants :
- Les hêtraies et chênaies, pures ou en mélange, couvrent 66% de la surface sonienne ;
- Près de la moitié de la superficie de hêtraies est constituée de vieilles hêtraies de plus de 120 ans ;
- Tant pour les hêtraies que pour les chênaies, on observe un important déséquilibre des classes d’âges ce qui hypothèque une gestion durable de la forêt en l’absence d’intervention humaine ;
- La croissance de la hêtraie en forêt de Soignes bruxelloise se situerait dans une fourchette comprise entre 9 et 11 m3/ha/an ce qui en fait l’une des hêtraies les plus productives de Belgique, voire au niveau mondial ;
- Depuis 2005, la régénérationEn sylviculture, opération consistant à remplacer un peuplement mûr soit par voie naturelle, soit par voie artificielle. naturelle du hêtre s’installe dans les vieux peuplements de hêtre. L’érable, le frêne, le charme, le merisier et le bouleau se régénèrent aussi naturellement bien.
- Avec une moyenne d’environ 21 m3 de bois mort par ha, les quantités de bois mort présentes en forêt de Soignes semblent avoir augmenté ces dernières années mais ces données restent à confirmer.
L’inventaire forestier : un outil de gestion sylvicole
Avec ses 1.659 ha, la forêt de Soignes bruxelloise couvre de l’ordre de 10% du territoire bruxellois. Sa gestion, assurée principalement par la sous-division « Forêt et Nature », s’appuie sur de nombreuses données scientifiques et notamment sur l’inventaire sur l’état du patrimoine forestier de la forêt de Soignes.
Cet inventaire annuel, débuté en 2008, se base sur un échantillonnage systématique de placettes localisées au sein de chaque maille carrée (200 m de côté) d’une grille d'inventaire. Les campagnes de mesures sont organisées de manière à couvrir chaque année une des 8 coupes définies en forêt de Soignes bruxelloise.
Les mesures et observations concernent non seulement les arbres mais également la flore présente, certains indices de présence de faune, le sol ou encore, la topographie. Au terme de 8 années d’inventaire, un traitement statistique permet l'extrapolation des valeurs observées à l'ensemble de la forêt. Les arbres pris en compte sont ceux dont la circonférence du tronc mesurée à 1,5 m du sol est supérieure ou égale à 40 cm.
Ces données une fois traitées permettent d’obtenir de nombreuses informations (LEJEUNE P. et al. 2009) :
- importance et nature du matériel ligneux sur pied dans les peuplements : volume de bois sur pied, nombre d'arbres et densité du peuplement, surface terrière (surface de la section transversale à 1,5 m du sol d’un arbre ou d’un peuplement), grosseur moyenne des troncs, etc.;
- composition : importance et diversité des essences ligneuses rencontrées dans les peuplements;
- structure : distribution des arbres par classe de grosseur (reflet de l’âge des arbres et de l’équilibre démographique du peuplement) ;
- composition et importance de la régénération : ce paramètre caractérise l’intensité du rajeunissement de la forêt qui constitue une condition essentielle à sa pérennité, il doit être considéré en parallèle avec la structure ;
- état sanitaire : état de santé apparent des arbres ;
- composition végétale : liste et importance relative des espèces rencontrées dans les différents étages du couvert végétal (arbres, arbustes, plantes herbacées), indicateur intéressant de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). de l’écosystèmeC'est l'ensemble des êtres vivants (faune et flore) et des éléments non vivants (eau, air, matières solides), aux nombreuses interactions, d'un milieu naturel (forêt, champ, etc.). L'écosystème se caractérise essentiellement par des relations d'ordre bio-physico-chimique. ;
- stock de bois mort : la quantification du volume de bois mort, debout ou en décomposition au niveau du sol, est un autre indicateur intéressant en terme d’évaluation de la biodiversité. Ces arbres morts sont en effet des niches écologiques privilégiées pour de nombreux organismes ;
- calcul de l’accroissement : dès lors que l’inventaire atteint son second cycle et que les placettes d’échantillonnage sont revisitées, les données relatives aux passages successifs permettent de mesurer la croissance des arbres (exprimée en termes de grosseur, hauteur ou volume).
L’évolution du nombre d’arbres présents permet également de contrôler dans quelle mesure les coupes d’arbres planifiées par le gestionnaire sont compatibles avec le potentiel de croissance de la forêt.
Les paragraphes ci-dessous résument l’essentiel des enseignements issus de cet inventaire.
Des peuplements forestiers largement dominés par le hêtre
60% de la superficie de la forêt de Soignes bruxelloise est recouverte de hêtraies dont 52% d’hêtraies pures. Les chênaies, pures ou en mélange, représentent 6% de la surface sonienne. La superficie restante est occupée par des peuplements de résineux (3%) et par des peuplements mélangés d’essences diverses (31%).
Outre le hêtre, le chêne pédonculé (majoritaire) et le chêne sessile, les essences feuillues sont représentées notamment par l’érable, le bouleau, le frêne, le saule, l’aulne, le charme, le merisier ou encore le châtaignier. Les principaux résineux présents (3%) sont le pin sylvestre, le mélèze et le pin de Corse.
Composition des peuplements forestiers en forêt de Soignes
Source : Synthèse 2020 de l’inventaire forestier de la forêt de Soignes bruxelloise – Unité de gestion des ressources forestières et des milieux naturels (FUSAGX-ULg, 2020)
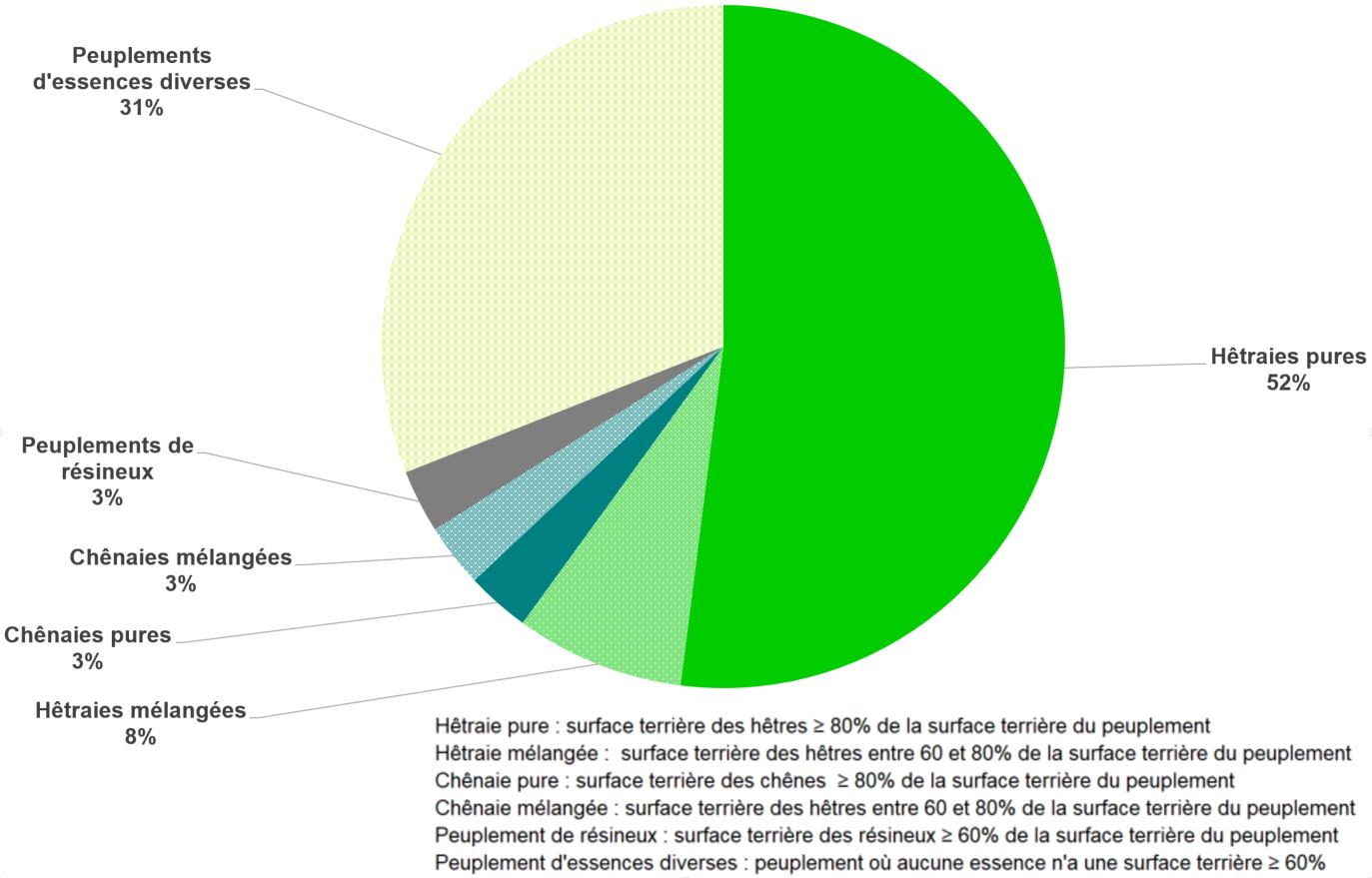
Notons que ces données ne sont pas totalement comparables avec celles reprises dans le plan de gestion de la forêt de Soignes dans la mesure où la manière de caractériser les peuplements est différente. Ceci a notamment pour conséquence qu’une partie des chênes qui auparavant était classifiée dans la catégorie « chênaie mélangée » se trouve maintenant dans la catégorie « peuplement d’essences diverses ». Par ailleurs, les nombreuses plantations de chênes effectuées ces dernières années (surtout sous forme de chênaies pures) sont encore trop jeunes pour être reprises dans l’inventaire (pour rappel, on inventorie que les arbres dont la circonférence est > à 40 cm).
La carte de la composition des peuplements réalisée dans le cadre de l’élaboration du second plan de gestion de la forêt de Soignes est disponible dans la fiche documentée consacrée à l’inventaire du patrimoine forestier sonien (voir liens ci-dessous).
Près de la moitié de la superficie de hêtraies est constituée de vieilles hêtraies de plus de 120 ans
Pour qu’une forêt soit en équilibre, il faut théoriquement que chaque classe d’âge occupe la même surface. Tant pour les hêtraies que pour les chênaies, peuplements prédominants, on observe un important déséquilibre des classes d’âges.
Pour les hêtraies pures et mélangées, ceci se traduit par une surreprésentation des classes d’âge les plus vieilles et une sous-représentation des classes les plus jeunes ce qui hypothèque la pérennité de ces peuplements. La récente régénérationEn sylviculture, opération consistant à remplacer un peuplement mûr soit par voie naturelle, soit par voie artificielle. naturelle du hêtre (voir ci-dessous) se traduit cependant par une représentation accrue de la catégorie 0-20 ans.
Pour les chênaies pures, les jeunes classes d’âge sont fortement représentées, notamment suite aux plantations mises en place après la tempête de 1990. Les classes d’âge intermédiaires (de 80 et 140 ans) sont peu représentées tant pour les chênaies pures que mélangées et créeront, dans le futur, un déficit en peuplements de vieux chênes.
Une des forêts parmi les plus productives de Belgique
Sur base des données d’inventaire disponibles, une estimation de l’accroissement des hêtraies en forêt de Soignes bruxelloise a été calculée par le département Forêt (comm. personnelle, 2021) : celui-ci se situerait dans une fourchette comprise entre 9 et 11 m3/ha/an. Cet ordre de grandeur, correspondant à une productivité très élevée, est comparable à d’autres évaluations réalisées pour la forêt de Soignes.
Ces valeurs témoignent d’une croissance très soutenue des hêtres et d’une situation actuellement favorable pour cette essence qui ne montre, à ce stade, pas de signes sensibles de dépérissement (voir aussi Etat de santé des hêtres et chênes en forêt de Soignes). Cette situation pourrait néanmoins rapidement changer.
La régénération naturelle de plusieurs essences, une opportunité à valoriser
La régénération naturelle a notamment comme avantage d’être gratuite, de provenance locale adaptée et souvent abondante. De plus, les meilleurs semis font l’objet d’un processus de sélection naturelle.
Selon les conditions de milieu, un certain nombre d’essences se régénèrent plus ou moins facilement en forêt de Soignes, parfois de façon très locale (érable sycomore, charme, merisier, bouleaux, saules, tilleuls…). La régénération naturelle de ces essences offre une opportunité aux sylviculteurs de régénérer et de convertir la forêt conformément aux objectifs de gestion décrits dans le plan de gestion. Celui-ci prévoit donc de valoriser la régénération naturelle là où elle s’installe et de la compléter par la plantation de plants issus de pépinière là où elle est déficitaire ou sans avenir (par exemple par manque de lumière).
Le hêtre représente une grande part de la régénération. Ce constat est en accord avec le fait que le hêtre est une essence qui tolère bien l’ombrage dans le jeune âge et que le couvert des plus vieux hêtres est assez dense. La régénération naturelle du hêtre en forêt de Soignes a néanmoins été très difficile à obtenir jusqu’en 2005, année à partir de laquelle les premiers semis sont apparus, se sont développés et se sont avérés viables. Les bonnes fainées apparaissent depuis presque tous les deux ans.
Les graphiques suivants montrent la régénération observée dans les hêtraies pures ou en mélange lors de l’inventaire de l’année 2020. La régénération est évaluée en % de recouvrement.
Figure 21.11 Régénération dans les hêtraies (surface échantillonnée 992 ha)
Source : Synthèse 2020 de l’inventaire forestier de la forêt de Soignes bruxelloise
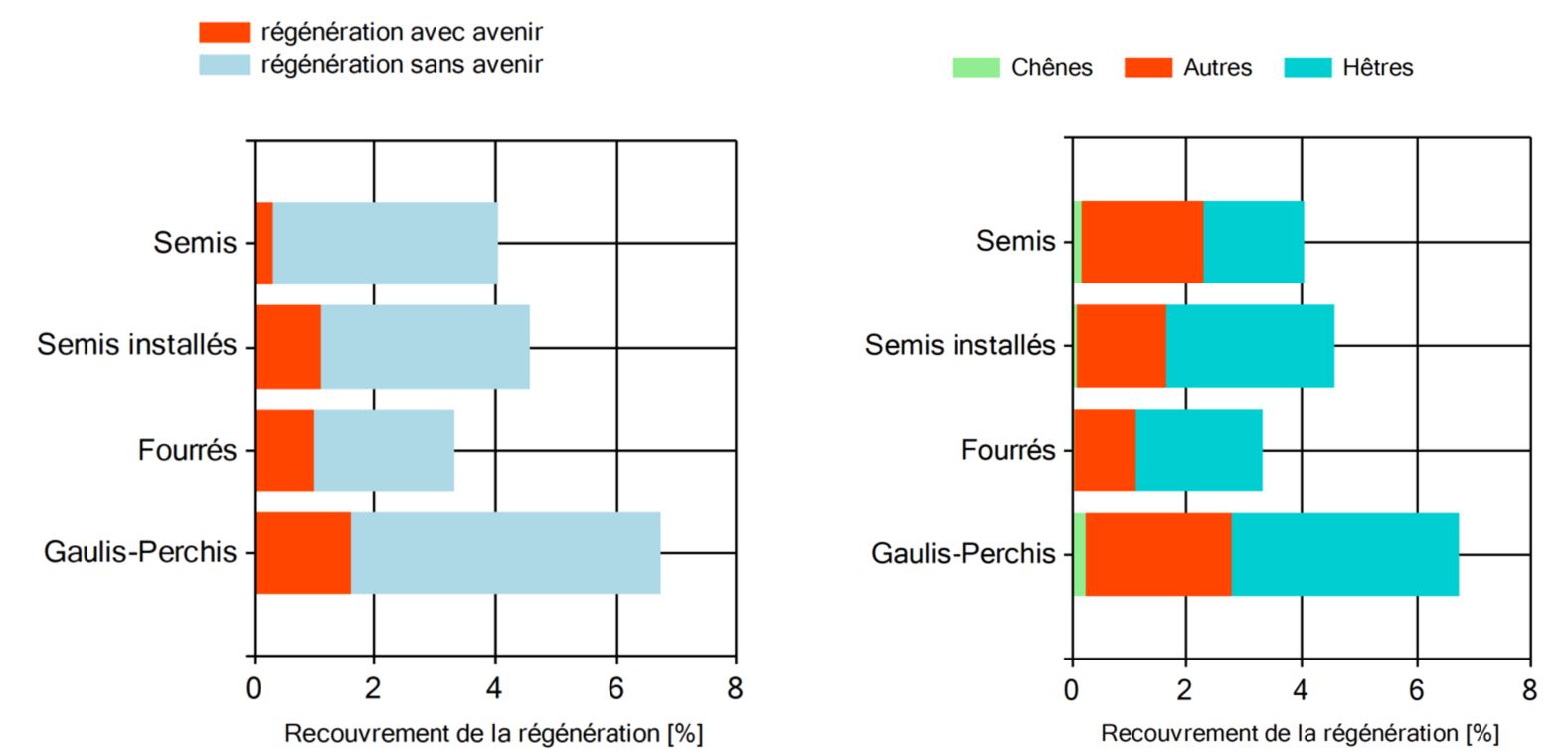
Les semis sont les plants d'une hauteur inférieure à 30 cm, les semis installés sont les plants de hauteur comprise entre 30 et 150 cm, les fourrés sont les plants de hauteur comprise entre 150 et 300 cm. Les gaulis-perchisStade de développement d'une forêt, entre le gaulis et la futaie proprement dite. sont les tiges de plus de 3 m de hauteur et de moins de 40 cm de grosseur.
La régénérationEn sylviculture, opération consistant à remplacer un peuplement mûr soit par voie naturelle, soit par voie artificielle. du chêne - essence nécessitant un couvert léger à ses premiers stades - est quantitativement très limitée ce qui justifie les plantations de cette essence.
Une gestion qui vise à augmenter les quantités de bois mort
La présence de bois mort, à tous ses stades de décomposition, contribue à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). de la forêt. Au sol ou sur pied, il est important pour de très nombreuses espèces, que ce soit en tant qu’abri ou en tant que ressource alimentaire : chauves-souris et oiseaux cavernicoles, petits mammifères, amphibiens et reptiles, insectes xylophages, lichens, bryophytes, champignons, etc.
Le bois mort permet aussi de conserver l’humidité du sol, d’y stimuler la vie et participe, par sa lente décomposition, à la formation d’humus et donc à la fertilité de la forêt.
D’un point de vue paysager, la présence de bois mort et de la vie qui l’accompagnent concourent à créer une ambiance forestière.
L’augmentation de la quantité de bois mort dans toutes les stations et sous différentes formes est un objectif important du plan de gestion de la forêt de Soignes. Par ailleurs, certaines zones de la forêt plus spécifiquement dédiées à la formation d’un maillage écologique au sein du massif forestier, se caractérisent par le maintien d’un maximum de gros bois ainsi que de bois mort sur pied ou au sol.
Sur base des campagnes de mesures réalisées dans le cadre de l’inventaire forestier (données 2020) et en prenant la hêtraie comme référence, le volume moyen de bois mort est estimé à environ 21 m3/ha, soit de l’ordre de 6% du volume total sur pied (l’objectif minimum fixé dans le plan de gestion est de 5% ou de 8% pour certains types d’habitats).
Ce volume avait été évalué à 14 m3/ha à partir des données rassemblées par ce même inventaire en 2013. Même s‘il convient de considérer ces résultats avec prudence compte tenu de leur marge d’imprécision, ces données faisant état d’un accroissement de la quantité de bois mort rejoignent les constats des gestionnaires et experts présents sur le terrain. Si elle se confirme, cette évolution positive serait à mettre en relation avec certaines modifications de la gestion forestière qui ont été introduites ou renforcées au cours de ces dernières années (voir fiche documentée consacrée à l’inventaire forestier).
Un suivi de l’état sanitaire des peuplements
Comme ailleurs dans le monde, la forêt de Soignes est victime de ce que les scientifiques appellent le « dépérissement forestier » et dont les causes sont multiples. En plus du suivi des défauts de conformation et des dégâts (gibier, travaux de débardage) observés sur les arbres dans le cadre de l’inventaire forestier, un suivi sanitaire complémentaire des peuplements de hêtres et de chênes a été mis en place en 2009. Il porte sur des paramètres comme la défoliation, la décoloration, la structure de la couronne ou encore, les dégâts liés aux insectes.
La répétition annuelle des campagnes d’observation doit permettre de dégager des tendances d’évolution au cours du temps. Aujourd’hui, le phénomène semble stabilisé, mais pour limiter tout risque d’accentuation, il est nécessaire de prendre des mesures destinées à limiter le compactage du sol - qui, selon Herbauts (1995), pourrait aggraver les phénomènes de stress hydriques ou d’éventuelles déficiences en éléments nutritifs - et assurer, lors de la régénération de la forêt, l’adéquation des essences aux conditions stationnelles. Il est également indispensable de poursuivre ce suivi car la situation pourrait évoluer rapidement.
De plus amples informations à ce sujet sont disponibles dans le focus consacré à l’état sanitaire des hêtres et chênes en forêt de Soignes .
Des points positifs pour la biodiversité
En terme de biodiversité, le patrimoine forestier de la forêt de Soignes bruxelloise présente de nombreux atouts. Le massif comporte un nombre important de hêtres de grand diamètre à valeur écologique élevée pour de nombreuses espèces. En moyenne, selon les gestionnaires forestiers, la forêt de Soignes bruxelloise compte plus de 5 gros arbres de plus de 80 cm de diamètre par hectare ce qui est exceptionnel pour une forêt gérée. On y trouve également une quantité importante d’arbres sénescents et morts sur pied ainsi que de gros bois morts au sol. La régénération naturelle du hêtre s’installe depuis 2005 dans les vieux peuplements de hêtre. L’érable, le frêne, le charme, le merisier et le bouleau se régénèrent aussi naturellement bien.
Par ailleurs, du fait de sa continuité temporelle et spatiale (5000 ha restés sous forêt), le massif sonien constitue une vieille forêt et peut être considéré comme un conservatoire de biodiversité des forêts anciennes. Ceci se traduit par une richesse en biodiversité élevée, notamment en espèces et habitats d’intérêt communautaire (Natura 2000).
…. mais aussi des faiblesses que la gestion sylvicole vise à contrer
Le patrimoine forestier sonien présente cependant également des faiblesses liées notamment à la dominance de peuplements constitués essentiellement d’une seule espèce d’arbres (hêtre) d’âge identique, avec surreprésentation des classes d’âge les plus vieilles et sous-représentation des classes les plus jeunes, ce qui hypothèque la pérennité de la forêt. Cette dominance du hêtre donne un faciès forestier manquant de structure, dominé par une seule essence et un seul étage. Ceci est d’autant plus problématique que, selon plusieurs études (voir liens ci-dessous), l’augmentation attendue de la fréquence et de l’intensité des sécheresses printanières et des canicules estivales liées aux changements climatiques pourraient mettre en péril la survie à long terme des hêtraies soniennes. Les plantations de hêtres présentent en outre une très grande sensibilité au risque de chablis du fait notamment de la présence fréquente d’un horizon de sol induré à faible profondeur (fragipan), de leurs âges, des hauteurs atteintes et de la déstructuration de certains peuplements suite aux tempêtes de 1990. Par ailleurs, les vieilles chênaies sont dominées par le chêne pédonculé qui, à l’instar du hêtre, sera probablement aussi fortement impacté par les changements climatiques annoncés. Le chêne sessile, plus résistant aux changements climatiques en cours, y est généralement très minoritaire. Dans les conditions actuelles, le massif s’avère dès lors peu résilient face aux perturbations du milieu et notamment face aux changements climatiques attendus.
Le nouveau plan régional de gestion de la forêt de Soignes, adopté en 2019, vise notamment à augmenter la résilience du massif en s’appuyant entre autres sur une plus grande diversification des essences, la mise en place progressive d’une structure plus étagée et moins dense et le rajeunissement des peuplements (voir fiche documentée 22. Prélèvements de bois, accroissement et régénération en forêt de Soignes bruxelloise). Dans ce cadre, une part importante des peuplements gérés en futaiePeuplement forestier composé d'arbres directement issus de semences sur place et qui sont destinés à atteindre un plein développement avant d'être coupés. mono spécifique régulière devront progressivement évoluer vers une futaie irrégulière constituée d’un mélange d’essences d’âges multiples. La régénération naturelle actuellement observée pour le hêtre et d’autres essences constitue une opportunité dans le cadre de cette transition.
À télécharger
Fiches documentées :
- 10. Habitats naturels dans les espaces verts bruxellois
- 20. Surveillance des habitats naturels en Région bruxelloise (.pdf)
- 21. Inventaire du patrimoine forestier de la forêt de Soignes bruxelloise (.pdf)
- 22. Prélèvements de bois, accroissement et régénération en forêt de Soignes bruxelloise (.pdf)
Carnet « L’occupation du sol et les paysages bruxellois »
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Indicateur : Etat sanitaire des hêtres et chênes en forêt de Soignes (édition 2019-2020)
- Focus : Prélèvements de bois, accroissement et régénération en forêt de Soignes bruxelloise (édition 2019-2020)
- Focus : Changement climatique et croissance du hêtre en forêt de Soignes (édition 2015-2016)
- Focus : L’adaptation aux changements climatiques (édition 2011-2014)
- Forêt de Soignes et risques associés au changement climatique (édition 2007-2008) (.pdf)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Rapport sur l’état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale, septembre 2012 (.pdf)
- Carte « Potentialités sylvicoles actuelles et à l'horizon 2100 du hêtre en Forêt de Soignes »
Etudes et rapports
- DAISE J., CLAESSENS H., RONDEUX J. 2009. « Etude de l’adéquation des essences aux stations forestières de la forêt de Soignes (zone bruxelloise) dans le contexte du changement climatique», Unité de Gestion des Ressources Forestières et des Milieux Naturels, FUSAGx-ULg, étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 368 pp.+ annexes. (.pdf)
- EARTH & LIFE INSTITUTE ENVIRONMENTAL SCIENCES (UCL) 2020. « Suivi de l’état sanitaire des arbres en forêt de Soignes bruxelloise 2020 ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 81 pp. (.pdf)
- GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES (FUSAGx-ULg) 2015. « Analyse de l’influence du changement climatique du hêtre en forêt de Soignes ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 14 pp. + annexes (.pdf)
- GODEFROID S., KOEDAM N. 2007. « Quantification et qualification du bois mort dans les habitats Natura 2000 en Région de Bruxelles-Capitale », Laboratorium voor Algemene Plantkunde en Natuurbeheer (General Botany and Nature Management) – VUB, étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 35 pp. (.pdf)
- LEJEUNE P., ALDERWEIRELD M., RONDEUX J. 2009. « La forêt de Soignes - Connaissances nouvelles pour un patrimoine d'avenir" in chapitre "L'apport d'un inventaire forestier par échantillonnage à la gestion de la forêt de Soignes", publication LES AMIS DE LA FORET DE SOIGNES.
- LATTE N. et al. 2015. "Dendroécologie du hêtre en forêt de Soignes - Les cernes des arbres nous renseignent sur les changements récents et futurs », in Forêt.Nature n°137, recherche financée par Bruxelles Environnement et l’Accord-cadre de recherches et de vulgarisation forestières (SPW, DGO3, DNF), pp.25-37. (.pdf)
- UNITE DE GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES ET DES MILIEUX NATURELS - FUSAGx-ULg - 2020. « Synthèse 2020 de l’inventaire forestier de la forêt de Soignes bruxelloise », inventaire réalisé pour le compte de Bruxelles Environnement.
- VAES F., VANWIJNSBERGHE S. 2020. "Un nouveau plan de gestion pour la forêt de Soignes" in "Forêt Nature" n°155. (.pdf)
Plans et programmes
- Plan régional nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale, 2016 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre I - Etat des connaissances, 2018 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre II - Objectifs et mesures de gestion, 2018 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre III - Plans de gestion des réserves archéologiques, naturelles et forestières, 2018 (.pdf)
Liens utiles
Prélèvements de bois en forêt de Soignes bruxelloise
Focus – Actualisation : janvier 2021
Le prélèvement de bois et la régénérationEn sylviculture, opération consistant à remplacer un peuplement mûr soit par voie naturelle, soit par voie artificielle. des peuplements poursuivent avant tout des objectifs en matière de biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., de mise en valeur paysagère et de sécurité des usagers. La gestion sylvicole vise aussi à assurer le maintien à long terme du patrimoine sonien. La sélection des arbres prélevés tient compte de nombreux éléments décrits dans le plan de gestion. Elle veille également à ce que les prélèvements de bois ne dépassent pas les volumes d’accroissement de la forêt. La régénération des peuplements repose à la fois sur la régénération naturelle et sur des plantations à petite échelle, en privilégiant notamment des essences dont la régénération naturelle est difficile et/ou présentant un intérêt écologique.
Une gestion sylvicole qui vise la diversification des essences et le rajeunissement des peuplements
En 2020, le hêtre couvre 52% de la partie bruxelloise de la forêt de Soignes en peuplement pur et 8% en peuplement mélangé dominé par le hêtre. Or, selon plusieurs études, les changements climatiques attendus au niveau régional pourraient mettre en péril la survie à long terme des hêtraies. D’autres essences sont également susceptibles d’être impactées par les changements climatiques. C’est le cas du chêne pédonculé, deuxième essence la plus présente en forêt de Soignes.
La forêt bruxelloise est par ailleurs marquée par une prédominance de peuplements de hêtres souvent vieillissants - et donc fragiles - et par un déséquilibre de la structure des âges des peuplements (voir focus et fiche documentée sur le patrimoine forestier de la forêt de Soignes).
Le nouveau plan régional de gestion de la forêt de Soignes prévoit notamment de rajeunir la forêt en régénérant les vieux peuplements de hêtres et de diversifier davantage les espèces d’arbres. Les essences les plus tolérantes aux conditions climatiques projetées - comme, par exemple, le chêne sessile, le tilleul à petites feuilles et le charme - seront privilégiées. La diversification est par ailleurs favorable à la biodiversité et permet d’augmenter la capacité des écosystèmes forestiers à résister aux perturbations du milieu, aux maladies ainsi qu’aux vents violents (résilience).
L’objectif de maintien du faciès paysager de « hêtraie cathédraleForêt de hêtres ou riche en hêtres qui ne laissent filtrer que très peu de lumière, à la façon des vitraux d'une cathédrale. » caractéristique de la forêt de Soignes concerne actuellement 20% de la forêt (il était de 50% dans le précédent plan de gestion). Le nouveau plan de gestion prévoit aussi de développer des chênaies à objectif cathédrale à partir de jeunes plantations de chênes pédonculé et sessile (9% de la forêt).
Une régénération à la fois naturelle et artificielle
La gestion de la forêt de Soignes vise la transition d’une part importante des peuplements se trouvant actuellement en futaie régulière (peuplement composé d’arbres sensiblement d’une même classe d’âge issus de semis ou de plantations) vers une futaiePeuplement forestier composé d'arbres directement issus de semences sur place et qui sont destinés à atteindre un plein développement avant d'être coupés. irrégulière (plusieurs classes d’âges). Cette transition s’appuie notamment sur l’exploitation de la régénération naturelle ainsi que sur des plantations réalisées en cellules d’une trentaine de plants.
Le nouveau plan de gestion prévoit qu’en moyenne 12,8 ha soient régénérés chaque année soit par plantation, soit par régénération naturelle, soit par une combinaison des deux.
Des plantations sont nécessaires là où il n’y a pas de semis naturels en suffisance ou lorsque la régénération naturelle ne convient pas aux objectifs de gestion fixés sur la parcelle. Dans ce dernier cas, il s’agira le plus souvent de plantations de chênes sessiles et d’autres essences dont la régénération naturelle est difficile. Le choix des essences tient également compte d’autres facteurs tels que leur adéquation par rapport aux caractéristiques de la station, leur intérêt écologique et leur résistance attendue aux changements climatiques. La plantation permet également d’apporter une diversité génétique dans les peuplements et d’augmenter ainsi leur résilience.
En moyenne 12,5 ha de forêt ont été replantés chaque année au cours de cette dernière décennie (11 ha au cours de la période 2003-2016). Durant cette période, plus de 130.000 arbres de diverses espèces ont été plantés.
Régénération artificielle : nombre de plants par essence et par exercice (2012-2021)
Source : Département forêt – Bruxelles Environnement, 2020
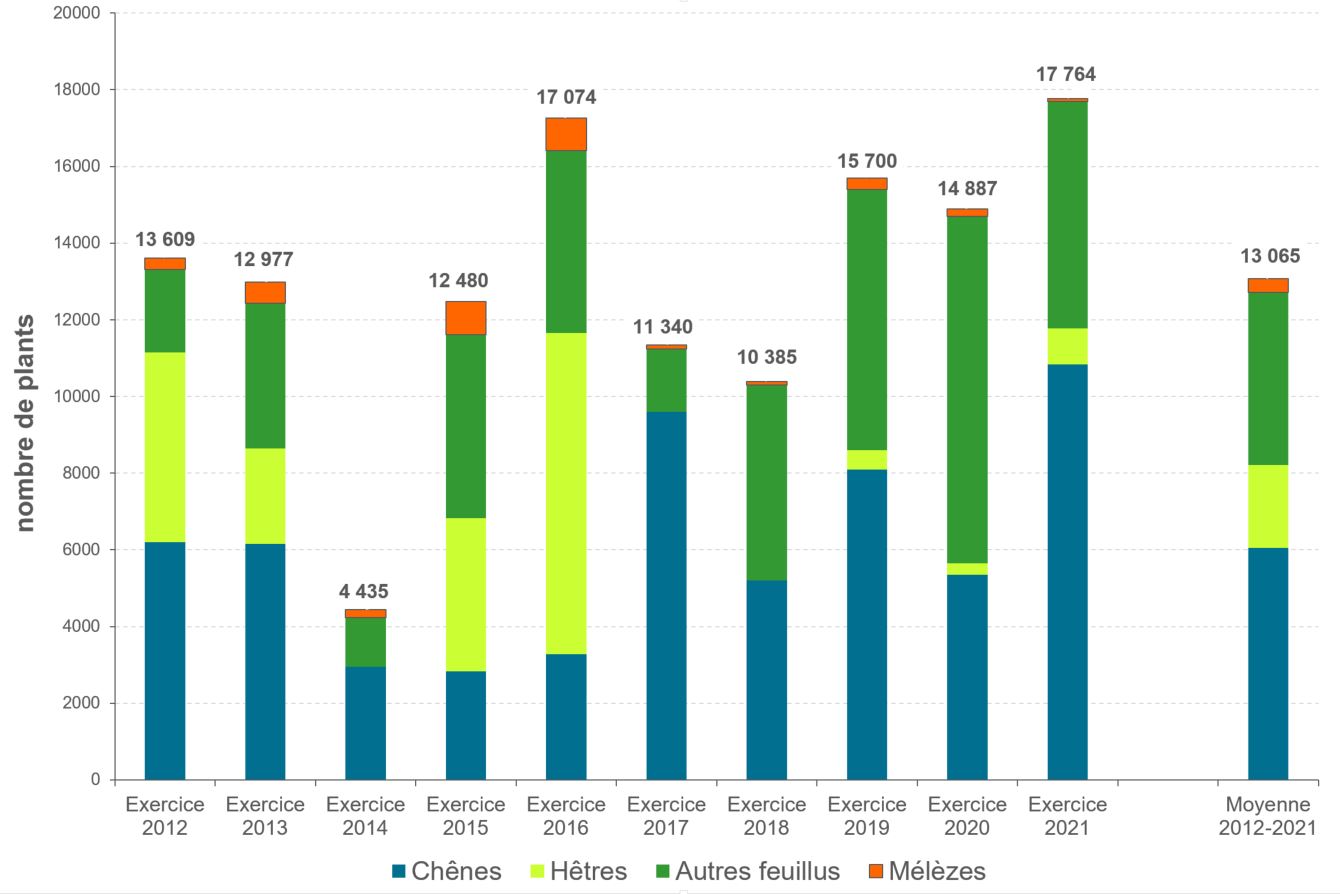
Le chêne sessile est une essence privilégiée au niveau des plantations effectuées. Il s’agit en effet d’une essence actuellement peu présente en forêt de Soignes et dont la régénérationEn sylviculture, opération consistant à remplacer un peuplement mûr soit par voie naturelle, soit par voie artificielle. naturelle est très limitée mais qui semble pouvoir s’adapter aux effets attendus du changement climatiqueDésigne de lentes variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l'air, résultant d'activités humaines, menacent de modifier sensiblement les climats, dans le sens d'un réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants : élévation du niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones, etc.), déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d'eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales, etc.. Pour les reboisements de hêtres, seuls des plants d'origine "Forêt de Soignes" dont le patrimoine génétique est unique et qui présente des qualités intéressantes sont utilisés.
La régénération naturelle du hêtre s’installe depuis 2005 dans les vieux peuplements de hêtres. Ce phénomène était imprévu et donne des opportunités pour la gestion en futaiePeuplement forestier composé d'arbres directement issus de semences sur place et qui sont destinés à atteindre un plein développement avant d'être coupés. irrégulière et pour la conversion de certains peuplements. D’autres essences telles que l’érable, le frêne, le charme, le merisier et le bouleau se régénèrent aussi naturellement bien (voir focus et fiche documentée sur le patrimoine forestier de la forêt de Soignes).
Des prélèvements d’arbres visant avant tout à préserver la biodiversité et les paysages et à assurer la pérennité de la forêt
En forêt de Soignes, le prélèvement de bois et la régénération des peuplements poursuivent cinq grands objectifs :
- régénérer les peuplements vieillis de hêtres et assurer la pérennité de la forêt ;
- préserver les paysages ;
- protéger et favoriser la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). ;
- assurer la sécurité des usagers de la forêt ;
- alimenter la filière économique du bois avec du bois de qualité et labellisé « gestion durable ».
La production de bois ne constitue pas un objectif premier de cette gestion multifonctionnelle de la forêt mais en constitue un « produit dérivé ».
Une sélection réfléchie des arbres à prélever
En plus des coupes de sécurité, les peuplements sont éclaircis tous les 8 ans. Ces éclaircies se font en désignant dans un premier temps des « arbres-objectif » (ou arbres d’avenir) que le forestier choisi de préserver au fil des éclaircies. Ces arbres-objectif sont appelés à déterminer l’aspect de la forêt pendant une période plus ou moins longue. Différentes considérations interviennent dans leur choix: ils peuvent être sélectionnés pour la rareté de leur essence, pour leur beauté et leur valeur paysagère, pour leur résistance attendue aux changements climatiques, pour leur production de bois de haute qualité ou pour une combinaison de ces motifs. Excepté dans certains peuplements spécifiques (objectif cathédrale, conifères,…), le gestionnaire s’attache aussi à renforcer le mélange d’essences.
Outre les arbres-objectif le plan de gestion vise le maintien d’ « arbres-habitat » (au minimum 10 par ha). Ces arbres (ou îlots d’arbres) sont préservés jusqu’à leur mort naturelle puis seront laissés sur place sous forme de bois mort, en vue de favoriser la présence d’une biodiversité particulière et parfois très rare (chauve-souris, pics, etc.), liée aux gros arbres âgés et à leurs anfractuosités ainsi qu’au bois mort. Certains vieux arbres sont aussi laissés sur pied pour des questions paysagères.
Avec en moyenne 6 arbres-habitat par ha, la forêt de Soignes présente un nombre exceptionnellement élevé d’arbres de gros diamètre (supérieur à 80 cm). L’objectif du plan de gestion est de maintenir le nombre de gros arbres par ha à un niveau constant et ce, malgré l’abattage de gros arbres.
Le gestionnaire procède ensuite à la sélection et au marquage des arbres qui doivent être supprimés à proximité des arbres objectifs (martelage) afin d’offrir à ces derniers suffisamment d’espace pour qu’ils puissent croître de façon optimale. Cette sylviculture dynamique doit permettre de faire évoluer les jeunes peuplements équiennes mono spécifiques de hêtres vers des peuplements à structure plus complexe (mélange d’essences et d’âges) là où la futaie irrégulière est prévue.
Une cartographie des arbres en soutien à la gestion sylvicole
Depuis 2020, un relevé et une caractérisation des arbres-objectif et des arbres-habitat sont effectués systématiquement dans les coupes passées en martelage. La cartographie de ces arbres permet de voir si les objectifs de gestion sont bien respectés (nombre d’arbres-habitat par hectare, densité finale des peuplements, essences favorisées, etc.).
Ces cartes sont également très pertinentes pour illustrer les mesures des gestions prévues dans les différents peuplements et pour avoir un aperçu de l’état actuel de ceux-ci.
Des exemples de cette cartographie et de la logique sous-tendant la sélection des arbres-objectif et des arbres-habitat à l’échelle de la parcelle compte tenu des objectifs de gestion qui y ont été fixés sont fournis dans la fiche documentée complétant ce focus.
Des règles techniques imposées pour minimiser les impacts de l’exploitation forestière
Les arbres marqués (ou martelés) constituent des lots de bois sur pied mis en vente par adjudication publique. C’est aux acquéreurs des lots (marchands de bois, scieries) d’exécuter les travaux d’abattage, façonnage, transport, etc., en conformité avec le cahier des charges d’exploitation imposé par Bruxelles Environnement et sous la surveillance des gardes forestiers. Celui-ci comporte un ensemble de règles techniques d’exploitation visant à minimiser les impacts de l’exploitation forestière sur les sols (compaction, exportation d’éléments minéraux), la végétation et la faune. Parmi les règles imposées figure l’interdiction des abattages en période de nidification (1 avril-15 août).
Une autre obligation concerne la découpe du tronc qui doit se faire à 16 mètres de longueur dans les lots à gros bois. Ceci a pour conséquence que les houppiers (ensemble des branches situées au sommet du tronc) sont laissés sur place ce qui augmente le taux de bois mort au sol de façon significative. Cette mesure limite également le nombre de passages des machines sur les layons de débardage et diminue ainsi l’impact des exploitations.
Des volumes de bois prélevés inférieurs à l’accroissement
En moyenne, au cours de la dernière décennie (2012-2021), 5542 m³ de bois d’œuvre (soit environ 3,4 m³/ha) ont été prélevés chaque année en forêt de Soignes bruxelloise via les ventes de bois. Notons que le volume de bois d’œuvre est un volume qui ne tient compte que du volume du tronc jusqu’à une recoupe au sommet, variable suivant la forme des arbres. Il diffère du volume de bois fort qui est la mesure utilisée pour les calculs de productivité effectués par les scientifiques et qui est estimé se situer entre 9 et 11 m3/ha/an en forêt de Soignes (voir focus et fiche documentée sur le patrimoine forestier de la forêt de Soignes).
Selon le plan de gestion de la forêt de Soignes, l’accroissement du « volume bois d’œuvre » serait d’environ 5 m³/ha/an pour le cantonnement de Bruxelles et de Groenendael. Dans la mesure où les prélèvements de bois sont inférieurs à l’accroissement naturel des volumes de bois, la tendance semble dès lors être à la capitalisation du bois sur pied.
Le graphique ci-dessous reprend les volumes de bois prélevés chaque année en forêt de Soignes bruxelloise. Les lots sont de trois types :
- gros bois c’est-à-dire des arbres adultes à maturité de coupe ;
- petits et moyens bois correspondant à du bois d’éclaircie coupé pour permettre aux arbres d’avenir de disposer de suffisamment de place pour se développer ;
- chablis : arbre ou groupe d’arbres renversé(s), déraciné(s) ou rompu(s) sous l'action de différents agents naturels ou pour des raisons qui lui sont propres et dont l’abattage est de ce fait délicat.
Vente de bois du cantonnement de Bruxelles - Forêt de Soignes bruxelloise : Evolution des volumes de bois vendus (exercices 2004-2021)
Source : Bruxelles Environnement – département Forêt, 2020
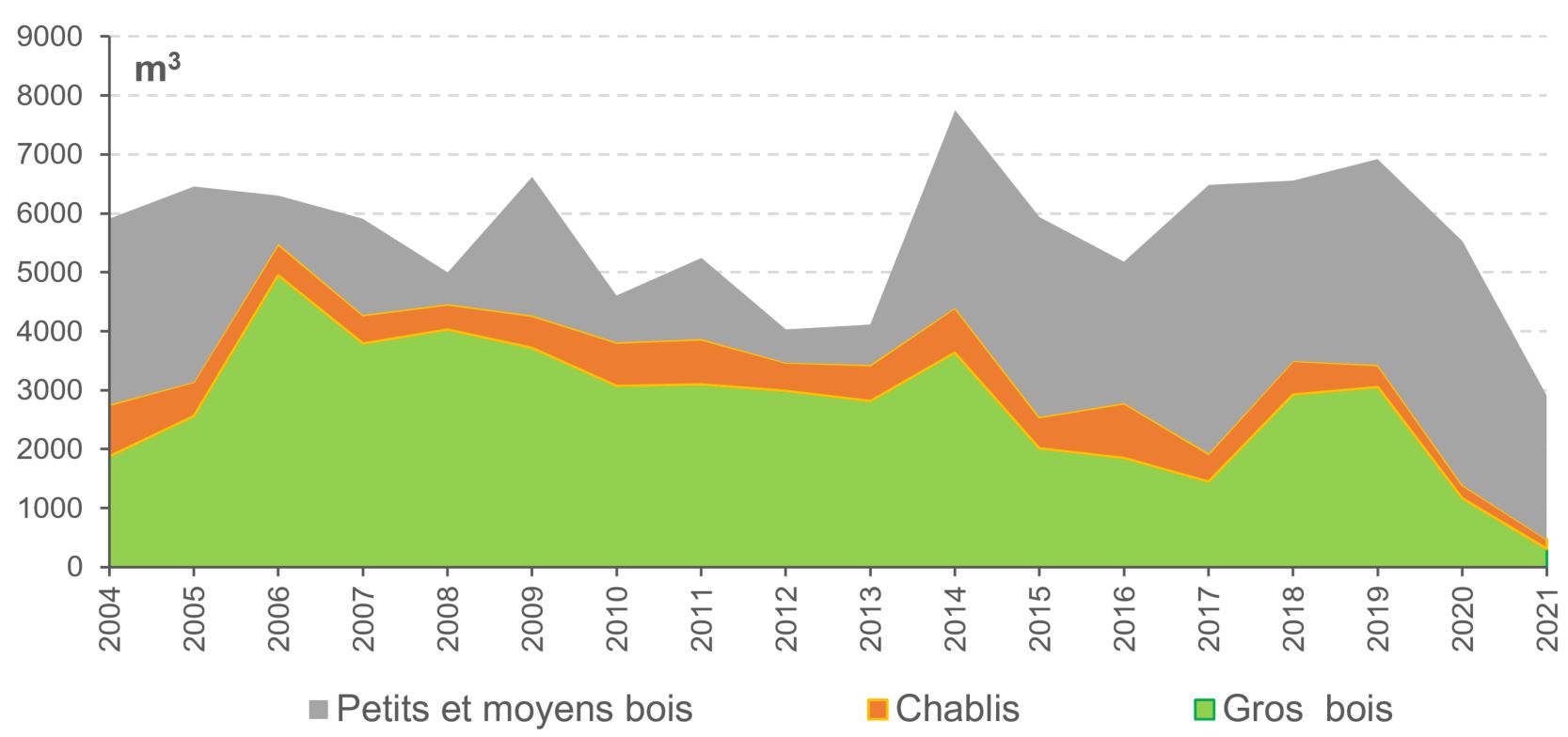
Ces chiffres sont établis sur base du bilan des ventes de bois du cantonnement de Bruxelles.
La vente du bois sonien alimente un fonds destiné aux espaces verts
Les revenus issus de la vente varient fortement d’une année à l’autre en raison de différents facteurs dont :
- variation des volumes exploités ;
- pour les gros bois, fluctuations importantes du marché du bois de hêtre se traduisant par des variations du prix/m3;
- concurrence tendant à diminuer dans l’exploitation des bois de chablis (plus difficiles à exploiter).
Au cours des 10 dernières années, les recettes ont ainsi oscillé entre environ 125000 € et 501000 €, avec une moyenne de l’ordre de 300000 € par an. Le prix moyen obtenu avoisine les 90 €/m³ pour les gros bois et les 30 €/m³ pour les petits bois.
Vente de bois du cantonnement de Bruxelles - Forêt de Soignes bruxelloise : Evolution des recettes des ventes de bois actualisées selon l’indice des prix à la consommation (exercices 2004-2021)
Source : Bruxelles Environnement – département Forêt, 2020
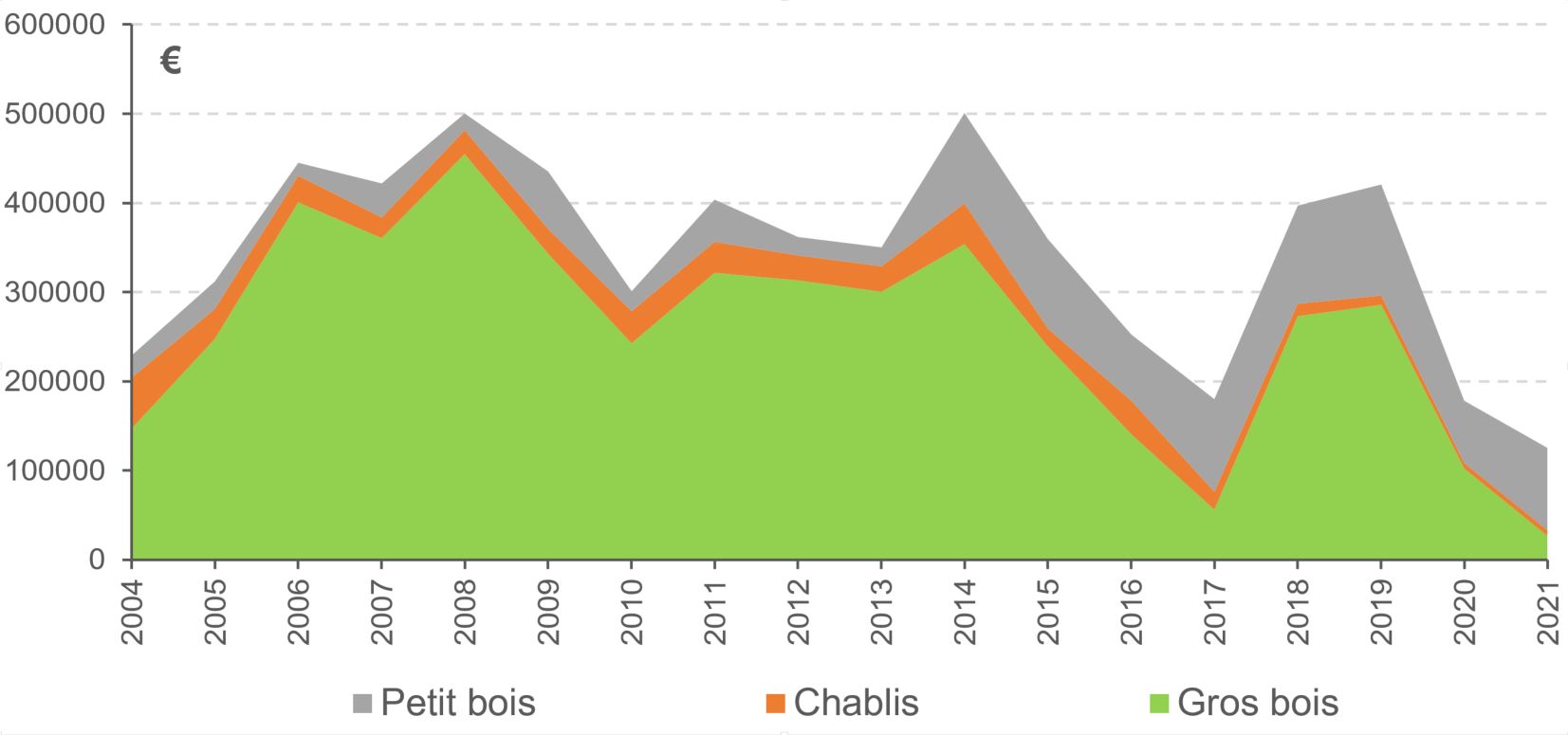
Malgré certains défauts lié à l’âge d’exploitation souvent très élevé des hêtres vendus, le hêtre de Soignes se vend généralement assez bien en raison notamment de sa localisation géographique et de l’actuelle forte demande asiatique en hêtres.
Les recettes issues de la vente annuelle de bois de la forêt de Soignes sont reversées dans un fonds régional destiné à l’entretien, à l’acquisition et à l’aménagement d’espaces verts, des forêts et des sites naturels ainsi qu’au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune.
Le bois de la forêt de Soignes au service d’une économie circulaire ?
Globalement, les gros bois et chablis partent en bois d’œuvre et d’industrie. Les petits et moyens bois partent en bois d’industrie et en bois de chauffage.
Actuellement la plus grande part des fûts de hêtres abattus sont exportés vers l’Asie où ils sont très souvent transformés en meubles dont une partie revient en Europe sous forme manufacturée.
Cette situation, dommageable d’un point de vue environnemental et économique, est liée à plusieurs facteurs :
- obligation pour la Région bruxelloise de recourir à des marchés publics pour la vente du bois ;
- faible coût du transport et de la transformation du bois dans les pays asiatiques ;
- raréfaction des filières locales de transformation du bois de hêtre.
Une réflexion est en cours pour que le bois sonien soit vendu et transformé au sein de la Région bruxelloise et que sa valorisationToute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. s’inscrive dans le cadre d’une économie circulaireL'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur.. Par ailleurs, depuis plusieurs années, une entreprise de travail adapté achète certains lots de bois et assure leur exploitation jusqu’à leur vente sous forme de bûches de chauffage.
À télécharger
Fiches documentées :
- 10. Habitats naturels dans les espaces verts bruxellois
- 20. Surveillance des habitats naturels en Région bruxelloise (.pdf)
- 21. Inventaire du patrimoine forestier de la forêt de Soignes bruxelloise (.pdf)
- 22. Prélèvements de bois, accroissement et régénération en forêt de Soignes bruxelloise (.pdf)
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Focus : Patrimoine forestier de la forêt de Soignes bruxelloise (édition 2019-2020)
- Focus : Changement climatique et croissance du hêtre en forêt de Soignes (édition 2015-2016)
- Focus : L’adaptation aux changements climatiques (édition 2011-2014)
- Forêt de Soignes et risques associés au changement climatique (édition 2007-2008) (.pdf)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Rapport sur l’état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale, septembre 2012 (.pdf)
- Carte « Potentialités sylvicoles actuelles et à l'horizon 2100 du hêtre en Forêt de Soignes »
Etudes et rapports
- DAISE J., CLAESSENS H., RONDEUX J. 2009. « Etude de l’adéquation des essences aux stations forestières de la forêt de Soignes (zone bruxelloise) dans le contexte du changement climatique», Unité de Gestion des Ressources Forestières et des Milieux Naturels, FUSAGx-ULg, étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 368 pp.+ annexes. (.pdf)
- GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES (FUSAGx-ULg) 2015. « Analyse de l’influence du changement climatique du hêtre en forêt de Soignes ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 14 pp. + annexes (.pdf)
- LATTE N. et al. 2015. "Dendroécologie du hêtre en forêt de Soignes - Les cernes des arbres nous renseignent sur les changements récents et futurs », in Forêt.Nature n°137, recherche financée par Bruxelles Environnement et l’Accord-cadre de recherches et de vulgarisation forestières (SPW, DGO3, DNF), pp.25-37. (.pdf)
- UNITE DE GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES ET DES MILIEUX NATURELS - FUSAGx-ULg - 2020. « Synthèse 2020 de l’inventaire forestier de la forêt de Soignes bruxelloise », inventaire réalisé pour le compte de Bruxelles Environnement.
- VAES F., VANWIJNSBERGHE S. 2020. "Un nouveau plan de gestion pour la forêt de Soignes" in "Forêt Nature" n°155. (.pdf)
Plans et programmes
- Plan régional nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale, 2016 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre I - Etat des connaissances, 2018 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre II - Objectifs et mesures de gestion, 2018 (.pdf)
- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre III - Plans de gestion des réserves archéologiques, naturelles et forestières, 2018 (.pdf)
Liens utiles
Changement climatique et croissance du hêtre en forêt de Soignes
Focus - Actualisation : janvier 2018
L’étude des cernes (ou « anneaux de croissance ») des hêtres de la forêt de Soignes a mis en évidence une réduction de leur croissance depuis les années ’90. Cette évolution apparaît davantage liée à l’évolution du climat qu’au vieillissement des peuplements. Si jusqu’à présent aucun seuil critique mettant directement les arbres en danger n’a été atteint, l’augmentation attendue de la fréquence et de l’intensité des sécheresses printanières et des canicules estivales liée aux changements climatiques pourrait mettre en péril la survie à long terme des hêtraies.
La fragilité des hêtres de la forêt de Soignes
La forêt de Soignes dans sa forme actuelle résulte de plantations, majoritairement de hêtres, qui ont été entreprises à l’époque autrichienne à la fin du 18ème siècle. Celles-ci visaient principalement à produire du bois de qualité mais, au fil des décennies, la vocation productive de la forêt s’est atténuée au bénéfice d’une gestion davantage axée sur le développement de la fonction récréative et la préservation des paysages et de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore).. Le rythme des coupes et des régénérations, initialement effectuées avec une révolution de 80 ans, a été progressivement allongée à 200 ans et la futaiePeuplement forestier composé d'arbres directement issus de semences sur place et qui sont destinés à atteindre un plein développement avant d'être coupés. a vieilli, donnant naissance à un paysage particulier qualifié de « forêt cathédrale ». En forêt de Soignes, celle-ci est composée de hautes futaies, constituées de hêtres de même âge aux longs troncs rectilignes (cimes atteignant jusqu’à 50 mètres de haut) et présentant un sous-bois dégagé.
La partie bruxelloise de la forêt de Soignes est aujourd’hui couverte d’environ 57% de hêtraies (dont 50% pure et 7% en mélange) et de 21% de chênaies (dont 13% pure et 8% en mélange, il s’agit essentiellement de chênes pédonculés).
La forêt de Soignes représente un patrimoine naturel, historique et culturel d’une importance considérable pour les Bruxellois. Depuis une dizaine d’années, son avenir fait cependant l’objet de nombreuses interrogations de la part du monde forestier, en particulier en ce qui concerne l’impact qu’auront les changements climatiques prévus sur les peuplements de hêtres.
La hêtraie sonienne apparaît en effet fragile pour différentes raisons parmi lesquelles on peut notamment citer des facteurs liés aux caractéristiques des peuplements (hêtraies le plus souvent pures faites d’arbres de plus de 40 mètres et s’approchant de leur limite de longévité) et des sols (présence fréquente d’un horizon de sol induré à faible profondeur dénommé « fragipan », compaction superficielle, sécheresse relative d’une partie des sols de versants). Dans ces conditions, certains peuplements s’avèrent particulièrement vulnérables aux évènements climatiques extrêmes mais aussi aux maladies et ravageurs.
Une étude visant à caractériser les impacts potentiels des changements climatiques sur la forêt de Soignes à l’horizon 2100 (Daise et al., 2009) a par ailleurs mis en évidence le fait que l’essence qui devrait être la plus touchée par les modifications attendues du climat était le hêtre. D’autres essences telles que le Chêne pédonculé, l’Erable sycomore ou le Frêne sont cependant également susceptibles d’être sensiblement impactées par les évolutions climatiques (voir focus « Forêt de Soignes et risques associés au changement climatique » de la synthèse 2007-2008).
L’étude de la croissance des cernes des hêtres pour mieux comprendre l’effet des changements climatiques
C’est dans ce cadre qu’une recherche visant à approfondir les connaissances relatives à l’effet des changements climatiques sur la croissance des hêtres soniens a été menée en 2015.
L’approche utilisée dans cette étude est la « dendroécologie » c’est-à-dire une combinaison de la dendrochronologie et de l’écologie forestière. La dendrochronologie est la discipline scientifique relative à la mesure et à la datation des largeurs des cernes lesquelles permettent d’estimer la croissance annuelle des arbres. En mettant en relation des variables environnementales et la croissance des arbres, la dendroécologie constitue l’une des méthodes permettant d’analyser l’impact des changements environnementaux sur les écosystèmes forestiers.
L’étude s’est focalisée sur l’analyse des relations entre la croissance, d’année en année, d’un échantillon de quelques centaines de hêtres et, d’une part, des données climatiques (températures et précipitations) et, d’autre part, l’âge des hêtres.
Pour ce faire, l’étude s’est appuyée sur un important jeu de données dendrochronologiques se rapportant à 286 hêtres répartis sur 35 sites représentatifs de l’aire de répartition des hêtraies en Belgique et couvrant les différentes classes d’âges étudiées.
Cet échantillon a été réparti en 3 groupes:
- Hêtraies de plaines hors forêt de Soignes (zone bioclimatique atlantique, entre le sillon Sambre et Meuse et la mer du Nord);
- Hêtraies soniennes (zone bioclimatique atlantique);
- Hêtraies ardennaises (zone bioclimatique sub-montagnarde).
L’étude a mis en évidence une phase d’augmentation de la croissance des hêtres entre les années ’20-’30 et les années ’60-70’. Selon les chercheurs, cette évolution est à mettre en relation avec le réchauffement progressif du climat allié à l’allongement de la période de végétation observé durant cette période. Ces derniers ont par ailleurs émis l’hypothèse que cette croissance accrue des hêtres pourrait également être liée aux retombées atmosphériques azotées (fertilisation) résultant des émissions polluantes et à l’évolution de la gestion sylvicole. Ces variables n’ont néanmoins pas été étudiées dans le cadre de cette étude.
L’analyse des cernes a également montré qu’en forêt de Soignes, l’augmentation de cette croissance a été nettement moins marquée que dans les deux autres groupes. Selon les chercheurs, ce constat pourrait être lié à la densité importante des peuplements ainsi qu’aux caractéristiques physiques des sols.
Cette phase de croissance accrue a été suivie d’une phase de diminution, observée également à l’échelle de l’Europe, et qui résulterait en grande partie de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur ainsi que des épisodes de sécheresse. Le hêtre, espèce typique des climats tempérés frais et normalement bien arrosés, est en effet une essence peu adaptée au manque d’humidité - en particulier durant le printemps où se fait l’essentiel de sa croissance - ainsi qu’aux fortes chaleurs estivales. En cas de stress marqué en été, la capacité des arbres à accumuler des réserves diminue ce qui pénalise leur accroissement au printemps suivant.
De ce fait, les changements climatiques attendus pour la Région bruxelloise pourraient s’avérer particulièrement négatifs pour les hêtres et, plus généralement, pour diverses essences présentes en forêt de Soignes. En effet, selon une étude (Pouria et al. 2012) commanditée par Bruxelles environnement sur l’adaptation au changement climatiqueDésigne de lentes variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l'air, résultant d'activités humaines, menacent de modifier sensiblement les climats, dans le sens d'un réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants : élévation du niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones, etc.), déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d'eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales, etc. en Région de Bruxelles-Capitale, l’évolution probable du climat au niveau régional - établie en se basant sur différents modèles - se traduirait entre autres par:
- une modification du régime des précipitations avec une diminution des précipitations en été (-11 à 37% en 2085) et une augmentation des précipitations hivernales (+21% en 2085 selon les projections moyennes), au niveau annuel les projections pour 2085 sont très divergentes selon les modèles et scénarios;
- une augmentation des t° moyennes annuelles (entre +1,9 et +5,4°C en 2085) et des t° estivales (entre +2,3 et +7,2°C en 2085), pour les t° automnales et printanières les projections divergent selon les modèles et scénarios ;
- à partir de 2050, une augmentation du nombre de jours de canicules estivales.
En outre, selon le rapport 2007 du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), notre pays pourrait être également soumis à un accroissement, en fréquence et en intensité, des tempêtes hivernales à l’horizon 2100 (degré de certitude moindre).
La pluviométrie annuelle minimale permettant encore la croissance du hêtre est de 600 mm sous réserve que celui-ci bénéficie d’une humidité ambiante importante et/ou d’une bonne alimentation en eau du sol. En forêt de Soignes, certaines études ont montré que le hêtre pouvait, dans une certaine mesure, adapter son architecture racinaire pour accéder à des ressources hydriques profondes (pénétration des racines, via des fissures, en-dessous du fragipan où se trouve un sol limoneux riche et meuble) (LANGHOR R. 2010, LA SPINA S. 2011).
Les graphiques ci-dessous représentent, pour chacun des groupes considérés, l’évolution de la moyenne des accroissements annuels des hêtres (exprimée en pourcentage de la situation moyenne en 1900). Une technique de standardisation a été utilisée afin de créer une courbe représentant l’accroissement d’un arbre moyen qui aurait un âge constant pendant toute la période étudiée (1900-2008) ce qui permet d’isoler les effets des changements environnementaux dans le temps.
Croissance radiale (cernes) des hêtres entre 1900 et 2008 : tendances générales (courbes régionales standardisées ou RCS en anglais)
Source : Gembloux Agro Bio-Tech 2015
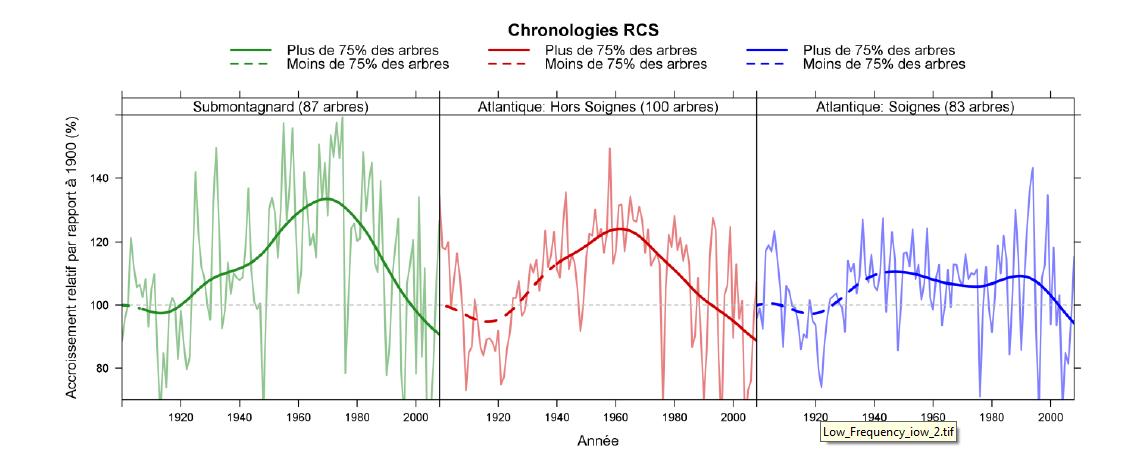
Comme l’illustre le graphique, en forêt de Soignes, la diminution de la croissance radiale s’est amorcée plus tardivement que dans les 2 autres groupes, à savoir, à partir des années ’90. Pour les hêtraies de plaines hors forêt de Soignes ainsi que pour les hêtraies ardennaises étudiées, la croissance des hêtres observée à la fin du 20ème siècle – début du 21ème siècle s’avère inférieure à ce qu’elle était au début du 20éme siècle. Cette tendance semble également s’amorcer en forêt de Soignes.
L’étude s’est également attachée à identifier les données météorologiques (mesurées à la station d’Uccle) permettant d’expliquer au mieux les variations de la croissance des hêtres d’une année à l’autre.
Ceci a notamment permis de montrer qu’en forêt de Soignes les années de croissance particulièrement faibles avaient toutes un lien direct avec un climat exceptionnel survenu l’année en cours ou l’année précédente et qu’elles étaient essentiellement concentrées sur la période 1976-2004. Par ailleurs, pour les 3 groupes, on constate globalement qu’avant 1976 l’accroissement des arbres a été essentiellement influencé par le climat de l’année en cours. Après 1976, année charnière marquée par une sécheresse printanière et des vagues de chaleur estivales, l’influence de ces 2 paramètres climatiques a fortement augmenté et celle des éventuelles canicules de l’été précédent est devenue prépondérante.
En forêt de Soignes, pour la période 1990-2013, les précipitations printanières et les canicules de l’été précédent expliquent à elles seules jusqu’à 50% de la variation de l’indice de cerne. Une approche par modélisation a par ailleurs montré que l’augmentation observée de la sensibilité moyenne au cours de la seconde moitié du 20ème siècle - mesurée par le taux de variation entre deux accroissements consécutifs - était davantage due aux changements climatiques qu’au vieillissement des hêtraies de Soignes.
Quels enseignements pour la gestion de la forêt de Soignes ?
Aucun seuil critique mettant directement les arbres en danger n’a encore été atteint : un rétablissement de la croissance des hêtres a en effet toujours été observé lors des années favorables, plus humides et moins chaudes. Néanmoins, les changements climatiques attendus pour la fin du 21ème siècle au niveau régional, avec entre autres une augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses et des canicules estivales, pourraient mettre en péril la survie à long terme des hêtres en affectant leur croissance annuelle. Cette conclusion converge avec celle d’une autre étude, menée en 2009, qui a modélisé l’évolution de l’aire de répartition potentielle de 26 essences (présentes ou envisageables en forêt de Soignes) à l’horizon 2100 dans le contexte du changement climatiqueDésigne de lentes variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l'air, résultant d'activités humaines, menacent de modifier sensiblement les climats, dans le sens d'un réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants : élévation du niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones, etc.), déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d'eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales, etc.. D’après ces projections, les seules stations où le hêtre sera en relative adéquation avec son milieu seront les vallons et la zone du Rouge-Cloître (voir focus « Forêt de Soignes et risques associés au changement climatique de la synthèse 2007-2008).
Ces informations ont été prises en compte pour l’élaboration du nouveau plan de gestion de la forêt de Soignes qui devrait être adopté en 2018. Pour les peuplements de hêtres existants, ce plan prévoit notamment de réaliser des éclaircies plus fortes et fréquentes afin de limiter la concurrence entre les arbres et d’accélérer leur croissance ce qui permettra de diminuer l’âge d’exploitation et donc les risques, en particulier de chablis (chute d’arbres). La gestion devra aussi privilégier les hêtres les plus vigoureux car ceux-ci sont susceptibles de posséder des prédispositions génétiques à mieux surmonter le stress et leur descendance pourrait se révéler d’un grand intérêt.
L’objectif de maintien du faciès paysager de hêtraie cathédraleForêt de hêtres ou riche en hêtres qui ne laissent filtrer que très peu de lumière, à la façon des vitraux d'une cathédrale., qui concernait 50% de la superficie de la forêt de Soignes bruxelloise dans le plan de gestion adopté en 2003, a été revu à la baisse et concerne actuellement 20% de la forêt. Compte tenu des qualités paysagères du faciès cathédrale, le nouveau plan de gestion prévoit par ailleurs de développer des chênaies équiennes- c’est-à-dire constituée d’arbres du même âge - à objectif cathédrale (9% de la forêt). Pour les superficies restantes, la gestion s’orientera vers une mise en place progressive d’une structure plus étagée et moins dense, issue de mélanges d’essences, en combinaison avec la mise en place de lisières étagées. Les espèces les plus tolérantes aux conditions climatiques attendues à la fin du siècle (chêne sessile, tilleul à petites feuilles, etc.) seront privilégiées. La diversification est par ailleurs favorable à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). et permet d’augmenter la capacité des écosystèmes forestiers à résister aux perturbations du milieu, aux maladies ainsi qu’aux vents violents (résilience).
Au total le projet de plan de gestion de la forêt de Soignes prévoit de maintenir le hêtre sur 44% de la surface bruxelloise de la Forêt de Soignes (20% à objectif paysager « cathédrale », 12% sous forme de futaiePeuplement forestier composé d'arbres directement issus de semences sur place et qui sont destinés à atteindre un plein développement avant d'être coupés. irrégulière à base de hêtre et 12% sous forme d’îlots de vieillissement, de sénescence et de réserve forestièreLa réserve forestière est une forêt ou une partie de celle-ci, protégée dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables, ou des peuplements d'essence indigène, et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu. intégrale).
À télécharger
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Focus : L’adaptation aux changements climatiques (édition 2011-2014)
- Forêt de Soignes et risques associés au changement climatique (édition 2007-2008) (.pdf)
Autres publications de Bruxelles Environnement
Etudes et rapports
- EARTH & LIFE INSTITUTE ENVIRONMENTAL SCIENCES (UCL) 2017. « Suivi de l’état sanitaire en forêt de Soignes bruxelloise 2016 ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 66 pp. (.pdf)
- GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES (ULg-GEMBLOUX AGRO-BIO TECH) 2015. « Analyse de l’influence du changement climatique du hêtre en forêt de Soignes ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 14 pp.+ annexes (.pdf)
- LATTE N. et al. 2015. “Dendroécologie du hêtre en forêt de Soignes - Les cernes des arbres nous renseignent sur les changements récents et futurs », in Forêt.Nature n°137, recherche financée par Bruxelles Environnement et l’Accord-cadre de recherches et de vulgarisation forestières (SPW, DGO3, DNF), pp.25-37.
- UNITÉ DE GESTION DES RESSOURCES FORESTIÈRES ET DES MILIEUX NATURELS (FAC. DE GEMBLOUX AGRO-BIO TECH - ULg) 2009. « Etude de l’adéquation des essences aux stations forestières de la forêt de Soignes (zone bruxelloise) dans le contexte du changement climatique». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 368 pp.+ annexes. (.pdf)
Plans et programmes
- Plan régional nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale, 2016 (.pdf)
- Plan de gestion de la Forêt de Soignes - partie de Bruxelles-Capitale, 2003 (.pdf)
- Projet de plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre I - Etat des connaissances, 2018 (.pdf)
- Projet de plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre II - Objectifs et mesures de gestion, 2018 (.pdf)
- Projet de plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre III - Plans de gestion des réserves archéologiques, naturelles et forestières, 2018 (.pdf)
Liens utiles
Forêt de soignes et risques associés au changement climatique
Focus - Actualisation : décembre 2009
Les arbres vivent généralement plusieurs dizaines (peupliers,…) à plusieurs centaines d’années (hêtre, chêne,…). La gestion forestière implique dès lors une vision à long terme anticipant les changements susceptibles de se produire, en particulier en ce qui concerne le milieu environnant.
La forêt de Soignes est actuellement composée majoritairement de peuplements uniformes de hêtres, souvent vieillissants. Le paysage particulier formé par cette « hêtraie cathédraleForêt de hêtres ou riche en hêtres qui ne laissent filtrer que très peu de lumière, à la façon des vitraux d'une cathédrale. » et son histoire revêtent une grande importance pour bon nombre de Bruxellois. Cette hêtraie est cependant fragile du fait de différents facteurs : sécheresse relative d’une partie des sols de versants, compaction superficielle, présence fréquente d’un horizon de sol quasi imperméable aux racines à faible profondeur (fragipan), uniformité des peuplements se traduisant par une mauvaise résistance aux intempéries (vents violents) et aux maladies.
La question de l’impact du réchauffement climatique sur ces écosystèmes soniens déjà fragilisés a récemment émergé. Différentes recherches universitaires ont tenté ou tentent d’apporter des éléments de réponse à cette question. Parmi celles-ci, une étude menée par l’unité de gestion des ressources forestières et des milieux naturels (FuSAGx) à la demande de Bruxelles Environnement a modélisé l’évolution de l’aire de répartition potentielle de 26 essences (présentes ou envisageables dans un reboisement futur) en forêt de Soignes dans le contexte du changement climatiqueDésigne de lentes variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l'air, résultant d'activités humaines, menacent de modifier sensiblement les climats, dans le sens d'un réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants : élévation du niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones, etc.), déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d'eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales, etc.. Le scénario retenu pour les simulations climatiques est un scénario intermédiaire (A1B) parmi ceux développés par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Il prévoit, à l’horizon 2100, pour la région de la forêt de Soignes, un climat comparable à celui de la basse Loire, c’est-à-dire :
- une augmentation de la t° moyenne annuelle de 3°C et de la t° moyenne estivale de près de 4°C ;
- une diminution des précipitations en saison de végétation d’environ 15% et des précipitations en été d’environ 25%;
- une augmentation des précipitations hivernales de près de 20% ;
- un accroissement, en fréquence et en intensité, des tempêtes hivernales (degré de certitude moindre).
L’étude met en évidence le fait qu’en forêt de Soignes, l’essence qui sera la plus touchée par de telles modifications du climat est le hêtre. Les cartes ci-jointes représentent la plus ou moins grande aptitude du hêtre à se développer dans les conditions actuelles (la classe « tolérance » correspond à la présence d’un facteur limitant toléré) ainsi que dans celles projetées en 2100, au niveau des différentes stations (parcelle homogène au niveau climatique, topographie, géologie, sol, flore spontanée) de la zone étudiée (partie bruxelloise de la forêt de Soignes). D’après ces projections, les seules stations où le hêtre sera en plus ou moins bonne adéquation avec son milieu (« en station » ou « tolérance » dans la figure) correspondent aux vallons ou à la zone du Rouge-Cloître. Sur cette base, l’objectif - repris dans le plan de gestion de la forêt de Soignes adopté par la Région bruxelloise en 2003 - de maintenir le faciès paysager de hêtraie cathédrale sur 50% de la superficie de la forêt n’apparaît pas tenable. Compte tenu des incertitudes subsistant concernant l’intensité du changement climatique auquel sera exposée la forêt de Soignes et de son impact sur les écosystèmes, il convient d’adopter le principe de précaution en diversifiant les espèces et en privilégiant celles qui peuvent potentiellement résister aux changements annoncés (chêne sessile, tilleul,…). Le hêtre continuera néanmoins à être planté mais dans une proportion moindre. Une réflexion sur les modalités précises de cette stratégie de plantation est actuellement en cours.
Des mesures de gestion sylvicoles ont d’ores et déjà été prises pour faire face au défi posé par le changement climatique : développement d’un système de surveillance des peuplements (état de santé des arbres, attaques parasitaires), évolution de la stratégie de régénérationEn sylviculture, opération consistant à remplacer un peuplement mûr soit par voie naturelle, soit par voie artificielle. de la hêtraie (modalités des coupes, choix des essences,…), élaboration d’un « plan incendie »,…
Potentialités sylvicoles actuelles et à l’horizon 2100 du hêtre en forêt de Soignes dans l’hypothèse d’un changement climatique
Source : DAISE & CLAESSENS, 2009.
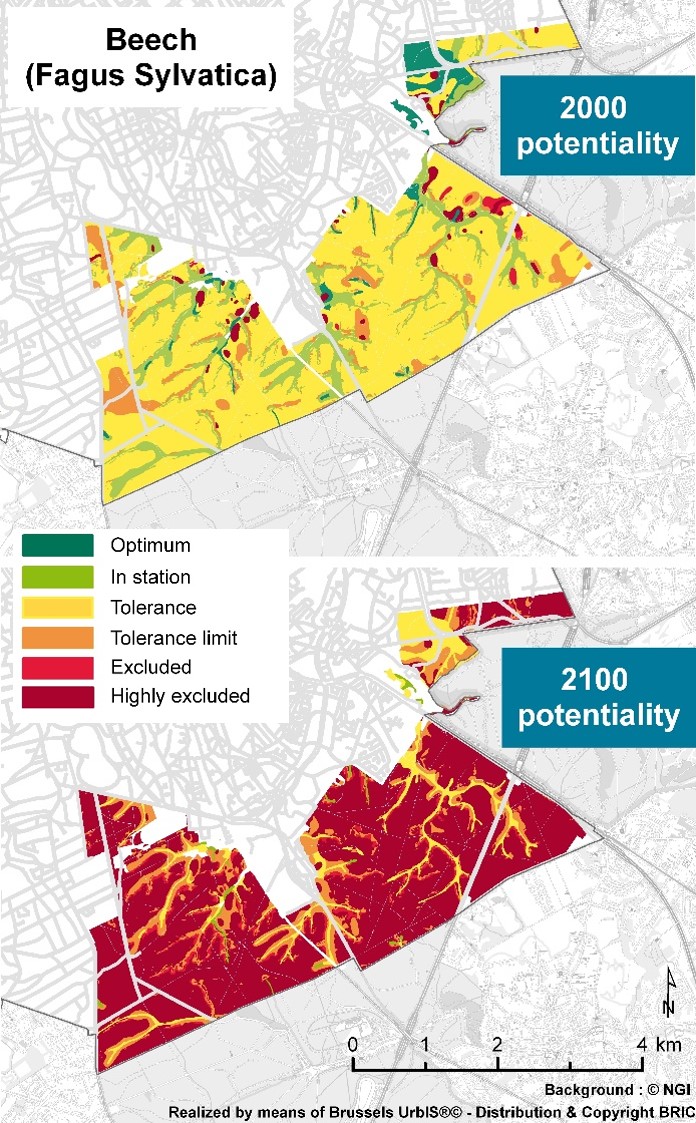
(Accédez à la carte interactive)
Miellées, origine botanique et qualité du miel
Focus - Actualisation : décembre 2015
Tout comme dans de nombreuses villes, un intérêt croissant pour l’apiculture s’observe en Région bruxelloise. Afin d’accroître les connaissances du contexte apicole général en milieu urbain, un système de surveillance de colonies d’abeilles installées en Région bruxelloise a été mis en place. Le suivi régulier de la prise de poids d’une ruche de production localisée à Uccle ainsi que l’analyse de miels fournis par diverses ruches de la Région fournissent des résultats intéressants : - les rentrées de miel (ou miellées) de la ruche uccloise sont toujours supérieures à la moyenne de celles mesurées dans d’autres ruches localisées en zone rurale (Région wallonne); - les miellées de printemps de la ruche uccloise sont plus précoces qu’en zone rurale; - en Région bruxelloise, les abeilles sont principalement intéressées par un nombre relativement restreint de plantes : ronces, trèfles, fruitiers, châtaigniers, saules, oléacées (type Ligustrum), tilleuls et marronniers ainsi que robinier faux-acacia; - tout comme en Région wallonne, la majorité des miels bruxellois analysés sont de type « toutes fleurs » et leur qualité est équivalente à celle des miels récoltés en zone rurale.
Surveillance des colonies d’abeilles
Les abeilles jouent un rôle indispensable dans la pollinisation des plantes et donc aussi dans leur reproduction. Il est important de développer une stratégie pour gérer et intégrer au mieux la pratique apicole en milieu urbain en vue de favoriser la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). régionale. Il s’agit notamment d’assurer un bon équilibre entre l’ensemble des pollinisateurs et, dans un contexte de ressources alimentaires limitées, d’éviter la concurrence entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages.
Afin d’accroître les connaissances du contexte apicole général en milieu urbain, un système de surveillance de colonies d’abeilles installées en Région bruxelloise a été mis en place. Quatre balances électroniques sont placées sous de bonnes ruches de production réparties sur le territoire régional. Leurs mesures régulières sont transmises via des GSM et intègrent une série de données : poids de la ruche, humidité de l’air et température extérieure. Ces informations viennent compléter les informations déjà recueillies par les apiculteurs de la SRABE (Société Royale d’Apiculture de Bruxelles et ses Environs). Chaque année, plusieurs miels produits en Région bruxelloise sont également envoyés au laboratoire du CARI (Centre apicole de Recherche et d’Informations) afin analyser leur qualité et l’origine botanique des grains de pollens qu’ils contiennent. L’ensemble des informations disponibles sont analysées et comparées aux données du réseau de ruches wallonnes suivi depuis 1998 par le CARI. Notons que dans le cadre de la présente analyse, seules les données fournies par la balance d’Uccle ont pu être exploitées.
Production de miel
La figure ci-dessous permet d’analyser le profil des entrées quotidiennes de nectar (échelle de poids à droite) dans la ruche de production d’Uccle au cours de la saison apicole 2014 et ce, en relation avec les données de températures (échelle de gauche). Afin de garder uniquement les données liées aux miellées, les variations importantes de poids associées aux interventions de l’apiculteur (pose de hausses, récolte, nourrissement, …) ont été ôtées. L’enregistrement de poids négatifs peut s’expliquer par un essaimage, une consommation partielle des réserves stockées dans la ruche, une visite de l’apiculteur entraînant de faibles variations de poids (marquage de la reine, vérification de l'état sanitaire des colonies, etc.)…
Variations de poids et de t° enregistrées au niveau de la ruche d’Uccle - saison apicole 2014
Source : CARI 2015 (balance d’Uccle gérée par la SRABE)
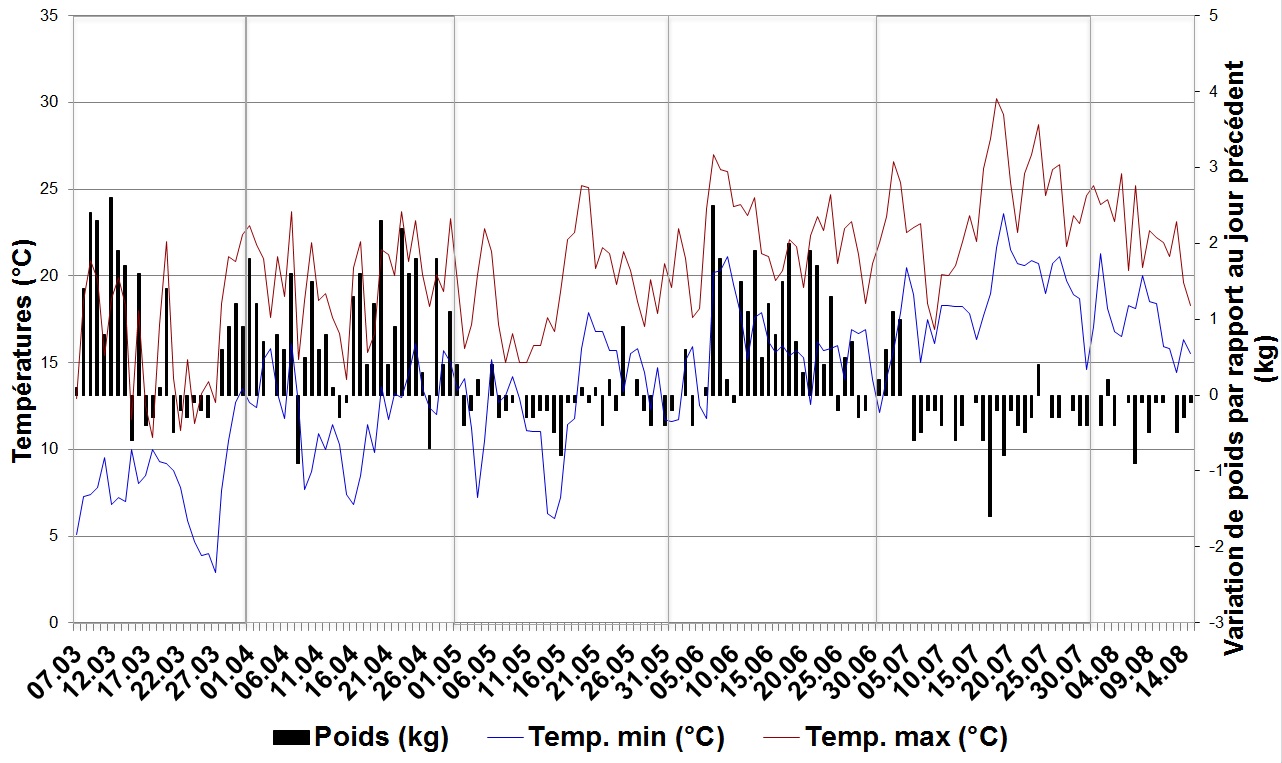
La figure inférieure compare, pour cette même année, la prise de poids de la ruche bruxelloise avec la prise de poids moyenne, minimale et maximale de 15 ruches du réseau wallon. Toutes les ruches n’ayant pas le même poids, un poids initial commun - fixé arbitrairement à 40 kg- est défini afin de pouvoir comparer les résultats. Les ajouts et retraits de matériel ont également été éliminés lors du traitement des données pour permettre des comparaisons.
Comparaison entre la prise de poids de la ruche d’Uccle par rapport à celle de 15 ruches wallonnes - saison apicole 2014
Source : CARI 2015 (balance d’Uccle gérée par la SRABE)
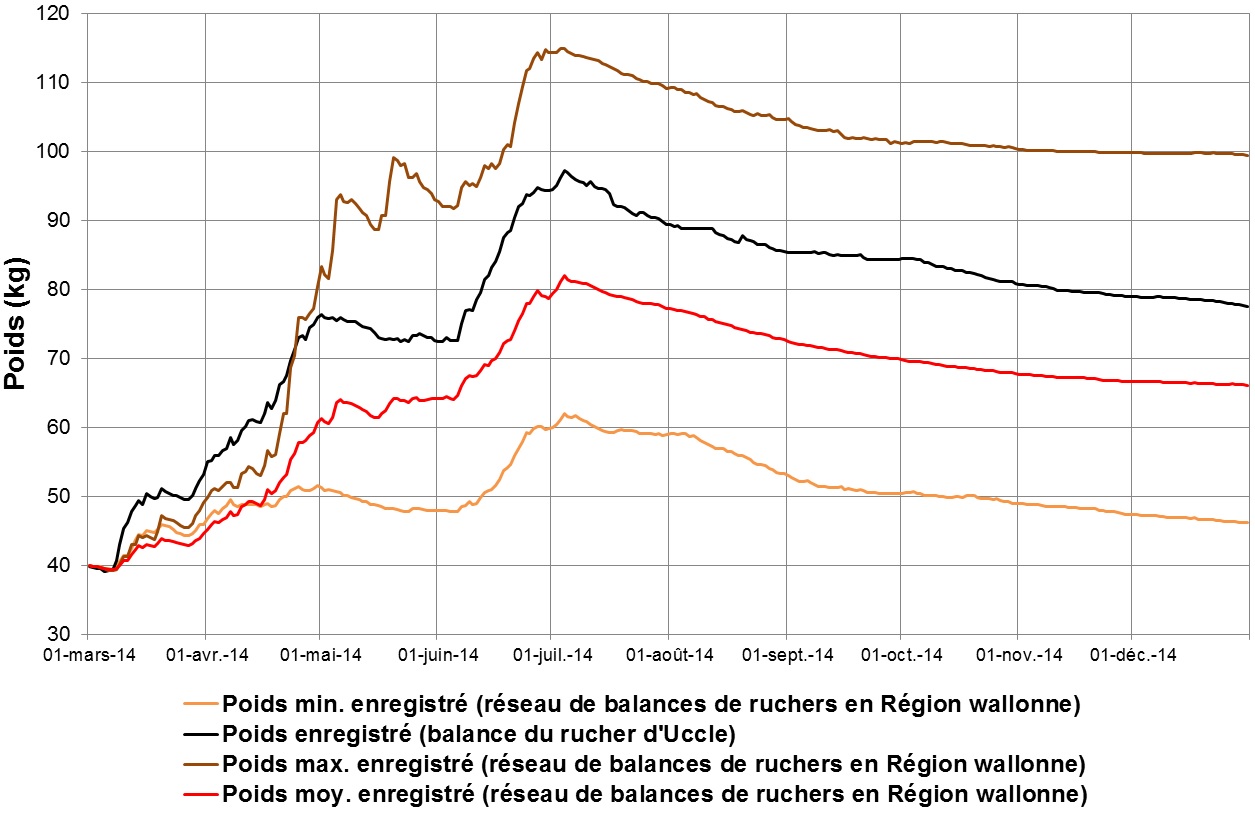
Pour les 3 années pour lesquelles cette comparaison a été effectuée (2012-2014), on constate que la prise de poids de la ruche d’Uccle a débuté systématiquement plus tôt que celle des ruches wallonnes. Les températures plus élevées en milieu urbain (voir Focus : Îlots de chaleur) se traduisent en effet par des floraisons, et donc aussi par un butinage, plus précoces. De plus, la prise globale de poids de la balance uccloise a été supérieure à celle de la moyenne wallonne. Cette différence est surtout liée à des entrées de nectar plus importantes au printemps. La miellée estivale est, quant à elle, beaucoup plus normale (hormis en 2012). Il serait cependant utile d’analyser les données d’un plus grand nombre de balances pour pouvoir confirmer cette tendance.
Flore butinée
Lorsque les abeilles butinent une fleur, elles entraînent également le pollen qui se retrouve alors dans le nectar. L’analyse pollinique des miels par microscopie permet d’identifier les fleurs qui ont été butinées et qui présentent donc un intérêt pour les abeilles.
Lorsqu’un pollen d’une espèce donnée est présent dans un échantillon, il est considéré soit comme « pollen dominant », « pollen d’accompagnement » ou « pollen isolé » selon que ses grains représentent respectivement plus de 45% du total des grains de pollens présents, entre 10 et 45 % ou moins de 10%. Un pollen sera par ailleurs qualifié d’ « isolé significatif » si sa fréquence est inférieure à 10 % mais qu’il provient d’une espèce où le pollen est sous-représenté en raison de la morphologie de la fleur ou parce qu’il provient d’une espèce peu pollinifère.
Origine botanique des pollens issus de plantes ou familles de plantes nectarifères (192 échantillons de miels bruxellois analysés sur la période 2007- 2014)
Source : CARI 2015
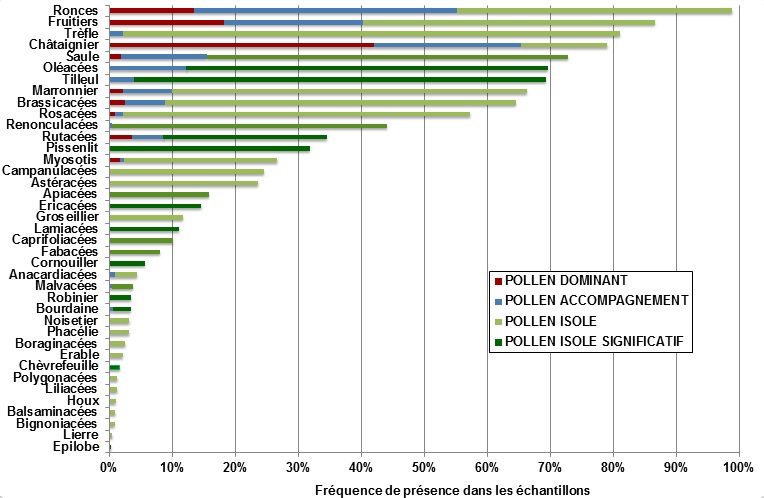
Le graphique ci-dessus, établi à partir de l’analyse pollinique de 192 miels bruxellois produits sur la période 2007-2014, montre que l’essentiel des apports de nectar provient des ronces et des trèfles ainsi que d’essences arborées ou arbustives. Par rapport aux zones rurales, on observe une plus grand proportion de pollens d’arbres présents classiquement dans les parcs (marronniers, évodia, robinier faux-acacia…).
Dans certains miels, on va également retrouver des pollens de plantes anémophiles c’est-à-dire dont le pollen est transporté par le vent (graminées, bouleaux, pins…). Ces pollens se collent sur les gouttelettes de miellats, sécrétions très sucrées produites par des insectes piqueurs-suceurs à partir de la sève des végétaux et se retrouvant régulièrement sur des espèces arborées ou arbustives. En butinant ces miellats, les abeilles emportent avec elles les grains de pollens collés qui se retrouvent dès lors dans le miel.
Qualité des miels bruxellois
L’analyse physico-chimique de 192 miels produits en Région bruxelloise entre 2007 et 2014 montre notamment que:
- la teneur en eau de tous les miels analysés est inférieure à la norme règlementaire de maximum 20% et, pour la grande majorité des miels analysés, inférieure à 18% (limite assurant une bonne stabilité du produit et l’absence de fermentation);
- tous les miels analysés répondent aux critères de qualité du CARI (plus restrictifs que les normes légales) concernant les paramètres indicateurs de dégradation liée à un chauffage ou à un âge trop important (teneur en hydroxy-méthyl furfural et indice de saccharase);
- les miels analysés présentent en moyenne un pH de 4,5 et une acidité de 9,0 à 17,7 méq./kg, valeurs laissant présager une bonne stabilité des miels;
- le rapport Fructose/Glucose de la quasi-totalité des miels analysés se situe dans la zone des miels à cristallisation plutôt lente et consistance onctueuse à tartinable, 8 miels (principalement des miels de robinier faux-acacia), possèdent cependant un rapport F/G supérieur à 1,45 assurant une consistance fluide.
Les analyses physico-chimiques couplées aux analyses polliniques et organoleptiques permettent de déterminer l’origine botanique des miels. En Région bruxelloise, comme en Région wallonne, la majorité des miels produits sont de type « toutes fleurs ». Les années où les conditions météorologiques permettent le butinage intensif de certaines variétés, des miels monofloraux ou à dominance monoflorale sont également élaborés; il s’agit principalement de miels de robiniers faux-acacia, de tilleuls, de marronniers ou de rutacées (Evodia). Des miels contenant du miellat viennent enfin compléter régulièrement l’offre proposée, ceci en raison des nombreux sites boisés présents en Région bruxelloise.
En conclusion
Globalement, les ruchers bruxellois bénéficient d’un environnement très favorable lié en premier lieu à une température plus douce en début de saison, ce qui permet un démarrage plus précoce des colonies. Le fait de bénéficier de grands ensembles floraux mellifères (arbres) permet d’assurer des récoltes importantes. De plus, les bonnes connaissances techniques des apiculteurs assurent une bonne qualité des miels commercialisés. Les consommateurs bruxellois peuvent ainsi bénéficier de miels répondant aux critères de qualités les plus élevés.
Malgré ce constat positif, il importe toutefois de se garder de toute approche simpliste et de mener une politique réfléchie et équilibrée en ce qui concerne l’implantation de ruchers en milieu urbain et, plus généralement, dans les espaces verts. En effet, l’introduction d’un trop grand nombre de colonies d’abeilles domestiques dans certaines zones sensibles pourrait potentiellement entraîner des impacts en matière de biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore).. Des études doivent cependant encore être menées afin de pouvoir objectiver ce risque au niveau bruxellois.
À télécharger
Fiches documentées
- n°15. Miellées, origine botanique et qualité du miel en Région de Bruxelles-Capitale (.pdf)
- n°10. Habitats naturels dans les espaces verts bruxellois (.pdf)
Fiches de l’Etat de l’Environnement
- Focus : îlots de chaleur (édition 2011-2014)
- Focus : Habitats naturels dans les espaces verts bruxellois (édition 2011-2012)
- Environnement semi-naturel et espaces verts publics bruxellois : Etat de la flore et de la faune (édition 2003-2006) (.pdf)
Autres publications de Bruxelles Environnement
Etudes et rapports
- CARVALHEIRO L.G., KUNIN W. E., KEIL P., AGUIRRE-GUTIERREZ J., ELLIS W.N., FOX R., GROOM Q., HENNEKENS S., VAN LANDUYT W., MAES D., VAN DE MEUTTER F., MICHEZ D., RASMONT P., ODE B., POTTS S.G., REEMER M., ROBERTS S.P.-M., SCHAMINEE J., WALLISDEVRIES M.F. and BIESMEIJER J.C., 2013. « Species richness declines and biotic homogenisation have slowed down for NW-European pollinators and plants », in Ecology Letters 16, p 870-878. (.html) (EN uniquement)
- LEFEVBRE M., BRUNEAU E., 2005. « Etat des lieux du phénomène de dépérissement des ruches en Région wallonne », Convention entre la Région wallonne (DGRNE) et le CARI, 50 pp.
- Potts S.G., Biesmeijer J.C., Kremen C., Neumann P., Schweiger O. et al., 2010. "Global pollinator declines: trends, impacts and drivers", in Trends in Ecology & Evolution 25 (6): 345-353. doi:10.1016/j.tree.2010.01.007. (.pdf) (EN uniquement)
- TOMMASI D., MIRO A., HIGO H.A., WINSTON M.L., 2004. « Bee diversity and abundance in an urban setting », in Canadian Entomologist 136 (6): 851-869. doi:10.4039/n04-010. (.pdf) (EN uniquement)
- Vaissière B., Morison N., Carré G., 2005. « Abeilles, pollinisation et biodiversité », in Abeilles & Cie n°106, p 10-14. Editeur responsable Etienne Bruneau, Louvain-la-Neuve. (.pdf)
Plans et programmes