Eau et environnement aquatique : état des lieux
- Eau
- Pollution
- État des lieux de l'environnement
- Étude
Sommaire
-
Approvisionnement et consommation d'eau de distribution
-
Consommation en eau de distribution par les ménages
-
Qualité physico-chimique des eaux de surface
-
Qualité chimique des eaux de surface
-
Qualité biologique des principaux cours d'eau et étangs
-
Etat hydromorphologique des cours d’eau Bruxellois
-
Epuration des eaux usées
-
Rénovation de la station d'épuration Sud
-
Emissions de polluants vers les eaux de surface
-
Cartographie relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondations
-
Les inondations importantes récentes
-
Etat chimique des eaux souterraines
-
Etat quantitatif des eaux souterraines
-
Modélisation des nappes d’eaux souterraines des sables du Bruxellien et du Landénien
-
Poursuivre la lecture
L’eau est une ressource précieuse qu’il faut préserver. Si la consommation d’eau par habitant stagne, celle de l’ensemble des ménages risque d’augmenter compte tenu de la croissance démographique.
L’exploitation actuelle des eaux souterraines semble raisonnée et durable. En revanche, la qualité de l’une d’entre elles (la nappe des Sables du Bruxellien, exploitée entre autre pour l’alimentation en eau potable) est contaminée par certains polluants issus des activités humaines.
Les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) voient également leur qualité dégradée par les activités humaines. Les deux stations bruxelloises doivent limiter leur impact en épurant les eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. avant leur rejet dans la Senne. Un vaste chantier de remise à niveau de la station Sud s’est achevé fin 2018 : la station traite désormais l’azote et le phosphore mais élimine aussi d’autres substances telles que les micro-plastiques.
La Senne subit les pressions les plus importantes et sa qualité ne répond pas encore à toutes les normes. Sa qualité physico-chimique, qui s’améliorait significativement depuis 20 ans, a permis aux poissons de s’y ré établir en 2016. Mais l’année climatique exceptionnelle de 2018 a mis à mal ces bons résultats, preuve que cet équilibre reste fragile. Toute restauration écologique sur le long terme ne pourra survenir sans re naturation préalable de l’état du lit et des berges.
Selon les cartes des aléas et des risques d’inondation mises à jour en 2019, un cinquième du territoire régional se situe en zone d’aléa d’inondation et un habitant sur trois est potentiellement touché par les inondations.
Approvisionnement et consommation d'eau de distribution
Indicateur - Actualisation : mars 2024
Seul 3% de l’eau potable alimentant la Région est prélevé sur le territoire bruxellois. En 2022, la consommation régionale en eau de distribution s’est élevée à 60,6 millions de m3. Elle se répartit essentiellement entre les ménages (près des ¾ de la consommation) et le secteur tertiaire (environ ¼). Depuis 2008, la consommation des ménages ne cesse de grossir, à un rythme moindre que la population toutefois. Mais saura-t-on faire face à ce besoin croissant compte tenu du changement climatiqueDésigne de lentes variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l'air, résultant d'activités humaines, menacent de modifier sensiblement les climats, dans le sens d'un réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants : élévation du niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones, etc.), déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d'eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales, etc. ?
Les Bruxellois boivent de l’eau wallonne
L’eau alimentant la Région bruxelloise, produite et fournie par l’intercommunale Vivaqua, est majoritairement captée en Région wallonne, soit dans les aquifères (environ 81%), soit dans les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.). Seuls 3% des besoins de la Région (environ 2 millions de m3) sont couverts par des captages situés sur le territoire régional, en forêt de Soignes et au Bois de la Cambre, dans l’aquifère du Bruxellien.
L’approvisionnement en nette baisse par rapport à 2020
De 2009 à 2020, l’approvisionnement en eau potable de la Région bruxelloise représentait près de 68,4 millions de m3 par an en moyenne. Bien qu’ayant connu plusieurs fluctuations, il est resté globalement stable sur cette période. Dans le même temps, la population continuait à croître.
2021 et 2022 se démarquent de cette période par une nette diminution de l’approvisionnement (-4%). En cause ? Une baisse significative des volumes non enregistrés.
L’approvisionnement en eau de la Région bruxelloise de ces 2 dernières années est significativement plus bas qu’en 2020
Sources : Vivaqua (approvisionnement et consommations d’eau relevées aux compteurs), IBSA sur base de données de Statbel (population au 1er janvier), évolution sur la période 1996-2022
Les volumes d’eau non enregistrés sous la barre des 10% !
La différence entre l’approvisionnement en eau de distribution et la consommation des abonnés correspond aux « volumes non enregistrés ». Ces derniers oscillaient généralement entre 11 et 15% de l’approvisionnement de la Région jusqu’en 2020.
En 2021 et 2022, les volumes non enregistrés représentaient respectivement 9% puis 8% seulement de l’approvisionnement, soit 6,2 et 5,6 millions de m3. Des taux qui n’avaient encore jamais été atteints ! Cette baisse est liée à la mise en place d’un plan d’action de lutte contre les fuites d’eau. En 2021 en particulier, l’analyse des images satellites a permis de déceler d’importantes fuites d’eau qui rejoignaient le réseau d’égouttage et qui ont pu être réparées.
L’objectif est que ce taux demeure systématiquement inférieur à 10% à partir de 2024.
Les volumes non enregistrés représentent moins de 10% de l’approvisionnement en eau depuis 2021
Source : Part des volumes non enregistrés dans l’approvisionnement en eau de la Région bruxelloise, évolution sur la période 1995-2022 - Vivaqua, 2023
Bon à savoir
Les volumes d’eau « non enregistrés » correspondent essentiellement aux fuites d’eau sur le réseau de distribution. Le reste des volumes non enregistrés comprend les consommations d’eau des pompiers, des services communaux (nettoyage des voiries, etc.), de Vivaqua (travaux de renouvellement ou de réparation de conduite), ainsi que les mètres cubes non comptabilisés par les compteurs d’eau (dysfonctionnements, fraudes, …).
3 outils pour réduire les fuites d’eau
Le plan d’action de lutte contre les fuites d’eau s’appuie sur 3 outils :
- Une sectorisation accrue du réseau de distribution : plus les zones de gestion sont petites, plus il est aisé de suivre les débits d’eau, de détecter un problème et d’agir en conséquence. Le nombre de zones a donc été multiplié : il est passé de 47 en 2019 à 70 fin 2023. Ce chiffre est très proche de l’optimum souhaité par Vivaqua.
- Un système d’alerte : la Garde centrale surveille en permanence le réseau depuis 2018. Grâce à un monitoring des compteurs, elle est prévenue dans le quart d’heure de tout écart majeur des pressions/débits par rapport à leurs niveaux de référence. Ce système d’alerte précoce est rendu d’autant plus efficace par la sectorisation accrue du réseau. La Garde centrale dispose aussi d’un outil de monitoring à l’échelle des zones de gestion, qui compare les situations réelles et de référence. Les écarts importants sont ensuite analysés.
- L’analyse d’images satellitaires : un scanner embarqué à bord de ces satellites détecte les accumulations d’eau dans le sol pouvant être dues à des fuites, jusqu’à 2 ou 3 mètres de profondeur. Les techniques classiques de recherche de fuite d’eau sur le terrain permettent ensuite de confirmer ou non le problème. Testé en 2021, l’outil aurait doublé l’efficacité des hommes de terrain selon Vivaqua. Il a été généralisé à l’ensemble du réseau en 2022 et sera utilisé une fois par an, au moins jusqu’en 2025 inclus.
Last but not least, un réseau de distribution en bon état limite le risque de fuites. Un taux de rénovation supérieur à 1% apparait comme un minimum. Vivaqua doit donc parfaire sa connaissance de l’état du réseau et prévoir des investissements suffisants pour remplacer ou rénover les conduites les plus anciennes ou en mauvais état.
Bon à savoir
L’indice linéaire de perte fournit une indication du volume perdu sur un kilomètre de conduite en une journée. Cet indice est le rapport des volumes non enregistrés sur la longueur des conduites (hors réseau de répartition). Plus il est faible, meilleur est l’état du réseau. L’indice linéaire de perte bruxellois est passé de 11 m3/(km.j) en 2020 à 7 m3/(km.j) en 2021 puis 6 m3/(km.j) en 2022.
Le changement climatique met sous pression l’appareil de production
Ces dernières années ont été marquées par des sécheresses prolongées et des canicules estivales. Si cela ne se reflète pas à l’échelle annuelle, les fournitures journalières sont en revanche classiquement de 15 à 25% plus élevées que la moyenne durant ces épisodes (Vivaqua, 2024).
Si la tendance de ces 10 dernières années est loin de suivre le rythme de croissance de la population (+9% en 2021 par rapport à 2011), elle est néanmoins à surveiller : les besoins accrus liés à la population grandissante, en particulier en période de sécheresse, mettent sous pression l’appareil de production. La recharge de certains aquifères peut être mise à mal par plusieurs hivers secs successifs. Quant à la Meuse, son débit est parfois tellement faible en été qu’il frôle voire franchit des niveaux en-dessous desquels le prélèvement par Vivaqua doit être limité.
Selon une analyse prospective, 60.000 m3/jour supplémentaires devront être produits en période de pointe (principalement en mai-juin et septembre) à l’horizon 2040 pour l’ensemble des clients de Vivaqua (Vivaqua, Water Quantity Plan, 2024). Soit 18% de plus que la production moyenne de 2022. L’entreprise adapte dès à présent son appareil de production pour y faire face : elle révise notamment à la baisse les volumes de pointe autorisés dans les contrats avec ses clients. Et sa lutte contre les fuites d’eau participe aussi à cette adaptation.
Signalons que la croissance démographique est identifiée, au niveau européen, comme un des facteurs responsables de l’augmentation de la demande en eau de ces 50 dernières années et que les grandes agglomérations urbaines font partie des principales zones sensibles au stress hydriqueLe stress hydrique est une situation critique qui surgit lorsque les ressources en eau disponibles sont inférieures à la demande en eau. (AEE, Signaux 2018).
Les ménages ont consommé trois quarts de l’eau distribuée en 2021
La consommation totale d'eau facturée, tous secteurs confondus, s'élevait à 61,8 millions de m3 en 2021 (Vivaqua, consommation relevée aux compteurs en 2021, les chiffres n’étant pas disponibles pour 2022).
Cette consommation se répartit essentiellement entre les ménages (73%) et le secteur tertiaire (23%). Au niveau du secteur tertiaire, les principaux consommateurs sont la santé et l’action sociale (18% de la consommation de ce secteur), l’Horeca (17%), les commerces de gros et de détail (14%) ainsi que les administrations publiques et les organismes extraterritoriaux (10%) et l’éducation (10%).
Les ménages consomment 73% de l’eau distribuée, le secteur tertiaire 23%
Source : Vivaqua, consommations d’eau relevées aux compteurs en 2021 (classification NACE 2003)
Attention
La part des ménages a augmenté avec la crise du Coronavirus, au détriment de celle du secteur tertiaire : les Bruxellois ont été confinés chez eux en 2020 et le télétravailTravail effectué à distance avec l'utilisation de la télématique, lien entre le travailleur et l'entreprise. s’est très développé. A titre de comparaison, en 2019, les ménages ne représentaient « que » 69% de la consommation d’eau et le secteur tertiaire 28%.
La consommation des ménages bruxellois en très forte hausse depuis la crise sanitaire
Les consommations d’eau en 2020 et 2021, années influencées par la crise sanitaire, se démarquent très nettement de celles des années antérieures :
- la consommation d’eau du secteur domestique a bondi de 6% en 2021 par rapport à 2019 (+2,7 millions de m3 en l’espace de 2 ans !) ; alors qu’elle n’augmentait que de 0,5 millions de m3 tous les 2 ans en moyenne entre 2008 et 2019.
- tandis que celles du secteur tertiaire et secondaire ont dégringolé de près de 15 à 20% (-2,6 et -0,2 millions de m3 respectivement). A titre de comparaison, la consommation du secteur tertiaire avait globalement diminué de 0,12 millions de m3 tous les 2 ans entre 2008 et 2019 ; et celle du secteur secondaire, de 0,08 millions de m3 tous les 2 ans sur cette période.
Les consommations en eau des différents secteurs ont fortement évolué en 2 ans (2019-2021)
Source : Vivaqua, consommations d’eau relevées aux compteurs sur la période 2020-2021 (classification NACE 2003)
À télécharger
Fiche(s) méthodologique(s)
- Indicateur : Approvisionnement en eau de distribution (.pdf)
- Indicateur : Consommation d’eau de distribution totale et par secteurs (.pdf)
Tableau(x) reprenant les données
- Approvisionnement en eau de distribution et consommation des abonnés (.xls)
- Répartition de la consommation en eau au sein des différents secteurs en 2021 (.xls)
Fiche(s) documentée(s)
- Normes et valeurs légales de référence en matière d’eau (.pdf)
- Consommation et prix de l’eau de distribution (.pdf)
- Qualité de l’eau de distribution (.pdf)
- Cadre légal bruxellois en matière d’eau (.pdf)
Autres publications de Bruxelles Environnement
Etude(s) et rapport(s)
- VIVAQUA, années diverses. « Rapport d’activités annuel » (.pdf)
- Agence Européenne pour l’Environnement, 2018. « Signaux 2018 – L’eau, c’est la vie »
Plan(s) et programme(s)
Liens utiles
- VIVAQUA, La qualité d’eau dans votre rue
- Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA)
- Agence Européenne pour l’Environnement, Indicateur « Water scarcity conditions in Europe (Water exploitation index plus) »
- Etat de l’environnement wallon, Indicateur « Production d’eau de distribution »
- Etat de l’environnement wallon, Indicateur « Consommation d’eau de distribution »
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Indicateur « Drinkwaterproductie »
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Indicateur « Waterverbruik totaal »
Consommation en eau de distribution par les ménages
Indicateur - Actualisation : octobre 2022
Chaque Bruxellois a consommé en moyenne 101 litres d’eau par jour en 2021. C’est 5 litres de plus qu’en 2019. En cause ? La crise sanitaire. La consommation était stable depuis 2012. Mais la tendance attendue, indépendamment de la pandémie, est une augmentation, compte tenu de la croissance de la population, du changement climatiqueDésigne de lentes variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l'air, résultant d'activités humaines, menacent de modifier sensiblement les climats, dans le sens d'un réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants : élévation du niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones, etc.), déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d'eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales, etc. et du faible recours à l’eau de pluie.
Chaque Bruxellois utilise quotidiennement près de 100 litres d’eau

En 2021, la consommation en eau de distribution s’élève en moyenne à 101 litres par jour et par Bruxellois. Soit l’équivalent de 10 seaux de 10 litres.
Ces mêmes moyennes, ramenées à l’échelle des communes, oscillent entre 92 et 112 litres/jour/habitant.
Précisons toutefois que ces estimations ne prennent pas en compte la consommation domestique des Bruxellois sur leur lieu de travail. La consommation domestique réelle des Bruxellois est donc supérieure.
Comparaisons inter-régionales et internationales
La consommation domestique d’eau de distribution par habitant en Région bruxelloise est supérieure à celle de la Région flamande (89 l/jour/hab en 2021 pour un ménage moyen – VMM, 2022) et à celle de la Région wallonne (90 l/jour/hab en 2017 – Aquawal, 2018 dans l’Etat de l’environnement wallon). La différence observée pourrait notamment s’expliquer par une moindre utilisation d’eau de pluie en Région bruxelloise.
Il convient cependant d’être prudent lorsqu’on établit ce type de comparaison vu les différences et difficultés méthodologiques à établir ces statistiques. Par ailleurs, en Région bruxelloise, le problème des personnes « statistiquement invisibles » (candidats réfugiés inscrits sur le registre d’attente, personnes sans papiers, personnel diplomatique étranger et étrangers attachés aux institutions internationales) est plus marqué que dans les autres régions.
Selon la Fédération belge du secteur de l’eau (BELGAQUA), la consommation domestique d’eau par habitant en Belgique est l’une des plus basses des pays industrialisés. Elle est proche de celle observée en Allemagne mais nettement plus basse que celle des Pays-Bas et de la France (Bureau Fédéral du Plan, 2018).
Utilisation de l’eau par les ménages
Utilisation domestique de l’eau
Source : VMM, 2018, enquête auprès de 504 ménages en 2016
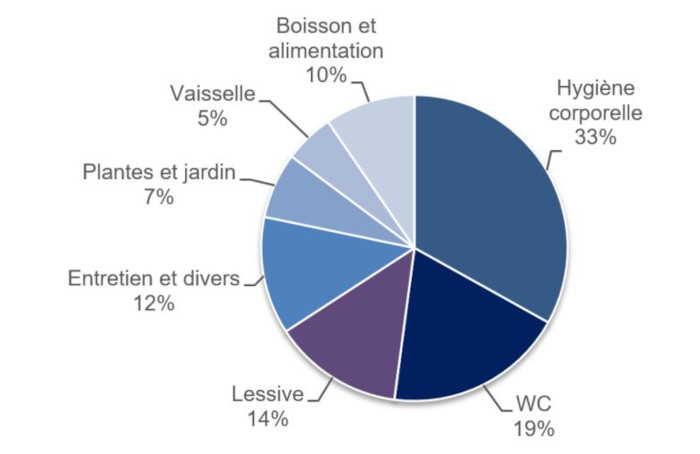
Selon une enquête de 2016 auprès de 504 ménages flamands, les deux plus gros postes de consommation d’eau des ménages sont l’hygiène corporelle (33%) et les chasses d’eau (19%). Seuls 10% de la consommation des ménages sont consacrés à la boisson et à l’alimentation (VMM, 2018).
Buvez l’eau du robinet !
 La moitié des Bruxellois (55%) boivent de l’eau du robinet à leur domicile (selon le baromètre de l’environnement de 2014). Les principales raisons avancées par ceux qui choisissent l’eau en bouteille sont le goût, une préférence pour l’eau de source ou encore la présence potentielle de produits dangereux pour la santé.
La moitié des Bruxellois (55%) boivent de l’eau du robinet à leur domicile (selon le baromètre de l’environnement de 2014). Les principales raisons avancées par ceux qui choisissent l’eau en bouteille sont le goût, une préférence pour l’eau de source ou encore la présence potentielle de produits dangereux pour la santé.
Or la qualité de l’eau distribuée en Région bruxelloise est de très bonne qualité. Elle répond aux normes légales avec un taux de conformité supérieur à 99%. Assurez-vous juste que vos conduites privées ne sont pas en plomb (voir la fiche documentée n°10).
En outre, l’eau du robinet est beaucoup moins chère que l’eau en bouteille et son coût environnemental est moins élevé.
L’eau de pluie encore trop peu exploitée
Le recours à l’eau de pluie demeure assez (trop) marginal en Région bruxelloise, bien qu’il soit difficile à estimer car aucun recensement du parc de citernes n’est organisé à ce jour. Lors du Baromètre de l’environnement de 2020, 16% des Bruxellois interrogés déclaraient utiliser de l’eau de pluie.
Une étude réalisée en 2012 a mis en évidence certains freins au placement ou à la rénovation de citernes en Région bruxelloise : faible montant des primes par rapport au coût de l’installation, retour sur investissement faible, accès difficile et manque de place sur les terrains, mais aussi l’inquiétude des citoyens de devoir payer une taxe dans le futur.
Une consommation qui était stable depuis 2012
Consommation domestique en eau de distribution par Bruxellois (2002-2021)
Sources : VIVAQUA (consommations relevées aux compteurs) et Statbel (Registre national, population au 1er janvier de l’année)
Deux grandes tendances caractérisaient l’évolution de la consommation en eau par habitant jusqu’à présent :
- une baisse régulière et significative entre 2002 et 2012 (- 26 litres soit près de 20%). Plusieurs hypothèses ont été avancées pour la justifier : généralisation des équipements plus économes en eau (douches, WC, lave-vaisselles et lave-linges, …), ou encore conscientisation accrue des ménages...
- une stabilité jusqu’en 2019. La consommation moyenne atteignait 96 l/jour/hab. Elle pourrait s’approcher de la « consommation efficace » bruxelloise, à savoir que les besoins domestiques minimum sont satisfaits sans perte de bien-être et sans recours à une ressource alternative.
Bon à savoir
La consommation efficace a été évaluée à 94 l/jour/hab en Wallonie, lors d’une étude menée auprès de 3000 ménages. Cette même étude indique que le niveau de consommation chute à 72 l/jour/hab dès qu’une ressource alternative (dans 95% des cas, de l’eau de pluie) est utilisée pour un usage intérieur (Predevello, 2009 in Indicateurs clés de l’environnement wallon 2014).
Une consommation significativement en hausse en 2020 et 2021
 Les années 2020 et 2021 marquent une rupture par rapport à la stabilité observée les années précédentes : chaque Bruxellois a consommé en moyenne 5 litres de plus en 2021 par rapport à 2019.
Les années 2020 et 2021 marquent une rupture par rapport à la stabilité observée les années précédentes : chaque Bruxellois a consommé en moyenne 5 litres de plus en 2021 par rapport à 2019.
Ce rebond s’explique sans aucun doute par la pandémie. Avec les confinements et l’essor du télétravailTravail effectué à distance avec l'utilisation de la télématique, lien entre le travailleur et l'entreprise., l’eau habituellement consommée sur le lieu de travail et comptabilisée dans la consommation du secteur tertiaire se retrouve en 2020 et 2021 dans celle du secteur domestique.
Perspectives : des besoins accrus ?
Mais la crise sanitaire masque peut-être une inversion de tendance. En examinant les chiffres des dernières années et en faisant abstraction des valeurs anormalement élevées de 2020 et 2021, on constate que la consommation par habitant augmente très légèrement. Le taux d’accroissement annuel de la consommation du secteur domestique est effectivement supérieur à celui de la population depuis 2017. Les besoins en eau des Bruxellois tendent donc à augmenter.
Cette demande croissante pourrait résulter des vagues de chaleur et sécheresses qui se succèdent ces dernières années. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées : augmentation du nombre de douches/bains pour se rafraichir, remplissage des piscines, recours à la climatisation (cas de climatiseurs fonctionnant à l’eau), arrosage du jardin, du potager (en l’absence de système de récupération d’eau de pluie ou si ceux-ci sont à sec)…
À télécharger
Fiche(s) méthodologique(s)
Tableau(x) reprenant les données
Fiche(s) documentée(s)
- Normes et valeurs légales de référence en matière d’eau (.pdf)
- Consommation et prix de l’eau de distribution (.pdf)
- Qualité de l’eau de distribution (.pdf)
- Cadre légal bruxellois en matière d’eau (.pdf)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Qualité de l’eau distribuée par réseau. Qualité de l’eau destinée à la consommation humaine – période 2017-2018-2019, 2021, (.pdf)
- Info-fiche « Perceptions, connaissances et comportements des Bruxellois en matière d’alimentation durable », 2014 (.pdf)
Etude(s) et rapport(s)
- VIVAQUA, années diverses. « Rapport d’activités annuel » (.pdf)
- SONECOM, novembre 2020. « Baromètre des comportements 2020 », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 22 pp. (.pdf)
- IPSOS PUBLIC AFFAIRS, 2014. « Baromètre environnemental de la Région de Bruxelles-Capitale – Résultats 2014 », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 112 pp. (.pdf)
- VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM), 2018. « Watergebruik door huishoudens – het watergebruik in 2016 bij de Vlaming thuis », 41 pp. (seulement en néerlandais) (.pdf)
- INTERTEK et RDC Environnement, septembre 2012. « Etude du marché des citernes d’eau de pluie en Région de Bruxelles-Capitale », étude élaborée dans le cadre du projet « Brussels Sustainable Economy (BSE) », 71 pp. Diffusion restreinte
- BELGAQUA, 2008. « Livre Bleu - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’eau potable et l’assainissement des eaux usées », Edition 2008, 76 pp. (.pdf)
- PREVEDELLO C., septembre 2006. « L’utilisation de l’eau de distribution en Région wallonne. Dossier scientifique réalisé dans le cadre de l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur l’état de l’environnement wallon. A AQUAWAL ». 110 pp. (.pdf).
- AGENCE EUROPENNE DE L’ENVIRONNEMENT, novembre 2018. « Signaux 2018 – L’eau, c’est la vie ». 80 pp. (.pdf)
Liens utiles
- VIVAQUA, La qualité d’eau dans votre rue
- Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA)
- Bureau Fédéral du Plan (BFP), Indicateurs de Développement DurableMode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Il s'agit donc d une démarche qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement, et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine. « Consommation d’eau »
- Etat de l’environnement wallon, Indicateurs « Consommation d’eau de distribution », « Utilisation de l’eau par les ménages »
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Indicateur « Waterverbruik huishoudens »
Qualité physico-chimique des eaux de surface
Indicateur - Actualisation : août 2022
Une bonne qualité physico-chimique de l’eau est la condition préalable et essentielle à la survie et au développement de la vie aquatique. L’évolution positive observée depuis le début des années 2000 se poursuit, mais à un rythme moins soutenu. Si le Canal possède dans l’ensemble une bonne qualité physico-chimique, ni la Senne, ni la Woluwe - soumise à des critères de qualité plus stricts – ne peuvent se targuer d’atteindre une qualité suffisante. Et les perspectives ne sont pas roses : les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) bruxelloises semblent disposer d’une faible résilience vis-à-vis du réchauffement climatique.
Qu’est-ce que la qualité physico-chimique ?
La physico-chimie de l’eau caractérise la qualité d’eau vis-à-vis de paramètres physiques (tels que la température, le pH, la conductivité) et de certains paramètres chimiques (tels que l’oxygène, l’azote, le phosphore, etc.) qui sont essentiels au développement et à la survie des organismes vivant dans le milieu aquatique. Elle participe à la qualité biologique du cours d’eau et reflète donc indirectement son état ou son potentiel écologique (voir « Qualité biologique des principaux cours d’eau et étangs » ).
La qualité physico-chimique du Canal, de la Woluwe et de la Senne est évaluée ici au moyen d’une sélection de 9 paramètres, parmi ceux retenus dans le Plan de Gestion de l’Eau :
- la température,
- l’acidité (le pH),
- la conductivité,
- la teneur en oxygène dissous : indispensable à la vie aquatique, il favorise également la dégradation des polluants biodégradables permettant l’autoépuration,
- la charge organique (la demande biologique en oxygène (DBO) - indice de pollution par la matière organique biodégradable dont la dégradation consomme de l’oxygène dissous, la demande chimique en oxygène (DCO)),
- la turbidité : les matières en suspension (MES),
- et les nutriments (azote total et phosphore total).
La Woluwe étant située en zone Natura 2000, des objectifs plus stricts sont d’application.
De nouveaux objectifs de qualité
Des normes de qualité de base ont été adoptées pour la qualité physico-chimique de l’eau en 2011 puis révisées une première fois en 2015. Mais elles sont jugées peu représentatives et souvent insuffisantes compte tenu du contexte urbanisé de la Région (Bruxelles Environnement, 2019).
De nouveaux objectifs sont donc proposés depuis 2019, pour le 3ème plan de gestion de l’eau. Ils ont été harmonisés dans la mesure du possible vis-à-vis des normes des deux autres Régions (voir fiche méthodologique et la fiche documentée n°4 ). Cinq classes de qualité (très bonne, bonne, moyenne, médiocre et mauvaise) ont également été fixées pour chaque paramètre. L’objectif de qualité correspond à la limite inférieure de la classe de la « bonne » qualité.
Cette fiche se concentre spécifiquement sur les trois masses d’eau de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) définies en Région bruxelloise (Canal, Woluwe et Senne), à l’amont et à l’aval du territoire. Notons toutefois que le réseau de surveillance a été étendu depuis 2014 à des points de mesure intermédiaires ainsi qu’à d’autres cours d’eau.
Le Canal : une qualité satisfaisante et qui s’améliore
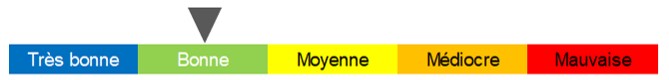
Dans l’ensemble, la qualité physico-chimique de l’eau du Canal est bonne et en nette amélioration depuis le début des années 2000. Ces tendances positives concernent de nombreux paramètres : l’oxygène dissous, la DCO, les matières en suspension, ou encore les nutriments. Conséquence directe : de moins en moins de dépassements des objectifs cibles sont constatés.
Seul l’azote total ne respecte toujours pas l’objectif de qualité, même si les concentrations diminuent indéniablement depuis 2012 et s’en rapprochent. 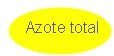
L’autre paramètre à surveiller est l’oxygène dissous. Il a connu une évolution spectaculaire, notamment à la sortie de la Région où les teneurs au début des années 2000 étaient très faibles. Des fluctuations importantes y sont cependant encore observées et entrainent des concentrations insuffisantes à certains moments voire des dépassements de l’objectif de qualité, comme en 2019. En revanche, à l’entrée de la Région, la valeur cible est respectée depuis 2011.
Malheureusement, le Canal pâtit également des épisodes de surverses du réseau d’égouts et de la dérivation des eaux de la Senne via la déviation Aa en cas de crue, qui dégradent brusquement et temporairement la qualité de l’eau et provoquent des dégâts aux communautés aquatiques, tels que la mort de nombreux poissons.
De plus, le Canal fait face à des crises écologiques récurrentes en période estivale (efflorescences de cyanobactéries) en raison de son eutrophisationApport excessif d'éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème. et de sa faible vitesse d’écoulement. Ces algues peuvent causer des chutes d’oxygène et libérer des toxines dans l’eau, néfastes aux organismes aquatiques.
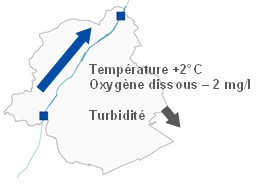
En général, le Canal possède une qualité assez similaire au début ou à la fin de son parcours bruxellois.
Trois paramètres présentent en revanche des différences intéressantes à relever. Ainsi, lors de son parcours bruxellois, la température de l’eau du Canal gagne 2°C en moyenne tandis que la concentration en oxygène dissous baisse d’environ 2 mg/l. De plus, l’eau du Canal est plus turbide à l’entrée de la Région qu’à la sortie, même si l’écart s’est nettement réduit.
La Woluwe : une qualité insuffisante au regard des objectifs Natura 2000

La Woluwe présente une relativement bonne qualité physico-chimique, comparée à la Senne et au Canal. Elle est en effet principalement alimentée par des eaux de source provenant de la Forêt de Soignes. Les matières en suspension en particulier présentent de faibles teneurs.
Cependant, la Woluwe traversant des zones Natura 2000, des objectifs plus sévères sont d’application. Et force est de constater que le bilan est mitigé :
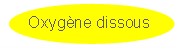 La teneur en oxygène dissous est insuffisante : la concentration minimum cible n’a été atteinte qu’une seule fois, en 2016, depuis le début des années 2000.
La teneur en oxygène dissous est insuffisante : la concentration minimum cible n’a été atteinte qu’une seule fois, en 2016, depuis le début des années 2000. - Plusieurs paramètres flirtent avec les objectifs de qualité, conduisant des dépassements occasionnels (conductivité, nutriments) ou plus fréquents (charge organique).
Bien que la qualité de la Woluwe se soit globalement améliorée depuis le début des années 2000, la vigilance est donc de mise pour ces paramètres.
Ces altérations pourraient résulter du rejet ponctuel d’eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances.. Mais des investigations restent encore nécessaires afin de le confirmer. Dans tous les cas, cette physico-chimie dégradée pourrait avoir une incidence sur la qualité biologique de la Woluwe. En particulier, le manque d’oxygène dissous à certains moments pourrait affecter les populations piscicoles (voir « Qualité biologique des principaux cours d’eau et étangs » ).
La Senne : une qualité détériorée par les rejets d’eaux usées
La Senne reçoit les rejets des deux stations d’épuration de Bruxelles Sud et de Bruxelles Nord. Elle recueille également de nombreuses surverses via les déversoirs d’orage, en cas de précipitations importantes. Sa qualité d’eau est donc fortement influencée par les performances épuratoires des stations et par la fréquence de fonctionnement des déversoirs et la qualité des eaux qui y sont rejetées. Sans surprise, la Senne présente la qualité physico-chimique la plus dégradée.
Les rejets des deux stations d’épuration constituent environ la moitié du débit médian de la Senne à la sortie de Bruxelles. Les mesures supplémentaires faites sur son trajet en 2014 montreraient d’ailleurs un effet de dilution de certains polluants, après le rejet de la station Sud. Ces eaux rejetées sont aussi plus « chaudes », et pourraient donc être à l’origine de la hausse de température observée à la sortie du territoire bruxellois par rapport à son entrée (différence moyenne de 2°C depuis 2001).
Une évolution spectaculaire
Néanmoins, la qualité de la Senne a évolué de manière spectaculaire entre le début des années 2000 et les années 2010. Il faut dire que la Senne au départ était particulièrement polluée, surtout à la sortie de Bruxelles ! Cette amélioration se poursuit encore aujourd’hui pour plusieurs paramètres, mais à un rythme moins soutenu.
Evolution de la qualité physico-chimique de la Senne à la sortie de la Région (2001-2020)
Source : Bruxelles Environnement, 2022, sur base des moyennes glissantes sur 3 ans des concentrations moyennes annuelles
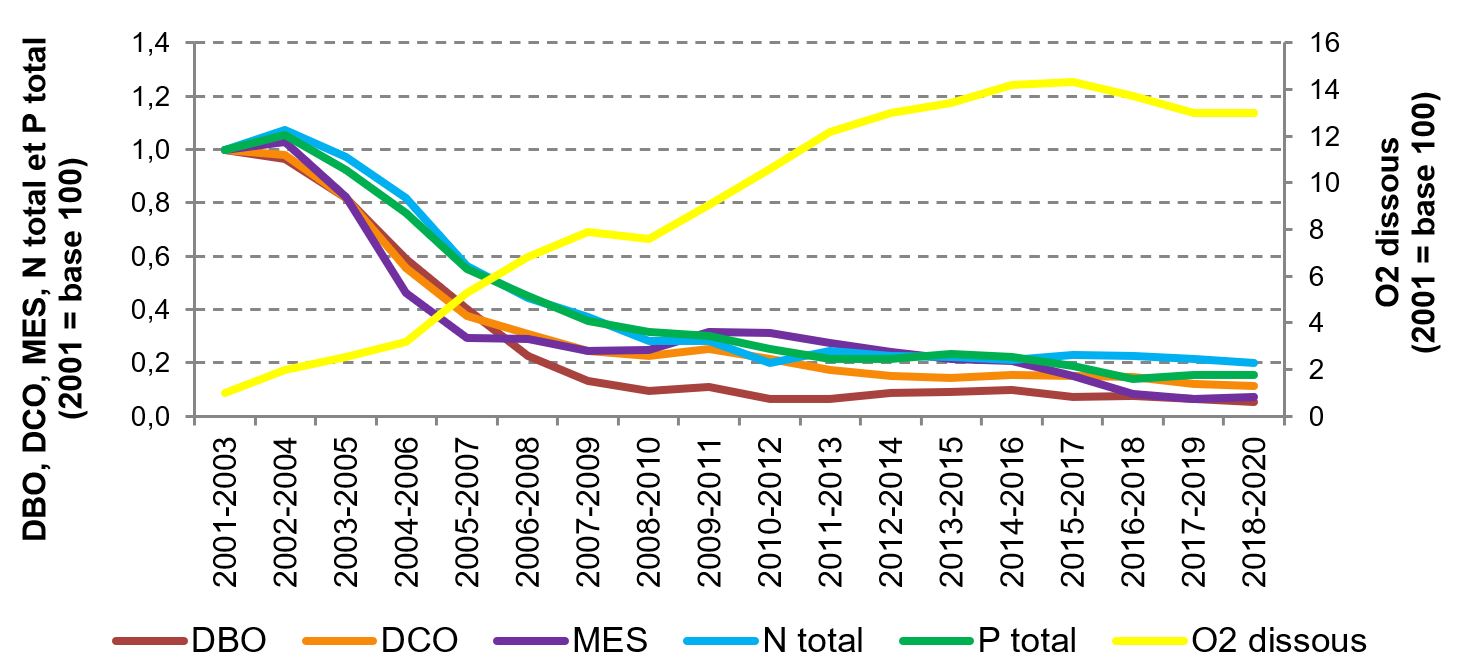
Ce progrès découle essentiellement du traitement accru des eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. en Région bruxelloise (station Sud mise en service en 2000, station Nord en 2007) et en amont (voir « Epuration des eaux usées » ). Les cinq polluants classiquement épurés par les stations (DBO, DCO, MES, N et P) ont logiquement drastiquement diminué dans la Senne, comme l’illustre le graphique ci-dessus. Progressivement, la qualité à la sortie de la Région se rapproche de celle à l’entrée voire l’égale (ex : nutriments).
Evolution des teneurs en oxygène dissous dans la Senne (2001-2020)
Source : Bruxelles Environnement, 2022
Note : Les percentiles 10 (P10) et 90 (P90) sont les valeurs qui séparent respectivement les 10% et 90% inférieurs des données (triées par ordre croissant en 100 parts égales)
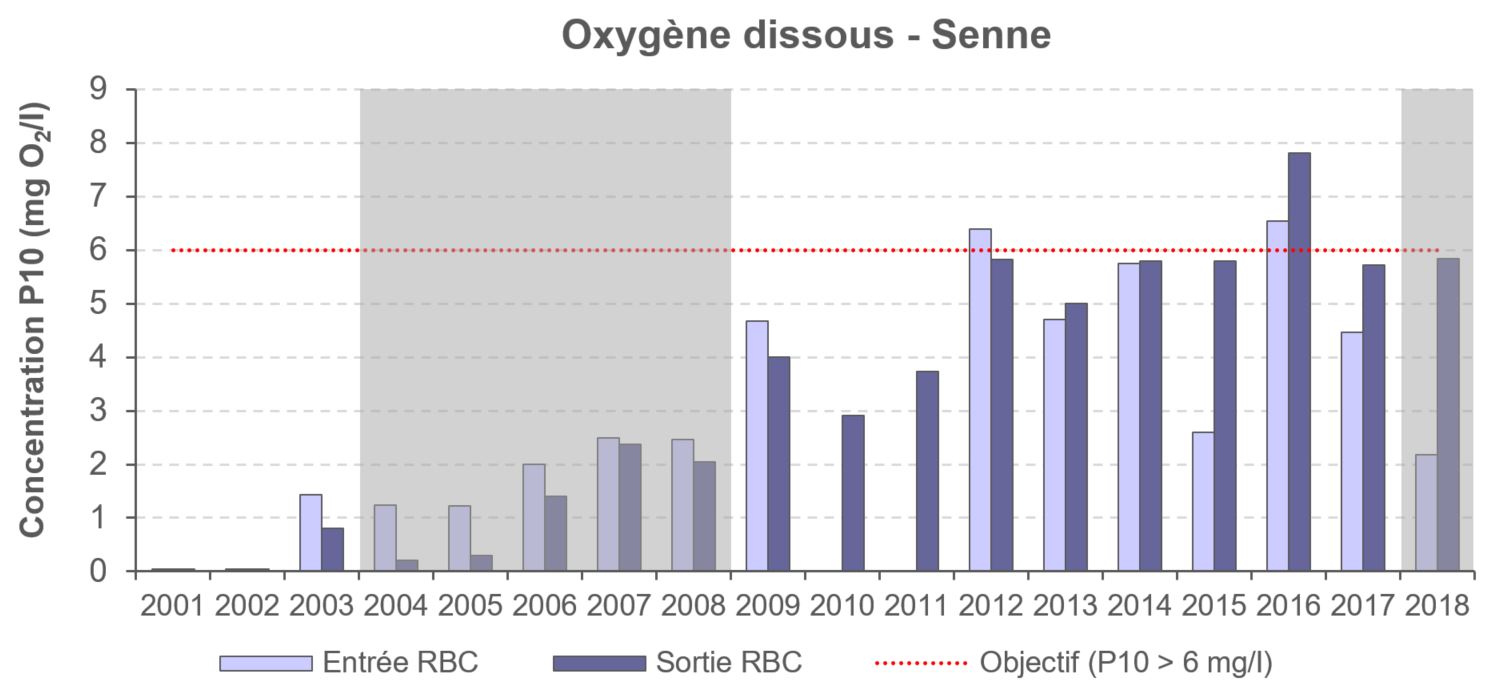
En parallèle, l’oxygène dissous, quasiment absent au début des années 2000, a pu monter en flèche. Et cette amélioration s’est poursuivie au-delà de 2010, certes à une vitesse moins rapide. On observe cependant un tassement voire une légère dégradation ces dernières années. Remarquons que, depuis 2015, les conditions d’oxygénation sont meilleures à la sortie du territoire régional qu’à l’entrée.
Cette évolution se répercute de façon bénéfique au niveau de la vie aquatique marquée, en 2016, par le retour des poissons à l’entrée de la Région (voir « Qualité biologique des principaux cours d’eau et étangs » ).
Mais des efforts encore à fournir
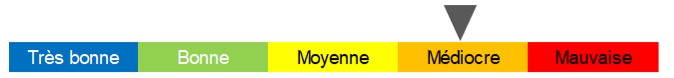
S’il y a lieu de se réjouir de ces tendances favorables, la qualité physico-chimique de la Senne reste globalement médiocre:
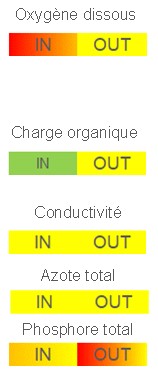 Les teneurs en oxygène dissous demeurent insuffisantes avec une qualité moyenne à la sortie de la Région et même, une qualité médiocre à mauvaise à l’entrée. La situation à l’entrée apparait d’autant plus critique que certaines mesures sont sous le seuil des 3 mg/l, jugé comme critique pour la vie piscicole, même s’il n’est franchi que quelques heures ou jours. De plus, elle semble s’aggraver ces dernières années (voir les deux graphes ci-dessus).
Les teneurs en oxygène dissous demeurent insuffisantes avec une qualité moyenne à la sortie de la Région et même, une qualité médiocre à mauvaise à l’entrée. La situation à l’entrée apparait d’autant plus critique que certaines mesures sont sous le seuil des 3 mg/l, jugé comme critique pour la vie piscicole, même s’il n’est franchi que quelques heures ou jours. De plus, elle semble s’aggraver ces dernières années (voir les deux graphes ci-dessus).- Sa charge organique demeure trop élevée à la sortie de la Région : les valeurs cibles tant pour la DCO que pour la DBO sont généralement excédées. Néanmoins, elle tend à diminuer. La valeur cible pour la DBO a ainsi été respectée pour la 1ère fois en 2020.
- En lien probablement avec cette charge organique encore élevée, les valeurs très hautes de conductivité à la sortie de la Région conduisent à un dépassement systématique de l’objectif. Bien que la conductivité soit plus basse à l’entrée, elle l’excède fréquemment et notamment ces 4 dernières années.
- Pour l’azote total, la qualité est moyenne et les concentrations évoluent à la baisse. Pour le phosphore total, la qualité est généralement moyenne. Mais les concentrations sont plus éloignées de l’objectif de qualité et donc plus susceptibles de changer de classe de qualité en cas de pic de pollution (tels qu’en 2019 à la suite du curage d’un émissaire à la sortie de Bruxelles).
En revanche, le bilan est positif en ce qui concerne les matières en suspension. Grâce à une amélioration indéniable, les teneurs respectent la valeur cible depuis 2017 et permettent donc à la Senne d’atteindre une bonne qualité vis-à-vis de ce paramètre.
Des progrès tangibles mais un équilibre fragile
Les progrès tangibles constatés ces 20 dernières années sont mis à mal lors des années climatiques exceptionnelles, démontrant la faible résilience des cours d’eau bruxellois. Les conditions climatiques extrêmes se répercutent directement sur la qualité physico-chimique de la Senne, comme en témoignent les chutes en oxygène dissous. De nombreux poissons sont retrouvés morts dans le Canal et plusieurs étangs de la Région bruxelloise certains étés. Mais d’autres organismes aquatiques souffrent potentiellement de ces conditions extrêmes, à en juger par les résultats de 2019 pour la qualité biologique. Or, dans un contexte de réchauffement climatique, ce scénario risque de se reproduire.
La Senne souffre également des rejets d’eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. qu’elle peine à absorber, a fortiori lorsque son débit est faible. Ce fut en particulier le cas en 2019, avec le relargage de polluants consécutif au curage de l’émissaire rive droite. Il est donc essentiel de limiter la fréquence des surverses du réseau d’égouttage.
À télécharger
Fiche(s) méthodologique(s)
Accès aux données
Fiche(s) documentée(s)
- 4. Normes et valeurs légales de référence en matière d’eau (.pdf)
- 8. Eaux pluviales et inondations (.pdf)
- 11. Cours d’eau et étangs bruxellois (.pdf)
- 12. Maillage bleu (.pdf)
- 13. Cadre légal bruxellois en matière d’eau (.pdf)
- 16. Qualité biologique des cours d’eau et étangs bruxellois (.pdf)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Carte interactive de l’eau à Bruxelles
- Herziening van de fysicochemische normen van de oppervlaktewateren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2019. 51 pp. Document interne (seulement en néerlandais) (.pdf)
- Fiches descriptives de la physico-chimie des eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) bruxelloises (2001-2012), septembre 2015. 118 pp. Document interne (.pdf)
Etude(s) et rapport(s)
- Rapports techniques présentant les résultats des campagnes annuelles de mesure de la qualité physico-chimique des eaux de surface, années diverses jusqu’en 2013, accessibles sur le centre de documentation (.pdf)
- Résultats d’analyse des campagnes annuelles de mesure de la qualité physico-chimique des eaux de surface. BDB (2013), EUROFINS (2014-2017), CAR (2018). Diffusion restreinte (.xls)
Plan(s) et programme(s)
Qualité chimique des eaux de surface
Indicateur - Actualisation : mars 2023
Des polluants omniprésents compromettent l’atteinte d’une bonne qualité chimique de la Senne, du Canal et même de la Woluwe : les polluants incriminés sont des hydrocarburesCe sont des composés organiques liquides constitués de carbone et d’hydrogène dérivés du pétrole. Le mazout, l’essence et d’autres types d’huiles minérales en font partie. Ces huiles ont la particularité d’avoir une faible densité. Lorsqu’elles s’infiltrent dans le sol, elles peuvent atteindre l’eau souterraine et y former une couche flottante. aromatiques polycycliques (HAP), le PFOS ou encore les composés du tributylétain. En revanche, peu d’autres polluants déclassent la qualité chimique de la Senne et du Canal en 2019 et 2020. Il s’agit souvent d’HAP ou de métaux dissous. La zone la plus contaminée est la sortie de la Région. La qualité chimique apparait meilleure en 2019-2020 qu’elle ne l’était en 2016-2018 : est-ce le signe qu’elle évolue favorablement ? Ou simplement la conséquence de l’amélioration des méthodes de mesure ?
Une cinquantaine de substances européennes prioritaires sous la loupe
Les micropolluants sont des substances chimiques potentiellement toxiques pour les écosystèmes voire la santé humaine à de très faibles concentrations. Or ils sont généralement peu éliminés au niveau des stations d’épuration. Ces polluants sont de nature et d’origine très variée : pesticides, hydrocarburesCe sont des composés organiques liquides constitués de carbone et d’hydrogène dérivés du pétrole. Le mazout, l’essence et d’autres types d’huiles minérales en font partie. Ces huiles ont la particularité d’avoir une faible densité. Lorsqu’elles s’infiltrent dans le sol, elles peuvent atteindre l’eau souterraine et y former une couche flottante., métaux lourdsNom générique d'un groupe de métaux de densité relativement élevée, tels que le plomb, le mercure, le zinc et le cadmium. Ces métaux sont présents naturellement dans l'environnement et sont même nécessaires à certains processus naturels. Ils sont toutefois nocifs en concentrations élevées. Les principales sources de métaux lourds sont l'industrie non ferreuse, la combustion de combustibles fossiles, l'incinération de déchets et le trafic., polychlorobiphényles (PCB)…
Les Etats membres sont tenus d’assurer leur surveillance et de prendre des mesures afin d’en limiter progressivement, voire d’en interdire, les rejets, émissions et pertes.
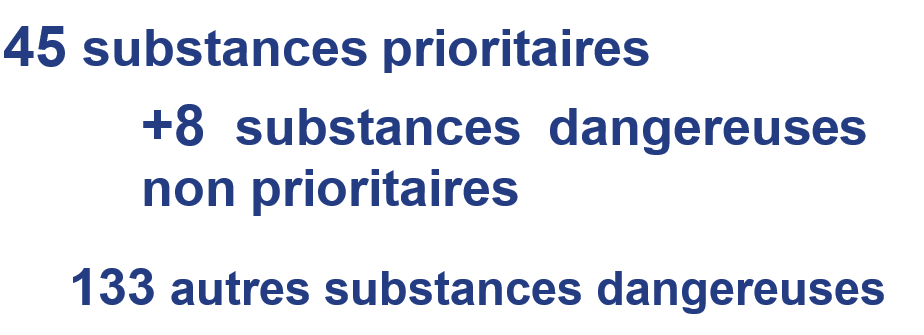 Parmi ces substances, certaines sont jugées particulièrement préoccupantes par la Commission européenne pour le milieu aquatique et qualifiées de « prioritaires » dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau en raison de leurs rejets/émissions importantes vers les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) et de leur caractère particulièrement dangereux et persistant. La liste actuelle compte 45 substances (ou groupes de substances) prioritaires et 8 substances dangereuses non prioritaires (cf. fiche documentée n°4 & annexes 1 et 2 de l’AGRBC de 2015). C’est cette liste qui sert de base à l’évaluation de l’ « état chimique » des masses d’eaux de surface, conformément aux dispositions de la Directive Cadre Eau (DCE).
Parmi ces substances, certaines sont jugées particulièrement préoccupantes par la Commission européenne pour le milieu aquatique et qualifiées de « prioritaires » dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau en raison de leurs rejets/émissions importantes vers les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) et de leur caractère particulièrement dangereux et persistant. La liste actuelle compte 45 substances (ou groupes de substances) prioritaires et 8 substances dangereuses non prioritaires (cf. fiche documentée n°4 & annexes 1 et 2 de l’AGRBC de 2015). C’est cette liste qui sert de base à l’évaluation de l’ « état chimique » des masses d’eaux de surface, conformément aux dispositions de la Directive Cadre Eau (DCE).
133 autres substances qualifiées de « dangereuses » doivent également faire l’objet d’un suivi au sein de la Région de Bruxelles-Capitale et répondre à des objectifs environnementaux de qualité (cf. annexe 4 de l’AGRBC de 2015).
Outre ces substances européennes, une attention toute particulière est accordée localement, en Région bruxelloise, à quelques polluants spécifiques de nos eaux de surface : le zinc dissous, l’acénaphtène et le pyrène (2 HAP), des polychlorobiphényles (PCB) et les huiles minérales.
Surveillance des micropolluants dans l’eau mais aussi dans les sédiments et le biote
La Région bruxelloise a mis en place depuis 2001 des programmes de surveillance de la qualité chimique de ses eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.), qui reposent sur l’analyse des concentrations de quelques centaines de paramètres. 5 sites sont ainsi contrôlés depuis le début des mesures : il s’agit des points d’entrée et de sortie de la Région des trois masses d’eau de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) désignées (Senne, Canal et Woluwe). Les résultats présentés dans cette fiche se rapportent à ces 5 sites historiques, sachant que la surveillance concerne également d’autres sites de mesures et d’autres cours d’eau.
Bon à savoir
Outre la colonne d’eau, une surveillance est mise en place dans les sédiments et dans le biote (tissus d’organismes vivants). L’objectif est de s’assurer qu’il n’y ait pas d’accumulation de certains polluants lipophiles dans les sédiments (les polluants qui y sont retenus étant parfois relargués vers la colonne d’eau) ou dans le biote.
Des objectifs environnementaux en constante évolution
Les objectifs de qualité en vigueur depuis 2011 pour les substances européennes dans la colonne d’eau sont les Normes de Qualité Environnementale (NQE). Ces normes se rapportent :
- aux moyennes annuelles d’une campagne d’analyse. Elles visent à protéger la vie aquatique à moyen et long termes vis-à-vis d’une exposition chronique.
- ainsi que, pour certaines substances prioritaires dangereuses, à des concentrations maximales admissibles (CMA) pour chaque échantillon. Ces normes CMA visent à protéger la vie aquatique à court terme vis-à-vis d’une exposition aiguë.
Les normes en vigueur sont reprises dans la fiche méthodologique et la fiche documentée n°4.
En 2013, les NQE de 7 substances prioritaires ont été révisées (avec effet à compter de fin 2015). Et 12 nouvelles substances prioritaires (dont la moitié qualifiées de « dangereuses ») ont été désignées et font l’objet de normes depuis fin 2018.
Précisons que certains polluants n’ont pu faire l’objet d’une évaluation certaines années (absence de mesures) ou d’une comparaison par rapport aux objectifs de qualité en raison de l’imprécision des méthodes d’analyse (seuil de détection supérieur à la NQE).
Une qualité chimique satisfaisante pour un très grand nombre de polluants
La plupart des 45(+8) substances prioritaires européennes et des 133 substances dangereuses ne posent aucun problème pour les trois masses d’eau de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) définies en Région bruxelloise : le Canal, la Senne et la Woluwe. Elles ne sont souvent même pas détectées dans la colonne d’eau, les sédiments ou le biote.
Il en est de même pour trois des cinq substances chimiques jugées pertinentes à l’échelle de la Région de Bruxelles Capitale. Seuls le zinc et les huiles minérales posent toujours souci dans la Senne.
La Senne est le cours d’eau le plus contaminé
De manière générale, au vu du nombre de substances déclassant la qualité chimique de l’eau et des concentrations observées :
- La Senne est le cours d’eau le plus contaminé, surtout à la sortie de la Région.
- A l’inverse, la Woluwe apparait relativement préservée, à l’exception toutefois de polluants omniprésents tels que les HydrocarburesCe sont des composés organiques liquides constitués de carbone et d’hydrogène dérivés du pétrole. Le mazout, l’essence et d’autres types d’huiles minérales en font partie. Ces huiles ont la particularité d’avoir une faible densité. Lorsqu’elles s’infiltrent dans le sol, elles peuvent atteindre l’eau souterraine et y former une couche flottante. Aromatiques Polycycliques (HAP).
- Le Canal occupe une position intermédiaire.
En 2019 et 2020, 13 substances ont ainsi dépassé les normes dans la Senne, 8 dans le Canal et 1 seule dans la Woluwe. Environ la moitié d’entre elles ont un caractère omniprésent.
Deux familles de polluants posent particulièrement problème : les HAP et les métaux dissous. Ces paramètres sont examinés en détail dans la suite de cette fiche.
Par rapport aux années précédentes, le nombre de substances responsables de dépassement de normes tend à diminuer. Si ce constat est encourageant, il découle en partie de l’amélioration des méthodes de mesure fin 2018 : l’abaissement des seuils de quantification se répercute en effet sur le calcul des moyennes annuelles (voir fiche méthodologique).
Le problème généralisé des substances omniprésentes
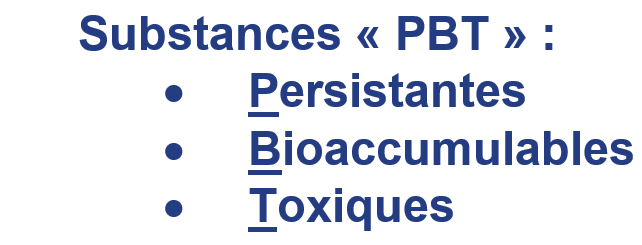 L’Union européenne a dressé une liste de treize substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou se comportant comme tel (cf. article 8bis de la directive 2013/39/UE). Parmi celles-ci figurent des HAP, le mercure, le PFOS ou encore les dioxines. Bien qu’ils ne figurent pas sur cette liste, les polychlorobiphényles (PCB) appartiennent également à la famille des polluants PBT
L’Union européenne a dressé une liste de treize substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou se comportant comme tel (cf. article 8bis de la directive 2013/39/UE). Parmi celles-ci figurent des HAP, le mercure, le PFOS ou encore les dioxines. Bien qu’ils ne figurent pas sur cette liste, les polychlorobiphényles (PCB) appartiennent également à la famille des polluants PBT
Bon à savoir
Les substances « PBT » sont persistantes, bioaccumulables et toxiques. Elles sont susceptibles d’être détectées sur le long terme dans l’environnement aquatique, malgré les mesures prises à leur encontre. Certaines d’entre elles présentent même la particularité de pouvoir être transportées sur de longues distances ; elles sont alors qualifiées d’ubiquistes ou d’omniprésentes car tous les compartiments environnementaux sont touchés (eau, air, sol, etc.).
Sans surprise, la Région bruxelloise n’échappe pas à cette contamination qui touche la grande majorité des Etats membres de l’Union Européenne. Le principal problème au niveau de la colonne d’eau concerne les HAP mais aussi le PFOS.
Des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) partout, même dans la Woluwe
6 des 8 HAP classés comme prioritaires ou assimilés excèdent les normes dans les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) bruxelloises. Même la Woluwe est touchée. Et avec la révision des normes de qualité environnementale (NQE), effective depuis 2016, le bilan s’est aggravé.
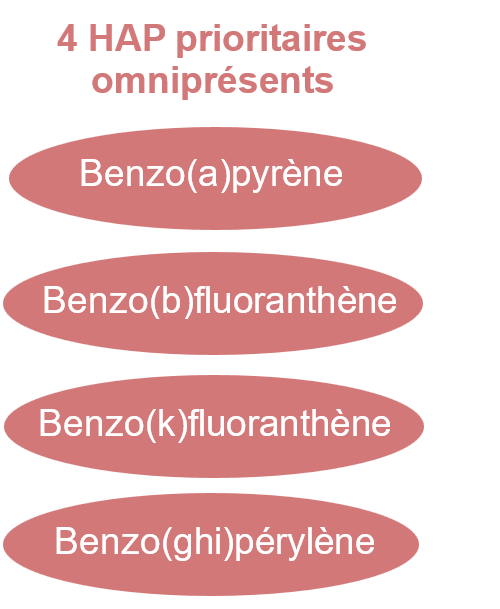 Parmi les principaux HAP prioritaires incriminés, figurent quatre des cinq HAP omniprésents
Parmi les principaux HAP prioritaires incriminés, figurent quatre des cinq HAP omniprésents
- Le benzo(a)pyrène contamine la Senne et le Canal mais aussi la Woluwe. La norme relative à la moyenne annuelle, qui était régulièrement dépassée avant sa révision en 2016, entraine des dépassements systématiques dans ces 3 masses d’eau depuis 2018. De plus, la concentration maximale admissible, bien que révisée à la hausse, a été excédée dans la Senne à la sortie de la Région en 2016 et 2017. Mais depuis lors, elle est respectée.
- De plus, le benzo(ghi)pérylène, le benzo(b)fluoranthène ainsi que, dans une moindre mesure, le benzo(k)fluoranthène dépassent fréquemment les concentrations maximales admissibles dans la Senne et le Canal. Et cela aurait aussi été le cas avant 2016, si elles avaient été en vigueur.
Le benzo(ghi)pérylène a ainsi été responsable en 2019 comme en 2020 de 7 dépassements par an (3 dans le Canal et 4 dans la Senne). Le benzo(b) fluoranthène a occasionné 1 dépassement en 2019 (dans la Senne) et 4 en 2020 (2 dans la Senne et 2 dans le Canal). Le benzo(f)fluoranthène ne compte à son actif qu’1 dépassement en 2019 dans la Senne et aucun en 2020.
L’indeno(123cd)pyrène, cinquième HAP omniprésent, n’est pas soumis à une norme de qualité environnementale. Mais il est très souvent quantifié dans les eaux de surface bruxelloises.
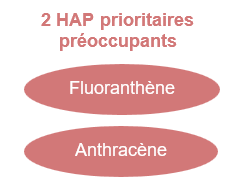 Deux autres HAP prioritaires sont préoccupants :
Deux autres HAP prioritaires sont préoccupants :
- Le fluoranthène, qui contamine tant la Senne que le Canal. Depuis la révision des normes en 2016, les dépassements de la moyenne annuelle y sont systématiques à la sortie de la Région et très fréquents à l’entrée. En outre, la Senne à la sortie de la Région a également excédé la concentration maximale admissible à deux reprises, en 2016 et 2017. Dans la Woluwe, à une exception près en 2016, les concentrations mesurées restent en-dessous des normes.
- L’anthracène, dans la Senne à la sortie de la Région. La norme relative à la moyenne annuelle a été outrepassée une seule fois, en 2017. En revanche, la concentration maximale admissible a été excédée à plusieurs reprises, notamment en 2016, 2017 et 2019.
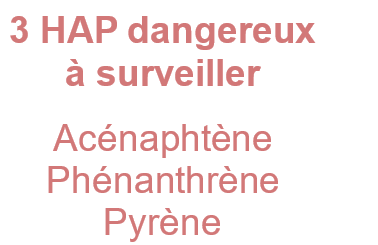 Par ailleurs, 3 des 8 HAP de la liste des 133 autres substances dangereuses ont présenté des concentrations moyennes annuelles supérieures à la norme certaines années, notamment en 2016 et 2017 : l’acénaphtène, le phénanthrène et le pyrène. La Senne à la sortie de la Région était systématiquement concernée. Par le passé, le pyrène avait également connu des dépassements ponctuels dans la Senne à l’entrée de la Région et plus rarement, dans le Canal à la sortie de la Région.
Par ailleurs, 3 des 8 HAP de la liste des 133 autres substances dangereuses ont présenté des concentrations moyennes annuelles supérieures à la norme certaines années, notamment en 2016 et 2017 : l’acénaphtène, le phénanthrène et le pyrène. La Senne à la sortie de la Région était systématiquement concernée. Par le passé, le pyrène avait également connu des dépassements ponctuels dans la Senne à l’entrée de la Région et plus rarement, dans le Canal à la sortie de la Région.
Point positif toutefois, aucune de ces substances n’a présenté de dépassement sur les trois dernières années de mesure (2018, 2019 et 2020).
Les HAP arrivent dans les eaux de surface majoritairement de manière diffuse
De manière générale, le respect des normes relatives aux HAP s’inscrit dans un processus long et complexe dans la mesure où ces polluants résultent essentiellement d’apports diffus. Selon l’inventaire des émissions de 10 HAP pour l’année 2016, 60% des apports résultent de sources diffuses : 44% du transport (usure des pneus et des voiries, combustions incomplètes) et 13% du dépôt atmosphérique.
Les HAPs étant lipophiles, ils sont retenus à plus de 90% au niveau des boues de stations d’épuration. Leur présence dans l’eau découle des rejets au niveau des déversoirs d’orage (37%), au niveau de la filière temps pluie des stations d’épuration (31%) et dans une moindre mesure, des eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. des zones égouttées non raccordées aux stations d’épuration (15%) et du ruissellement (10%).
Au niveau des cours d’eau, les HAP s’associent aux sédiments et se dégradent difficilement. Preuve en est leur présence dans les sédiments, mais leur concentration serait stable.
Sources (à gauche) et cheminements (à droite) des émissions nettes annuelles de 10 HAP dans les eaux de surface
Source : Bruxelles Environnement, données issues de l’inventaire des émissions vers les eaux de surface (années de référence : 2016-2017-2018) pour le benzo(a)pyrène, le benzo(b)-, le benzo(k)fluoranthène, le benzo(ghi)pérylène, le fluoranthène, l’indeno(123cd)pyrène), l’acénaphtène, l’anthracène, le naphtalène et le pyrène
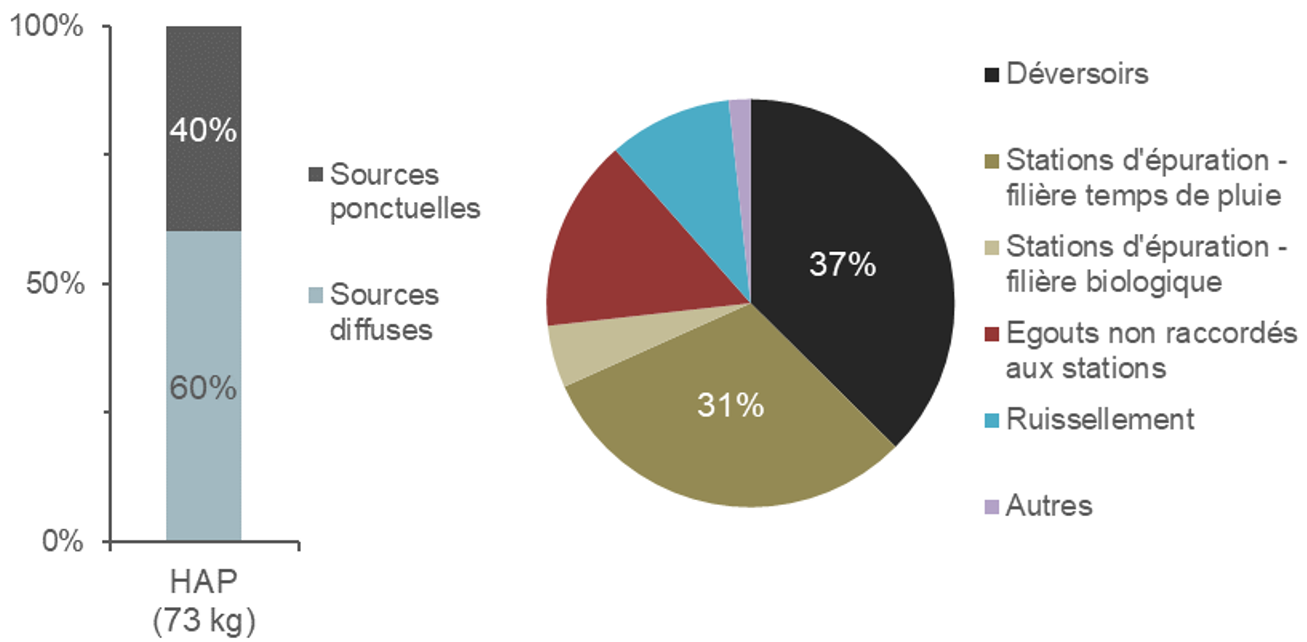
Le PFOS : autre substance omniprésente polluant la Senne et le Canal
Le PFOS (acide perflurooctane-sulfonique et ses dérivés) est un polluant fluoré omniprésent qui est systématiquement problématique dans la Senne et le Canal lorsqu’il est mesuré.
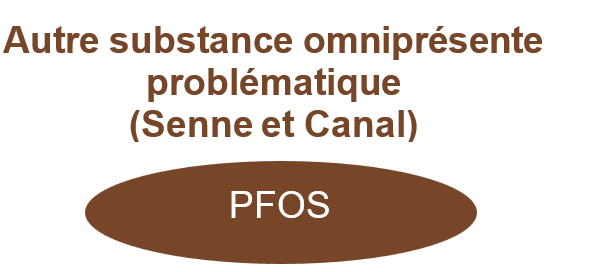 La norme annuelle est excédée :
La norme annuelle est excédée :
- plus de 5 fois dans la Senne
- et plus de 20 fois dans le Canal !
Il était également en dépassement dans la Woluwe en 2014-2016 mais n’est plus quantifié en 2018-2020, signe d’une évolution encourageante pour ce cours d’eau.
Bon à savoir
Le PFOS n’existe pas à l’état naturel. C’est un composé fluoré hydro- et lipophobe, très stable chimiquement, couramment utilisé à des fins domestiques ou industrielles. Il est devenu une problématique majeure ces dernières années car il se propage largement dans l’environnement, est persistant et ne se dégrade que lentement.
Les polychlorobiphényles : bientôt plus un problème dans les eaux bruxelloises ?
Les polychlorobiphényles (PCB) font également partie des substances PBT omniprésentes et des polluants spécifiques au bassin versant. Des teneurs trop élevées ont été relevées en 2015 et 2016 dans l’eau de la Senne et du Canal tant à l’entrée qu’à la sortie du territoire. La bonne nouvelle est qu’en 2019 et 2020, avec des seuils de quantification plus bas, les concentrations sont demeurées inférieures à la norme. Faut-il l’interpréter comme un signe d’amélioration ?
Bon à savoir
Les PCB ont été utilisés jusque dans les années 70 comme isolants électriques. Ils sont désormais interdits. Un plan régional d’élimination et de décontamination des PCB-PCT a été adopté en 1999 ainsi qu’un programme de mesures visant à réduire cette pollution en 2005.
Certaines substances PBT passent sous les radars…
L’imprécision des méthodes de mesure ne permet malheureusement pas d’évaluer toutes les substances PBT dans la colonne d’eau : c’est le cas entre autres en 2019 et 2020 de l’hexabromo-cyclododécane (HBCDD) ou encore des diphényléthers bromés. Mais, vu leur caractère omniprésent et les dépassements observés dans le passé, la probabilité qu’ils soient présents voire en dépassement est élevée.
Les métaux dissous : autres substances problématiques dans la Senne et le Canal
Si les concentrations mesurées dans l’eau en métaux totaux respectent les normes, les composés dissous eux posent problème. La Senne est la plus touchée, surtout à la sortie de la Région, suivie par le Canal. La Woluwe en revanche est généralement épargnée.
Deux métaux dissous se révèlent problématiques :
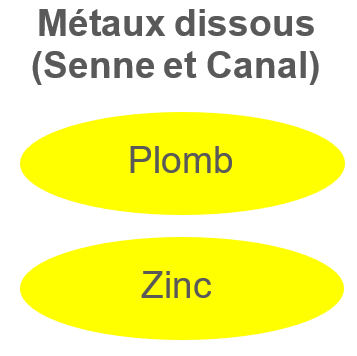 Le plomb (Pb): depuis le durcissement de la norme en 2016, les concentrations moyennes annuelles sont invariablement en dépassement dans la Senne et le Canal, tant à l’entrée qu’à la sortie de la Région. Seule exception : la Senne à l’entrée de la Région en 2020. Même la Woluwe a connu un dépassement en 2017 ! Plus inquiétant, les concentrations maximales admissibles ont été surpassées en 2016 et 2017 à la sortie de la Région dans la Senne et/ou le Canal. La tendance évolue toutefois positivement, avec une baisse significative des concentrations.
Le plomb (Pb): depuis le durcissement de la norme en 2016, les concentrations moyennes annuelles sont invariablement en dépassement dans la Senne et le Canal, tant à l’entrée qu’à la sortie de la Région. Seule exception : la Senne à l’entrée de la Région en 2020. Même la Woluwe a connu un dépassement en 2017 ! Plus inquiétant, les concentrations maximales admissibles ont été surpassées en 2016 et 2017 à la sortie de la Région dans la Senne et/ou le Canal. La tendance évolue toutefois positivement, avec une baisse significative des concentrations.- Le zinc (Zn) : la norme annuelle est outrepassée en 2020 comme chaque année dans la Senne à la sortie de la Région. C’était également le cas jusqu’en 2016 à l’entrée de la Région, de même que dans le Canal, aux deux points de mesure.
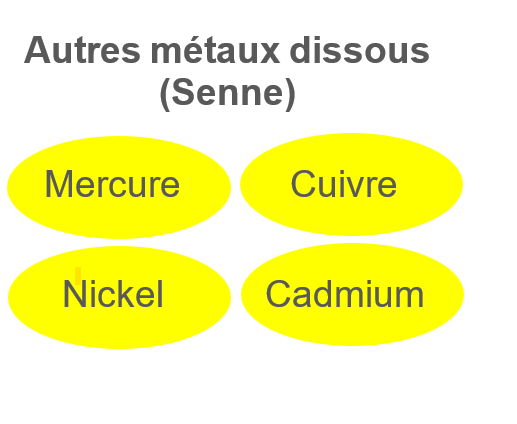 Quatre autre métaux dissous contaminent potentiellement la Senne, surtout à la sortie de la Région : le mercure, le cuivre, le nickel et le cadmium.
Quatre autre métaux dissous contaminent potentiellement la Senne, surtout à la sortie de la Région : le mercure, le cuivre, le nickel et le cadmium.
Alors que ces quatre substances déclassaient sa qualité d’eau en 2016, l’évolution sur les deux dernières années de mesure disponibles semble positive : seul le cuivre a excédé la norme en 2017 et aucun dépassement n’a été constaté en 2020.
La prudence reste néanmoins de mise vu la propension des métaux à fortement s’accumuler dans les sédiments, ce que confirment les teneurs élevées qui y sont mesurées. Un autre point d’attention est l’accumulation de mercure dans les tissus des organismes vivants (biote).
D’où viennent ces métaux ?
Les sources diffuses contribuent de manière prépondérante aux émissions de zinc (88%, principalement en raison de la corrosion des matériaux de construction du bâti) et de mercure (82%, principalement à cause du trafic).
Les sources ponctuelles en revanche (la population, les entreprises et l’industrie) constituent presque l’entièreté des apports en nickel (98%), l’essentiel de ceux en cadmium (78%) et plus de la moitié de ceux en plomb (55%).
Sources des émissions nettes annuelles de 5 métaux dans les eaux de surface
Source : Bruxelles Environnement, données issues de l’inventaire des émissions vers les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) (années de référence : 2016-2017-2018)
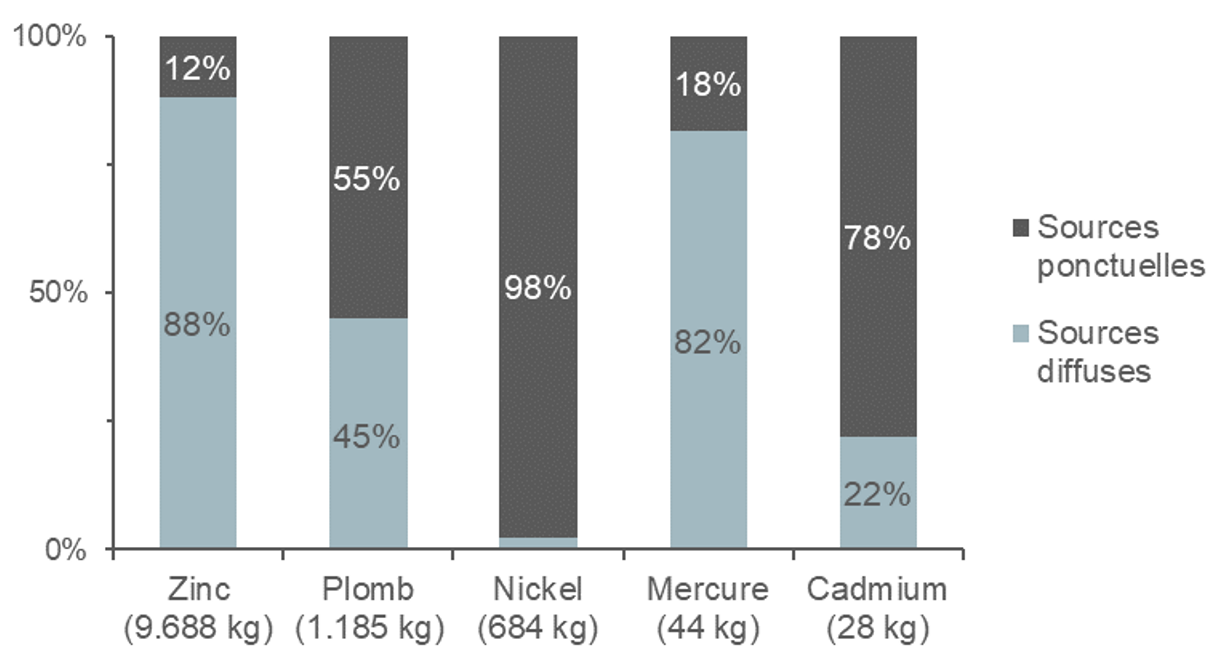
Les émissions nettes vers la Senne sont environ 6 fois plus importantes que celles vers le Canal.
Les métaux étant moins bien épurés ou retenus au niveau des stations d’épuration, les effluents des STEP représentent la principale voie d’acheminement des métaux vers la Senne.
Autres polluants méritant une attention particulière
- Les substances tensioactives occasionnent des dépassements dans la Senne et le Canal certaines années telles qu’en 2019.
- Les huiles minérales sont quantifiées chaque année dans la Senne et le Canal. Bien que non soumises actuellement au respect d’une NQE, elles nécessitent une attention particulière car elles sont émises en grande quantité sur le territoire régional: 9 tonnes d’émissions nettes par an dont 8 vers la Senne et 1 vers le Canal (selon l’inventaire des émissions pour les années 2016-2017-2018). Elles proviennent du trafic routier et ferroviaire (huiles utilisées au niveau des aiguillages). Une des sources significatives pour la Senne serait le site de Schaerbeek formation.
- En ce qui concerne les pesticides figurant sur la liste des substances prioritaires et sur celle des autres polluants, les normes sont respectées depuis 2009. Seul l’aclonifène a dépassé en 2019 et 2020 la concentration maximale admissible dans la Senne à l’entrée de la Région. La contamination par les pesticides constatée dans les eaux souterraines de la Région ne se vérifie donc pas pour les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) (voir « Etat chimique des eaux souterraines »).
- Les concentrations moyennes annuelles en DEHP (type de phtalate utilisé comme plastifiant) n’ont dépassé la norme qu’une seule fois : en 2016, sur la Senne à l’entrée de la Région. Mais la vigilance s’impose car les concentrations observées dans les sédiments du Canal augmentent.
- Les diphényléthers bromés sont présents dans les sédiments et conduisent à des dépassements de norme pour le biote. Les concentrations dans la colonne d’eau restent toutefois bien en-dessous des concentrations maximales admissibles. Il est en revanche difficile de statuer sur le caractère préoccupant ou non de ces substances vis-à-vis des eaux de surface, compte tenu du niveau de précision des méthodes de mesures.
- Substances préoccupantes seulement depuis une dizaine d’années, les nonylphénols sont présents dans les eaux de surface bruxelloises, comme dans presque tous les pays. Leur concentration respecte les normes en 2019 et 2020 mais ce ne fut pas le cas d’autres années. Les dépassements concernaient tant la moyenne annuelle que la concentration maximale admissible. Ils s’observaient aussi bien dans le Canal que la Senne, à chaque fois à la sortie de la Région.
Comment lutter efficacement contre ces pollutions ?
Un grand nombre de mesures préventives et curatives sont prises dans le cadre du plan de gestion de l’eau pour réduire la pollution chimique de l’environnement et des cours d’eau : gestion des permis d’environnement (normes de rejets, recours aux meilleurs techniques disponibles, etc.), restriction puis interdiction dès 2019 de l’usage des pesticides dans les espaces publics, dragage et curage des cours d’eau et étangs pour enlever les sédiments pollués, information et sensibilisation en matière d’utilisation de certains produits, etc.
L’amélioration de la qualité des eaux de surface bruxelloises dépend par ailleurs aussi des efforts réalisés en amont de la Région.
Néanmoins la lutte contre les substances omniprésentes ne peut être restreinte à la seule politique de l’eau. Seule une gestion globale à l’échelle européenne (voire mondiale) et transversale aux différentes politiques environnementales (eau, air, sols…) pourrait contenir cette pollution.
À télécharger
Fiche(s) méthodologique(s)
Accès aux données
Fiche(s) documentée(s)
- Normes et valeurs légales de référence en matière d’eau (.pdf)
- Eaux pluviales et inondations (.pdf)
- Cours d’eau et étangs bruxellois (.pdf)
- Maillage bleu (.pdf)
- Cadre légal bruxellois en matière d’eau (.pdf)
- Qualité biologique des cours d’eau et étangs bruxellois (.pdf)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Carte interactive de l’eau à Bruxelles
- Inventaire des émissions, rejets et pertes des substances prioritaires dans les eaux de surface de la Région de Bruxelles-Capitale, 2022. Annexe 2 du Plan de Gestion de l’Eau 2022-2027. 287 pp. (.pdf)
Etude(s) et rapport(s)
- Rapports techniques présentant les résultats des campagnes annuelles de mesure de la qualité physico-chimique des eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.), années diverses jusqu’en 2013, accessibles sur le centre de documentation (.pdf)
- Résultats d’analyse des campagnes annuelles de mesure de la qualité chimique des eaux de surface. BDB (2013), EUROFINS (2014-2017), CAR (2018-2020). Diffusion restreinte (.xls)
Plan(s) et programme(s)
Qualité biologique des principaux cours d'eau et étangs
Indicateur - Actualisation : juillet 2022
Aucune des masses d’eau suivies en Région de Bruxelles-Capitale n’atteint le « bon potentiel écologique » en 2019. La qualité globale de la Senne reste encore loin de cet objectif et elle a régressé en 2019, entre autre à cause de la sécheresse. Le Canal connait une nette dégradation en 2019 pour tous les groupes biologiques. En revanche, si on fait abstraction des poissons, la vallée de la Woluwe est proche du bon potentiel écologique. La Woluwe comme le Roodkloosterbeek l’atteignent pour plusieurs groupes biologiques et ont évolué positivement entre 2016 et 2019. Deux des trois étangs étudiés obtiennent aussi de très bons scores ; le troisième affiche de moins bons résultats.
Cinq groupes biologiques sous la loupe
La qualité biologique des cours d’eau et étangs bruxellois est évaluée tous les 3 ans depuis 2004, conformément à la Directive Cadre Eau (DCE) et aux recommandations des experts. La dernière campagne de mesures date de 2019.
Cinq groupes – ou éléments - biologiques sont pris en compte :
- le phytoplancton (algues généralement microscopiques en suspension dans l’eau),
- le phytobenthos (micro- et macro-algues vivant fixées ou à proximité du fond de l’eau),
- les macrophytes (plantes telles que les roseaux),
- les macro-invertébrés (insectes et larves, vers, crustacés,…)
- et les poissons.
Les cinq éléments biologiques pris en compte dans l’évaluation de la qualité biologique
Source : Figure extraite de VUB & INBO, 2021
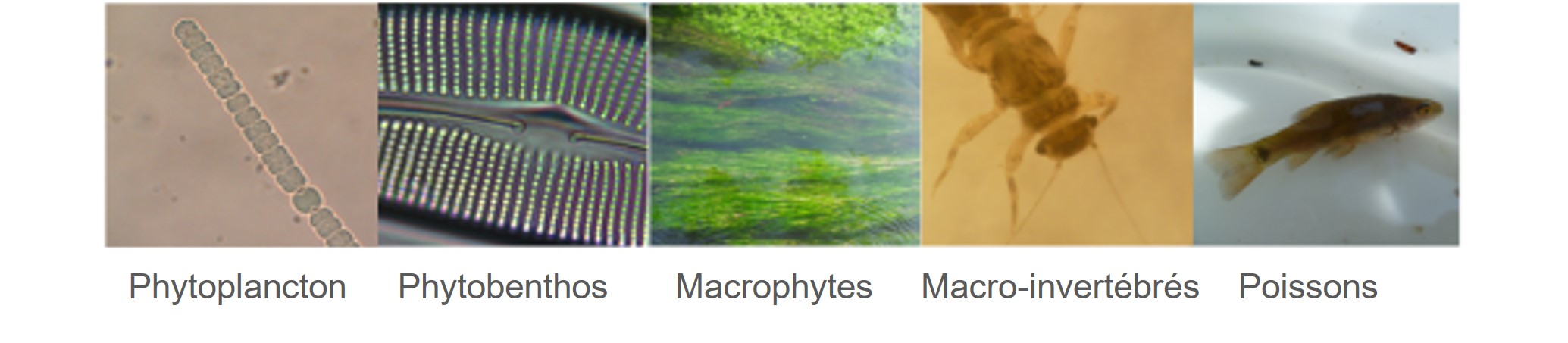
L’évaluation de la qualité de chaque élément repose sur une comparaison de la situation observée par rapport à des conditions de référence. Ces dernières correspondent à une situation optimale (« potentiel écologique maximal ») compte tenu des altérations aux conditions physiques naturelles consécutives des activités humaines (voir fiche méthodologique). Cinq classes de qualité sont déterminées.
C’est l’élément de moins bonne qualité qui détermine l’état biologique global (principe « one-out, all-out »). Cette méthode d’évaluation est donc particulièrement restrictive. De plus, le laps de temps entre deux campagnes (3 ans) est peut-être trop réduit que pour mettre en évidence des évolutions significatives. Ces dernières doivent, pour être pertinentes, être considérées sur le long terme car les communautés biologiques peuvent voir leur population fluctuer naturellement sur le court terme.
Evolution de la qualité biologique
Les cartes ci-dessous illustrent les résultats obtenus pour les points de mesure suivis à chaque campagne. Ces sites sont localisés sur la Senne, le Canal, la Woluwe (cours d’eau et étangs) et l’un de ses affluents, le Roodkloosterbeek. Depuis 2019, le grand étang Mellaerts a remplacé l’étang du parc des Sources.
Evolution de la qualité biologique des principaux cours d’eau et étangs bruxellois (2004-2019)
Source : Bruxelles Environnement, dpt. Reporting et incidences environnementales, 2022
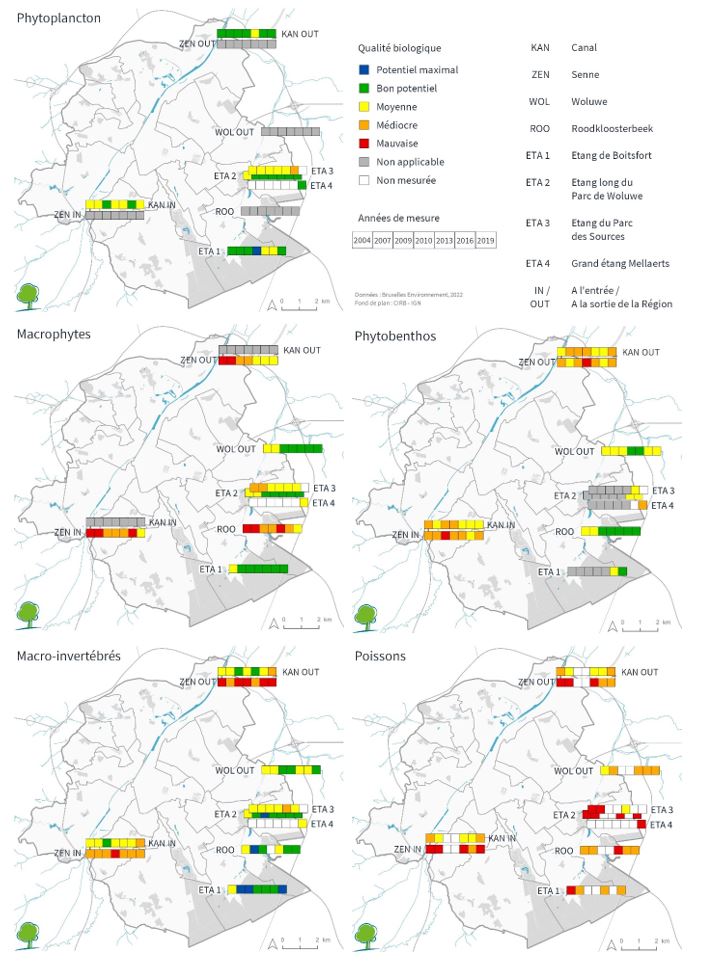
Les poissons, de retour dans la Senne depuis 2016, ont souffert en 2019
 Le changement positif le plus marquant est le retour des poissons dans la Senne depuis 2016, alors que ce cours d’eau était auparavant considéré comme « mort » pour cet élément. Une quinzaine d’espèces différentes y a été recensée en 2016, avec près de 200 individus à l’entrée de la Région et 100 à la sortie. Cette évolution semble résulter d’une restauration écologique progressive suite à la mise en route des stations d’épuration de Bruxelles-Sud en 2000 et de Bruxelles-Nord en 2007. Malheureusement, cette tendance positive ne s’est pas confirmée en 2019, avec une dizaine d’espèces seulement et un nombre de spécimens divisé par 5 à l’entrée de la Région et par 3 à la sortie. Plusieurs explications sont avancées :
Le changement positif le plus marquant est le retour des poissons dans la Senne depuis 2016, alors que ce cours d’eau était auparavant considéré comme « mort » pour cet élément. Une quinzaine d’espèces différentes y a été recensée en 2016, avec près de 200 individus à l’entrée de la Région et 100 à la sortie. Cette évolution semble résulter d’une restauration écologique progressive suite à la mise en route des stations d’épuration de Bruxelles-Sud en 2000 et de Bruxelles-Nord en 2007. Malheureusement, cette tendance positive ne s’est pas confirmée en 2019, avec une dizaine d’espèces seulement et un nombre de spécimens divisé par 5 à l’entrée de la Région et par 3 à la sortie. Plusieurs explications sont avancées :
Tout d’abord, la vie piscicole est compromise par les afflux d’eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. que reçoit le cours d’eau (rejets des stations d’épuration et déversements par temps de pluie lors de la saturation du réseau d’égouttage) (voir l’indicateur sur l’épuration des eaux usées). Les indicateurs biologiques témoignent en effet en 2019 d'une qualité d’eau très dégradée :
- Le phytobenthos a régressé en qualité médiocre en raison d’une pollution exceptionnelle due au curage d’un collecteurcollecteur, négociant et courtier ayant charrié une importante charge organique.
- Le Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus), espèce résistante aux eaux eutrophes (très riches en nutriments), est le seul représentant de la végétation submergée et ne permet pas aux macrophytes d’aller au-delà d’une qualité moyenne.
- Les macro-invertébrés sont dominés par un petit nombre de taxons, tous tolérants à la pollution.
 Ensuite, cette pollution des eaux est aggravée par les périodes de sécheresse, à l’instar de 2019 : le faible débit combiné à des rejets pollués en charge organique entraine une chute des teneurs en oxygène dissous, souvent en-deçà du seuil de 3 mg/l jugé comme critique pour la vie des poissons.
Ensuite, cette pollution des eaux est aggravée par les périodes de sécheresse, à l’instar de 2019 : le faible débit combiné à des rejets pollués en charge organique entraine une chute des teneurs en oxygène dissous, souvent en-deçà du seuil de 3 mg/l jugé comme critique pour la vie des poissons.
Enfin, l’établissement durable des poissons dans la Senne est entravé par de profonds bouleversements hydromorphologiques que constituent les berges bétonnées, le voûtement des deux tiers de son parcours et un ouvrage infranchissable au début du pertuis du centre-ville (voir le focus sur l’état hydromorphologique).
La Senne doit également faire face à une croissance du crabe chinois (Eriocheir sinensis), espèce invasive, à la sortie de la Région : presque 150 crabes ont été piégés dans les nasses en mai 2019.
Quelles perspectives pour la Senne ?
La Senne reste donc très éloignée du « bon potentiel écologique » et le chemin à parcourir pour l’atteindre semble encore long. Limiter les rejets polluants et améliorer l’hydromorphologie apparaissent comme deux préalables indispensables à toute restauration écologique de cette rivière emblématique.
Limiter les rejets polluants signifie notamment gérer les surverses des déversoirs d’orage. Trois déversoirs majeurs, responsables des plus importants rejets annuels en volume, vont ainsi être réaménagés dans le cadre du programme européen Life-Belini. Une autre mesure de lutte contre les rejets polluants est l’enlèvement des sédiments de la Senne : le curage de la partie amont a été effectué à l’été 2013 et celui de la partie aval et du centre s’est terminé en 2016. Deux tronçons doivent potentiellement encore être curés à la sortie de la Région : en aval de l’effluent de la station Nord d’une part et en aval de la Chaussée de Buda jusqu’à la frontière régionale d’autre part. Les travaux sont prévus pour 2026 et 2027.
Plusieurs projets d’envergure visant à restaurer l’hydromorphologie de 3 tronçons de la Senne sont menés dans le cadre du programme Life-Belini et pourraient changer la donne d’ici quelques années :
- La renaturation des berges sur 1 km le long du Boulevard Paepsem, au sud de la Région, s’est terminée en mars 2020 (plus d’informations sur cette page web du projet Belini) ;
- La remise à ciel ouvert sur 300 mètres et la restauration des berges sur 400 mètres à hauteur de l’avenue de Vilvorde, en amont de la station d’épuration Nord, se sont achevées à l’automne 2021 (plus d’informations sur cette page web du projet Belini) ;
Remise à ciel ouvert de la Senne en amont de la station d’épuration Nord (avant/après travaux)
Source : Photos extraites du site web Belini, 2022

- La remise à ciel ouvert dans le Parc Maximilien, près de la gare du Nord, dont les travaux débuteront en 2022.
Une dégradation à tous niveaux de la qualité biologique du Canal en 2019
Le Canal connait entre 2016 et 2019 une dégradation pour tous les éléments biologiques analysés, avec comme conséquence une rétrogradation de classe de qualité :
- De moyenne à médiocre pour le phytobenthos (à la sortie de la Région uniquement), les macro-invertébrés et les poissons (aux deux sites de collecte).
- Du bon potentiel à une qualité moyenne pour le phytoplancton (à l’entrée de la Région).
Le phytoplancton à la sortie de la Région est le seul à se maintenir au « bon potentiel écologique » en 2019, malgré une baisse de son score.
De nombreuses communautés aquatiques vivant dans le Canal sont dominées par des espèces invasives, telles que le crabe chinois (Eriocheir sinensis), le gobie à tâches noires (Neogobius melanostomus) ou encore l’écrevisse américaine (Faxonius limosus). Ces espèces sont connues pour exercer une pression sur les macro-invertébrés et dans le cas du gobie et de l’écrevisse, aussi sur les petits poissons (voir fiche documentée « Poissons »). La croissance du nombre de crabes chinois en 2019 pourrait expliquer le déclin écologique constaté cette année-là. Le gobie est présent depuis 2013 à la sortie de la Région et a malheureusement aussi été pêché en 2019 à l’entrée, témoignant de son expansion vers l’amont.

La présence d’espèces invasives est un phénomène courant au sein des voies navigables : celles-ci constituent un axe de transit privilégié pour les organismes vivants et le point de départ à leur potentielle expansion. Dans le Canal, ces espèces affectent de façon plus ou moins importante sa qualité biologique, mais une quantification de l’effet sur l’atteinte du « bon potentiel écologique » est encore nécessaire.

Hormis les espèces exotiques envahissantes, plusieurs freins au développement de la vie aquatique sont identifiés dans le Canal : la constante remise en suspension des sédiments et les vagues liées à la navigation. Avec la grande profondeur et le manque (voire l’absence) de végétation, les macro-invertébrés peinent à s’y établir. L’aménagement d’îles flottantes ou de berges végétalisées pourrait y remédier mais il faudrait les déployer à grande échelle pour avoir un réel impact sur la qualité écologique du Canal. Sept radeaux végétalisés d’une surface totale de 224 m2 ont été installés au printemps 2022 à hauteur du Bruxelles Royal Yacht-Club pour un test d’un an.
La Woluwe, une belle progression entre 2016 et 2019

La situation de la Woluwe est positive et elle a évolué favorablement entre 2016 et 2019. Cette amélioration ainsi que l’assez bonne qualité physico-chimique de l’eau se traduisent par un gain de classe pour les macro-invertébrés, qui atteignent ainsi le bon potentiel en 2019. Les macrophytes se maintiennent au « bon potentiel écologique », et ce depuis 2009, grâce une belle végétation submergée et une riche végétation au niveau des berges, notamment des indicateurs de suintement. Le phytobenthos obtient un score légèrement supérieur en 2019 par rapport à 2016 mais demeure en qualité moyenne. Il a pourtant atteint le bon potentiel par le passé (respectivement en 2009-2010 et 2013).
Le principal bémol de la Woluwe est la qualité médiocre du groupe biologique des poissons : ils stagnent à un niveau « médiocre » depuis 2007, en raison de l’absence d’espèces clés comme le brochet ou le rotengle et d’une pauvre diversité spécifique. La campagne de 2019 est d’ailleurs marquée par un recul du nombre d’espèces pêchées (5 seulement) et d’individus. Un point positif toutefois est la présence d’une espèce protégée : la bouvière.
La Woluwe présente en effet un état hydromorphologique dégradé. Un grand nombre d’obstacles transversaux notamment (28 ouvrages dont 23 infranchissables) empêche la libre circulation piscicole (voir le focus sur l’état hydromorphologique).
Le Roodkloosterbeek : une qualité bonne et en amélioration… sauf pour les poissons
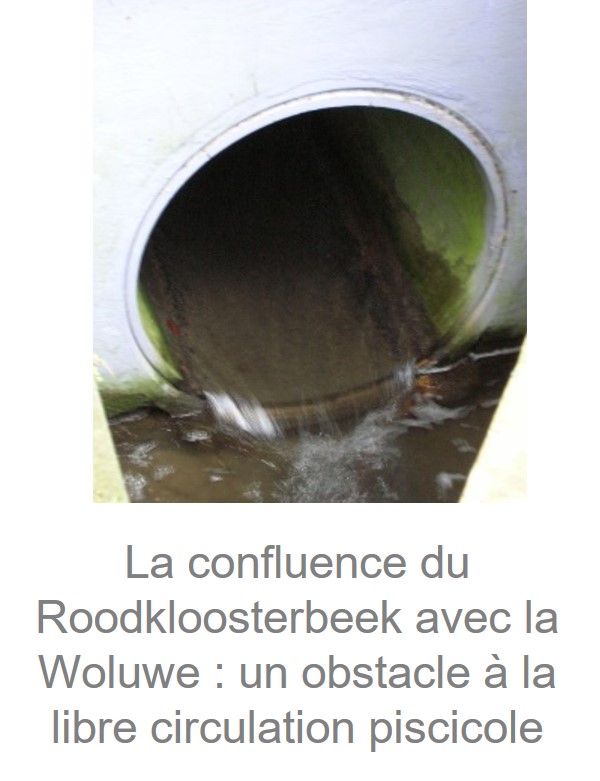 Si on excepte les poissons, la qualité biologique du Roodkloosterbeek est satisfaisante. Certains indices de qualité atteignent même le « bon potentiel écologique » : les macro-invertébrés depuis 2016 et le phytobenthos, qui persiste dans cet état depuis 2009.
Si on excepte les poissons, la qualité biologique du Roodkloosterbeek est satisfaisante. Certains indices de qualité atteignent même le « bon potentiel écologique » : les macro-invertébrés depuis 2016 et le phytobenthos, qui persiste dans cet état depuis 2009.
De plus, une évolution globale positive est constatée. C’est le cas en particulier pour les macrophytes : complètement absents en 2013, ils apparaissent en 2016 et se hissent en qualité moyenne en 2019.
Comme pour la Woluwe, la qualité écologique du Roodkloosterbeek est déclassée par le groupe biologique des poissons qui stagnent en qualité « médiocre ». Le nombre tant d’individus que d’espèces y est encore plus faible que dans la Woluwe (seulement 3 espèces pêchées en 2019, dont la bouvière). Et il souffre toujours de l’absence de certaines espèces clés représentatives d’une bonne santé écologique du milieu.
L’hydromorphologie détériorée du Roodkloosterbeek apparait comme le frein principal au développement des macrophytes et des poissons. Les macrophytes submergés ne peuvent s’y installer en raison d’un ombrage important, d’un tracé rectiligne du cours d’eau et du caractère artificiel de certaines berges. Les poissons manquent d’habitats et des obstacles empêchent leur libre circulation. Une des recommandations des experts est donc d’améliorer la structure du Roodkloosterbeek en recréant des méandres, en restaurant les berges et en supprimant les obstacles à la circulation piscicole.
Deux étangs pourraient presque prétendre au bon potentiel
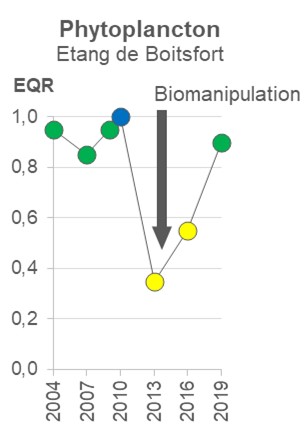 L’étang de Boitsfort et l’étang long du Parc de la Woluwe atteignent le bon potentiel voire le potentiel écologique maximal pour plusieurs éléments de qualité. Et ces bons résultats perdurent depuis plus de 10 ans :
L’étang de Boitsfort et l’étang long du Parc de la Woluwe atteignent le bon potentiel voire le potentiel écologique maximal pour plusieurs éléments de qualité. Et ces bons résultats perdurent depuis plus de 10 ans :
- pour les macrophytes,
- pour les macro-invertébrés
- et dans le cas de l’étang long, pour le phytoplancton.
L’étang de Boitsfort a connu une brusque dégradation en matière de phytoplancton entre 2010 et 2013, chutant du potentiel écologique maximal à une qualité moyenne. Une biomanipulation a donc été entreprise et semble avoir restauré les populations de phytoplancton, à en juger par l’amélioration significative observée en 2016 puis 2019. L’étang accède ainsi de nouveau au bon potentiel en 2019.
Le phytobenthos, évalué depuis deux campagnes seulement dans ces deux étangs, évolue positivement entre 2016 et 2019. L’étang de Boitsfort gagne une classe de qualité et atteint le bon potentiel. L’étang long du parc de la Woluwe demeure en qualité moyenne, mais frôle le bon potentiel.
Bon à savoir
La biomanipulation désigne un ensemble de techniques dont l’une consiste en une mise à sec hivernale (permettant une oxygénation et une minéralisation des boues) et en une suppression partielle ou totale des poissons. Lorsque la végétation submergée parvient à couvrir plus de 30% de la surface de l’étang, des poissons piscivores sont réintroduits. La biomanipulation est une mesure de gestion qui a été utilisée dans plusieurs étangs bruxellois. Si les résultats à court terme se révèlent positifs, ceux à plus long terme restent mitigés. Un suivi régulier des étangs biomanipulés constituerait une condition essentielle à la stabilisation des progrès observés. Autrement dit, il s’agit d’une opération gagnante à condition d’être bien suivie. Pour en savoir plus sur ce procédé et sur ses effets sur les étangs bruxellois, consultez la fiche documentée n°16.
Le grand étang Mellaerts a une moins bonne qualité écologique
Le grand étang Mellaerts, évalué pour la 1ère fois en 2019, présente une qualité inférieure à celle des deux étangs précités : les plantes aquatiques (macrophytes), submergées ou émergées, y sont sporadiques, ce qui offre peu d’habitats pour les macro-invertébrés. L’étang atteint néanmoins le bon potentiel pour un élément de qualité : le phytoplancton.
Mais dans les étangs, comme dans les cours d’eau, les poissons souffrent
Tous les étangs suivis présentent une qualité médiocre à mauvaise vis-à-vis des poissons. Lorsque cet élément est mesuré, il conduit inévitablement à un déclassement de ces masses d’eau. La campagne de 2019 ne fait pas exception. Cependant, dans l’étang du Parc de la Woluwe, la chute de la densité piscicole (10 fois moins élevée en 2019 qu’auparavant) résulte principalement de la biomanipulation de 2017 qui comprenait une intervention sur les populations piscicoles.
La vallée de la Woluwe est relativement préservée des espèces invasives
La principale préoccupation pour la vallée de la Woluwe est l’expansion de l’écrevisse américaine (Faxonius limosus). Cette espèce est bien installée dans le Roodkloosterbeek où elle pourrait influencer négativement, via son régime alimentaire, les macrophytes submergés et les poissons. Elle est également présente dans le grand étang Mellaerts, dont elle pourrait expliquer les mauvais scores au niveau des macrophytes et des macro-invertébrés. Elle ne semble en revanche pas établie dans la Woluwe, où elle n’a été capturée que certaines années, par exemple en 2013.
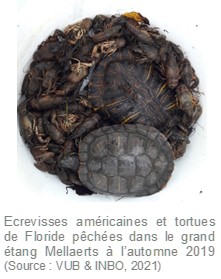 Par ailleurs, l’étang de Boitsfort est infesté par une autre espèce d’écrevisse : l’écrevisse turque (Pontastacus leptodactylus).
Par ailleurs, l’étang de Boitsfort est infesté par une autre espèce d’écrevisse : l’écrevisse turque (Pontastacus leptodactylus).
D’autres espèces invasives sont ponctuellement observées. Des poissons-chats américains (Ameiurus nebulosus) ont été pêchés dans le Roodkloosterbeek en 2016. Signalons aussi qu’un à deux exemplaires de tortue de Floride (Trachemys scripta) ont été attrapés dans chaque étang en 2019.
Les espèces invasives constituent une menace grandissante sur l’état écologique des eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.). Un projet Life Riparias (2021-2026) sur leur gestion en bordure de rivières et dans les étangs vient de débuter. Il cible notamment les écrevisses envahissantes, dont l’écrevisse américaine. L’objectif est d’avoir leur population sous contrôle d’ici la fin du projet.
À télécharger
Fiche(s) méthodologique(s)
Tableau(x) reprenant les données
Fiche(s) documentée(s)
- 4. Normes et valeurs légales de référence en matière d’eau (.pdf)
- 11. Cours d’eau et étangs bruxellois (.pdf)
- 12. Maillage bleu (.pdf)
- 13. Cadre légal bruxellois en matière d’eau (.pdf)
- 16. Qualité biologique des cours d’eau et étangs bruxellois (.pdf)
- Faune et Flore 8. Poissons (.pdf)
Fiche(s) de l’Etat de l’Environnement
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Carte interactive de la qualité biologique des cours d’eau et des étangs
- Carte interactive de l’eau à Bruxelles
Etude(s) et rapport(s)
- VUB & INBO - STIERS I., AYMERE AWOKE A., VAN WICHELEN J., BREINE J., TRIEST L., mars 2021. « De biologische kwaliteit van waterlopen, kanaal en vijvers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2019. Fytoplankton, fytobenthos, macrofyten, macro-invertebraten en vissen ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 111 pp. (seulement en néerlandais)
Plan(s) et programme(s)
Liens utiles
Etat hydromorphologique des cours d’eau Bruxellois
Focus - Actualisation : janvier 2018
L’état hydromorphologique des principaux cours d’eau bruxellois a été inventorié et se révèle sans surprise très dégradé. Le Canal, voie navigable artificielle, est logiquement classé en mauvais état. La Senne sur ses parties à ciel ouvert est dans un état médiocre mais des aménagements de son lit mineur et de ses berges sont envisageables. De plus, bien que la Senne soit voûtée sur les deux tiers de son parcours, deux sites pourraient être remis à ciel ouvert. La Woluwe présente une qualité moyenne. Sa continuité écologique est en effet entravée par un grand nombre d’obstacles, en grande majorité infranchissables. Si ce premier bilan confirme en grande partie ce qu’on savait déjà, il permet néanmoins de mettre en évidence les priorités d’interventions pour ces prochaines années. Or améliorer la qualité hydromorphologique est un préalable indispensable à toute restauration écologique sur le long terme.
Qu’est-ce que l’hydromorphologie d’un cours d’eau ?
La Directive Cadre Eau (ou Directive 2000/60/CE) et l’Ordonnance Cadre Eau qui la transpose au niveau bruxellois fixent un objectif environnemental aux masses d’eau de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) : l’atteinte du « bon état » chimique et écologique. L’évaluation de la composante écologique fait appel à des éléments de qualité biologique, physico-chimique et hydromorphologique.
L’hydromorphologie d’un cours d’eau correspond à la combinaison :
- des caractéristiques et des processus relatifs à la morphologie des cours d’eau (diversité de profondeur et de largeur des rivières, structure du lit et des berges),
- de leur régime hydrologique (dynamique des cours d’eau et notamment leur débit),
- ainsi que de leur continuité écologique.
Plus un cours d’eau connaitra une diversité importante dans ses faciès et ses écoulements, meilleure sera sa qualité hydromorphologique.
Cours d’eau à l’hydromorphologie fortement modifiée à gauche (la Senne voûtée) vs. proche de l’état naturel à droite (La Trie, 2010, Picardie, France)
Source : ©Vivaqua & Duseigne (image du haut), ©EPTB Somme – AMEVA (image du bas)

Un cours d’eau en bonne « santé » hydromorphologique est plus résilient face aux pressions naturelles et/ou anthropiques : il pourra, dans une certaine mesure, absorber certaines perturbations sans que son état n’en soit trop affecté et ainsi assurer sa fonction écologique (on parle de « capacité auto-épuratoire » d’un cours d’eau). Un bon fonctionnement des processus hydromorphologiques permet en effet la mise en place d’habitats diversifiés et de grande qualité, indispensables au bon développement et au maintien de la vie aquatique (Onema, 2010a). De bonnes conditions hydromorphologiques contribuent donc à la qualité biologique des cours d’eau, et in fine, à l’atteinte du « bon état » (Onema, 2010b).
Restaurer la continuité écologique d’un cours d’eau pour améliorer son état hydromorphologique
La restauration de la continuité écologique constitue un des axes important de l’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau (Onema, 2010c). De nombreux ouvrages, qu’ils soient transversaux (ponts, barrages, seuils,…) ou longitudinaux (digues, berges aménagées,…), peuvent fragmenter le réseau hydrographique et entraver le déplacement longitudinal et transversal des espèces vers des zones indispensables à l’accomplissement de leur cycle de vie (alimentation, croissance et reproduction). De plus, la présence de tels ouvrages joue sur le régime hydrologique puisqu’ils modifient la pente ou l’écoulement du cours d’eau, et donc son débit. Il en résulte l’apparition de zones d’eaux stagnantes qui diminuent la qualité physico-chimique du milieu en impactant négativement la température ou la quantité d’oxygène dissous par exemple. Ces eaux stagnantes favorisent également l’accumulation d’éléments nutritifs menant à un enrichissement du milieu - phénomène appelé eutrophisationApport excessif d'éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème. - et donc au final, à la prolifération excessive de certaines espèces (algues et macrophytes principalement).
Enfin, si les ouvrages entravent le déplacement des organismes vivants, ils constituent également un obstacle au flux de sédiments qui restent alors bloqués en amont. Si cette partie du cours d’eau voit sa morphologie modifiée, l’aval peut quant à lui subir un phénomène d’érosion du lit et des berges, entraînant ainsi la disparition d’habitats nécessaires à la vie aquatique.
L’hydromorphologie des cours d’eau bruxellois est fortement dégradée
Dans une région urbanisée comme Bruxelles-Capitale, la qualité hydromorphologique des cours d’eau est fortement dégradée sur de nombreux tronçons. Par le passé, les cours d’eau ont subi de nombreuses modifications, ayant pour but d’endiguer les inondations récurrentes et les risques sanitaires auxquels devaient faire face les Bruxellois (cf. chapitre 2 du plan de gestion de l’eau 2016-2021 - tableau 2.2 reprenant la liste des altérations morphologiques). C’est ainsi que la Senne a été voûtée et nombre de ses affluents asséchés. D’autres cours d’eau ont subi un sort similaire. En parallèle, de nombreux étangs et zones marécageuses ont été asséchés et ont donc disparu du paysage bruxellois (cf. chapitre 2.1.3.3 du plan de gestion de l’eau 2016-2021). Depuis lors, l’urbanisation n’a cessé d’exercer une pression sur le réseau hydrographique : chenalisation, aménagement des berges, mise en place d’ouvrages transversaux tels que barrages, ponts, passerelles, etc.
En raison de ces altérations morphologiques importantes, la Senne et la Woluwe ont été désignées comme masses d’eau fortement modifiées et le Canal comme masse d’eau artificielle.
Vers un inventaire détaillé
Une étude a été réalisée en 2016 par le bureau d’étude Merytherm pour le compte de Bruxelles Environnement, afin de caractériser l’état hydromorphologique du Canal, de la Senne et de la Woluwe, ainsi que des étangs qui y sont connectés. Des tronçons prioritaires sur lesquels concentrer des actions de restauration ont été identifiés, afin d’améliorer l’état hydromorphologique des eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) et d’y rétablir une continuité écologique.
La méthode QUALPHY (évaluation de la qualité du milieu physique des cours d’eau), initialement développée par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse pour des masses d’eaux naturelles, a été appliquée. Cette méthode mesure l’écart entre le cours d’eau étudié et son type géomorphologique - soit l’état morphologique naturel de référence considéré comme non impacté par les activités humaines - pour 40 paramètres qualitatifs et quantitatifs. Les résultats obtenus sont à relativiser puisque les masses d’eaux bruxelloises sont loin des conditions naturelles auxquelles elles sont comparées.
Concrètement, les cours d’eau sont d’abord divisés en tronçons homogènes sur base de leurs caractéristiques naturelles (forme de la vallée…) et anthropiques (présence d’ouvrages d’art…) via des données cartographiques et bibliographiques :
- Le Canal présente une morphologie relativement uniforme. Deux tronçons à ciel ouvert de 500 m de long, considérés comme représentatifs de l’ensemble de la voie navigable, ont été étudiés.
- La Senne a été scindée en 8 tronçons à ciel ouvert d’une longueur totale de 5,1 km.
- La Woluwe a été découpée en 36 tronçons à ciel ouvert d’une longueur totale de 12,8 km, depuis l’étang sec du Vuylbeek, la source de l’affluent le Bocq et la source de l’Empereur.
En ce qui concerne les parties voûtées et les étangs, deux cas se présentent. Lorsque leur longueur est inférieure à 50 m, ils ont été « assimilés » au tronçon à ciel ouvert. Dans le cas contraire (> 50 m), leur étude a été simplifiée et centrée sur l’estimation de leur franchissabilité par les populations piscicoles. La méthode QUALPHY leur attribue systématiquement une qualité mauvaise en raison de l’uniformité du lit mineur, des berges « bloquées » et de l’urbanisation du lit majeur.
Une fiche d’inventaire, associée à chaque tronçon, est complétée sur le terrain par les opérateurs. Pour chacun des 40 paramètres, une cote est attribuée en fonction de laquelle est calculé un indice. L’ensemble de ces indices est ensuite traité via une analyse multicritères, permettant de pondérer les paramètres en fonction de leur importance relative. Un indice de qualité est enfin obtenu pour le tronçon, appelé indice QUALPHY, mais aussi pour chacune de ses composantes, c’est-à-dire le lit mineur1 , les berges et le lit majeur2 . L’indice global d’un cours d’eau est déterminé en sommant les indices de chacun de ses tronçons, pondérés par leurs longueurs respectives.
Schéma des trois composantes d’un cours d’eau : lit mineur, berges et lit majeur
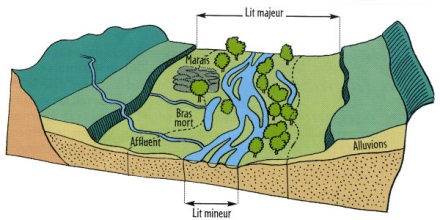
L’indice de qualité est compris entre 0% (totalement artificialisé) et 100% (état naturel, aucune dégradation par rapport à son type géomorphologique de référence). Cinq classes de qualité sont possibles :
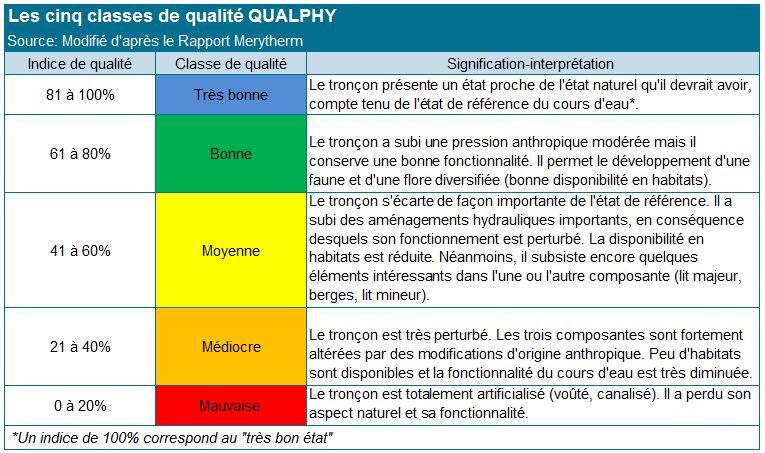
L’évaluation de la franchissabilité des obstacles recensés est basée sur le « protocole de recueil d’informations sur la continuité écologique (ICE) », développé par l’Office français de l’eau et des milieux aquatiques (Onema, 2014). Ce protocole se focalise sur la franchissabilité des obstacles à la montaison, c’est-à-dire à la remontée d’un poisson migrateur vers son lieu de reproduction/développement en amont. Des groupes d’espèces de poissons, présentant des capacités de nage similaires, sont définis pour évaluer leurs chances de franchir un obstacle donné. Cette estimation est basée sur la confrontation entre les caractéristiques (morphologiques, physiologiques et comportementales) du groupe de poissons et les caractéristiques relatives à l’obstacle (type auquel il appartient et ses cotes altimétriques).
Il en résulte un indice ICE, compris entre 0 et 1, déterminant le degré de franchissabilité de l’obstacle pour le groupe d’espèces considéré, où 0 correspond à un ouvrage infranchissable et 1 à un obstacle franchissable à la montaison pour la majorité des individus. Enfin, une classe ICE globale (franchissable, épisodiquement franchissable ou infranchissable) est attribuée à l’ouvrage en combinant les indices ICE des différents groupes de poissons (moyenne qui peut être nuancée sur jugement d’expert).
Un état hydromorphologique très variable d’un cours d’eau à l’autre
L’hydromorphologie du réseau hydrographique bruxellois reflète le contexte urbain dans lequel il s’inscrit. Sans surprise, les masses d’eau de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) de la RBC s’écartent très fort de l’état de référence naturel auquel elles sont comparées avec la méthode QUALPHY.
Indice de qualité hydromorphologique pour les tronçoncs à ciel ouvert (méthode QUALPHY)
Source : Rapport Merytherm, 2016-2017
Note : Moyenne des indices de chaque tronçon, pondérés par leur longueur pour la Senne (8 tronçons) et pour la Woluwe (36 tronçons). Pour le Canal, il s'agit des indices individuels pour chacune des deux placettes étudiées.
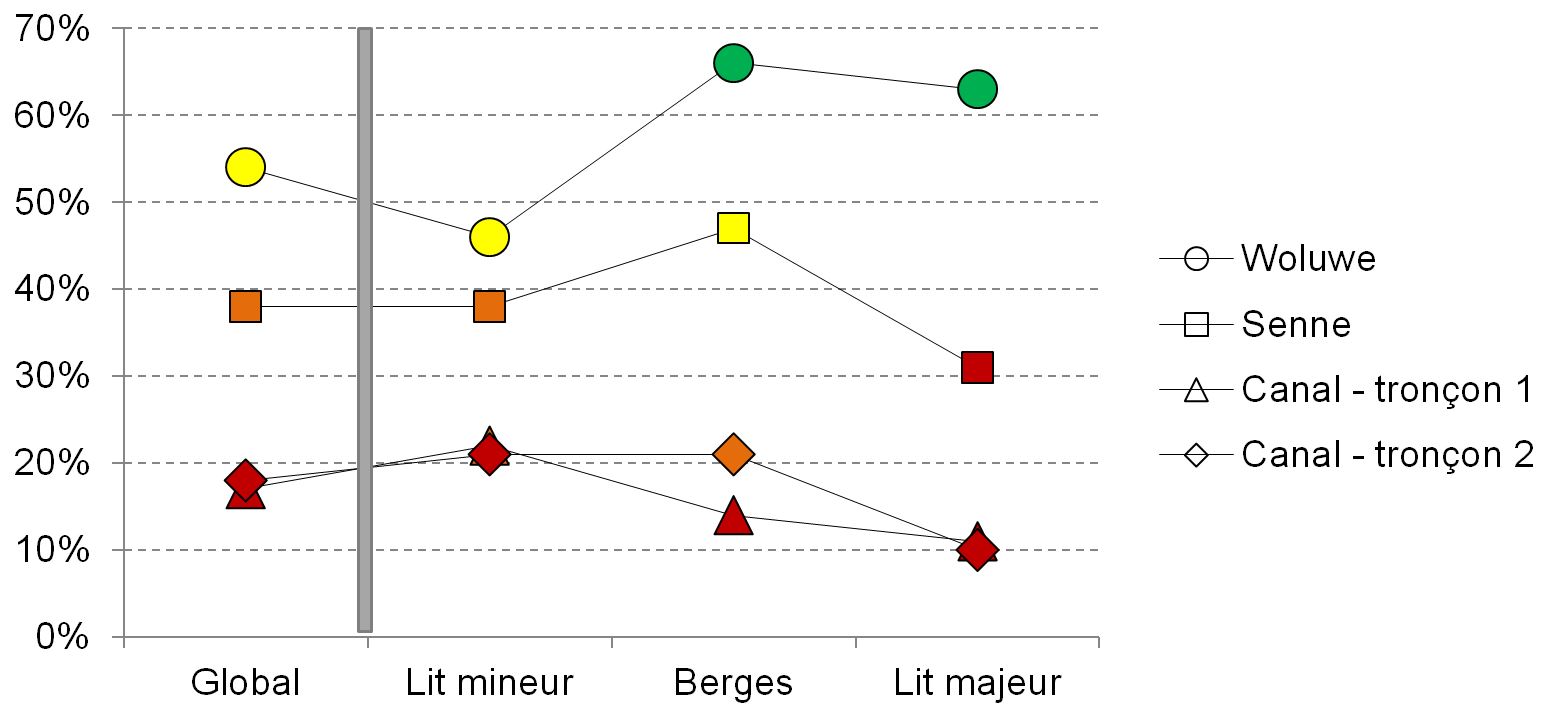
La Woluwe présente une qualité hydromorphologique globale moyenne. L’état de son lit majeur et de ses berges est qualifié de bon alors que celui du lit mineur est moyen. Cette détérioration du cours d’eau s’explique principalement par les aménagements hydrauliques que la Woluwe a subi jusqu’à présent : rectification du lit, présence d’ouvrages tels que seuils ou barrages infranchissables, … Les tronçons voûtés présentent quant à eux une qualité mauvaise.
Si l’état physico-chimique de la Woluwe est bon (voir fiche qualité physico-chimique des eaux de surface), son hydromorphologie dégradée -révélatrice d’un processus d’artificialisation- explique partiellement la mauvaise qualité biologique qui y est observée (voir fiche qualité biologique des principaux cours d’eau et étangs). 28 ouvrages ont été répertoriés sur la Woluwe, la majorité étant des vannes, appelées moines, permettant de réguler le niveau d’eau des étangs qui lui sont connectés. Parmi ces 28 ouvrages, pas moins de 23 sont considérés comme des barrières infranchissables par les poissons (indice global ICE de 0). Sur les 5 ouvrages restant, 3 sont considérés comme épisodiquement franchissables (ICE de 0,33 ou 0,66) et 2 toujours franchissables (ICE de 1). Les obstacles à la migration entravent la continuité écologique du cours d’eau et jouent majoritairement sur les poissons, dont la qualité biologique a été évaluée comme « médiocre ». Restaurer une bonne qualité de cet élément ne peut donc se faire sans améliorer au préalable la qualité hydromorphologique du cours d’eau.
Inventaire de la franchissabilité des ouvrages sur la Woluwe
Source : Rapport Merytherm, 2016-2017
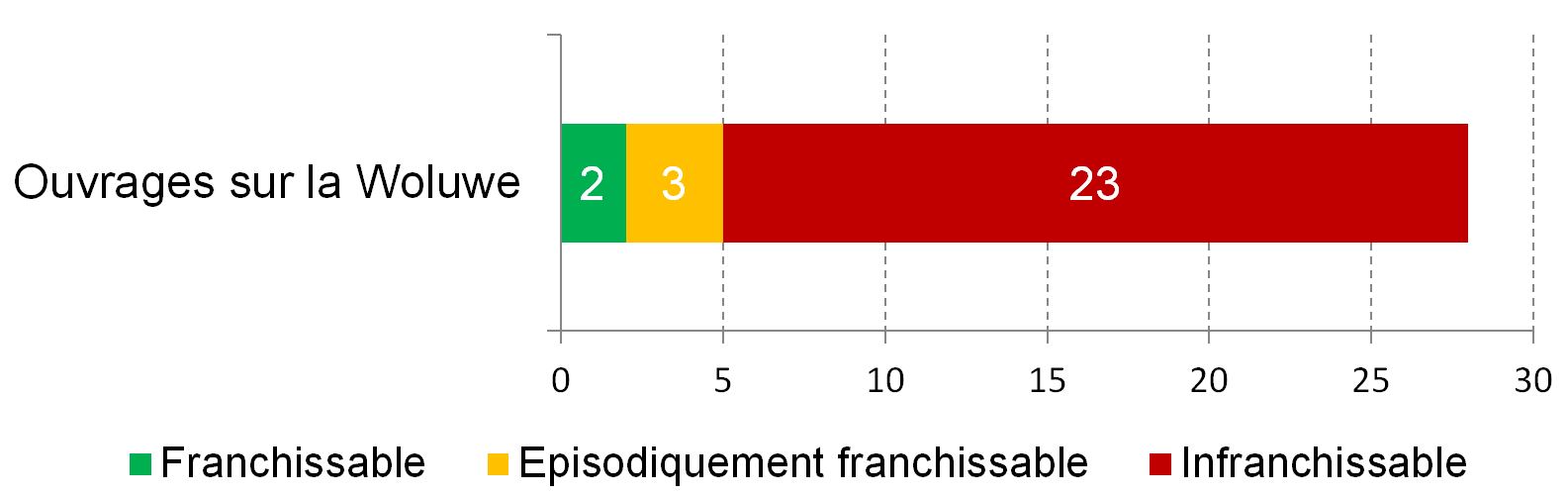
La Senne est voûtée sur les deux tiers de son parcours bruxellois. Ce voûtement résulte en une mauvaise qualité hydromorphologique des tronçons concernés, ce qui influence négativement l’état général de la masse d’eau. Concernant la Senne à ciel ouvert (à Anderlecht, Schaerbeek et Haren), la plupart des méandres ont subi une linéarisation. Les berges fortement urbanisées sont souvent composées de matériaux tels que le béton, des palplanches ou du métal et donc actuellement peu fournies en végétation. Le lit majeur est très impacté car souvent imperméabilisé et très fortement urbanisé. Il en résulte un état global de la Senne qualifié de « médiocre », tout comme l’état du lit mineur et du lit majeur. Seules les berges se trouvent dans un état moyen. Un seul ouvrage a été relevé au niveau de la Senne et a été évalué comme infranchissable par les populations piscicoles ; il s’agit d’une chute d’eau située au début du pertuis du centre-ville.
Dans son ensemble, le Canal présente un état hydromorphologique mauvais. Créé par l’homme pour le transport de marchandises, le Canal est une masse d’eau artificielle. Une évaluation de sa qualité biologique et hydromorphologique n’a donc que très peu de sens. Aucun obstacle à la migration n’a été observé au niveau du Canal puisque les deux écluses sont considérées comme franchissables.
Potentiel d’améliorations et d’aménagements
La Woluwe semble au premier abord le cours d’eau au potentiel d’amélioration le plus important, mais le rapport coûts-bénéfices des travaux à réaliser est élevé. D’importants investissements ont déjà été réalisés dans le passé : des méandres ont été recréés et 400 m de tronçons voûtés ont été remis à ciel ouvert entre le Parc des Sources et le Moulin de Lindekemale. Le décloisonnement de tronçons toujours voûtés permettrait certes d’améliorer l’hydromorphologie mais à un prix élevé au vu des (faibles) bénéfices écologiques qui pourraient en découler. La remise à ciel ouvert de la Woluwe au niveau du bâtiment d’Axa le long du boulevard du Souverain sera néanmoins à l’étude ces prochaines années. Par ailleurs, l’hydromorphologie de la Woluwe pourrait être améliorée en agissant sur les barrières à la migration des poissons (cf. figure ci-dessus) : effacer les ouvrages qui n’ont plus d’utilité, abaisser les seuils ou encore installer des dispositifs de franchissement lorsque tout autre intervention est impossible, sont des pistes en vue de restaurer, au moins partiellement, une certaine continuité écologique longitudinale. En outre, favoriser le développement d’une végétation indigène sur les berges permettrait également de restaurer une continuité transversale.
Si remettre la Senne à ciel ouvert sur l’ensemble de son linéaire vouté est irréaliste, deux sites ont été identifiés comme étant réalistement dévoûtables : un tronçon de 230 m au nord de Bruxelles juste avant la station d’épuration de Bruxelles-Nord, et un autre plus central au niveau du Parc Maximilien. Pour le 1er tronçon, les travaux de dévoûtement sont prévus en 2018-2019, pour le 2ème, une étude de faisabilité va être engagée courant 2018. Ces deux projets bénéficient d’un cofinancement européen via la participation de Bruxelles Environnement au projet LIFE BELINI.
Les possibilités d’aménagements des tronçons à ciel ouvert sont eux limitées étant donné leur urbanisation. Deux chantiers vont toutefois avoir lieu dans le sud de Bruxelles pour créer d’une part une zone d’immersion temporaire connectée à la Senne, et d’autre part pour améliorer la qualité des berges le long du boulevard Paepsem. Ces projets seront mis en œuvre courant 2018 (également cofinancé par le projet LIFE BELINI). Il est en revanche très difficile d’intervenir sur le lit majeur. De manière générale, le lit mineur des masses d’eau bruxelloises constitue souvent l’élément sur lequel il semble le plus facile d’agir afin d’en améliorer la qualité hydromorphologique, et donc aussi biologique (amélioration de la sinuosité du lit ou de son écoulement par exemple, au moyen d’épis).
Comme expliqué plus haut, le Canal est une masse d’eau artificielle. Mis à part quelques aménagements ponctuels des berges qui permettraient d’améliorer localement la qualité biologique, le potentiel d’amélioration au niveau hydromorphologique reste très faible en raison des contraintes associées à la navigation vis-à-vis des berges et du lit mineur. Le lit majeur lui est urbanisé.
À télécharger
Fiche(s) documentée(s)
- 11. Cours d’eau et étangs bruxellois (.pdf)
- 16. Qualité biologique des cours d’eau et étangs bruxellois (.pdf)
- Faune et Flore 8. Poissons (.pdf)
Etude(s) et rapport(s)
- MeryTherm, juin 2016. « Analyse de l’état hydromorphologique de la Senne, du Canal et de la Woluwe en Région de Bruxelles-Capitale et inventaire des obstacles à la migration des poissons » - « Rapport 1 : Revue bibliographique et synthèse des méthodes existantes ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 31 pp. (.pdf)
- MeryTherm, novembre 2016. « Analyse de l’état hydromorphologique de la Senne, du Canal et de la Woluwe en Région de Bruxelles-Capitale et inventaire des obstacles à la migration des poissons » - « Rapport 2 : Développement de la méthode ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 100 pp. (.pdf)
- MeryTherm, avril 2017. « Analyse de l’état hydromorphologique de la Senne, du Canal et de la Woluwe en Région de Bruxelles-Capitale et inventaire des obstacles à la migration des poissons » - « Rapport 3 : Résultats et Analyses ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 135 pp. (.pdf)
- OFB (Office Français de la Biodiversité - anciennement Onema), juillet 2014. « Evaluer le franchissement des obstacles par les poissons - Principes et méthodes ». 203 pp. (.pdf)
- OFB (Office Français de la Biodiversité - anciennement Onema), mai 2010a. « Le recueil d’expériences sur l’hydromorphologie des cours d’eau. Pourquoi restaurer ? » - « L’intérêt et l’importance d’une hydromorphologie non perturbée ». 6 pp. (.pdf)
- OFB (Office Français de la Biodiversité - anciennement Onema), mai 2010b. « Le recueil d’expériences sur l’hydromorphologie des cours d’eau. Pourquoi restaurer ? » - « L’altération de l’hydromorphologie d’un cours d’eau à l’origine de dysfonctionnements ». 6 pp. (.pdf)
- OFB (Office Français de la Biodiversité - anciennement Onema), septembre 2010c. « Pourquoi rétablir la continuité écologique des cours d’eau ? ». 28 pp. (.pdf)
Plan(s) et programme(s)
Liens utiles
Epuration des eaux usées
Indicateur - Actualisation : Octobre 2022
Les deux stations d’épuration bruxelloises ont traité ensemble près de 150 millions de m3 d’eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. en 2021 : un volume rarement égalé. Les quatre cinquième sont traités par la station Nord, le cinquième restant par la station Sud. Les performances épuratoires de la Station Nord sont bonnes malgré un infléchissement depuis 2017. Celles de la Station Sud sont excellentes depuis sa rénovation en 2019 où elle a été équipée d’un traitement tertiaireApplication de procédés supplémentaires de traitement pour réduire les effets de la pollution par des eaux usées ayant subi des traitements primaires et secondaires : traitement physique, traitement chimique, ou traitement biologique supplémentaire. associé à une filtration membranaire. Il est cependant faux de considérer que toutes les eaux usées sont traitées par les stations : les déversoirs d’orage jouent en effet un rôle majeur dans le transfert de polluants vers la Senne et le Canal.
Deux stations pour épurer les eaux usées bruxelloises
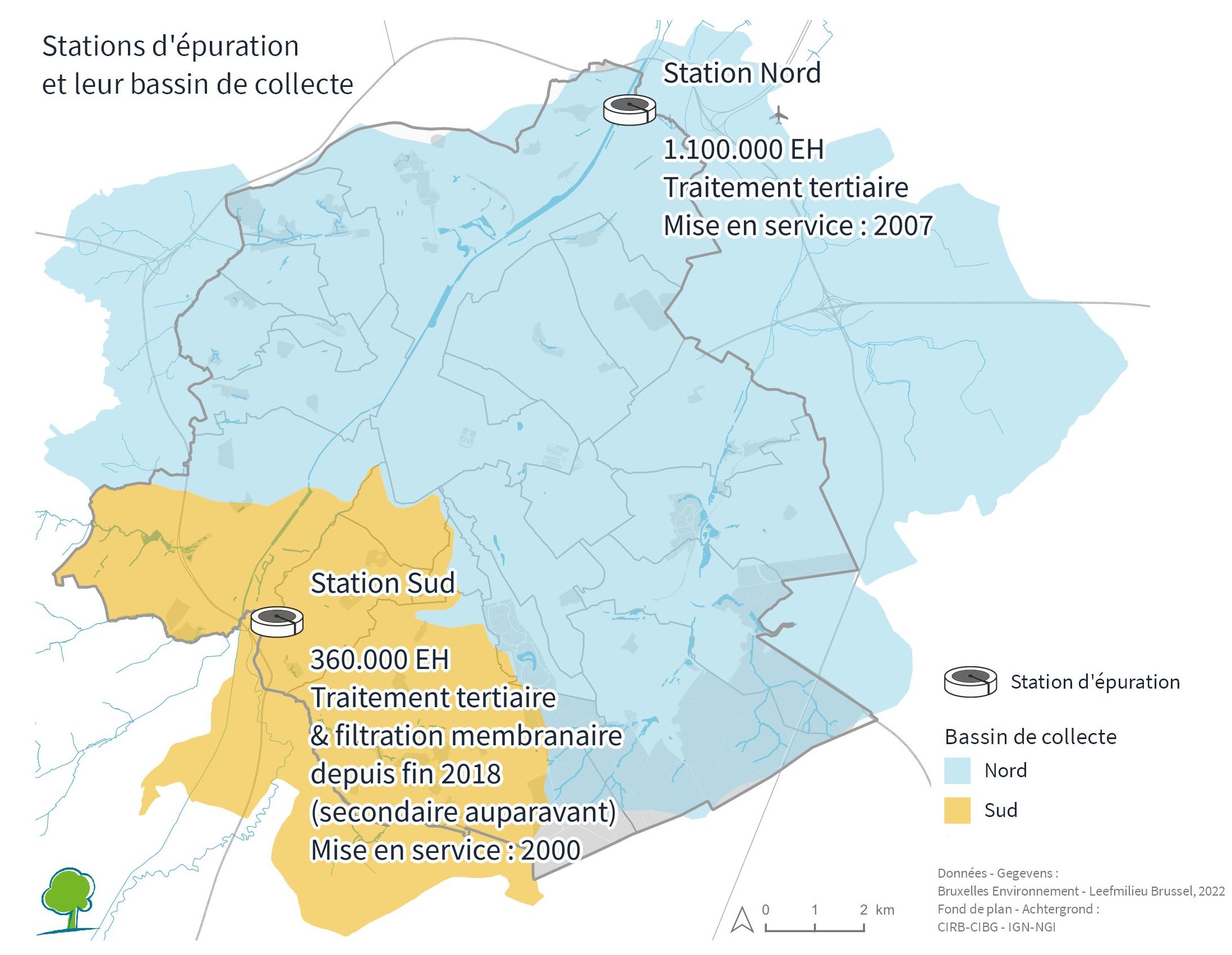
Deux stations d’épuration assurent le traitement des eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. provenant de la Région bruxelloise et d’une partie des communes flamandes périphériques :
- l’une au Nord de la Région, dimensionnée pour traiter 1.100.000 équivalents-habitants (EH), soit les trois quarts. Mise en service en 2007, elle est équipée d’un traitement tertiaireApplication de procédés supplémentaires de traitement pour réduire les effets de la pollution par des eaux usées ayant subi des traitements primaires et secondaires : traitement physique, traitement chimique, ou traitement biologique supplémentaire.. Ce niveau de traitement élimine l’essentiel de la pollution organique (Demande Biologique en Oxygène ou DBO et Demande Chimique en Oxygène ou DCO), particulaire (Matières En Suspension ou MES) et des nutriments (azote N et phosphore P).
- l’autre au Sud, dimensionnée pour traiter 360.000 EH, soit le quart restant. Depuis novembre 2018 et à la suite d’une longue rénovation débutée en février 2014, elle est dotée d’un traitement tertiaire associé à une filtration membranaire : ce procédé permet de retenir d’autres polluants que les cinq « classiques », tels que les microplastiques. Avant sa rénovation et depuis sa mise en service en 2000, la station Sud n’était équipée que d’un traitement secondaire, qui ne permettait donc pas d’éliminer les nutriments. Le phosphore y a cependant été traité dès mai 2011.
Bon à savoir
La Belgique est classée en « zone sensible » aux nutriments (azote et phosphore) sujette à eutrophisationApport excessif d'éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème., en application de la directive sur les eaux résiduaires urbaines. Pour l’agglomération bruxelloise, ce classement signifie que ses eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. doivent, avant leur rejet dans la Senne, être collectées et soumises au minimum à un traitement secondaire.
Des rejets conformes aux objectifs européens depuis 2007… mais une remise à niveau de la station Sud nécessaire
Le sous-bassin de la Senne respecte les prescriptions de la directive sur les eaux résiduaires urbaines depuis 2007, à savoir qu’un taux d’abattement d’au moins 75% en azote total comme en phosphore total est atteint pour l’ensemble du sous-bassin, grâce aux performances de l’ensemble des stations d’épuration de la zone (dont les stations bruxelloises).
Le traitement secondaire réalisé à la station Sud s’est néanmoins révélé insuffisant pour respecter les objectifs environnementaux ambitieux de la directive cadre eau fixés pour la qualité de la Senne en Région bruxelloise. C’est pourquoi une rénovation complète de la station a été entreprise en 2014. Ce vaste chantier s’est achevé en novembre 2018 pour la filière de traitement des eaux et en novembre 2020 pour celle des boues (voir le focus dédié à cette rénovation pour de plus amples détails).
Près de 150 millions de mètres cubes traités en 2021, un record
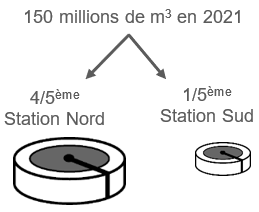 Près de 150 millions de m3 ont transité par les deux stations d’épuration en 2021. C’est un volume jamais égalé et près de 20 millions de m3 de plus que le volume annuel moyen des 4 années précédentes.
Près de 150 millions de m3 ont transité par les deux stations d’épuration en 2021. C’est un volume jamais égalé et près de 20 millions de m3 de plus que le volume annuel moyen des 4 années précédentes.
En cause ? Les pluies particulièrement abondantes de l’année 2021, notamment pendant l’été où elles ont provoqué des inondations dramatiques en Région liégeoise.
L’année 2021 rejoint ainsi les années 2012 et 2016 qui avaient elles aussi connu des précipitations élevées : le volume qui avait transité par les deux stations avoisinait alors les 140 millions de m3.
Bon à savoir
Le réseau d’égouttage est historiquement de type unitaire : il collecte les eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. mais aussi des eaux de ruissellement (eaux pluviales ruisselant vers les égouts) ainsi que des eaux détournées du réseau hydrographique (dont des cours d’eau complets tels que le Maelbeek ou le Molenbeek).
4/5ème des eaux usées sont traitées par la station Nord
Bon à savoir
La station Nord traite classiquement 4/5ème du volume total d’eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. transitant par les deux stations d’épuration bruxelloises ; la station Sud, le cinquième restant.
Le volume admis sur les stations est dirigé en principe vers la filière épuratoire complète (filière biologique). Mais en cas de dépassement d’un certain débit à l’entrée de la station ou lorsque la filière biologique ne fonctionne pas de manière optimale, les eaux sont orientées pour partie vers une filière dont le processus épuratoire n’est que partiel (filière dite de temps pluie).
Volumes traités par la station d’épuration Nord (2007-2021)
Source : Aquiris, rapports d’exploitation mensuels et annuels
La station Nord a ainsi traité 122 millions de m3 en 2021, sachant que 89% de ce volume a transité par la filière épuratoire complète (filière biologique). Et elle avait traité près de 107 millions de m3 en moyenne par an entre 2017 et 2020, avec un taux de 94% pour la filière biologique.
Entre 2007 et 2012, le volume épuré au niveau de la filière biologique a nettement augmenté (+38%). Parmi les facteurs explicatifs de cette croissance figurent la pluviométrie mais aussi le raccordement de nouvelles zones pendant cette période. Depuis 2012, ce volume est assez stable, les fluctuations interannuelles moins marquées, influencées principalement par la pluviométrie.
Volumes traités par la station d’épuration Sud (2007-2021)
Source : Vivaqua puis Hydria, rapports d’exploitation mensuels et annuels
Note : De profonds changements méthodologiques sont intervenus début 2011, rendant les valeurs plus fiables depuis cette date.
La station Sud a traité 27 millions de m3 en 2021, dont 86% sur la filière biologique. Et elle avait traité environ 23 millions m3 par an en moyenne entre 2017 et 2020, dont 95% sur la filière biologique.
Sur le bassin Sud, les travaux sur le réseau des collecteurs se sont achevés récemment. Le collecteurcollecteur, négociant et courtier du Verrewinkelbeek (27.000 EH) a été mis en service sur sa partie aval en 2014 et sur sa partie amont en mars 2019. Quant au collecteur du Geleytsbeek, dernier grand collecteur régional, il a été mis en service en décembre 2020.
Station Nord : des performances en légère baisse depuis 2017
Station d’épuration Nord – Filière biologique : concentrations moyennes annuelles à la sortie et taux d’abattement moyens annuels (2007-2021)
Source : Aquiris, rapports d’exploitation mensuels et annuels
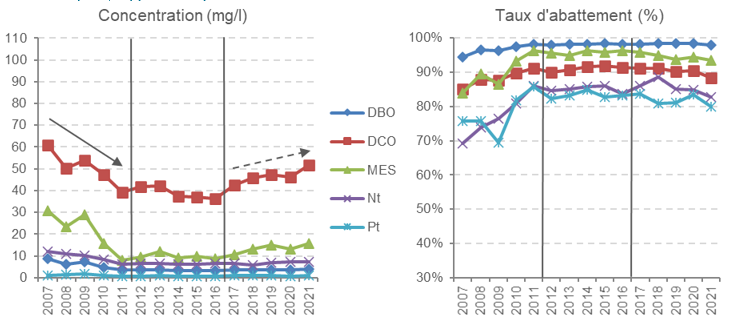
Les performances épuratoires de la station Nord ont nettement progressé entre 2007 et 2011 pour tous les paramètres (tant en concentrations qu’en taux d’abattement de la filière biologique). Les moins bons résultats de 2009 sont imputables à l’arrêt exceptionnel de la station en décembre de cette année-là.
Entre 2012 et 2016, les résultats ont été plutôt stables.
Depuis 2017, les performances de certains paramètres se sont légèrement infléchies : c’est le cas notamment pour la pollution particulaire (MES), la Demande Chimique en Oxygène (DCO) et pour le phosphore (P).
Station Sud : une station rénovée qui tient ses promesses
Station d’épuration Sud - Filière biologique : concentrations moyennes annuelles à la sortie et taux d’abattement moyens annuels (2007-2021)
Source : Vivaqua puis Hydria, rapports d’exploitation mensuels et annuels
Note : Les données sont jugées beaucoup plus fiables et représentatives de la qualité de l’eau à partir de 2011 (voir fiche méthodologique).
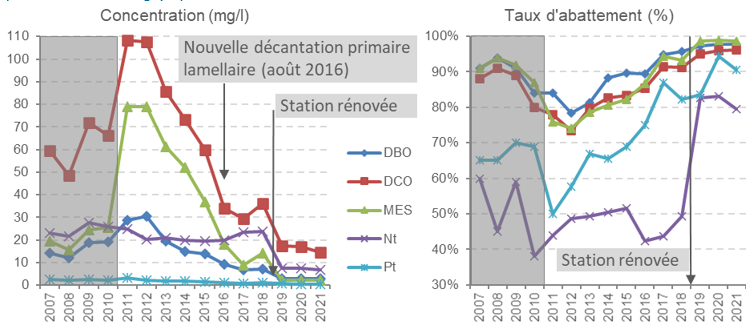
Les performances épuratoires de la Station Sud se sont très significativement améliorées entre 2012 et 2018 lorsque la station n’était encore équipée que d’un traitement secondaire. Précisons néanmoins que les concentrations de départ en 2012 étaient très élevées. Cette évolution positive a concerné la charge organique, les matières en suspension et même le phosphore, ce qui montre que l’ajout de chlorure ferrique a porté ses fruits. Seul l’azote n’a logiquement pas connu d’embellie, le traitement secondaire n’étant pas conçu pour le traiter. Ainsi en 2018, les performances de la filière biologique de la station Sud étaient équivalentes à celles de la station Nord pour plusieurs paramètres (DCO, MES et P).
A partir de 2019, la station Sud est devenue très performante voire exemplaire, grâce à la mise en service du traitement tertiaireApplication de procédés supplémentaires de traitement pour réduire les effets de la pollution par des eaux usées ayant subi des traitements primaires et secondaires : traitement physique, traitement chimique, ou traitement biologique supplémentaire. associé à la filtration membranaire :
- Plus de 95% de la matière organique et 99% des matières en suspension sont éliminées à l’issue du traitement biologique ;
- Quant aux nutriments, les taux d’abattement sont de l’ordre de 80% pour l’azote et 90% pour le phosphore ;
- Les concentrations à la sortie de la filière biologique sont particulièrement basses : 2 ou 3 mg/l pour la DBO et les MES, de l’ordre de 16 mg/l pour la DCO, de 7 mg/l pour l’azote total (N) et moins de 1 mg/l pour le phosphore total (P).
De plus, la station Sud élimine une très grande partie des micropolluants, grâce à son procédé de filtration membranaire.
Traitement des eaux par les stations d’épuration réduit lors des fortes intempéries
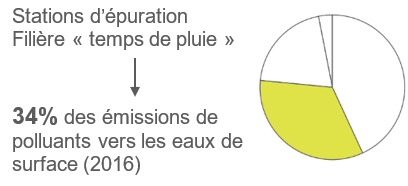 Les eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. de la Région bruxelloise sont aujourd’hui collectées en quasi-totalité. Mais lors de précipitations importantes, une partie des eaux parvenant aux stations d’épuration est aiguillée vers la filière « temps pluie » où le traitement appliqué est moins poussé que sur la filière biologique. Malgré ce traitement partiel, les rejets de la filière temps pluie constituent une source de pollution vers les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) : un tiers des émissions totales de polluants, selon un inventaire de 2010 (et mis à jour en 2016). Pour la Senne, il s’agit d’une voie de contamination majeure, notamment en charge organique, puisqu’elle reçoit les rejets des deux stations d’épuration.
Les eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. de la Région bruxelloise sont aujourd’hui collectées en quasi-totalité. Mais lors de précipitations importantes, une partie des eaux parvenant aux stations d’épuration est aiguillée vers la filière « temps pluie » où le traitement appliqué est moins poussé que sur la filière biologique. Malgré ce traitement partiel, les rejets de la filière temps pluie constituent une source de pollution vers les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) : un tiers des émissions totales de polluants, selon un inventaire de 2010 (et mis à jour en 2016). Pour la Senne, il s’agit d’une voie de contamination majeure, notamment en charge organique, puisqu’elle reçoit les rejets des deux stations d’épuration.
Toutes les eaux usées de la Région bruxelloise sont acheminées vers les stations d’épuration… Toutes ? Non ! Une cohorte d’irréductibles déversoirs d’orage résiste encore et toujours
En effet, lors de ces précipitations, pour éviter une mise sous pression du réseau d’égouttage, une partie des eaux y transitant est délestée vers le réseau hydrographique au niveau de « déversoirs d’orage » : agissant comme des soupapes de sécurité, une centaine d’ouvrages déversent le trop-plein d’eau directement vers la Senne et le Canal (les transferts vers la Woluwe sont rares). Or ces rejets sont très loin d’être négligeables, tant en volume qu’en qualité.
Principe de fonctionnement d’un déversoir d’orage
Source : Bruxelles Environnement, figure extraite du PGE 2016-2021

 Sur les 81 déversoirs susceptibles de polluer les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.), une vingtaine ont été identifiés comme particulièrement problématiques compte tenu des volumes concernés. Le suivi télémétrique de 13 d’entre eux met en évidence un fonctionnement régulier et très fréquent de ceux-ci, bien au-delà de 7 jours avec déversements par an, qui est la ligne directrice en Flandre. Par exemple, le débit moyen rejeté par le Nouveau Maelbeek, l’un des principaux déversoirs vers la Senne, représentait, avant son réaménagement en juin 2020, à lui seul près de 4,8 millions de m3 par an, soit l’équivalent de 4% du volume total admis sur la station Nord.
Sur les 81 déversoirs susceptibles de polluer les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.), une vingtaine ont été identifiés comme particulièrement problématiques compte tenu des volumes concernés. Le suivi télémétrique de 13 d’entre eux met en évidence un fonctionnement régulier et très fréquent de ceux-ci, bien au-delà de 7 jours avec déversements par an, qui est la ligne directrice en Flandre. Par exemple, le débit moyen rejeté par le Nouveau Maelbeek, l’un des principaux déversoirs vers la Senne, représentait, avant son réaménagement en juin 2020, à lui seul près de 4,8 millions de m3 par an, soit l’équivalent de 4% du volume total admis sur la station Nord.
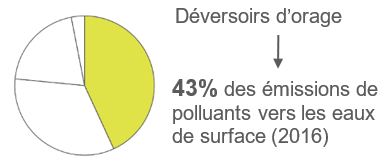 Bien que les eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. déversées soient diluées, elles ne sont pas traitées et constituent une source de pollution majeure de la Senne et du Canal. Les déversoirs constituent même la voie d’accès la plus importante des émissions nettes de polluants vers les eaux de surface : 43% pour l’ensemble des polluants selon un inventaire dressé en 2016. Ces rejets polluants représentent notamment une pression très forte pour la Senne : 66 à 87 chutes d’oxygène par an y ont ainsi été observées entre 2013 et 2016.
Bien que les eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. déversées soient diluées, elles ne sont pas traitées et constituent une source de pollution majeure de la Senne et du Canal. Les déversoirs constituent même la voie d’accès la plus importante des émissions nettes de polluants vers les eaux de surface : 43% pour l’ensemble des polluants selon un inventaire dressé en 2016. Ces rejets polluants représentent notamment une pression très forte pour la Senne : 66 à 87 chutes d’oxygène par an y ont ainsi été observées entre 2013 et 2016.
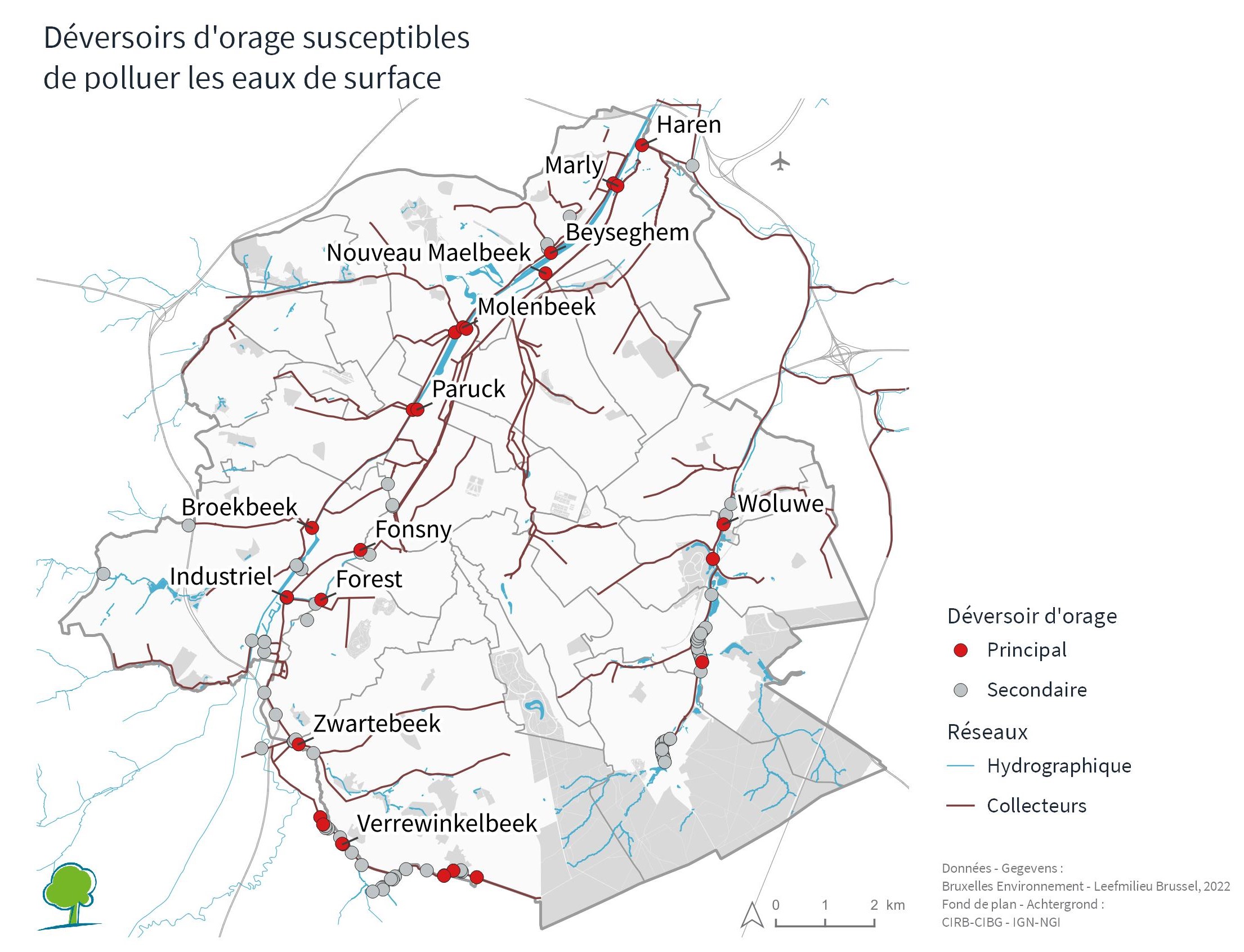
Quelles solutions pour limiter les surverses ?
Pour pouvoir agir sur le nombre de surverses, il est tout d’abord nécessaire de les quantifier en équipant les déversoirs de capteurs. De 2021 à 2023, le réseau de télémesures Flowbru va ainsi être étendu à l’ensemble des déversoirs. Près de 41 déversoirs vont être équipés en priorité.
Pour réduire la fréquence de fonctionnement des déversoirs d’orage au strict nécessaire, plusieurs actions sont entreprises de manière concomitante :
- La première est de s’assurer que le réseau d’égouttage offre une capacité de stockage et une fonction hydraulique optimales par un entretien régulier des égouts et des collecteurs. Cet entretien évite l’accumulation de dépôts et de boues qui obstruent les conduites.
- La seconde est de réaménager les déversoirs et optimiser leur conception et mode de fonctionnement. Ce réaménagement peut s’accompagner de dispositifs destinés à mieux retenir les déchets grossiers, en première ligne les déchets flottants, canettes, plastiques, etc.
 Le seuil du déversoir du Nouveau Maelbeek sur l’émissaire Nord a ainsi été réhaussé en juin 2020, avec à la clé, une diminution de plus de 50% des surverses constatées depuis lors ! Le déversoir du Paruck (2,1 millions de m3 déversés par an avant les premières modifications en 2018) a été équipé d’une vanne automatique en 2022, qui devrait aussi permettre de réduire de moitié les volumes déversés. Tant le Nouveau Maelbeek que le Paruck ont été équipés de barrière aux flottants. L’adaptation d’un troisième déversoir problématique, le Molenbeek (estimé à plus de 2 millions de m3/an), est à l’étude et devait être mise en œuvre en 2024. Les travaux sur ces 3 déversoirs ont été financés avec des fonds européens (Life Belini).
Le seuil du déversoir du Nouveau Maelbeek sur l’émissaire Nord a ainsi été réhaussé en juin 2020, avec à la clé, une diminution de plus de 50% des surverses constatées depuis lors ! Le déversoir du Paruck (2,1 millions de m3 déversés par an avant les premières modifications en 2018) a été équipé d’une vanne automatique en 2022, qui devrait aussi permettre de réduire de moitié les volumes déversés. Tant le Nouveau Maelbeek que le Paruck ont été équipés de barrière aux flottants. L’adaptation d’un troisième déversoir problématique, le Molenbeek (estimé à plus de 2 millions de m3/an), est à l’étude et devait être mise en œuvre en 2024. Les travaux sur ces 3 déversoirs ont été financés avec des fonds européens (Life Belini).
- La troisième est de réguler dynamiquement les débits dans le réseau d’égouttage et les bassins d’orage afin d’exploiter au maximum leurs capacités de stockage. Cette gestion dynamique suppose d’équiper le réseau en capteurs et de recourir à la modélisation pour prédire l’évolution de ces capacités au cours d’un épisode pluvieux. Après les précipitations, les eaux stockées peuvent être renvoyées vers les stations d’épuration où elles bénéficieront d’une épuration complète. Cette gestion dynamique est actuellement à l’étude à titre de projet pilote dans la vallée du Maelbeek.
- Enfin, un autre levier d’action est de diminuer la proportion d’eaux claires « parasites » dans les égouts. L’objectif annoncé dans le plan de gestion de l’eau 2022-2026 est de les réduire de moitié. Deux programmes participent à l’atteinte de cet objectif : la gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP) et le Maillage bleuLe Maillage bleu est un programme mis en œuvre depuis 1999, qui vise plusieurs objectifs : séparer les eaux usées des eaux propres afin de limiter l'apport d'eau aux stations d'épuration, restaurer certains éléments du réseau hydrographique de la Région, réaménager des tronçons de rivières, des étangs et des zones humides pour leur rendre toute leur valeur biologique, et leur faire éventuellement bénéficier de mesures spéciales de protection, et assurer la fonction paysagère et récréative de ces sites. (voir les fiches documentées « Eaux pluviales et inondations », « Cours d’eau et étangs bruxellois » et « Maillage Bleu »). Les eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. entrant dans les stations d’épuration sont alors moins diluées, ce qui augmente le rendement épuratoire.
À télécharger
Fiche(s) méthodologique(s)
- Indicateur : Volume d’eau usée traité par les stations d’épuration (.pdf)
- Indicateur : Concentration des rejets de stations d’épuration (.pdf)
- Indicateur : Taux d’abattement de pollution des stations d’épuration (.pdf)
Tableau(x) reprenant les données
- Volumes traités par les stations d’épuration (.xls)
- Performances épuratoires des stations d’épuration (.xls)
Fiche(s) documentée(s)
- Normes et valeurs légales de référence en matière d’eau (.pdf)
- Eaux pluviales et inondations (.pdf)
- Cours d’eau et étangs bruxellois (.pdf)
- Cadre légal bruxellois en matière d’eau (.pdf)
- Qualité biologique des cours d’eau et étangs bruxellois (.pdf)
Etude(s) et rapport(s)
- VIVAQUA ou HYDRIA, années diverses. « Rapportages mensuels » et « rapports annuels d’exploitation de la station d’épuration de Bruxelles-Sud ». Rapports réalisés pour le compte de Bruxelles Environnement. Diffusion restreinte.
- AQUIRIS, années diverses. « Rapports techniques mensuels » et « rapports techniques annuels de la station d’épuration de Bruxelles Nord ». Rapports réalisés pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale. Diffusion restreinte.
Plan(s) et programme(s)
Liens utiles
Rénovation de la station d'épuration Sud
Focus - Actualisation : février 2020
C’est une station d’épuration de Bruxelles-Sud entièrement rénovée qui fonctionne depuis mars 2019. La technologie employée assure un traitement quaternaire des eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. (élimination de micropolluants et de la microbiologie). Elle permet d’obtenir une eau à la sortie de la station d’excellente qualité. Avec 226.000 m2 de membranes installées, la station Sud est devenue la deuxième plus grande unité de ce type en Europe. Cette rénovation se révèle une opportunité pour l’économie circulaireL'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur. avec une réutilisation des eaux usées et une production d’énergie à partir de la digestion des boues.
Un chantier nécessaire
Les installations, actives depuis 2000, dépolluent un quart de la charge polluanteQuantité de polluants dans un corps. Dans le domaine de l'eau, cette charge polluante, exprimée en équivalent-habitant, sert de base au calcul de la taxe sur le déversement d'eaux usées. émise par l’agglomération bruxelloise (360.000 équivalents-habitants) : elles reçoivent des eaux usées des communes d’Uccle, de Forest, Saint-Gilles, Anderlecht et de 3 communes flamandes. Elles étaient mises à l’index depuis plusieurs années parce qu’elles n’éliminaient pas la pollution azotée et phosphorée (aussi appelé traitement tertiaireApplication de procédés supplémentaires de traitement pour réduire les effets de la pollution par des eaux usées ayant subi des traitements primaires et secondaires : traitement physique, traitement chimique, ou traitement biologique supplémentaire.), alors que la Région bruxelloise est une zone densément urbanisée. Or le bassin de la Senne, dans laquelle les eaux sont rejetées, est classé en « zone sensible » vis-à-vis de ces substances.
La station Sud était, avant sa rénovation, équipée d’un traitement secondaire, qui éliminait l’essentiel de la pollution particulaire, organique et carbonée. Si ce traitement contribuait à respecter les prescriptions de la directive sur les eaux résiduaires urbaines depuis 2007, il s’est néanmoins révélé insuffisant pour respecter les objectifs environnementaux ambitieux de la directive cadre eau fixés pour la qualité de la Senne en Région bruxelloise (voir l’indicateur « Epuration des eaux usées » ). C’est pourquoi une rénovation complète de la station a été inscrite au second plan de gestion de l’eau.
Vaste chantier ! Entamé en 2014, il a été marqué par le remplacement de la filière de traitement des eaux en mars 2019. Et il devrait s’achever en août 2020 avec l’installation d’une filière de digestion des boues (résidus d’épuration). Cette nouvelle unité permettra de réduire de 30% la quantité de boues à évacuer.
Une rénovation sous contraintes
Mais cette rénovation devait intervenir avec deux contraintes de taille. Première contrainte : la nouvelle usine devait occuper les terrains des anciennes installations, sans extension possible, en incluant une unité supplémentaire (traitement des boues). La station d’épuration est en effet bordée par les voies ferrées de la jonction Nord-Midi d’un côté et par des parcelles industrielles privées de l’autre côté. Seconde contrainte : le fonctionnement de la station devait être garanti pendant la durée des travaux.
Parmi les solutions techniques proposées pour la filière eau, c’est la plus compacte et celle offrant de très loin les meilleures performances épuratoires qui a été retenue : la technologie membranaire. Avec 226.000 m2 de membranes installées, la station Sud est devenue la 2de plus grande unité de ce type en Europe, derrière celle d’Achères en Région parisienne. Mais cette technologie a un coût : près de 100 millions d’euros. En outre, elle est énergivore. Pour compenser en partie ce désavantage, 10 à 15% des besoins énergétiques seront couverts par de la production d’électricité verte sur site (par cogénérationLa cogénération est la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ou mécanique. (DIRECTIVE 2012/27/UE) du biogazLe biogaz est le gaz produit par la fermentation de matières organiques animales ou végétales. obtenu par la digestion des boues).
Focus sur la technologie membranaire
La technologie membranaire désigne en réalité une des dernières étapes du traitement des eaux : celle de la clarification, après le traitement biologique. L’eau circule dans des trains de membranes, pourvues de trous invisibles à l’œil nu (diamètre de 0,04 µm), qui séparent l’eau des boues. La forme tubulaire particulière de ces membranes leur confère le surnom de « spaghetti ». Compte tenu de leur très faible diamètre, quantités de polluants sont retenues : non seulement les polluants classiques (matière organique, matières en suspension, azote, phosphore) mais aussi les micro-plastiques ou encore les bactéries, certains virus.
Principe de fonctionnement de la technologie membranaire utilisée à la station d’épuration Sud
Source : ZeeWeed® Membrane Bioreactor technology, ZENON
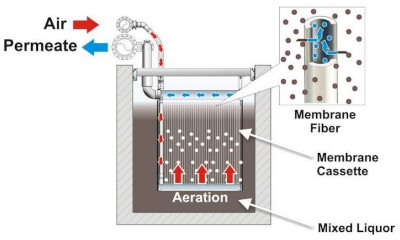
Photo d’éléments de membranes de forme tubulaire (surnommées spaghetti) dans une cassette
Source : SBGE, 2019

Il est fondamental que les membranes ne s’obturent pas. C’est pourquoi elles sont nettoyées de manière intensive : par des rétro-lavages à l’eau toutes les 10 minutes, par des lavages hebdomadaires à l’eau de Javel et à l’acide citrique et par aération (pour éviter les accumulations). Cette dernière opération consomme beaucoup d’énergie et contribue pour beaucoup aux besoins énergétiques de la station.
L’élément limitant des membranes est leur débit. Le débit maximal admissible sur la filière biologique est de 6.500 m3/heure (contre 9.000 m3/h auparavant). Ce débit n’est dépassé que 5% du temps, sachant que le débit moyen par temps sec que reçoit la station se situe aux alentours de 2.000 à 2.500 m3/h. Lorsque la filière biologique est saturée, en cas de pluies abondantes donc, des réactifs sont ajoutés en amont au traitement primaire pour en augmenter le rendement : l’objectif est d’abattre au minimum 70% de la pollution particulaire (matières en suspension).
Les différentes étapes de la filière eau
Mais la filière eau ne se résume pas à cette filtration membranaire. En voici le descriptif :
- Prétraitement : A leur arrivée, les eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. subissent un dégrillage, dessablage et déshuilage. Des grilles (de 40 mm puis 12 mm) retiennent les déchets grossiers puis les eaux sont débarrassées des sables et des huiles.
- Traitement primaire : Après un tamisage (6 mm), les eaux subissent une décantation lamellaire, à concurrence de 18.000 m3/h. Des réactifs chimiques sont rajoutés au-delà d’un certain débit (6.500 m3/h) pour augmenter le taux d’abattement de la pollution particulaire, comme expliqué plus haut. Les eaux transitent ensuite par un « module à masques » qui limite le débit admis sur la filière biologique et par un tamisage plus fin (1 mm), qui évite que des particules plus grosses n’endommagent les membranes en aval.
- Traitement secondaire et tertiaire : Les eaux sont ensuite dirigées dans un bassin d’anoxie (milieu dépourvu d’oxygène, nécessaire aux bactéries pour dénitrifier les eaux). Puis elles transitent par des bassins biologiques (milieu aéré). A l’issue de cette étape, l’essentiel de la pollution carbonée, azotée et phosphorée est traité.
- Traitement quaternaire : Il s’agit du dispositif d’ultrafiltration membranaire détaillé ci-dessus. Les eaux sont dispatchées dans 140 cassettes (trains de membranes), comportant chacune 48 modules. 10 cassettes additionnelles (actuellement vacantes) ont été prévues.
Schéma de la station d’épuration Sud rénovée
Source : SBGE, 2019
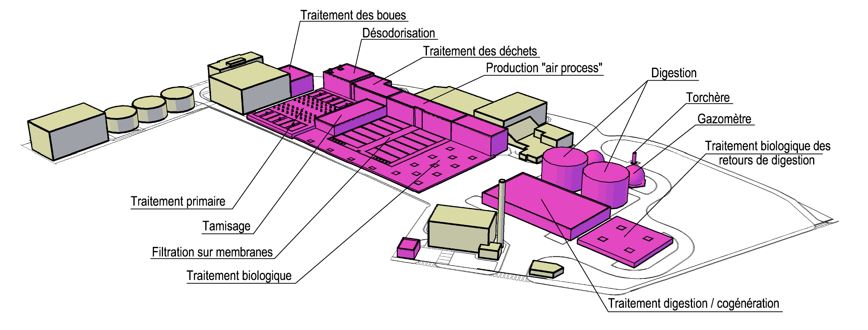
Une réutilisation de l’eau usée
Selon des analyses conduites fin 2019, l’eau épurée répondrait aux critères de qualité d’une eau de baignade. Une partie des eaux est recyclée sur site. Mais une réutilisation par des entreprises voisines du site est aussi planifiée. Selon le règlement européen relatif aux eaux de « re-use », les risques pour la santé et l’environnement doivent être évalués en fonction de chaque destinataire.
À télécharger
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Visite des installations, 3 décembre 2019. Document interne.
Etude(s) et rapport(s)
- HYDRIA, 2018. Rapport d’activités. « STEP Sud : La fin d’un chantier d’une incroyable complexité ». 36 pp. p.14-15. Diffusion restreinte
- HYDRIA, mars 2019. Présentation pour la Journée des Mandataires. 18 pp. Diffusion restreinte.
- EAU MAGAZINE, novembre 2018. « Bruxelles Sud : une station d’épuration à la pointe ». n°32. p.53-54.
- BECI, 12 juin 2018. « Epuration des eaux usées : des défis et d’énormes opportunités ». s'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Plan(s) et programme(s)
Liens utiles
Emissions de polluants vers les eaux de surface
Focus - Actualisation : décembre 2015
L’« inventaire des émissions » 2010 de la Région bruxelloise permet de connaître les émissions de 86 polluants vers la Senne, le Canal et la Woluwe à l’échelle du territoire régional en fonction de leur origine. Retraçant pas à pas la route de chaque polluant depuis sa source jusqu’à son arrivée dans le réseau hydrographique, cet inventaire constitue un puissant outil d’aide à la gestion. S’il a confirmé l’influence majeure de la population, des industries et entreprises sur la qualité de l’eau, il a également démontré la contribution élevée des apports diffus pour certaines substances et le rôle prépondérant joué par les déversoirs d’orage dans l’apport de polluants vers la Senne et le Canal.
Les émissions de 86 polluants quantifiés vers la Senne, le Canal et la Woluwe
La Région bruxelloise s’est dotée d’un outil performant permettant de quantifier de manière précise sur l’ensemble du territoire les différentes pollutions ponctuelles ou diffuses vers les cours d’eau et le Canal : un « inventaire des émissions ». Cet outil répond à l’obligation européenne de dresser ce type d’inventaire pour les 33+8 substances européennes prioritaires et prioritaires dangereuses (cf. article 5 de la directive 2008/105/CE et voir « qualité chimique des eaux de surface ») mais il va au-delà, puisque 45 autres substances pertinentes pour la Région bruxelloise ont également été prises en compte.
Cet outil quantifie les émissions « brutes » de polluants à la source, tant ponctuelles que diffuses (par exemple les émissions en azote et phosphore par la population au niveau des habitations en fonction des personnes qui y sont domiciliées). Puis il modélise les cheminements, flux ou transits de ces polluants (ruissellement, égouttage, stations d’épuration,…) depuis leur source jusqu’au réseau hydrographique. Et il fournit in fine les émissions « nettes » de polluants vers les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.), c’est-à-dire la part des émissions brutes qui atteignent effectivement le cours d’eau et qui vont y influencer les concentrations de polluants dans la colonne d’eau, les boues ou encore le biote.
Concrètement, l’inventaire bruxellois se concentre sur les émissions de 86 polluants vers les trois principaux cours d’eau (la Senne, le Canal et la Woluwe) depuis 20 sources (e.a. eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. des particuliers, des industries et des entreprises, corrosion des bâtiments, pollution liée au trafic routier, ferroviaire ou fluvial, emploi de pesticides et de fertilisants, relargage de polluants stockés dans les boues des cours d’eau, dépôt atmosphérique).
La force de l’outil est de géolocaliser chacune de ces étapes : les émissions (brutes) sont en effet calculées par mailles de 50m x 50m. Il est ainsi possible de caractériser les émissions de chaque polluant en tout point du territoire de la région. Cette « explicitation géographique » (ou spatialisation) de l’estimation des émissions est assez unique en son genre et a une potentialité énorme car elle permet de valider par la suite ces estimations en les comparant avec les mesures sur le terrain.
Une méthodologie distincte pour les émissions ponctuelles et diffuses
L’inventaire a été établi pour l’année de référence 2010 par le Vlaamse Instelling voor Technologische Onderzoek (VITO) pour le compte de Bruxelles Environnement. La méthodologie s’est basée sur le système WEISS (Water Emissions Inventory Support System), qui a été développé conjointement par le VITO et la VMM lors d’un projet européen Life+.
La méthode d’estimation des émissions brutes diffère suivant leur origine (ponctuelle ou diffuse) :
- Pour les émissions ponctuelles, comme des rejets directs dans les eaux de surface, les données de localisation du point de rejet et des charges annuelles rejetées par polluant (concentration x débit/volume) - mesurées ou estimées – seront directement encodées dans l’outil.
- Pour les émissions diffuses, qui ne peuvent par définition être caractérisées par un point unique de rejet, l’outil WEISS estime les émissions sur base d’une variable explicative (par exemple : le nombre d’habitations, le nombre de kilomètres de voies ferrées…) et d’un facteur d’émission issu de la littérature scientifique (par exemple : x grammes d’azote par habitant par an, x grammes d’huiles minérales par aiguillage sur une voie ferrée).
Ainsi, toutes les sources et polluants considérés sont soit calculés sur base de mesures sur le terrain, soit estimés à partir d’informations d’occupation du territoire.
Une validation des résultats du modèle
Les calculs et estimations en sortie de modèle sont comparés aux concentrations mesurées dans les eaux de surface et dans les eaux usées à l’entrée des stations d’épuration pour quantifier la marge d’erreurs ou charges non expliquées. Ceci permet une analyse critique des résultats obtenus.
Quelques limites méthodologiques et voies d’amélioration
Bien que l’outil soit très complet, il comporte certaines limites :
- Les échanges entres eaux souterraines polluées vers les eaux de surface ne sont pas encore pris en compte ;
- Les sources de matières en suspension et de sels/conductivité ne sont pas encore pleinement intégrées dans l’outil ;
- Pour certains paramètres et/ou sources, peu de facteurs d’émissions sont actuellement disponibles. L’outil ne sait alors pas donner une image complète des principales sources ;
- Des incertitudes propres aux différentes hypothèses dans le cadre de l’estimation de certaines sources, cheminements et/ou rejets.
Sur ce dernier point, des études spécifiques sont prévues dans les prochaines années afin d’affiner et de valider différentes estimations (parmi lesquelles : les charges transportées par les eaux de ruissellement, les facteurs d’émissions des voiries et voies ferrées, les charges entrantes au niveau des stations d’épuration via des campagnes de mesures spécifiques, etc.).
Illustration d’une sortie du modèle pour la demande biologique en oxygène (DBO)
Une des sorties de l’outil WEISS est un diagramme des charges quantifiées de polluant en chaque étape de son parcours (à l’échelle de la Région bruxelloise) jusque vers les eaux de surface (voir un exemple ci-dessous).
Schéma des flux de charges polluantes en Demande Biologique en Oxygène (DBO) à l’échelle de la Région de Bruxelles-Capitale (en tonnes pour l’année 2010)
Source : Bruxelles Environnement, extrait de l’inventaire des émissions vers les eaux de surface (VITO)
Les émissions brutes figurent dans l’encadré bleu en haut (« gross emission »), les émissions nettes dans l’encadré bleu en bas (« surface waters »), les cheminements dans les encadrés blancs et les pertes dans les encadrés rouges.
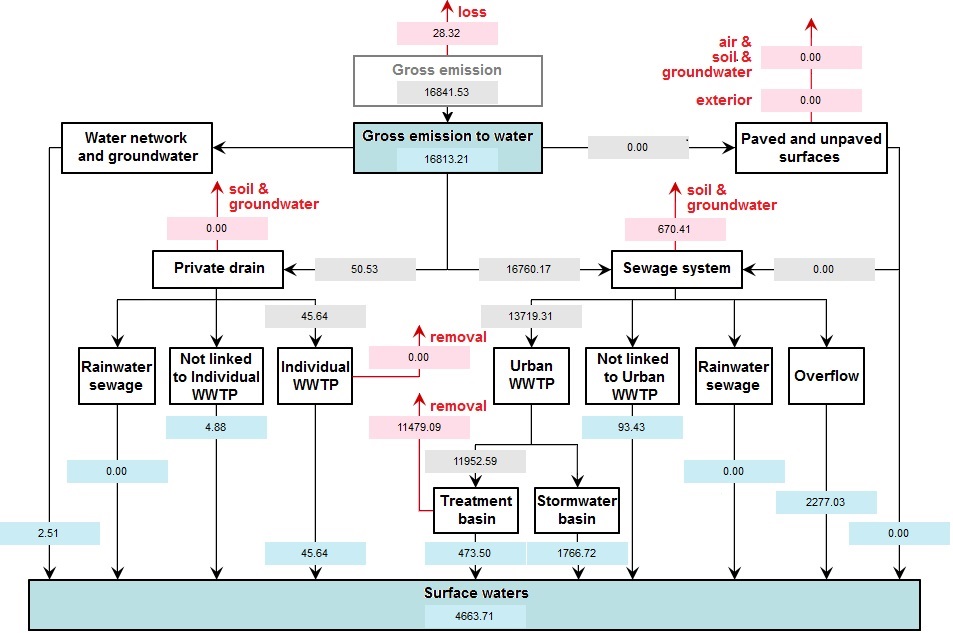
Ce schéma permet de déterminer la fraction des émissions nettes dans les émissions brutes et la charge annuelle émise vers les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.). Dans l’exemple de la DBO, les émissions brutes sur l’ensemble du territoire de la Région s’élèvent à presque 17.000 tonnes et les émissions nettes vers les eaux de surface en représentent un peu plus du quart (28%), soit quasiment 5.000 tonnes.
Une autre information intéressante qui ressort de ce schéma est la localisation des principales « pertes ». On constate ainsi que près de 70% de la charge polluanteQuantité de polluants dans un corps. Dans le domaine de l'eau, cette charge polluante, exprimée en équivalent-habitant, sert de base au calcul de la taxe sur le déversement d'eaux usées. en DBO est retenue au niveau de la filière temps sec des stations d’épuration (« treatment basin ») : autrement dit, l’épuration réalisée au niveau des stations permet d’abattre 70% de la DBO émise.
Autre analyse à extraire de ce schéma : les voies préférentielles de transit des polluants (ou à l’inverse, celles qui ne sont que peu ou pas utilisées). Toujours dans le cas de la DBO, on constate que près de 50% des émissions nettes qui atteignent les cours d’eau y sont acheminées par le biais des déversoirs d’orage (« overflow ») et 38% par les filières temps pluie des stations d’épuration (« stormwater basin ») : c’est donc là qu’on doit agir en priorité pour diminuer les émissions. En revanche, les zones non raccordées aux stations d’épuration ne contribuent finalement que très faiblement aux émissions pour ce paramètre (2% seulement).
Exposition des cours d’eau aux pollutions
Sans surprise, la Senne reçoit de façon générale – même si cela varie en fonction du paramètre considéré – la grande majorité des émissions nettes de polluants. Elle est en effet le milieu récepteur des effluents des deux stations d’épuration régionales et subit les rejets de nombreux déversoirs d’orage tout au long de son parcours bruxellois. Le corollaire à ce constat est que c’est sur ce cours d’eau que les impacts dus à la pollution sont donc les plus grands (voir « qualité physico-chimique des eaux de surface » et « qualité chimique des eaux de surface »).
A l’opposé, la Woluwe est peu affectée par les pollutions : elle bénéficie de la protection offerte par la forêt de Soignes sur son cours amont et de déversoirs d’orage qui, bien que présents, fonctionnent rarement dans la pratique. Et le Canal occupe une position intermédiaire : sa qualité est détériorée par certains polluants, mais dans une bien moindre mesure que la Senne.
Pollutions en charge organique, en matières en suspension et en nutriments
Pour les 5 substances épurables par les stations d’épuration, la Senne reçoit ainsi en moyenne près de 80% des émissions nettes, le Canal un peu moins de 18% et la Woluwe 2% (voir aussi « qualité physico-chimique des eaux de surface »).
Répartition relative des émissions nettes annuelles en demande biologique en oxygène (DBO), demande chimique en oxygène (DCO), matières en suspension (MES), azote total (Nt) et phosphore total (Pt) selon le cours d’eau
Source : Bruxelles Environnement, extrait de l’inventaire des émissions vers les eaux de surface (VITO), chiffres pour l’année 2010
Note : Les sources de MES ne sont pas encore entièrement intégrées à l’outil.
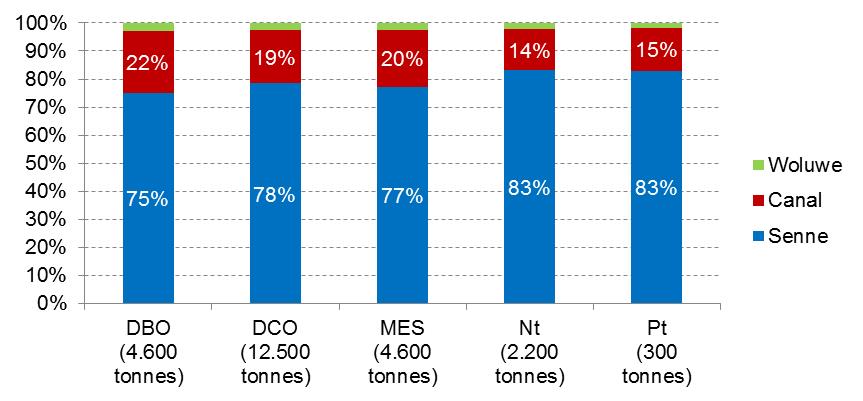
Concernant la répartition relative par secteur, il est évident que la population contribue le plus fortement à la pollution (entre 71% et 88% selon le paramètre considéré) et les entreprises pour le pourcentage restant. La contribution de l’agriculture au sein même de la RBC est négligeable.
Comme indiqué précédemment et en toute logique, la filière temps sec des deux stations d’épuration permet d’abattre une part très importante des émissions brutes de ces 5 substances. Le taux d’abattement moyen de la charge organique (exprimée en DBO et DCO) s’élève ainsi à 92%. Quant aux émissions nettes, elles atteignent les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) essentiellement par les déversoirs d’orage, la filière temps pluie des stations et dans une moindre mesure, la filière temps sec.
Autres pollutions
C’est encore et toujours la Senne qui reçoit les quantités nettes d’émissions les plus élevées, comparé au Canal et à la Woluwe. Parmi les principales substances problématiques identifiées en Région bruxelloise (HAP, zinc, plomb, nickel, cadmium et huiles minérales), la Senne reçoit près de 70% des émissions nettes de HAP et plus de 80% des émissions des autres polluants.
Répartition relative des émissions nettes annuelles en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), en certains métaux et en huiles minérales selon le cours d’eau
Source : Bruxelles Environnement, extrait de l’inventaire des émissions vers les eaux de surface (VITO), chiffres pour l’année 2010
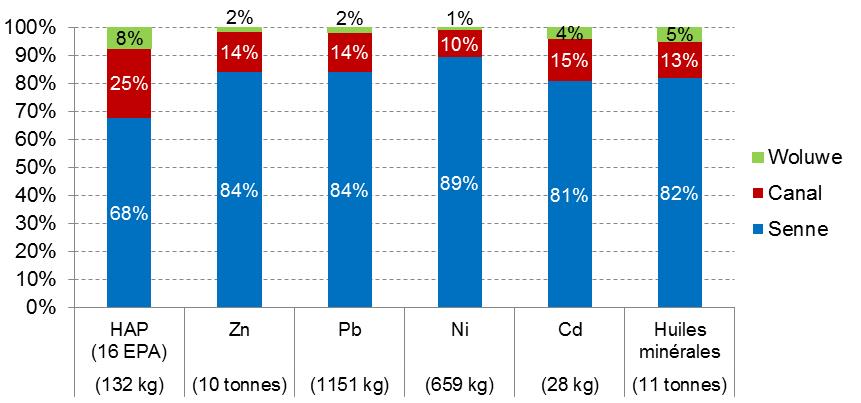
Pour la Senne, les cinq principales sources de pressions sont les eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. domestiques et des entreprises mais aussi les apports diffus liés au bâti, au trafic et au dépôt atmosphérique. Dans le cas du Canal, la navigation est une source de pression additionnelle. Quant à la Woluwe, elle est surtout affectée par une pollution diffuseOn dit d'une pollution qu'elle est diffuse lorsque les polluants sont présents de manière dispersée (et non pas concentrée). en HAP.
La prépondérance des sources de pressions varient suivant le paramètre considéré (voir « qualité chimique des eaux de surface »). Les pollutions diffuses représentent souvent une part significativement plus importante des émissions de ces polluants comparé à la matière organique, aux matières en suspension et aux nutriments (par exemple, 65% des émissions nettes en zinc et 28% de celles en plomb résultent de la corrosion des matériaux de construction). Dans le cas des huiles minérales, il s’agit même de la source quasi exclusive (trafic routier et ferroviaire).
Pour les substances qui sont bien épurées ou retenues par les stations d’épuration, comme par exemple les HAP, la voie d’accès la plus importante des émissions nettes vers les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) se situe au niveau des déversoirs d’orage (35% dans le cas des HAP). Sur le Canal, les rejets directs liés à la navigation fluviale peuvent contribuer pour une part significative.
Pour plus d’informations sur l’inventaire des émissions, le lecteur est invité à se référer au chapitre 2 du projet de second plan de gestion de l’eau et à l’étude du VITO.
À télécharger
Etude(s) et rapport(s)
- VITO, décembre 2013. «Inventarisatie van de emissies naar water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest» Post 1: voorstudie. Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 78 pp. (seulement en néerlandais)
- VITO, juin 2014. «Inventarisatie van de emissies naar water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest» Post 2: analyserapport en factsheets. Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 346 pp. (seulement en néerlandais)
- VITO, janvier 2014. «Technische nota – Transport naar het oppervlaktewater binnen WEISS voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 32 pp. (seulement en néerlandais)
Plan(s) et programme(s)
Cartographie relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondations
Focus - Actualisation : février 2020
La carte des zones inondables de la Région bruxelloise, mise à jour en 2019, représente l’étendue des inondations pour trois types d’aléas (faible, moyen, élevé). 21% de la superficie régionale se situe en zone inondable. L’évaluation des risques d’inondations indique que les inondations pluviales et celles dues au refoulement des égouts concerneraient près d’un habitant sur trois. Si la plupart réside en zone d’aléa faible, 8% de la population habite néanmoins en zone d’aléa moyen et 2% en zone d’aléa fort. Les inondations fluviales ont un impact négligeable.
Le réseau d’égouttage et le ruissellement, principales causes d’inondation
Trois phénomènes sont potentiellement à l’origine d’inondations en Région bruxelloise :
- Le débordement de cours d’eau (inondations « fluviales ») : les cours d’eau ou le Canal sortent de leur lit ;
- Le ruissellement d’eaux de pluie en cas de fortes précipitations (inondations « pluviales »), sur des surfaces imperméables ou sur des sols dont la capacité d’infiltration est excédée ;
- Le refoulement du réseau d’égouts, également en cas de fortes pluies : les égouts saturés ne peuvent plus évacuer les eaux, qui refoulent en voirie ou dans les caves.
La Région bruxelloise est peu (ou pas) exposée au risque d’inondations fluviales : 0,1% de la population bruxelloise selon la modélisation de 2019 . Lorsqu’elles se produisent, les inondations fluviales accompagnent généralement d’autres types d’inondations.
Les inondations généralement observées sont celles liées au ruissellement et au refoulement du réseau d’égouttage (essentiellement dans les caves). Elles se produisent habituellement pour des précipitations intenses et de courte durée liées à des orages au printemps ou en été, au vu du relevé historique des inondations . Rappelons à ce propos que le réseau d’égouttage est majoritairement unitaire : il évacue non seulement les eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. mais également les eaux de ruissellement. Or celles-ci représenteraient en moyenne la moitié des eaux collectées, selon des estimations des gestionnaires du réseau et des stations d’épuration. Elles peuvent temporairement décupler le débit circulant dans les collecteurs. On comprend donc aisément qu’une augmentation notable des eaux de ruissellement en cas de pluies importantes se traduise par des inondations. Et en milieu urbain, cette augmentation concerne tant leur volume (compte tenu du fort taux d’imperméabilisation des surfaces ruisselées) que leur vitesse d’écoulement (accélérée en raison de l’imperméabilisation et de l’artificialisation des milieux).
La carte des zones (potentiellement) inondables
La carte des zones inondables de la Région bruxelloise, aussi appelée « carte des aléas d’inondation », a été produite pour la première fois en 2013 et mise à jour en 2019. Très peu de changements sont observés entre ces deux versions.
Les zones potentiellement inondables ont été cartographiées pour trois scénarios ou aléas :
- Un scénario extrême, ayant peu de chances de survenir (d’aléa faible donc), associé à une inondation présentant une période de retour de 100 ans (c’est-à-dire ayant une probabilité de survenir en moyenne une fois par siècle, ou autrement dit n’ayant qu’1% de chance de se produire dans l’année).
- Un scénario occasionnel, d’aléa moyen associé à une inondation présentant une période de retour comprise entre 25 et 50 ans.
- Un scénario fréquent, d’aléa élevé, associé à une inondation de fréquence décennale (période de retour de 10 ans, ayant 10% de chance de se produire dans l’année).
En zone inondable, il existe un risque d’inondation, dont l’occurrence et a fortiori les conséquences sont corrélées à l’intensité de l’aléa : le risque est d’autant plus fort que l’aléa est élevé. Toutefois, le risque d’inondation n’est pas exclu dans les autres zones : en effet, des évènements imprévisibles (tels qu’un avaloir bouché, une rupture de canalisation, etc.) peuvent engendrer des inondations localement.
Pour délimiter les zones inondables (aléa pluvial), quatre facteurs de prédisposition aux inondations ont été cartographiés et combinés : un premier considérant l’altitude relative par rapport aux fonds de vallées, un second, l’« humidité topographique » (indice qui lie topographie et processus hydrologiques), un troisième, la surface urbaine drainée (qui intègre le degré d’imperméabilisation des sols) et un quatrième, le sol. Le résultat obtenu a été croisé avec les dossiers d’inondation déclarés au Fonds des Calamités (1992-2007) : ces derniers renseignent en effet sur l’intensité de l’inondation. Le périmètre des zones d’aléas a ensuite été défini. La carte d’aléa produite a ensuite fait l’objet d’une double validation : par la comparaison avec d’autres jeux de données (SIAMU, Vivaqua) sur les inondations qui se sont produites entre 1992 et 2019 puis par des ajustements d’experts. Certains post-traitements ont également été appliqués, prenant en compte les remarques des services communaux ayant une bonne connaissance de leur territoire. Précisons en outre que la protection offerte par des ouvrages collectifs (bassins d’orage et digues de protection) a été intégrée et a pu conduire à abaisser l’intensité d’aléa aux endroits concernés. Pour des informations détaillées sur la méthode d’élaboration de la carte, le lecteur est invité à consulter la fiche méthodologique se rapportant à cette carte .
Cartographie de l’aléa d’inondation
Source : Bruxelles Environnement, version 2019 (carte précise au 10.000ème)
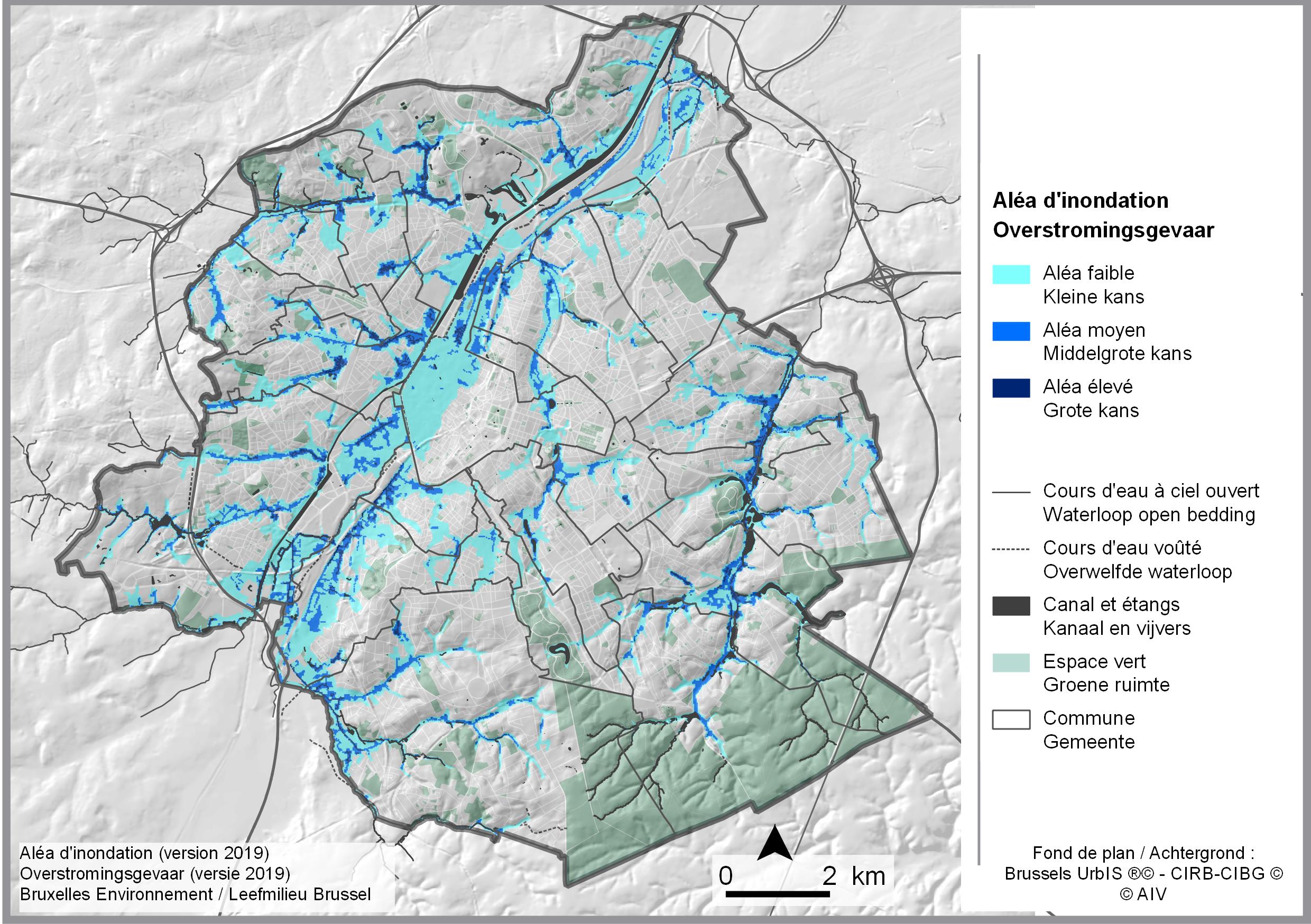
La plaine alluviale de la Senne concentre la majorité de la surface classée en zone potentiellement inondable
A la lecture de cette carte, un premier constat frappe : les zones potentiellement inondables semblent directement corrélées à la présence du réseau hydrographique, actuel ou même historique (comme dans la vallée du Maelbeek). Et ce, bien que la première cause d’inondation ne soit pas les débordements de cours d’eau. Cependant, ce constat n’est pas étonnant dans la mesure où les fonds de vallée sont des axes préférentiels d’écoulements et de convergence des eaux de ruissellement ainsi que le lieu d’implantation de nombreux collecteurs d’eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances..
En outre, logiquement, le relief influe directement sur l’étendue de la zone potentiellement inondable. Un fond de vallée relativement plat se caractérise en général par une vaste zone submersible : c’est ce qu’on observe typiquement pour la plaine alluviale de la Senne (la plus large du territoire) ou pour celle du Linkebeek. A l’inverse, la vallée de la Woluwe, plus encaissée, possède une zone potentiellement inondable plus étroite.
L’imperméabilisation des sols joue également un rôle primordial. Un fond de vallée drainant une surface à dominante verte, où l’eau s’infiltre naturellement, ne sera a priori pas touché par une inondation. Des exemples en sont les bassins versants amonts du Molenbeek (présence du bois du Laerbeek), du Neerpedebeek et du Vogelzangbeek. Et ce constat reste valable, même lorsque les pentes des surfaces drainées sont notables, comme pour la Woluwe ou son affluent, le Roodkloosterbeek, grâce à la présence de la Forêt de Soignes. En revanche, un fond de vallée drainant des surfaces fortement imperméabilisées est situé en zone d’aléa. Il en est ainsi de la partie ouest du pentagone comme de la vallée du Maelbeek. Le fait que le cours d’eau du Maelbeek soit voûté accentue sans aucun doute le phénomène.
La protection offerte par les bassins d’orage est « visible » à certains endroits, comme dans la plaine alluviale de la Senne. Ainsi, dans le pentagone, l’utilisation des anciens pertuis de la Senne comme bassins d’orage protègent le centre-ville : ce dernier est classé en aléa faible alors que sans cette protection, il serait en aléa élevé. Il en est de même pour la zone inondable à Forest, grâce aux bassins d’orage de Baeck-Merill et d’Audi. Les bassins d’orage récemment installés dans les vallées d’Uccle et dans la partie amont de la vallée du Molenbeek permettent de baisser localement l’intensité de l’aléa d’élevé à moyen. En effet, les bassins d’orage sont dimensionnés de sorte à gérer tout juste des pluies de temps de retour de 10 ans, ce qui correspond à la notion d’aléa élevé dans les cartes d’inondation. Pour des pluies plus rares, les bassins d’orage sont alors totalement remplis et ne peuvent plus empêcher la reprise des inondations en aval.
21% de la superficie régionale se situe en zone inondable
Potentiellement, moins d’1% du territoire régional est situé en zone d’aléa fort donc touché par une inondation de façon récurrente, au moins une fois tous les 10 ans. Et 4% du territoire est situé en zone d’aléa moyen, donc affecté par une inondation environ une fois tous les 25 à 50 ans. Pour les habitants et exploitants situés dans ces zones (surtout en zone d’aléa fort), il y a donc lieu de se prémunir et de se protéger contre les inondations. Quant à la zone d’aléa faible, elle couvre 16% de la superficie régionale. Pour rappel, les inondations concernées sont susceptibles de ne se produire qu’une fois par siècle.
Pourcentage du territoire régional (en superficie) situé en zone d’aléa d’inondation
Source : Bruxelles Environnement, sur base de la carte d’aléa d’inondation version 2019
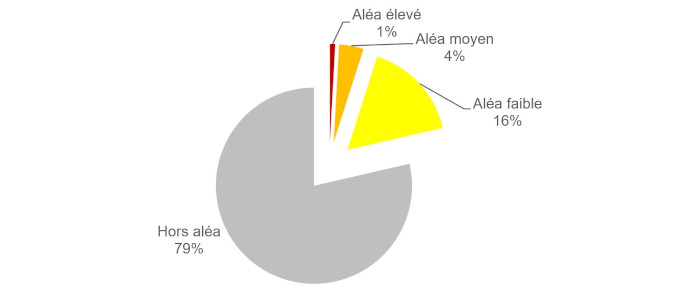
La carte d’aléa d’inondation pluviale ne renseigne pas les niveaux d’eau potentiellement atteints en cas d’inondation : il n’existe en effet pas à ce jour de modèle hydraulique combiné des réseaux d’égouttage et hydrographique permettant de les calculer. Néanmoins, les hauteurs d’eau observées dans les zones submergées restaient de l’ordre de quelques dizaines de centimètres et en général inférieures à 1 mètre (par rapport au niveau du sol). Elles peuvent être qualifiées de « modérées », comparativement à d’autres régions ou pays. Néanmoins, l’impact peut être notable pour les caves ou des infrastructures souterraines (ex : stations de métro, tunnels).
Un habitant sur trois est potentiellement exposé au risque d’inondation
Le risque d’inondation a été évalué pour certaines cibles (habitants, écoles, hôpitaux, certaines activités économiques, patrimoine bâti ou environnemental…). La cible est caractérisée « à risque » lorsqu’elle est située partiellement ou totalement en zone d’aléa. Les mesures locales de protection vis-à-vis des inondations n’ont pas été prises en compte, à l’exception toutefois des bassins d’orage (pour rappel, la carte d’aléa d’inondation en tient compte). Pour de plus amples détails, le lecteur est invité à consulter la carte interactive des risques d’inondation et la fiche méthodologique qui l’accompagne.
Exposition potentielle de la population et des établissements sensibles au risque d’inondation (pluviale et due au refoulement d’égouts) en Région bruxelloise
Source : Bruxelles Environnement, sur base des cartes de risque d’inondation version 2019
Les données sources datent du 1er janvier 2018 pour la population (Statbel), de 2019 pour les bâtiments, écoles et hôpitaux (UrbIS), de 1999 pour les maisons de repos (SITEX).
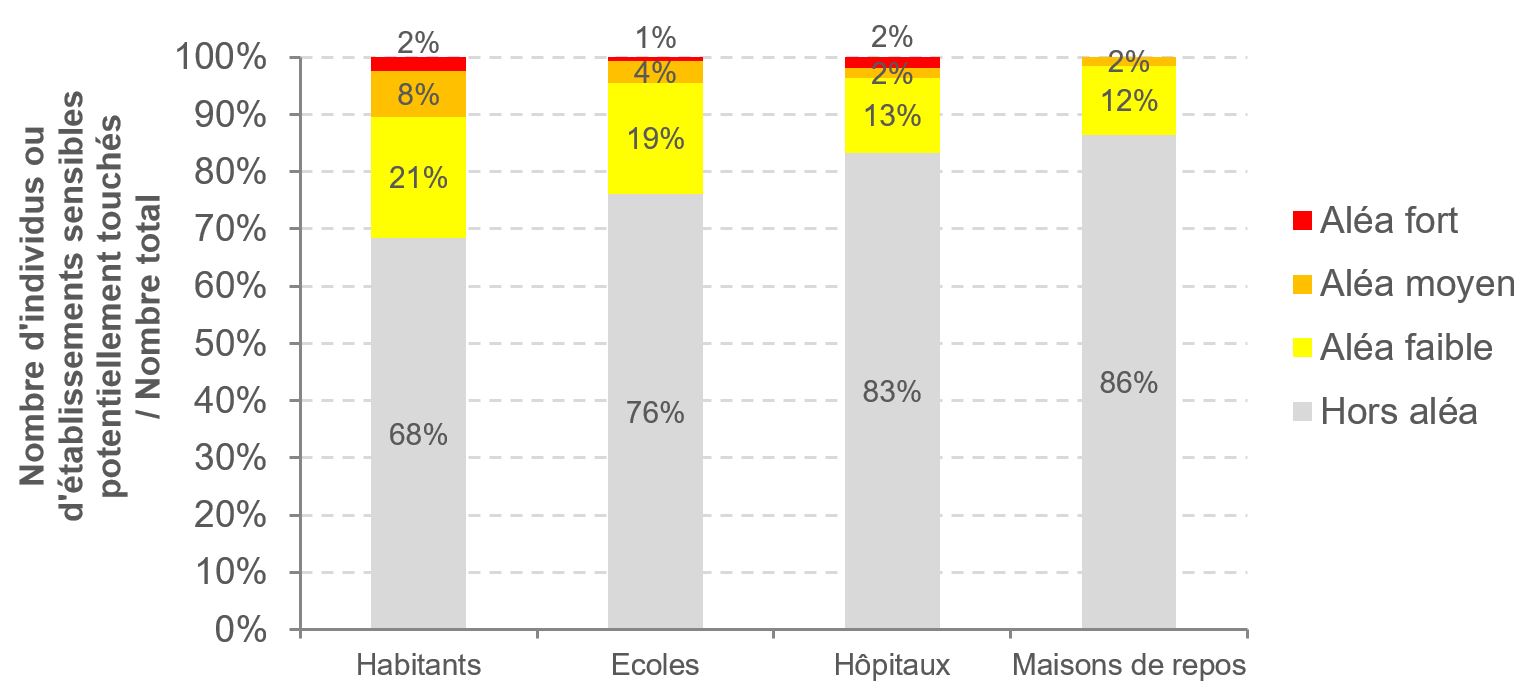
Près d’un habitant sur trois est potentiellement touché par les inondations pluviales (31%). Mais la grande majorité d’entre eux serait localisée en zone d’aléa faible. Néanmoins 8% des habitants sont potentiellement situés en zone d’aléa moyen ; 2% des habitants en zone d’aléa fort.
Evaluation des risques pour d’autres cibles
Vis-à-vis de l’activité économique, 78% de la superficie des zones industrielles (selon l’affectation au PRASLe Plan régional d'Affectation des Sols est l'un des outils majeurs de la politique d'aménagement du territoire régional. Il comprend des prescriptions générales pour l'affectation des sols, des cartes délimitant des zones d'affectation et des prescriptions particulières par zone (notamment pour la protection des espaces verts). Il constitue en outre la référence légale pour l'octroi des permis d'urbanisme, de primes à la rénovation, etc. Il transcrit par ailleurs les objectifs opérationnels du PRD en carte.) sont en zone inondable. Le bassin industriel résiduel de la RBC est en effet essentiellement présent sur l’axe Senne-Canal.
Dans le cas de certains établissements industriels, au dommage économique s’ajoute un risque de pollution accidentelle pour l’environnement compte tenu de la présence sur site de substances dangereuses notamment ou de dysfonctionnement des installations (par exemple sur l’efficacité du processus épuratoire au niveau des stations de traitement d’eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances.). Il s’agit de 9 installations IED (sur les 18 que compte la RBC) (du nom de la directive relative aux émissions industrielles) dont les 2 stations d’épuration et des 3 sites Seveso. Tous ces sites sont implantés dans la plaine alluviale de la Senne.
Si la zone de protection de captage d’eau potable du Bois de la Cambre et de la Forêt de Soignes et le réseau Natura 2000 se situent essentiellement en dehors de la zone d’aléa, il n’en est pas de même de certains sites Natura 2000 : en cas d’inondation, ceux-ci sont susceptibles de recevoir des eaux polluées soit par surverse du réseau d’égout soit par des eaux ruisselées contaminées.
Des cartes de risques ont également été dressées pour évaluer les conséquences négatives sur la mobilité, suite à l’inondation de tronçons de réseaux de transport (routier, ferroviaire, tram, métro), gares, stations de métro ou parkings couverts. Les infrastructures les plus sensibles correspondent sans surprise aux parties souterraines et en fond de vallée.
L’évaluation des risques a enfin porté sur les monuments et sites classés et sur les infrastructures vulnérables de type caserne de pompier ou poste de police.
Mieux se prémunir contre les inondations
Tant la carte des aléas que celle des risques d’inondations constituent des outils de sensibilisation et de conscientisation de la population à la lutte contre les inondations. Suivant le fameux adage « un homme averti en vaut deux », les habitants, entrepreneurs ou industriels potentiellement touchés ont tout intérêt à prendre des mesures de protection à l’échelle de leur bâtiment, lorsque cela est possible. A cet effet, le service de guidance inondations de Vivaqua offre depuis 2012 un accompagnement aux habitants rencontrant des problèmes de remontée d’eau dans leur logement. Par ailleurs, une brochure de Bruxelles Environnement à destination des habitants sur les bons gestes avant, pendant et après les inondations est sortie en 2017. Enfin, des alertes aux orages exceptionnels peuvent être reçues sur base horaire grâce à l’Application pour smartphone de l’IRM. Il est également possible de rapporter le constat d’une inondation via l’application.
Pour être réellement efficaces, ces mesures à l’échelle individuelle doivent s’accompagner de mesures collectives. De nombreuses figurent dans le plan de gestion des risques d’inondation (intégré au plan de gestion de l’eau). Elles couvrent l’ensemble du cycle de gestion d’une inondation : prévention, protection, préparation, gestion de crise et réparation. Un système d’alerte et de gestion de crise devraient ainsi voir le jour. En outre, l’accent est mis sur l’axe préventif avec un objectif principal : restaurer le cycle naturel de l’eau (infiltration de l’eau, tamponnage des eaux dans des bassins de rétention naturels, déconnexion des eaux pluviales / de ruissellement du réseau d’égouttage, etc.).
À télécharger
Fiche(s) méthodologique(s)
Fiche(s) documentée(s)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- L’évaluation préliminaire des risques d’inondation pour la Région de Bruxelles-Capitale, 2018 (.pdf)
- Brochure « Faire face aux inondations », 2020 (.pdf)
Etude(s) et rapport(s)
- Composante urbaine, avril 2014. « Etude présentant des projets innovants en matière de gestion des eaux pluviales sur l’espace public et en voirie ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 160 pp. (.pdf)
- FACTOR-X, ECORES, TEC, octobre 2012. « L’adaptation au changement climatique en Région de Bruxelles-Capitale : élaboration d’une étude préalable à la rédaction d’un plan régional d’adaptation ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 252 pp. [uniquement FR]
Plan(s) et programme(s)
Les inondations importantes récentes
Focus - Actualisation : février 2020
Pas moins de 19 inondations significatives (d’une période de retour supérieure ou égale à 10 ans) ont eu lieu en Région bruxelloise entre 2007 et 2017. 7 d’entre elles avaient une période de retour maximale localement de plus de 100 ans. Toutes découlaient du ruissellement d’eaux de pluie et du refoulement des égouts. Six s’accompagnaient aussi de débordements de cours d’eau. La plupart des inondations significatives ont eu lieu au printemps et en été.
Un inventaire des inondations historiques difficile à constituer
La Région bruxelloise est exposée au risque d’inondations et ce n’est pas nouveau. Mais si les archives d’articles de presse évoquent certains évènements marquants, il est difficile de dresser un historique minutieux des inondations passées et de connaitre avec précision les zones inondées.
La province du Brabant, qui était compétente sur le territoire avant la création de la Région de Bruxelles-Capitale, avait listé les grosses artères qui furent inondées au cours du siècle dernier. Mais ce n’est que depuis 1997 que nous disposons d’un inventaire suffisamment précis (liste d’adresses). Cet inventaire a été ou est alimenté par différentes sources : le Fonds des Calamités (1999-2007), le SIAMU (interventions des pompiers), Vivaqua (gestionnaire du réseau d’égouttage) ainsi que les communes.
Néanmoins, cette base de données est biaisée : les zones habitées ou sièges d’activités économiques sont bien représentées alors que les données sont inexistantes pour les espaces verts. Les données proviennent effectivement d’instances dont le but principal est de réparer, limiter ou indemniser les dommages matériels et économiques liées aux inondations.
19 inondations significatives entre 2007 et 2017
Pas moins de 19 inondations significatives ont été recensées de 2007 à 2017, soit près de 2 inondations par an en moyenne. C’est ce qui ressort d’une analyse croisée entre les conditions pluviométriques et les observations d’inondations (Bruxelles Environnement, 2018). Une inondation a été jugée significative pour toute pluie de période de retour supérieure ou égale à 10 ans : autrement dit, qui a 10% de chance ou moins de se produire dans l’année. Cette période de retour équivaut à l’aléa élevé de la cartographie des zones inondables .
Les périodes de retour associées à des précipitations d’intensité et de durée données ont été calculées pour la station météorologique de référence d’Uccle, à partir des observations de 1898 à 2007 (Van de Vyver, 2015). La période de retour de 10 ans correspond par exemple à un cumul pluviométrique de 25,7 mm en 1h ou encore de 62 mm en 24h. Ces résultats ont ensuite été comparés aux mesures de 16 autres pluviomètres (du réseau Flowbru), en service depuis 2007, à l’échelle de chacun des six sous-bassins versants de la Région. Les pluies à Uccle ont ainsi été associées à des pluies locales de référence au niveau de ces pluviomètres.
Pour chaque pluie significative identifiée au niveau des bassins versants entre 2007 et 2017, les observations d’inondations issues de l’inventaire ont été sélectionnées.
Inondations significatives ayant eu lieu en RBC entre 2007 et 2017 (précipitations de période de retour ≥ 10 ans)
Source : Bruxelles Environnement, évaluation préliminaire des risques d’inondation, 2018
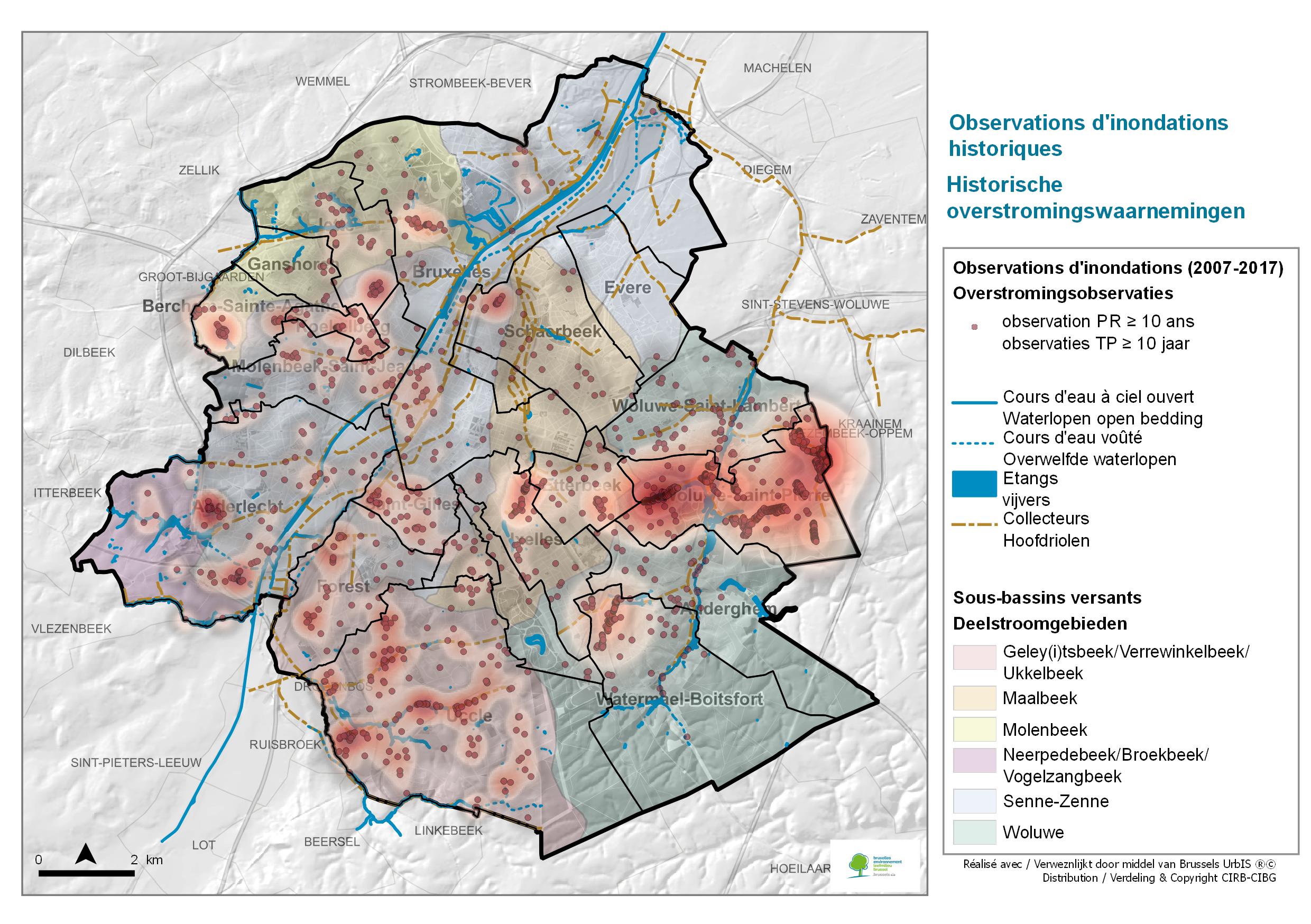
Des inondations généralement printanières ou estivales
19 inondations significatives ont ainsi été recensées de 2007 à 2017. Toutes correspondaient à des inondations pluviales (ruissellement d’eaux de pluie) et à des refoulements d’égouts. Six d’entre elles étaient également conjuguées avec des inondations fluviales (débordement de cours d’eau).
Nombre d’observations d’adresses inondées et période de retour maximale pour les inondations significatives ayant eu lieu en RBC entre 2007 et 2017
Source : Bruxelles Environnement, évaluation préliminaire des risques d’inondation, 2018
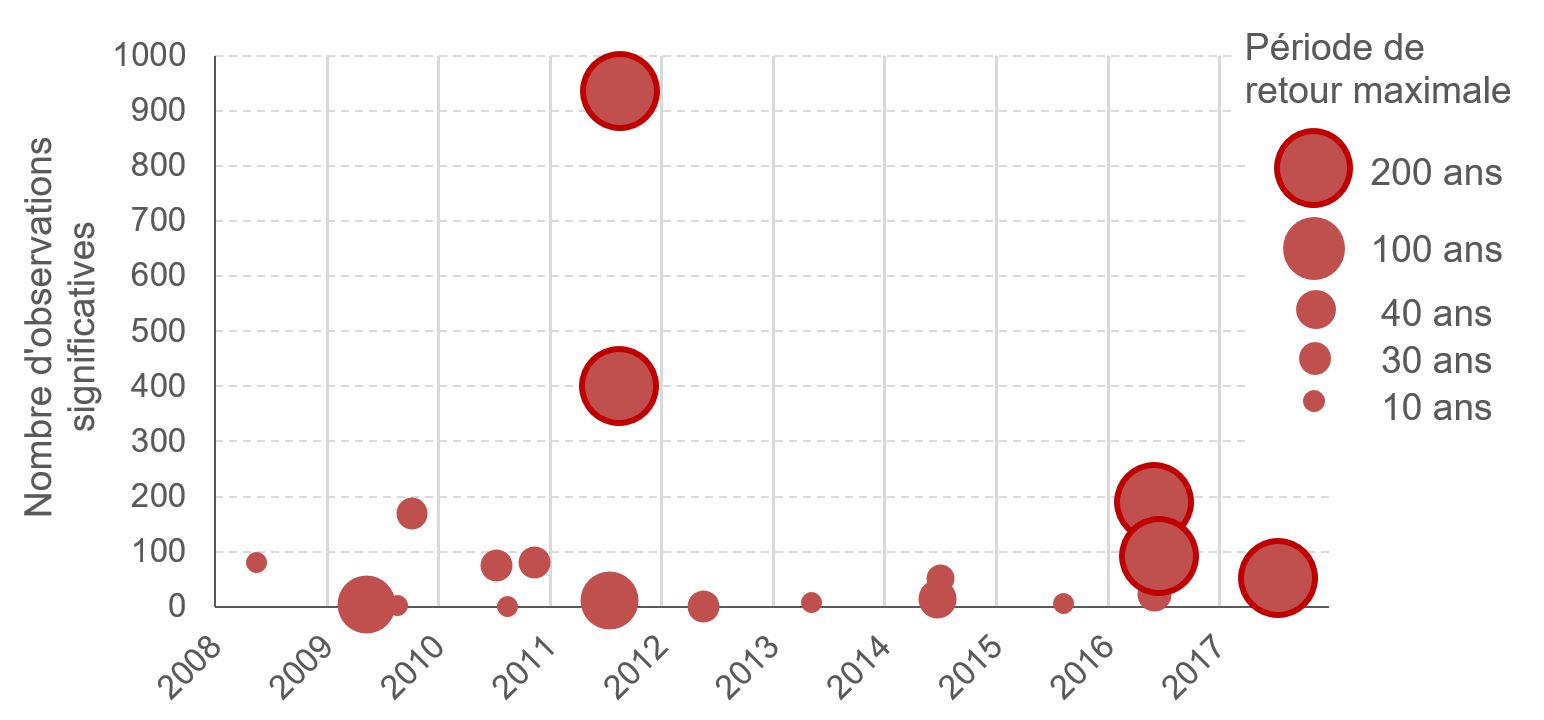
La période de retour maximale enregistrée localement (au niveau d’un bassin versant) est de 200 ans. Elle se rapporte à cinq inondations, dont le trio de tête en nombre de signalements (et donc a fortiori, de dommages) : les 23 et les 18 août 2011, avec respectivement 935 et 400 signalements et les 7-8 juin 2016 avec 190 signalements. Deux inondations avaient une période de retour locale maximale de 100 ans. Ce sont donc 7 inondations relevant ponctuellement du scénario extrême (aléa faible) de la cartographie des zones inondables qui ont été comptabilisées en une décennie. Les autres épisodes d’inondation appartenaient pour 7 d’entre eux au scénario occasionnel (aléa moyen) et 5 au scénario fréquent (aléa élevé).
La plupart des inondations significatives (17 sur 19) se sont produites au printemps ou en été. A ces saisons, les inondations découlent habituellement d’orages, responsables de précipitations intenses et de courte durée : elles touchent alors des zones situées aussi bien en tête de bassin versant qu’en fond de vallée et se caractérisent par de brusques phénomènes. Tandis que l’automne et l’hiver se définissent plutôt par de longues pluies : les inondations concernent alors surtout les fonds de vallée et sont progressives.
Quelle incidence du changement climatique ?
Les données historiques rassemblées, en raison de leur imprécision ou de leur faible couverture temporelle, n’offrent pas la possibilité de dégager une éventuelle tendance de l’occurrence des inondations sur la Région de Bruxelles-Capitale entre 1900 et aujourd’hui.
L’impact probable du changement climatiqueDésigne de lentes variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l'air, résultant d'activités humaines, menacent de modifier sensiblement les climats, dans le sens d'un réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants : élévation du niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones, etc.), déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d'eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales, etc. dans les années à venir correspondrait à une augmentation des inondations en Région bruxelloise tant en période hivernale (crues des rivières) qu’en période estivale (refoulement d’égout) (Factor-X, Ecores, TEC, 2012). Les modèles convergent toutefois plutôt vers une baisse des fortes précipitations en été. Mais ils tendent aussi vers une augmentation des températures, laquelle pourrait provoquer une instabilité plus grande de l’atmosphère et des orages dès lors plus intenses. Par principe de précaution, le risque d’inondation est tout de même envisagé à la hausse en période estivale.
À télécharger
Fiche(s) documentée(s)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- L’évaluation préliminaire des risques d’inondation pour la Région de Bruxelles-Capitale, 2018 (.pdf)
Etude(s) et rapport(s)
Plan(s) et programme(s)
Liens utiles
Etat chimique des eaux souterraines
Indicateur - Actualisation : juillet 2022
4 des 5 masses d’eau souterraine de la Région bruxelloise atteignent le « bon état chimique ». Mais l’une d’entre elles, le Socle, risque d’y échouer en 2027 du fait de l’augmentation significative des teneurs en ammonium. La masse d’eau des Sables du Bruxellien est classée en « état chimique médiocre » en raison de sa contamination par des nitrates et elle le resterait en 2027 à cause de ce paramètre. Moins profonde et en lien plus direct avec les activités humaines, elle présente également des contaminations significatives en certains pesticides, en tétrachloroéthylène, en chlorures et en sulfates. Un point positif mérite cependant d’être souligné : les pesticides totaux et certains pesticides tendent à baisser de manière significative et durable.
Objectif visé : l’atteinte du « bon état chimique »
Des objectifs environnementaux relatifs aux eaux souterraines présentes en Région bruxelloise ont été fixés en application de la directive et de l’ordonnance cadre eau (DCE et OCE) et de la « directive-fille » relative à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (2006/118/CE) et de son arrêté de transposition. Ils concernent le « bon état quantitatif et chimique » des 5 masses d’eau souterraines.
L’atteinte du « bon état chimique » implique le respect d’objectifs de qualité (concentrations maximales de certains polluants à ne pas dépasser) :
- des normes de qualité pour les nitrates et les pesticides (substances actives et produits de dégradation pertinents);
- et des valeurs seuils établies pour des polluants estimés à risque pour les eaux souterraines. Celles-ci sont fixées par masse d’eau en fonction des usages de l’eau notamment (qui sont en Région bruxelloise principalement l’alimentation en eau potable, l’utilisation par des activités industrielles ou par le secteur tertiaire).
La notion de « bon état chimique » recouvre également l’absence d’impacts négatifs sur les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) et les écosystèmes terrestres dépendant directement des eaux souterraines ainsi que sur les zones de protection de captage d’eau destinée à la consommation humaine. Seule la masse d’eau des Sables du Bruxellien est concernée.
La liste complète des objectifs de qualité en vigueur figure dans la fiche méthodologique ainsi que dans la fiche documentée n°4.
Des polluants… présents naturellement dans les aquifères
Lors de son infiltration à travers les formations géologiques du sous-sol puis lors de son stockage dans l’aquifère, l’eau souterraine peut sous certaines conditions s’enrichir naturellement en éléments chimiques (métaux, métalloïdes, minéraux et molécules organiques). Cet enrichissement naturel se traduit par la présence de concentrations de référence pour les éléments concernés, aussi appelées « fond géochimique ». Il peut parfois s’agir de polluants indésirables voire nocifs pour la santé humaine, rendant l’eau impropre à certains usages sans traitement préalable.
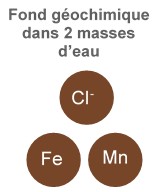 Il est important d’en tenir compte lors de la détermination des objectifs de qualité. Des études menées en 2018 et 2019 pour identifier la présence de fonds géochimiques dans les eaux souterraines bruxelloises ont révélé l’existence de fond géochimique élevé pour trois éléments dans les deux masses d’eau du Système du Socle et des craies du Crétacé et des sables du Landénien (ULg, 2018 et 2019) :
Il est important d’en tenir compte lors de la détermination des objectifs de qualité. Des études menées en 2018 et 2019 pour identifier la présence de fonds géochimiques dans les eaux souterraines bruxelloises ont révélé l’existence de fond géochimique élevé pour trois éléments dans les deux masses d’eau du Système du Socle et des craies du Crétacé et des sables du Landénien (ULg, 2018 et 2019) :
- en chlorures (Cl-). Polluant à risque, sa valeur seuilValeur à partir de laquelle des actions sont entreprises. a été majorée pour ces deux masses d’eau ;
- en fer (Fe) et en manganèse (Mn). Ces deux éléments métalliques ne sont toutefois pas considérés comme des polluants à risque pour les eaux souterraines. Mais ils peuvent générer des désagréments pour certains usages entraînant la coloration de l’eau et la formation de précipités indésirables au sein des installations d’exploitation
Comment surveille-t-on la qualité des eaux souterraines ?
La surveillance de l’état chimique de ces 5 masses d’eau souterraine, débutée en 2004, s’effectue par l’analyse d’échantillons prélevés au sein de piézomètres, de captages en activité et de quelques sources (exutoires des écoulements des eaux). Elle est assurée par 3 programmes de surveillance distincts :
- le contrôle de surveillance, destiné à caractériser l’état général de chaque masse d’eau, à identifier les éventuelles tendances à long terme et à détecter l’apparition de nouveaux polluants. Il comptait fin 2018, 24 sites de surveillance répartis dans les 5 masses d’eau souterraine. Il porte sur les substances polluantes pertinentes pour les eaux souterraines. La fréquence de contrôle était bisannuelle pour les nappes phréatiques. En 2013, cette fréquence a été abaissée à un contrôle annuel pour la masse d’eau du Système du Socle et des craies du Crétacé et celle des Sables du Landénien, compte tenu des connaissances acquises et du contexte hydrogéologique de ces masses d’eau. Depuis 2022, la fréquence de contrôle est bisannuelle pour les nappes phréatiques et annuelle pour les nappes captives.
- le contrôle opérationnel, destiné à suivre les masses d’eau risquant de ne pas atteindre le « bon état chimique » ou présentant une tendance à la hausse d’un polluant et à évaluer les incidences de la mise en place des programmes de restauration de la qualité des masses d’eau à risque. Il comptait, fin 2018, 10 sites de surveillance répartis dans la masse d’eau des Sables du Bruxellien, échantillonnés deux fois par an et portait principalement sur les paramètres caractérisés comme étant à risque (notamment les nitrates, certains pesticides, le tétrachloroéthylène et une liste minimale de paramètres polluants estimés à risque pour les eaux souterraines).
- Le contrôle additionnel, au sein de la masse d’eau des sables du Bruxellien, destiné au suivi de trois zones protégées :
- la zone de protection des captages d’eaux destinées à la consommation humaine ;
- les zones d’alimentation hydrogéologique des écosystèmes aquatiques associés et terrestres dépendants des eaux souterraines ;
- la zone vulnérable aux nitrates d’origine agricoles.
Les nappes superficielles - présentes dans les alluvions de la vallée de la Senne et des vallées adjacentes ainsi que dans les sédiments du Quaternaire - ne font actuellement pas l’objet d’une surveillance qualitative systématique.
4 masses d'eaux souterraines en « bon état chimique », mais des teneurs en ammonium en augmentation dans deux d’entre elles
Quatre des cinq masses d’eau bruxelloises ont été évaluées en « bon état chimique » sur base des résultats de surveillance de 2018 :
- le Système du Socle et des craies du Crétacé,
- le Socle,
- les Sables du Landénien
- le système Nord-Ouest des sables du Bruxellien et de Tielt.
Les perspectives à l’horizon 2027 sont moins favorables : une tendance à la hausse des concentrations en ammonium est observée dans les trois masses d’eau captives. Pour celle du Socle, cette tendance est statistiquement significative et durable. Cette masse d’eau est par conséquent déclarée à risque d’être déclassée en « état médiocre » en 2027.
Ces teneurs élevées en ammonium résulteraient de l’intrusion d’eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) polluées (rejets directs d’eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. domestiques et industrielles) dans les eaux souterraines et/ou d’un phénomène de réduction des nitrates (qui pourraient provenir d’activités agricoles situées en amont de la Région bruxelloise, au niveau des zones d’affleurement de ces trois masses d’eau).
Etat chimique des 5 masses d’eau souterraine bruxelloises (2018) et des tendances des polluants identifiés
Source : Bruxelles Environnement, 2022
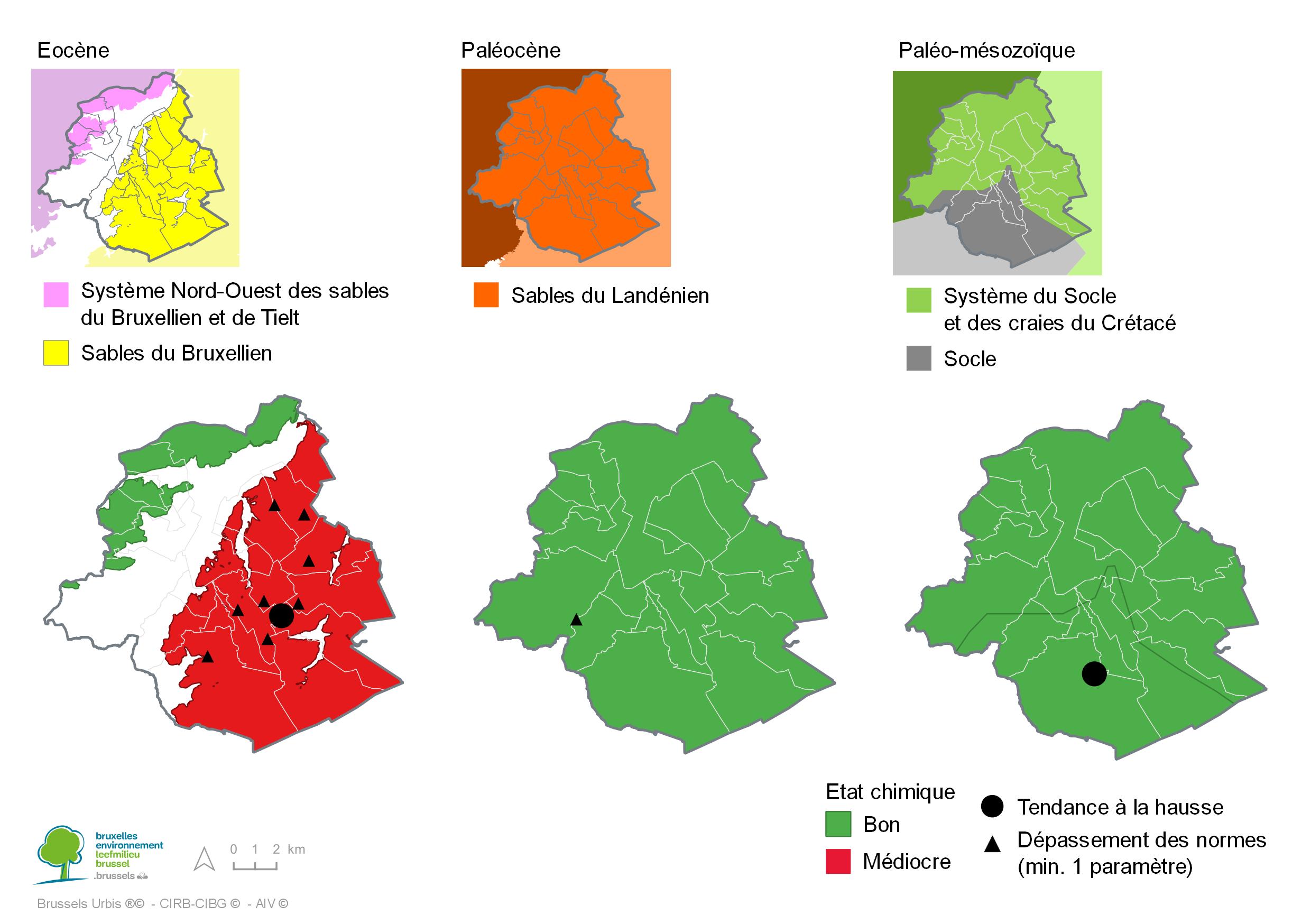
1 masse d’eau en « état médiocre » à cause des nitrates
La masse d’eau des Sables du Bruxellien - présente à plus faible profondeur dans le sous-sol et plus exposée à la pollution de surface – demeure en « état chimique médiocre » en raison de sa contamination par les nitrates. Et elle risque de le rester en 2027, toujours en raison de ce paramètre. Elle présente également une qualité dégradée par la présence ponctuelle d’autres polluants…
Les nitrates, la bête noire de la masse d’eau des Sables du Bruxellien
La contamination des Sables du Bruxellien par les nitrates n’est pas nouvelle… L’examen des tendances des concentrations aux différents sites de surveillance mené sur la période 2009-2018 à l’échelle de la masse d’eau ne montre pas d’évolution particulière, excepté en 4 sites parmi les plus contaminés où une baisse significative est enregistrée.
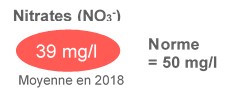 La concentration moyenne à l’échelle de la masse d’eau s’élève à 39 mg/l en 2018, sachant que la norme est de 50 mg/l. L’état de contamination est très variable selon les sites de surveillance, allant de 5 à 110 mg/l en 2018. Près d’un site sur deux (soit 44% des sites de mesure) dépasse la norme.
La concentration moyenne à l’échelle de la masse d’eau s’élève à 39 mg/l en 2018, sachant que la norme est de 50 mg/l. L’état de contamination est très variable selon les sites de surveillance, allant de 5 à 110 mg/l en 2018. Près d’un site sur deux (soit 44% des sites de mesure) dépasse la norme.
- Les dépassements s’observent essentiellement au centre de la Région, dans des zones très urbanisées.
- A l’inverse, les concentrations faibles en nitrates sont relevées dans la zone sud-est de la masse d’eau correspondant à la Forêt de Soignes, peu soumise à des pressions anthropiques.
- Des concentrations intermédiaires sont mesurées au sud-ouest de la masse d’eau, à Uccle, où l’urbanisation est faible.
Concentration moyenne en nitrates dans la masse d’eau souterraine des Sables du Bruxellien (2006-2018)
Source : Bruxelles Environnement, 2022
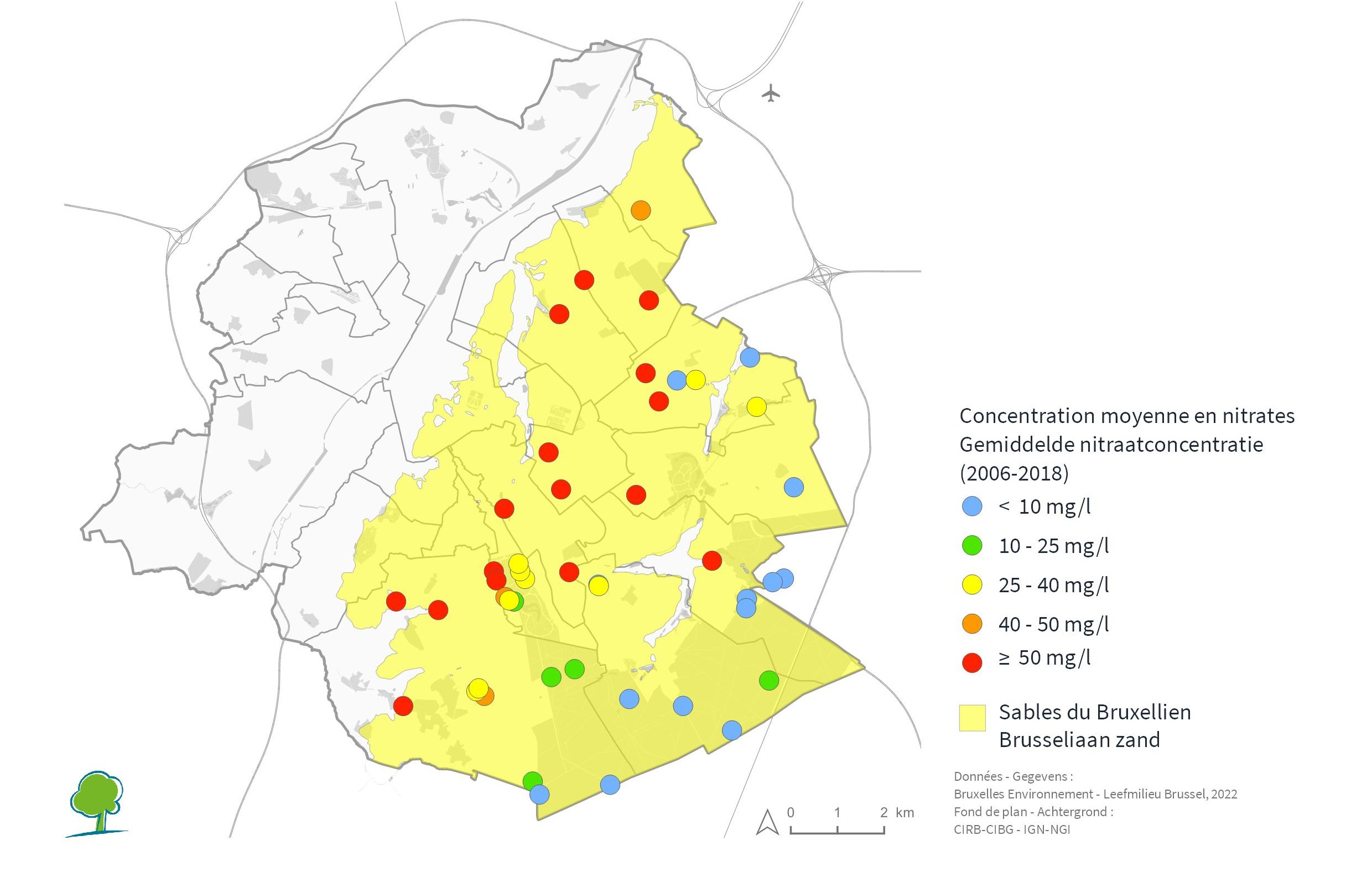
D’où proviennent ces nitrates ?
Des recherches universitaires ont été menées pour identifier l’origine de la contamination par les nitrates dans la masse d’eau des sables du Bruxellien, grâce notamment à des analyses isotopiques de l’azote et de l’oxygène effectuées entre 2009 et 2015 (UCL, 2013 et 2018). L’examen des isotopes permet de discriminer les sources majeures d’émission des nitrates, en chaque site de mesure et à l’échelle de la masse d’eau. Il en ressort trois principales sources de contamination et une quatrième, mineure :
Sources majeures d’émission des nitrates dans les Sables du Bruxellien
Source : UCL, 2013 et 2018
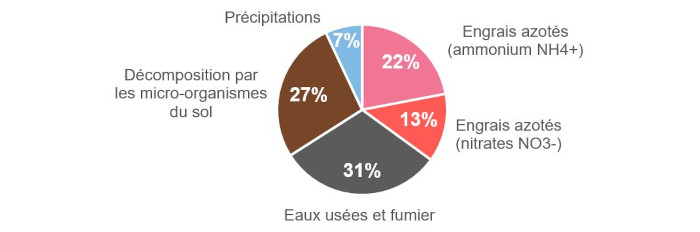
- Les engrais azotés, dont la contribution totale à l’échelle de la masse d’eau s’élèverait à 35% (en rose et saumon sur la figure). La fertilisation urbaine des jardins privés par les ménages et celle des espaces verts publics aurait ainsi un impact majeur sur cette contamination, surtout au sud-est de la Région. La fertilisation agricole en Région flamande, en amont de la masse d’eau, aurait, elle aussi, des répercussions sur les concentrations en nitrates relevées au sud de la Région bruxelloise.
- Les eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. domestiques (en gris). Cette contribution est estimée à 31% à l’échelle de la masse d’eau et atteint près de 50% pour les stations proches de zones fortement urbanisées. Ces eaux usées sont principalement issues des pertes du réseau d’égouttage jugé vétuste à certains endroits : selon l’inventaire dressé par Vivaqua, 17% des tronçons d’égouts sur les 1.100 km inspectés étaient considérés comme fortement dégradés fin 2019. Dans une moindre mesure, les eaux usées responsables de la pollution par les nitrates proviennent de l’absence de réseau d’égouttage dans certaines rues, voire de l’existence de puits perdus dans certains quartiers.
- La décomposition (ou minéralisation) de la matière organique par les micro-organismes du sol (en marron). Son impact est relativement homogène sur toute la zone d’étude et estimée à 27% de la contamination à l’échelle de la masse d’eau. Dans les espaces verts, et en particulier en Forêt de Soignes, il s’agit d’un processus naturel qui n’est pas assimilé à une pollution de l’eau. En zone urbaine, la minéralisation de sols organiques peut survenir après leur remaniement lors de travaux d’urbanisation.
- Les dépôts atmosphériques (en bleu), avec la plus faible contribution (7% à l’échelle de la masse d’eau). Cette part est néanmoins supérieure en Forêt de Soignes, au sud-est de la masse d’eau, peut-être en lien avec des précipitations plus abondantes.
Pour réduire les concentrations en nitrates dans la masse d’eau des Sables du Bruxellien, le 3ème plan de gestion de l’eau prévoit d’une part de poursuivre la rénovation et l’extension du réseau d’assainissementTraitement de la pollution affectant un site (sol, eau) afin de le remettre dans son état initial ou du moins atteindre des valeurs fixées légalement. pour réduire l’exfiltration des eaux usées vers les eaux souterraines. Si le raccordement à l’égout est techniquement impossible ou à des coûts disproportionnés, un système d’épuration individuel devra être installé. D’autre part, le plan prévoit de réduire l’emploi d’engrais azotés en révisant les conditions d’exploiter des installations agricoles ou assimilées et en sensibilisant les particuliers, les gestionnaires d’espaces verts et les professionnels aux bonnes pratiques agricoles.
Des pesticides significativement présents dans les Sables du Bruxellien mais la situation s’améliore
 Les pesticides significativement présents à l’échelle de la masse d’eau des Sables du Bruxellien sont des herbicides : l’atrazine, ses produits de dégradation (l’atrazine déséthyl et desisopropyl), le 2,6 dichlorobenzamide (BAM) ainsi que la simazine. D’autres herbicides comme le diuron ont également été observés localement et occasionnellement. Ces pesticides sont principalement à usage domestique, privé ou public (entretien des jardins, des allées, des espaces verts, des cimetières…).
Les pesticides significativement présents à l’échelle de la masse d’eau des Sables du Bruxellien sont des herbicides : l’atrazine, ses produits de dégradation (l’atrazine déséthyl et desisopropyl), le 2,6 dichlorobenzamide (BAM) ainsi que la simazine. D’autres herbicides comme le diuron ont également été observés localement et occasionnellement. Ces pesticides sont principalement à usage domestique, privé ou public (entretien des jardins, des allées, des espaces verts, des cimetières…).
Les dépassements des normes s’observent essentiellement en 3 sites de surveillance situés en zone fortement urbanisée.
La contamination en atrazine, en ses produits de dégradations, en simazine et en diuron témoignerait d’une pollution historique (tous sont interdits d’utilisation depuis le milieu des années 2000) ou de l’usage prohibé d’anciens stocks de produits. Les pollutions aux pesticides perdurent en effet de nombreuses années, étant donné la grande stabilité de certaines de ces molécules, leur migration très lente et complexe à travers le sol et le sous-sol (processus d’adsorption/désorption sur les particules des sols) ou encore du fait du renouvellement lent des eaux souterraines.
Néanmoins, pour la première fois en 2018, la masse d’eau des Sables du Bruxellien est classée en « bon état » vis-à-vis des pesticides (totaux et par substance) : sur les 77 substances actives et métabolites de pesticides analysés, 16% y ont été quantifiées. Et des tendances à la baisse significatives et durables ont été identifiées sur la période de 2009 à 2018 pour les pesticides totaux, l’atrazine, ses produits de dégradation, le bromacil et la propazine.
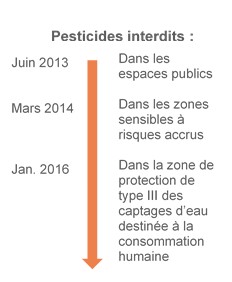 La prudence reste de mise car des tendances à la hausse sont relevées pour la simazine et le diuron en certains sites. En outre, deux métabolites non pertinents, le chlorothalonil SA et le desphenyl chloridazon, ont été quantifiés en 2018, suite à l’extension de la surveillance à de nouvelles substances. Leur présence doit être confirmée par de futures analyses.
La prudence reste de mise car des tendances à la hausse sont relevées pour la simazine et le diuron en certains sites. En outre, deux métabolites non pertinents, le chlorothalonil SA et le desphenyl chloridazon, ont été quantifiés en 2018, suite à l’extension de la surveillance à de nouvelles substances. Leur présence doit être confirmée par de futures analyses.
Les dispositions réglementaires européennes et fédérales relatives à la commercialisation et au retrait d’agréation de certains pesticides empêchant leur utilisation par les particuliers et les pouvoirs publics semblent donc porter leurs fruits. De même, l’ordonnance « pesticides » de 2013 ainsi que le programme régional de réduction des pesticides qui l’accompagne contribuent à protéger la qualité des eaux souterraines, en renforçant les exigences et les conditions relatives à leur utilisation. Il est envisagé d’étendre les restrictions d’usage des pesticides aux espaces privés.
Le tétrachloroéthylène, cancérigène, s’accumule dans certains sites des Sables du Bruxellien
Le tétrachloroéthylène est significativement présent dans trois sites de la masse d’eau des Sables du Bruxellien. L’un d’entre eux affiche même en 2018 des concentrations plus de 10 fois supérieures à la valeur seuilValeur à partir de laquelle des actions sont entreprises. ! Bien que le nombre de sites en dépassement soit faible et ne conduise pas à déclasser la masse d’eau vis-à-vis de ce composé, la concentration moyenne à l’échelle de la masse d’eau en 2018 côtoie la valeur seuil. En outre, une tendance à la hausse significative et durable a été identifiée pour ce paramètre sur la période 2009-2018.
Bon à savoir
Ce composé organique volatil est un solvant utilisé dans l’industrie (ex : nettoyage à sec, peinture, dégraissage de surfaces métalliques, finissage des textiles, extraction des huiles et graisses…). En raison de son pouvoir cancérogène, son usage est restreint depuis 1980 et il devrait être interdit en 2030 en Europe.
Il est difficile de savoir à l’heure actuelle si les dépassements observés découlent d’activités industrielles passées (sites pollués) ou actuelles.
Le 3ème plan de gestion de l’eau prévoit entre autres d’identifier ces sources ponctuelles de pollution, de contrôler voire renforcer les conditions d’exploitation des permis d’environnement des secteurs utilisateurs de cette substance, de remédier à la pollution des sols et de promouvoir des substances alternatives.
D’autres polluants sous la loupe pour les Sables du Bruxellien
D’autres polluants (sulfates, chlorures…) résultant d’activités de surface ont aussi été mesurés localement ou/et occasionnellement en certains sites de surveillance de la masse d’eau des Sables du Bruxellien. Des dépassements locaux ont ainsi été enregistrés en 2018 en ammonium, en nitrites, en chlorures et en sulfates. Ces deux derniers font l’objet d’une attention particulière car ils augmentent de manière significative depuis 2009, tant en certains sites de surveillance qu’à l’échelle de la masse d’eau.
À télécharger
Fiche(s) méthodologique(s)
Accès aux données
- Etat chimique des 5 masses d’eau souterraines (2009, 2012 et 2018) (.xls)
- Application Bruwater, accès aux données sur les eaux souterraines
- Application Brugeotool, accès aux données géologiques, hydrogéologiques et géothermiques
Fiche(s) documentée(s)
- 4. Normes et valeurs légales de référence en matière d’eau (2021) (.pdf)
- 7. Eaux souterraines (2005) (.pdf)
- 13. Cadre légal bruxellois en matière d’eau (2021) (.pdf)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Carte interactive de la géologie
- Carte interactive des stations de mesure du niveau et de la qualité des eaux souterraines
- Tableau des unités hydrogéologiques de la Région de Bruxelles-Capitale (.pdf)
Etude(s) et rapport(s)
- UNIVERSITE DE LIEGE, Thomas C., Brouyère S et Orban P., juillet 2019. « Mise en évidence des concentrations géochimiques de référence dans les nappes phréatiques tertiaires et du Socle en zone d’alimentation ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 235 pp. (.pdf)
- UNIVERSITE DE LIEGE, Thomas C., Brouyère S et Orban P., 2018. « Caractérisation de la concentration de référence de certains paramètres chimiques présents naturellement dans les masses d’eau souterraine captives du Socle et du Crétacé (BR01) et du Landénien (BR03) en Région de Bruxelles-Capitale". Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 202 pp. (.pdf)
- EARTH AND LIFE INSTITUTE – UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN (UCL), Petit S., Vanclooster M. et Bogaert P. mars 2018. « Caractérisation de la pollution par les nitrates dans la masse d’eau des Sables du Bruxellien/Yprésien en Région de Bruxelles-Capitale ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 88 pp. (.pdf)
- EARTH AND LIFE INSTITUTE – UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN (UCL), De Coster A., Vanclooster M., mars 2013. « Etude relative à la pollution de la masse d’eau du Bruxellien par les nitrates dans la Région de Bruxelles-Capitale : Etat des lieux et essai d’identification des sources de pollution ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 87 pp. (.pdf)
Plan(s) et programme(s)
Etat quantitatif des eaux souterraines
Focus - Actualisation : juin 2022
L’état quantitatif des cinq masses d’eau souterraine est jugé bon. Il devrait le rester à l’horizon 2027, pour autant que les tendances actuelles liées aux prélèvements et que les apports d’eau alimentant les aquifères se maintiennent. La pression liée aux prélèvements ne cesse de diminuer. Ceci est de bon augure, en particulier pour les trois masses d’eau les plus profondes dont le potentiel d’exploitation par captage s’avère limité. En revanche, la recharge des nappes depuis 2003 apparait relativement basse, suite à plusieurs années cumulées de faible recharge. Et elle devrait être affectée négativement par les changements climatiques. Compte tenu de son impact élevé sur le niveau des nappes, il existe donc un risque potentiel de non atteinte du bon état quantitatif dans les années à venir. Ce risque est plus élevé pour la masse d’eau des Sables du Bruxellien dont le niveau est actuellement historiquement bas en certains sites de surveillance.
Objectif visé : l’atteinte du « bon état quantitatif »
Des objectifs environnementaux relatifs aux eaux souterraines présentes en Région bruxelloise ont été fixés en application de la directive et de l’ordonnance cadre eau (DCE et OCE), de la « directive-fille » relative à la protection des eaux souterraines (2006/118/CE) et de son arrêté de transposition. Ils concernent le « bon état quantitatif et chimique » des 5 masses d’eau souterraines.
Le bon état quantitatif d’une masse d’eau souterraine correspond à une gestion durable de la ressource en eau compte tenu de l’évolution des prélèvements et de la recharge des aquifères. Autrement dit, les prélèvements (débits sortants, naturels ou artificiels) doivent être en équilibre avec le taux de renouvellement de l’aquifère (débits entrants). Un autre élément à prendre en compte sont les échanges d’eau entre aquifères dans le sous-sol, qu’il s’agisse de transferts verticaux entre différents étages ou horizontaux pour les aquifères transfrontaliers.
Bon à savoir
Le bon état quantitatif de la masse d’eau souterraine des Sables du Bruxellien tient également compte du débit de base de la Woluwe qu’elle alimente ainsi que de l’état de conservation des écosystèmes terrestres qui en dépendent (habitats Natura 2000).
La caractérisation du bon état se base notamment sur l’analyse de l’évolution des niveaux des nappes (ou chroniques piézométriques). L’évaluation de l’état quantitatif en 2018 présentée ici se base sur les données de la période 2000-2018.
Cette caractérisation s’appuie également sur l’estimation de la ressource disponible, obtenue grâce à la réalisation d’un bilan hydrogéologique au droit de la Région bruxelloise. Ce bilan vise à quantifier pour une année type les flux moyens entrants et sortants au niveau de chaque masse d’eau. Il est établi en ayant recours à des modèles numériques hydrogéologiques, qui permettent de reproduire et de simuler les écoulements de nappe.
Outre la quantification de ce bilan, les modèles permettent aussi d’évaluer la sensibilité d’une nappe vis-à-vis des pressions quantitatives, d’analyser les processus de transport de polluants ou de chaleur (géothermie) ou encore de tester les impacts de différents scénarios climatiques.
Des modèles numériques hydrogéologiques ont été développés pour 3 des 5 masses d’eau souterraine bruxelloises : Sables du Bruxellien, Système nord-ouest des sables du Bruxellien et de Tielt, Sables du Landénien. Pour les 2 masses d’eau du Socle et du système du Socle et des craies du Crétacé, en l’absence de modèle, l’évaluation de l’état repose uniquement sur l’évolution des chroniques piézométriques et peut donc être qualifiée d’incomplète.
Comment surveille-t-on l’état quantitatif des eaux souterraines ?
Trois réseaux de surveillance assurent le suivi de l’état quantitatif des eaux souterraines :
- Le premier vise les 5 masses d’eau souterraines déclarées en Région bruxelloise et les écosystèmes associés. Il assure en premier lieu le suivi du niveau piézométrique des eaux souterraines. Il comportait 41 sites de mesures fin 2018, répartis dans les 5 masses d’eau. Deux tiers des sites sont équipés de stations de mesures automatiques, qui relèvent le niveau d’eau toutes les heures. Le tiers restant correspond à des stations manuelles où le niveau est mesuré par un opérateur deux fois par mois.
Ce réseau s’est élargi en second lieu à la mesure du débit de sources, émergences de la masse d’eau du Bruxellien. Fin 2018, 6 sources étaient monitorées deux fois par an.
En dernier lieu, une surveillance additionnelle spécifique aux zones d’alimentation hydrogéologique des écosystèmes aquatiques et terrestres dépendant des Sables du Bruxellien est également mise en œuvre (5 stations piézométriques dont 4 automatiques et 6 sources).
- Le second vise les sédiments quaternaires et les nappes alluviales (4 stations piézométriques).
- Le troisième est spécifique à la zone de protection des captages d’eau destinés à la consommation humaine (10 stations piézométriques dont la surveillance est assurée par le producteur d’eau Vivaqua).]
Toutes les masses d’eau souterraines bruxelloises sont en bon état quantitatif
Les 5 masses d’eau souterraines ont été évaluées en bon état quantitatif en 2018. Et elles le resteront à l’horizon 2027 pour autant que les tendances actuelles liées aux prélèvements et que les apports d’eau alimentant les aquifères se maintiennent.
Etat quantitatif des 5 masses d’eau souterraine bruxelloises (2018)
Source : Bruxelles Environnement, 2022
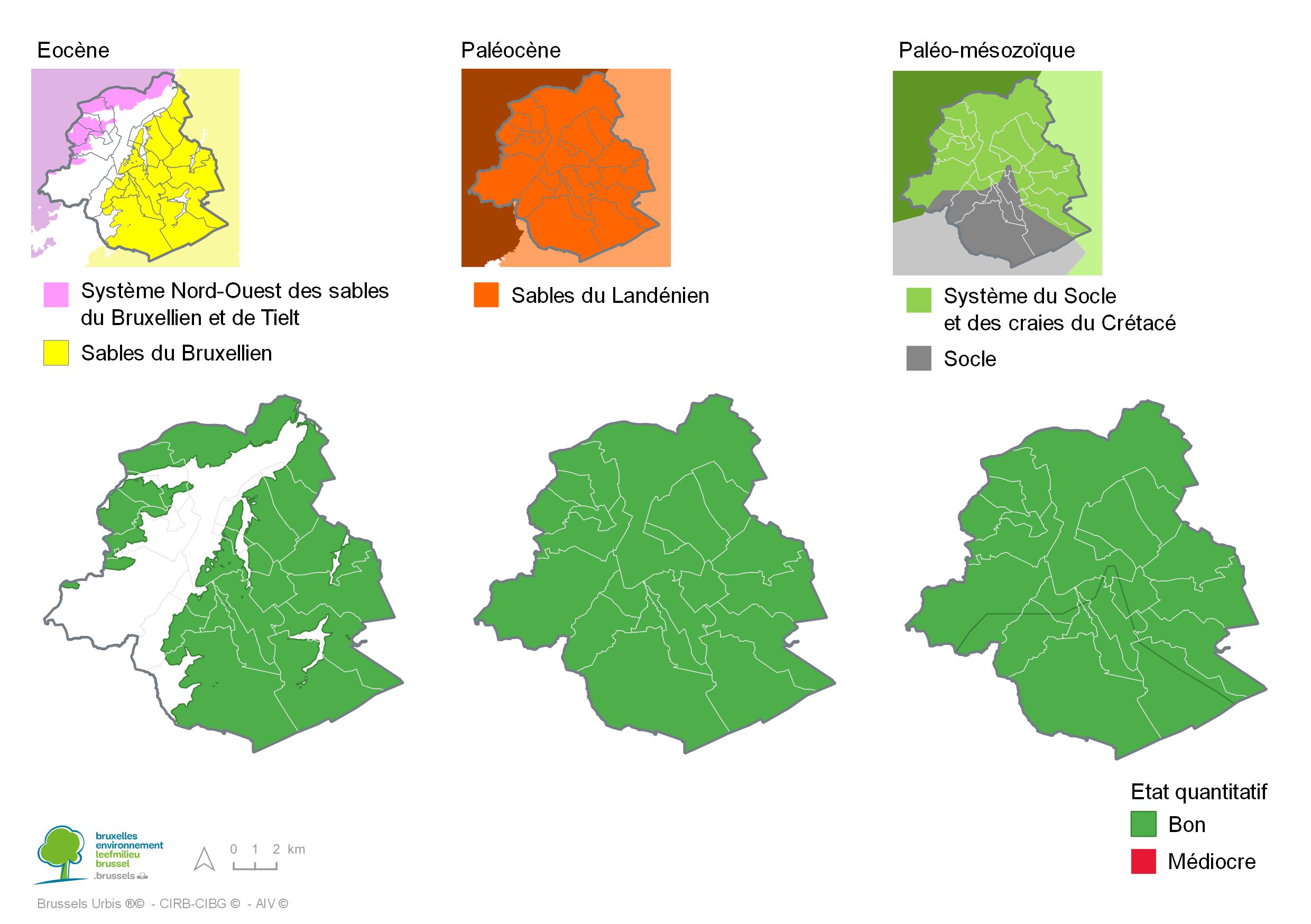
- Les deux premières masses d’eau souterraines rencontrées depuis la surface (et donc les plus récentes) datent de l’ère du Cénozoïque, de la série/époque de l’Eocène. Il s’agit du « système nord-ouest des sables du Bruxellien et de Tielt » (20 km2) ainsi que des « Sables du Bruxellien » (90 km2). La première est libre mais localement captive ; la seconde libre. Ensemble, ces masses d’eau font partie du « système phréatique » bruxellois.
- La masse d’eau intermédiaire date également de l’ère du Cénozoïque mais de la série/époque du Paléocène. Il s’agit des « Sables du Landénien » (162 km2). Cette masse d’eau est captive.
- Les deux masses d’eau souterraines les plus profondes (et donc les plus anciennes) datent de l’ère du Paléozoïque, des séries/époques du Cambrien et du Mésozoïque, de la série/époque du Crétacé. Il s’agit du « Système du Socle et des Craies du Crétacé » (111 km2) et du « Socle » (51 km2). Ces deux masses d’eau sont captives.
Toutes les masses d’eau souterraines bruxelloises appartiennent à des aquifères transfrontaliers du bassin hydrographique de l’Escaut.
L’alimentation (ou recharge) des masses d’eau du système phréatique se fait en partie en Région bruxelloise, essentiellement sur les plateaux. Celle des masses d’eau captives se produit exclusivement en dehors des frontières régionales, au niveau des vallées alluviales de la Dendre et de la Dyle en Régions flamande et wallonne.
Toute imperméabilisation des sols au droit de ces zones d’alimentation limite potentiellement l’infiltration vers les eaux souterraines et affecte donc leur capacité de recharge.
Premier élément de décryptage : l’évolution du niveau des eaux souterraines
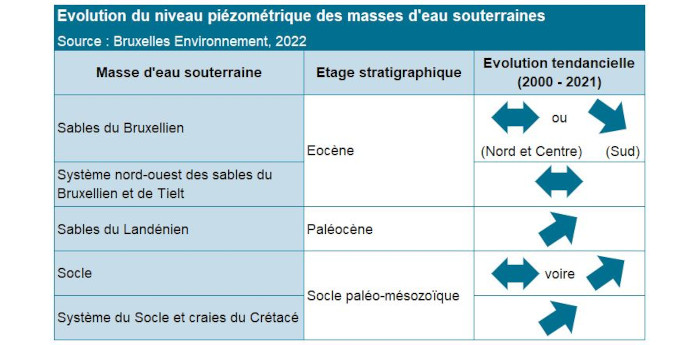
L’évolution tendancielle des chroniques piézométriques de 2000 à 2021 dans les masses d’eau souterraines est favorable : le niveau d’eau des nappes connait une tendance globale à la hausse ou reste stable.
La seule exception concerne la masse d’eau des Sables du Bruxellien dont les niveaux montrent une forte variabilité temporelle et spatiale selon les sites de mesures considérés :
- Au droit des zones amont de la masse d’eau (sur les plateaux), une tendance globale à la baisse depuis 2004 est observée, avec des niveaux actuels historiquement bas.
- Au droit des zones aval de la masse d’eau (proches des fonds de vallée/zones de sources à l’émergence), la tendance est plus stable.
Sur la période récente de 2016 à 2021, les niveaux des masses d’eau ont été influencés négativement par les recharges déficitaires de 2017 et 2018. Ils sont repartis à la hausse depuis 2019, sauf au droit des zones amont de la masse d’eau des Sables du Bruxellien (sur les plateaux), où les niveaux ont continué de baisser.
Pourquoi le niveau d’eau des Sables du Bruxellien évolue-t-il différemment selon les sites de mesure ?
Compte tenu de la relative faible profondeur de cette masse d’eau et de son caractère libre, le niveau piézométrique est directement influencé par les précipitations. Il oscille suivant les épisodes de recharge ou de vidange de la nappe. Mais ces fluctuations ne sont pas identiques ni synchrones selon les sites de mesure. Comme illustré par les figures ci-dessous, le cycle peut être saisonnier (comme au point 371, aval hydrogéologique de la masse d’eau) ou pluriannuel (comme au point 397, amont hydrogéologique de la masse d’eau). Par ailleurs, en ce qui concerne les tendances pluriannuelles, les inversions de tendance n’interviennent pas forcément à la même date et les évolutions observées ne vont pas nécessairement dans le même sens.
Evolution du niveau piézométrique de la masse d’eau des Sables du Bruxellien en deux points de mesure (371 et 397)
Source : Bruxelles Environnement, graphiques extraits de BruWater, 2022
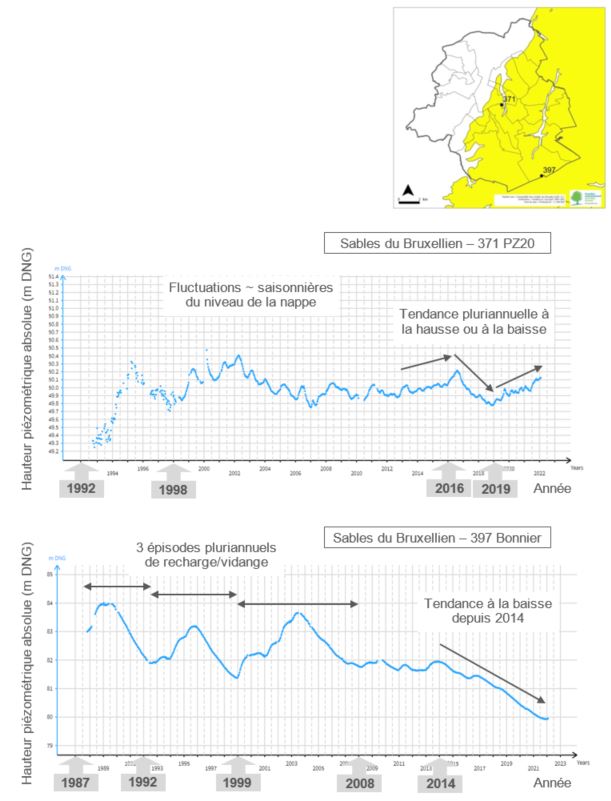
Plusieurs facteurs potentiels peuvent être avancés pour expliquer cette variabilité constatée au niveau de la masse d’eau du Bruxellien : l’environnement du site de mesure (urbanisation, etc.), sa localisation par rapport aux limites de l’aquifère, la profondeur de la nappe au droit du point de mesure, la perméabilité des formations géologiques de la zone non saturée traversées par les eaux d’infiltration, l’interaction avec des eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.), ...
Deuxième élément de décryptage : l’évolution des volumes d'eau prélevés par captage
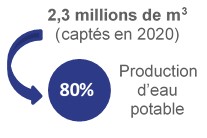 Environ 150 captages, répartis dans les différentes masses d’eau, sont soumis à autorisation. Parmi ceux-ci, une centaine sont réellement exploités. En 2020, 2,3 millions de m3 d’eau ont été prélevés dans les différentes nappes dont les 4/5 au niveau des captages de Vivaqua localisés au bois de la Cambre et en forêt de Soignes (masse d’eau des Sables du Bruxellien), qui sont destinés à la production d’eau potable (voir « Approvisionnement et consommation d’eau de distribution »). Le cinquième restant est consacré à des usages industriels ou tertiaires. Le volume attribué au secteur de l’agriculture est négligeable étant donné que ce secteur est peu présent en Région bruxelloise.
Environ 150 captages, répartis dans les différentes masses d’eau, sont soumis à autorisation. Parmi ceux-ci, une centaine sont réellement exploités. En 2020, 2,3 millions de m3 d’eau ont été prélevés dans les différentes nappes dont les 4/5 au niveau des captages de Vivaqua localisés au bois de la Cambre et en forêt de Soignes (masse d’eau des Sables du Bruxellien), qui sont destinés à la production d’eau potable (voir « Approvisionnement et consommation d’eau de distribution »). Le cinquième restant est consacré à des usages industriels ou tertiaires. Le volume attribué au secteur de l’agriculture est négligeable étant donné que ce secteur est peu présent en Région bruxelloise.
Bon à savoir
Les volumes prélevés dans les eaux souterraines bruxelloises pour l’alimentation en eau potable en 2020 représentent 80% du total des volumes captés dans celles-ci. En revanche, ils ne couvrent que 3% des besoins en eau potable de la Région bruxelloise !
On observe une tendance très nette à la diminution des volumes exploités soumis à autorisation et ce, pour toutes les masses d’eau et tous les usages. Cette baisse généralisée s’explique :
 essentiellement par une diminution globale des prélèvements pour l’alimentation en eau potable de 50% entre 1986 (année record) et 2020. Celle-ci n’est pas un choix du producteur d’eau mais une conséquence de l’évolution de la piézométrie des Sables du Bruxellien : la galerie de la Forêt de Soignes capte les eaux de la nappe par écoulement gravitaire.
essentiellement par une diminution globale des prélèvements pour l’alimentation en eau potable de 50% entre 1986 (année record) et 2020. Celle-ci n’est pas un choix du producteur d’eau mais une conséquence de l’évolution de la piézométrie des Sables du Bruxellien : la galerie de la Forêt de Soignes capte les eaux de la nappe par écoulement gravitaire.- et dans une moindre mesure, par la tertiarisation de l’économie bruxelloise : les prélèvements à des fins industrielles diminuent sans cesse tant en nombre qu’en volume. La baisse également observée pour le secteur tertiaire malgré cette tertiarisation pourrait indiquer que le secteur tertiaire a de moins en moins recours au captage d’eau souterraine comme alternative à l’eau potable. Les contraintes liées à l’entretien d’un captage (temps, coût) découragent sans doute les exploitants, comparées à l’accès aisé et « bon marché » à une connexion au réseau de distribution.
Les prévisions sont au statu quo ou à la baisse en ce qui concerne les prélèvements pour les secteurs industriels et tertiaires et à une stabilisation de la demande en eau potable par les ménages (voir « Consommation d’eau de distribution par les ménages »).
En plus de ces captages soumis à autorisation, des pompages temporaires sont effectués lors de chantiers pour rabattre la nappe et permettre la réalisation à sec des fondations de constructions ou lors de travaux d’assainissementTraitement de la pollution affectant un site (sol, eau) afin de le remettre dans son état initial ou du moins atteindre des valeurs fixées légalement. de sols pollués. Des captages permanents sont également réalisés afin d’empêcher des inondations dans les infrastructures souterraines du métro (aquifères superficiels alluviaux principalement), ou encore pour une utilisation géothermique de l’eau souterraine (aquifères captifs profonds). Concernant les infrastructures souterraines, les débits concernés ne sont pas connus avec précision mais sont généralement relativement limités. Concernant les systèmes géothermiques, les débits prélevés sont systématiquement réinjectés dans le même aquifère.
Quelle est la sensibilité des nappes aux prélèvements par captage ?
A l’aide entres autres des modèles hydrogéologiques, la sensibilité des masses d’eau aux prélèvements par captage a été évaluée. Autrement dit, on a déterminé quel était l’impact relatif de la pression exercée par les prélèvements d’eau sur l’état quantitatif des nappes.
Pour les deux masses d’eau du Socle paléo-mésozoïque, faute de modèle hydrogéologique, la sensibilité a été estimée à dire d’experts. Elle est considérée comparable à celle des Sables du Landénien, compte tenu des nombreux points communs entre ces masses d’eau (caractère captif des nappes, zones d’infiltrations +/- identiques, recharge fortement contrainte en raison d’un défaut de perméabilité des couches sus-jacentes…).
- Pour le système phréatique, constitué des masses d’eau des Sables du Bruxellien et du système nord-ouest des sables du Bruxellien et de Tielt, la sensibilité aux prélèvements est jugée faible à modérée.
- Pour les trois masses d’eau captives, elle est élevée. En d’autres termes, celles-ci présentent un potentiel limité pour leur exploitation par captage. Il est donc impératif de gérer strictement les prélèvements pour garantir une gestion durable de la ressource.
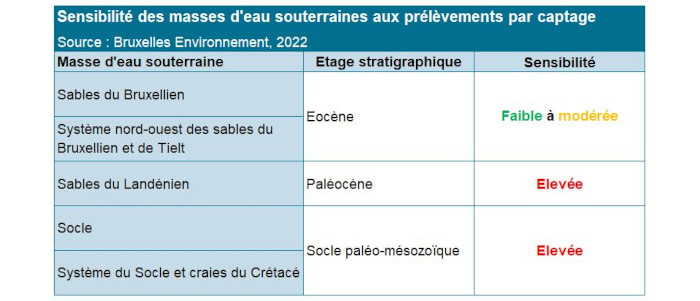
Autre élément de décryptage spécifique au système phréatique : le drainage des eaux souterraines en fond de vallée
Pour le système phréatique en contact avec les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.), les prélèvements par captage ne constituent pas la majorité des flux sortants, loin s’en faut. Le principal flux sortant est le drainage naturel des eaux souterraines en fond de vallée alluviale par le réseau hydrographique d’une part et par le réseau de collecteurs d’eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. d’autre part. L’autre flux sortant, l’alimentation des sources, a une part relative assez faible, comparable à celle des prélèvements par captage. Néanmoins, ce flux pourrait être réévalué à la hausse à l’issue de l’inventaire des sources bruxelloises mené actuellement (plus d’une centaine recensée).
Troisième élément de décryptage : l’évolution de la recharge moyenne annuelle
Un bilan hydrologique a été établi sur base des données de précipitations et d’évapotranspirationL’eau de pluie est retenue au niveau du sol puis s’évapore vers l’atmosphère. La présence de plantes amplifie/augmente fortement ce phénomène. potentielle de l’IRM, pour chaque année de la période allant de 1976 à 2019. Il indique de quelle manière les précipitations atmosphériques (P) se répartissent entre : l’évapotranspiration réelle (ETR), le ruissellement (R) sur les surfaces du sol et la recharge ou infiltration (I), à savoir la fraction qui percole à travers les sols et le sous-sol pour alimenter les nappes.
Bon à savoir
La période jugée comme propice à la recharge des nappes, dite de recharge efficace, s’étalerait de septembre-octobre à février-mars pour la Région de Bruxelles-Capitale (IRM, 2014 & étude sur la modélisation du Bruxellien, 2015). Au printemps et en été, les précipitations s’infiltrent peu puisqu’elles servent à la croissance végétale.
Bilan hydrologique à la station d’Uccle (1976-2019)
Source : Bruxelles Environnement, station d’Uccle, 2020
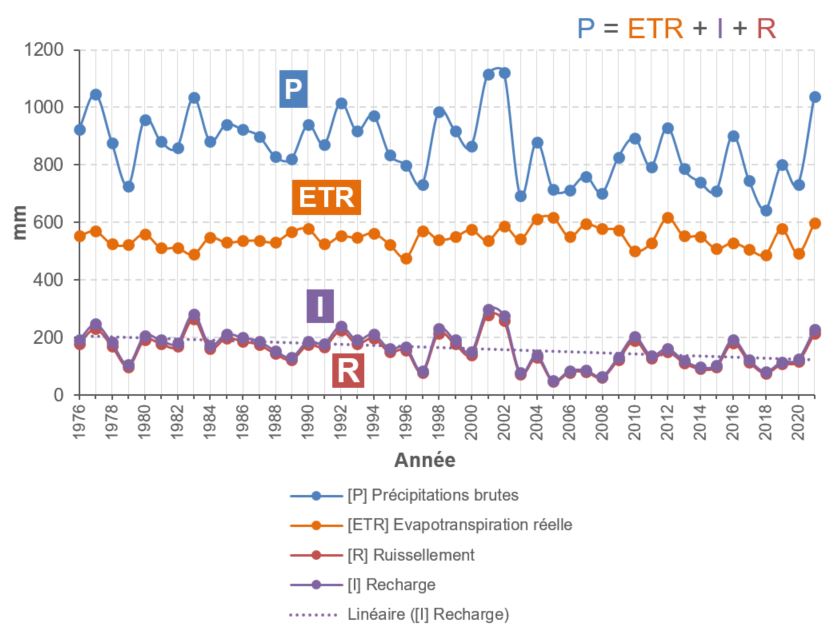
 Une tendance à la baisse de la recharge des eaux souterraines de près de 50% sur la période 1976-2019 a ainsi été mise en évidence. Elle résulte d’une diminution des précipitations observée sur cette période, conjuguée à une évapotranspirationL’eau de pluie est retenue au niveau du sol puis s’évapore vers l’atmosphère. La présence de plantes amplifie/augmente fortement ce phénomène. relativement constante.
Une tendance à la baisse de la recharge des eaux souterraines de près de 50% sur la période 1976-2019 a ainsi été mise en évidence. Elle résulte d’une diminution des précipitations observée sur cette période, conjuguée à une évapotranspirationL’eau de pluie est retenue au niveau du sol puis s’évapore vers l’atmosphère. La présence de plantes amplifie/augmente fortement ce phénomène. relativement constante.
Et les modélisations du changement climatiqueDésigne de lentes variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l'air, résultant d'activités humaines, menacent de modifier sensiblement les climats, dans le sens d'un réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants : élévation du niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones, etc.), déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d'eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales, etc. prédisent une diminution d’environ 10% de la recharge en 2100 par rapport à 2005, quel que soit le scénario climatique (consortium scientifique CORDEX). Le taux d’évapotranspiration (ETR) devrait augmenter, en lien avec la hausse des températures. Le régime des précipitations (P) changera mais les modifications (répartition temporelle, fréquence, intensité et durée) varient selon les scénarios climatiques.
Quelle est la sensibilité des nappes aux variations de recharge ?
La sensibilité de la recharge sur la piézométrie des nappes apparait significativement élevée, pour l’ensemble des masses d’eau. Au niveau du système phréatique, cette sensibilité est environ 15 fois plus élevée que celle des prélèvements par captage ; au niveau des Sables du Landénien, 5 fois plus élevée.
Quel impact du changement climatique sur le niveau des nappes ?
Une première quantification de l’impact de cette baisse programmée de la recharge sur les ressources en eaux souterraines a pu être réalisée pour le système phréatique grâce au modèle hydrogéologique. Il en ressort que la piézométrie de ces masses d’eau pourrait descendre jusqu’à -0,83 m à l’horizon 2100 par rapport à 2013, avec comme conséquences :
- Une baisse de 1 à 4% du débit de base moyen annuel provenant des eaux souterraines alimentant le système eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) / grands collecteurs en fond de vallée. Avec comme corollaire, une baisse du débit de base des cours d’eau bruxellois.
- Une baisse de 3% du débit moyen annuel de la galerie drainante en Forêt de Soignes.
À télécharger
Accès aux données
- Application Bruwater, accès aux données sur les eaux souterraines
- Application Brugeotool, accès aux données géologiques, hydrogéologiques et géothermiques
Fiche(s) documentée(s)
- 4. Normes et valeurs légales de référence en matière d’eau (.pdf)
- 7. Eaux souterraines (.pdf)
- 13. Cadre légal bruxellois en matière d’eau (.pdf)
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Carte interactive de la géologie
- Carte interactive de l’hydrogéologie
- Carte interactive des captages d’eau souterraine
- Carte interactive des stations de mesure du niveau et de la qualité des eaux souterraines
- Tableau des unités hydrogéologiques de la Région de Bruxelles-Capitale (.pdf)
- Brussels Phreatic System Model (BPSM) – version 1.0 – Modélisation hydrogéologique en éléments finis du système phréatique bruxellois, septembre 2020. 148 pp. (.pdf)
- BRUSTRATI3D Version 1.1, Harmonisation et corrections apportées aux rasters des toits des unités stratigraphiques du modèle BRUSTRATI3D version 1.0 et calcul des rasters d’épaisseurs - Addendum au rapport BRUSTRATI3D version 1.0 (Service Géologique de Belgique), 2018. 56 pp. (.pdf)
Etude(s) et rapport(s)
- INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE, SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE, 2017. « BRUSTRATI3D Version 1.0, Modélisation stratigraphique en 3D du sous-sol de la Région de Bruxelles-Capitale ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 110 pp. (.pdf)
- INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE, SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE et AQUALE, août 2015. « Modélisation géologique en 3D de l’aquifère du Landénien » - Phase 1. Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 61 pp. (.pdf)
- INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE, SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE et AQUALE, décembre 2016. « Réalisation d’une étude hydrogéologique de la masse d’eau souterraine du Landénien » - Phase 2. Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 278 pp. (.pdf) p.1-133 - p.134-278
- INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE, SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE et AQUALE, novembre 2015. « Réalisation d’une étude hydrogéologique de la masse d’eau souterraine du Bruxellien – Phase 1 : Modélisation géologique en 3D des formations géologiques composant la masse d’eau souterraine des sables du Bruxellien ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 56 pp. (.pdf)
- INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE, SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE et AQUALE, décembre 2015. « Réalisation d’une étude hydrogéologique de la masse d’eau souterraine du Bruxellien – Phase 2 ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 470 pp. (sans les annexes) (.pdf)
Plan(s) et programme(s)
Modélisation des nappes d’eaux souterraines des sables du Bruxellien et du Landénien
Focus - Actualisation : janvier 2018
Les masses d’eau souterraines des sables du Bruxellien et du Landénien constituent deux réserves en eau stratégiques en Région de Bruxelles Capitale. Des modélisations ont mis en évidence que leur exploitation actuelle pour l’alimentation en eau potable et les usages industriel et tertiaire semble raisonnée et durable. Alors que la nappe des sables du Bruxellien présente une bonne pérennité, son niveau d’eau s’avère toutefois sensible aux apports pluviométriques et donc aux changements climatiques. La nappe du Landénien se caractérise par une pérennité plus modérée et une plus grande sensibilité aux prélèvements.
L’atteinte du « bon état quantitatif » des eaux souterraines: un challenge pour le gestionnaire
Les eaux souterraines de la Région bruxelloise doivent atteindre, en 2015 et d’ici 2021, les objectifs environnementaux fixés dans les directives européennes (voir focus du REE 2011-2014 ). L’un de ces objectifs est l’atteinte du « bon état quantitatif » des masses d’eau souterraines, c’est-à-dire une gestion durable de la ressource en eau.
Prédire si l’état quantitatif des eaux souterraines continuera à être atteint dans les années à venir revient à estimer la pérennité des ressources en eau disponibles. Autrement dit, il s’agit d’évaluer si la ressource est et restera gérée durablement, et si les apports en eau (recharge de la nappe) permettront de répondre à la demande (captages). Le recours à la modélisation hydrogéologique est dans ce cadre très utile.
La modélisation hydrogéologique: un outil d’évaluation des ressources en eau
Bruxelles Environnement, en tant que gestionnaire des eaux souterraines, a ainsi fait appel au Service géologique de Belgique et à Aquale pour modéliser deux des cinq masses d’eau souterraines bruxelloises: celle des sables du Bruxellien (modèle Hydrobrux) et celle du Landénien (modèle Hydroland).
Hydrobrux (2012 – 2015) s’est focalisé sur la masse d’eau souterraine des sables du Bruxellien. Située sur le versant Est de la vallée de la Senne, cette ressource est de première importance puisque 80% de l’eau captée en RBC, tous usages confondus, provient de cette nappe, avec une forte majorité destinée à l’alimentation en eau potable (voir indicateur « approvisionnement et consommation d’eau de distribution»).
Hydroland (2014 – 2016) s’est concentré sur la masse d’eau souterraine du Landénien, aquifère plus profond que le Bruxellien et captif (c’est-à-dire surmonté d’une couche imperméable et sous pression). Si les prélèvements effectués dans cette nappe sont moins importants que dans le Bruxellien, elle peut tout de même être considérée comme la deuxième réserve stratégique en eau souterraine en RBC.
Ces modèles visent à estimer la pérennité des ressources en eau, et donc à évaluer la sensibilité des aquifères aux pressions qu’ils subissent (variations de leur recharge et/ou des prélèvements), en particulier dans le contexte du changement climatiqueDésigne de lentes variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l'air, résultant d'activités humaines, menacent de modifier sensiblement les climats, dans le sens d'un réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants : élévation du niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones, etc.), déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d'eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales, etc.. Ils ont également pour but de quantifier les flux d’eau transitant entre la Région bruxelloise et la Région flamande. Dans le cas d’Hydrobrux, la mise en évidence des interactions entre la nappe des sables du Bruxellien et le cours d’eau de la Woluwe a constitué un objectif additionnel.
Etape 1 : développement de modèles 3D des formations géologiques
La première étape a été la « construction » de l’architecture 3D du sous-sol bruxellois reprenant l’ensemble des formations géologiques connues en RBC, depuis la surface jusqu’au sommet du socle Paléozoïque (couche la plus ancienne et la plus profonde (> 100m) connue à Bruxelles).
Tout d’abord, les altitudes des sommets des formations issues de 3250 forages/sondages, ont été introduites dans une base de données (Microsoft Access). Grâce à un système d’information géographique (SIG), ces différentes données ont ensuite été interpolées afin de cartographier les sommets des différentes couches géologiques. Enfin, l’architecture 3D a été construite via la superposition des différentes surfaces en 2D modélisées lors de l’étape précédente. Une représentation 3D dite « layer-cake » a ainsi été obtenue.
Etape 2 : modélisation hydrogéologique
La seconde grande étape a été de modéliser les flux existants au sein de chacun des systèmes hydrogéologiques considérés (sables du Bruxellien ou Landénien) sous FEFLOW 6.0. Après implémentation de données géologiques, hydrogéologiques, hydrologiques et climatiques, le modèle a été calibré de façon à ce qu’il reproduise, entre autres, la piézométrie mesurée entre 2009 et 2013.
Evaluation de la pérennité des ressources disponibles
La pérennité des ressources en eau disponibles dans les sables du Bruxellien et du Landénien a été estimée via l’étude de deux paramètres influents : l’infiltration et les prélèvements en eau. En modifiant volontairement les valeurs de ces paramètres, différents scénarii ont ainsi pu être obtenus.
Au niveau des sables du Bruxellien, il apparaît clairement que l’infiltration –soit la recharge en eau du système via les précipitations- constitue le principal paramètre qui affecte la piézométrie de la nappe (i.e. niveau d’eau). La recharge plus ou moins importante de la nappe semble suivre un cycle saisonnier à pluriannuel et si actuellement, elle est plutôt basse, elle devrait progressivement remonter dans les années à venir. Une augmentation raisonnée des débits prélevés ne devrait pas menacer les ressources disponibles.
Concernant le Landénien, la piézométrie augmente depuis plusieurs années, en particulier au Nord de la RBC. Ceci suggère que l’exploitation actuelle semble affecter de manière modérée les ressources en eau, à priori suffisantes, mais ne justifierait pas pour autant une augmentation trop importante des prélèvements. En effet, cette masse d’eau souterraine apparait comme assez sensible aux débits prélevés.
En l’état actuel, l’exploitation de ces deux aquifères apparait donc raisonnée et leur gestion durable. Par ailleurs, les modèles mettent en évidence que les deux masses d’eau seraient potentiellement sensibles aux changements climatiques, via une variabilité de la pluviométrie.
Quantification des échanges d’eau souterraine avec la Région Flamande
Les échanges interrégionaux au sein des sables du Bruxellien et du Landénien ont été quantifiés et cartographiés, mettant en évidence une balance positive vers la RBC. Les principaux points d’entrée de ces flux sont localisés le long de la frontière Sud et le long de la frontière Est pour les deux aquifères étudiés. Pour le Landénien, les principaux points de sortie sont le long de la frontière Nord et Ouest et pour le Bruxellien, le long de la frontière Nord uniquement.
Mise en évidence des interactions entre la masse d’eau des sables du Bruxellien et le cours d’eau de la Woluwe
La nappe semble majoritairement drainée par la rivière, surtout sur la partie amont du cours d’eau, zone essentiellement forestière. Plus en aval, en milieu urbanisé, les collecteurs d’eau de pluie draineraient la nappe de façon plus importante que la Woluwe, rendant alors le système particulièrement complexe pour une modélisation précise. Due aux nombreuses incertitudes liées au contexte particulier de la Woluwe (proximité avec le collecteurcollecteur, négociant et courtier et interactions avec la nappe difficiles à quantifier), les résultats obtenus grâce au modèle sont partiels et préliminaires.
Vers un troisième modèle hydrogéologique
Les modèles hydrogéologiques développés dans les présents projets (Hydrobrux et Hydroland) constituent des outils de première importance, qui pourront continuer à être utilisés notamment à des fins prédictives et d’aide à la décision dans le cadre de la gestion durable des eaux souterraines en RBC.
Une amélioration continue de ces outils sera possible grâce à de nouvelles données permettant d’affiner leur calibration et grâce à des connaissances approfondies sur le système hydrogéologique bruxellois.
Le modèle Hydrobrux présente néanmoins un certain nombre de faiblesses. Tout d’abord, l’influence exercée par les collecteurs, de même que par l’ensemble du réseau hydrographique sur les masses d’eaux souterraines étudiées est difficile à intégrer. Ensuite, le contexte fort urbanisé de la Région ainsi que les nombreuses modifications anthropiques apportées au système hydrographique au cours des siècles complexifient l’étude.
Un troisième modèle de l’ensemble du système hydrogéologique bruxellois est donc en cours de développement, pour pallier aux faiblesses identifiées. Il se voudra plus complet et précis que le modèle Hydrobrux. Son extension horizontale permettra de reprendre l’ensemble de la RBC. Les différentes couches géologiques traversées seront définies plus finement et les réseaux d’égout et hydrographique seront mieux pris en compte.
À télécharger
Autres publications de Bruxelles Environnement
- Carte interactive de la géologie
- Carte interactive des captages d’eau souterraine
- Carte interactive des stations de mesure du niveau et de la qualité des eaux souterraines
- Carte interactive des données de niveau d’eau et de qualité des eaux souterraines
Etudes et rapports
- SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE (Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique) & AQUALE - ECOFOX DEVELOPPEMENT, 2011. Projet Hydrobrux. « Etude hydrogéologique de la masse d’eau souterraine des sables du Bruxellien – Phase 1 : Modélisation géologique ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 56 pp. (.pdf)
- AQUALE - ECOFOX DEVELOPPEMENT & SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE (Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique), décembre 2015. Projet Hydrobrux. « Etude hydrogéologique de la masse d’eau souterraine des sables du Bruxellien – Phase 2 : Modélisation hydrogéologique ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 470 pp. (.pdf)
- SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE (Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique) & AQUALE - ECOFOX DEVELOPPEMENT, août 2015. Projet Hydroland. « Etude hydrogéologique de la masse d’eau souterraine des sables du Landénien – Phase 1 : Modélisation géologique ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 61 pp. (.pdf)
- AQUALE - ECOFOX DEVELOPPEMENT & SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE (Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique), décembre 2016. Projet Hydroland. « Etude hydrogéologique de la masse d’eau souterraine des sables du Landénien – Phase 2 : Modélisation hydrogéologique ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 273 pp. (.pdf) http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/20161215-R-2016-043-Vfinale_p1_a_p133.pdf et http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/20161215-R-2016-043-Vfinale_p134_a_p278.pdf (.pdf)
- CAMBIER G. & DEVLEESCHOUWER X., décembre 2013. « A GIS-based methodology for creating 3D geological models in sedimentary environment : application to the subcrop of Brussels ». Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 164(4):557-567, 12 pp., (en Anglais)
- DEVLEESCHOUWER X. & POURIEL F., 2006. « Brussels Urban Geology (BUG) : a 2D and 3D model of the underground by means of GIS ». The Geological Society of London, IAEG2006 Paper number 420. 9 pp. (en Anglais) (.pdf)
Plans et programmes