Sols : état des lieux
- Sol
- Sous-sol
- Pollution
- État des lieux de l'environnement
- Étude
Sommaire
Le sol remplit de nombreuses fonctions essentielles mais celles-ci sont menacées. Ces dernières années, la gestion des sols à Bruxelles s’est principalement axée sur l’aspect chimique des sols (pollution chimique) mais dès à présent, elle prendra également en compte leurs aspects physiques et biologiques.
Les sols et les eaux souterraines de la Région ont souffert de nombreuses pollutions au cours des siècles. Celles-ci sont liées au passé industriel de la ville mais peuvent aussi avoir d’autres origines comme la mise en décharge de déchets, les fuites d‘égouts, les activités de PME (garages, stations-service, imprimeries, nettoyage à sec, ...), le logement (utilisation de pesticides, fuites de citernes, ...) ainsi que d’autres activités présentant des risques de pollution des sols. Ces pollutions présentent un risque pour la santé humaine ainsi que pour les écosystèmes. Par ailleurs, la réhabilitation et la réutilisation de terrains touchés par ces pollutions est souvent freinée ou entravée par les coûts élevés d’assainissementTraitement de la pollution affectant un site (sol, eau) afin de le remettre dans son état initial ou du moins atteindre des valeurs fixées légalement. ou de gestion des risques.
Une gestion de cette problématique a progressivement été mise en place au niveau régional. Elle s’est jusqu’à présent concrétisée notamment par la réalisation d’un inventaire de l’état des sols, le traitement de terrains pollués ou encore, par la mise en place de différents outils économiques visant à soutenir l’identification de sols pollués ou à traiter les parcelles polluées. Les activités actuelles sont quant à elles sévèrement encadrées.
Identification et traitement des sols pollues et mesures d'aide financière
Indicateur - Actualisation : Août 2023
Depuis 2005, 1011 hectares de terrains contaminés à Bruxelles ont été rendus à nouveau disponibles pour une réaffectation (logement, activités économiques…) suite à un assainissementTraitement de la pollution affectant un site (sol, eau) afin de le remettre dans son état initial ou du moins atteindre des valeurs fixées légalement. ou à une gestion du risque. Les travaux réalisés ont permis de traiter 17,5 millions de m³ de sols contaminés et 7 millions de m³ d'eau contaminé, pour un coût total de 494 millions d’euros. En guise de soutien financier, 4 912 primes de sol ont été accordées par Bruxelles Environnement entre 2007 et 2022, pour un total d’environ 15 millions d’euros.
L’Ordonnance « sols » comme cadre légal pour l’identification et le traitement des sols pollués
L’ordonnance « sols » actuelle du 23 juin 2017, encadre et définit les obligations en matière de traitement et de gestion des sites (potentiellement) contaminés. Selon les données de l'inventaire de l'état des sols, cette obligation couvre plus de 11.000 parcelles cadastrales (voir Inventaire de l’état du sol).
Cette ordonnance « sols » a introduit une procédure en plusieurs étapes techniques réalisées par un expert agréé en pollution du sol et permettant de savoir si un sol et/ou des eaux souterraines sont pollués, de connaître l’ampleur et le type de pollution ainsi que, le cas échéant, d’assainir la pollution ou d’en évaluer les risques pour la santé humaine et l’environnement et le cas échéant de gérer ces risques. Sur le site de Bruxelles Environnement, vous trouverez des informations plus détaillées sur ces procédures et études de sol ou sur le traitement des sols pollués (obligations et techniques d'assainissement).
Plusieurs actes peuvent générer à des obligations de réaliser des études de sol, comme:
- la vente de terrains ou de bâtiments inscrits à l’inventaire de l’état du sol (voir fiche sur l’inventaire de l’état du sol) ;
- le démarrage, la cession ou cessation de certaines « activités à risque » (voir Inventaire de l'état du sol). ;
- la réalisation, sur des terrains inscrits à l’inventaire, de travaux ou l’implantation d’une activité nécessitant une excavation ou compromettant le contrôle ou le traitement ultérieurs de la pollution du sol éventuelle ou encore, augmentant l’exposition de personnes ou de l’environnement au risque éventuel engendré par une pollution du sol (obligations « sols » imposées via la gestion des permis d’urbanisme et d’environnement) ;
- la découverte fortuite d’une pollution du sol lors de travaux d’excavation ;
- la survenance d’un accident ayant pollué le sol.
Evolution des études de sol et des travaux de traitement du sol
Le graphique suivant montre l’évolution depuis 2005 du nombre d’études de sol et de travaux de traitement effectués en Région bruxelloise dans le cadre de l’application des ordonnances « sols pollués ». 8.170 reconnaissances de l’état du sol (RES) ont été effectuées durant cette période pour mettre en lumière une pollution éventuelle du sol ou des eaux souterraines. Parmi celles-ci, 551 RES ont été effectuées avec un traitement minime depuis l’instauration de la procédure en 2017. Entre 2005 et fin 2021, il y a eu deux fois moins d’études détaillées (3.285) que de RES, pour déterminer l’ampleur et le type de pollution. Au total, il y a eu 1.041 projets d’assainissement ou de gestion du risque, et 353 traitements de durée limitée (TDL). Nous constatons depuis l'introduction de la procédure TDL en 2017 permettant un traitement accéléré et plus ciblé d'une pollution du sol, une diminution du volume annuel de projets d’assainissements et de gestion du risque. Depuis 2005, 959 évaluations finales ont été déclarées conformes, pour un total de 1.011 ha de superficie traitée (voir ci-dessous).
La grande majorité des pollutions identifiées depuis 2017 sont des pollutions orphelines. Il s'agit de pollutions pour lesquels aucune partie responsable ne peut être identifiée (voir définition ci-dessous).
Evolution du nombre d’études de sol, de projets de traitement des sols et d’évaluations finales (2005-2022)
Source : Bruxelles Environnement, sous-division Sols, 2023
Polluants
Les polluants du sol les plus fréquents (en termes de nombre de parcelles) sont les métaux lourdsNom générique d'un groupe de métaux de densité relativement élevée, tels que le plomb, le mercure, le zinc et le cadmium. Ces métaux sont présents naturellement dans l'environnement et sont même nécessaires à certains processus naturels. Ils sont toutefois nocifs en concentrations élevées. Les principales sources de métaux lourds sont l'industrie non ferreuse, la combustion de combustibles fossiles, l'incinération de déchets et le trafic., les hydrocarburesCe sont des composés organiques liquides constitués de carbone et d’hydrogène dérivés du pétrole. Le mazout, l’essence et d’autres types d’huiles minérales en font partie. Ces huiles ont la particularité d’avoir une faible densité. Lorsqu’elles s’infiltrent dans le sol, elles peuvent atteindre l’eau souterraine et y former une couche flottante. aromatiques polycycliques (HAP) et les huiles minérales. Pour les eaux souterraines, il s’agit des huiles minérales, des hydrocarbures chlorés et des métaux lourds.
Traitement des sols pollués
Entre 2005 et 2022, 1.651 parcelles en Région bruxelloise ont été réaffectés après un traitement par le biais d'un assainissementTraitement de la pollution affectant un site (sol, eau) afin de le remettre dans son état initial ou du moins atteindre des valeurs fixées légalement. ou d'une gestion du risque, correspondant à 1.011 ha. Les terres ont été rendues à nouveau disponibles pour le développement d’activités économiques, résidentielles et récréatives. Tous les travaux ont coûté au total environ 493,6 millions d'euros, ce qui représente environ 49 euros par m2.
Evolution de la superficie totale des parcelles cadastrales traitées et du coût total (2005-2022)
Source : Bruxelles Environnement, sous-division Sols, 2023
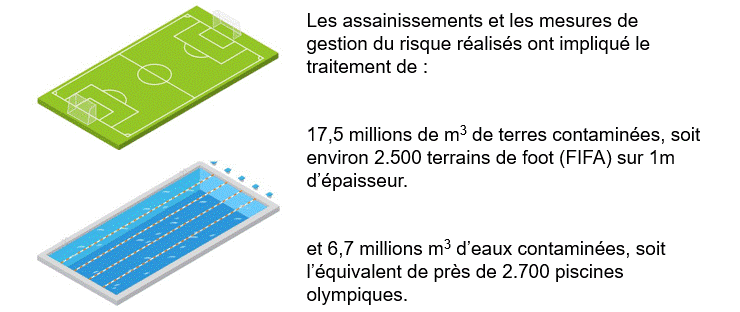
Lire le texte de transcription
Les assainissement et les mesures de gestion du risques ont impliqué le traitement de:
- 17,5 millions de m³ de terres contaminées, soit environ 2600 terrains de foot (FIFA) sur 1m d’épaisseur.
- Et 6,7 millions m³ d’eaux contaminées, soit l’équivalent de près de 2700 piscines olympiques.
La pollution du sol ou des eaux souterraines peut être traitée de différentes manières. En fonction de l'ampleur et du type de pollution et de la zone affectée, la méthode appropriée est choisie. Parmi les 23 techniques utilisées en Région bruxelloise, les plus courantes sont l’excavation de terres polluées, le pompage et le traitement d'eaux souterraines ou une combinaison des deux techniques. Ces traitements ont été utilisés sur 72% des parcelles traitées (soit 1359 parcelles) entre 2005 et 2022. Ensuite, les techniques les plus courantes sont la bioremédiation stimulée (utilisée sur 88 parcelles) et l’atténuation naturelle (85 parcelles).
Mesures d'aide financière
Pour réaliser des études de sol ou des travaux de traitement du sol, il est possible de faire appel, dans certains cas, à une aide financière, technique et/ou administrative offerte par Bruxelles Environnement ou d’autres institutions.
- Les primes sol
Dans certains cas, la Région de Bruxelles-Capitale peut octroyer des primes aux personnes qui sont ou ont étés obligées d’effectuer des études de sol ou des travaux de traitement. Les primes sont seulement attribuées en cas de pollutions orphelines ou quand aucune pollution n’a été constatée. Les primes sont en grande partie financées par les redevances perçues sur les attestations de sol (voir l'indicateur "Inventaire de l'état du sol").
Qu’est-ce qu’une pollution orpheline ?
Une pollution orpheline est une pollution dont le responsable n’est pas connu, dont l’auteur n’existe plus ou qui a été occasionnée avant le 20/01/2005 par des personnes qui ne sont pas (plus) propriétaire ou exploitant du terrain.
Depuis 2007, 4.912 primes ont été octroyées par la Région bruxelloise, pour un montant total de quelque 15 millions d'euros afin d’aider à la réalisation des études (reconnaissance de l’état du sol, étude détaillée, étude de risque, projet de gestion de risque, projet d’assainissementTraitement de la pollution affectant un site (sol, eau) afin de le remettre dans son état initial ou du moins atteindre des valeurs fixées légalement. et évaluation finale) et de travaux pour le traitement d’une pollution orpheline de sols. Comme illustré par le graphique ci-dessous, le nombre de primes émises par an fluctue autour de 400. Ces dernières années le nombre de primes octroyées diminue annuellement mais le budget total augmente. Cette tendance peut s’expliquer par une diminution du nombre d’études de sol effectuées et une nette augmentation du montant de la prime octroyée pour la réalisation d’études de sol et, essentiellement, de travaux de traitement du sol.
Montant total cumulatif des primes octroyées pour des études de sol et des travaux de traitement du sol et nombre de primes (2007-2022)
Source : Bruxelles Environnement, sous-division Sols, 2023
- BOFAS, le fonds d'assainissementTraitement de la pollution affectant un site (sol, eau) afin de le remettre dans son état initial ou du moins atteindre des valeurs fixées légalement. des sols des stations-service
Le fonds BOFAS a été créé pour l’assainissement du sol de stations-service publiques en Belgique en 2004. Dans le cas d'une pollution historique du sol causée par des stations-service, une demande d'intervention opérationnelle et/ou financière pour l'assainissement pouvait être introduite jusqu'à la fin de l'année 2019. Au total, 229 demandes d'intervention valides ont été reçues pour des sites de la région de Bruxelles.
- PROMAZ
Promaz est un fonds belge d'assainissement des sols pour la contamination causée par des fuites de réservoirs de mazout et/ou de tuyaux qui sont ou ont été utilisés pour chauffer des bâtiments. Le fonds fournit des conseils et un soutien financier pour l'assainissement de ce type de pollution du sol.
- Le traitement public
Lorsque certaines situations de pollution sont trop complexes, cela peut engendrer un blocage du processus de traitement et entraver le développement d’un terrain. C’est le cas notamment des pollutions qui se sont dispersées sur plusieurs parcelles (pollution voisine) et des grandes friches industrielles. Le mécanisme du traitement public a été créé pour débloquer ce genre de situations et pour pouvoir ainsi réhabiliter et réaffecter les sites le plus rapidement possible. Pour les dossiers sélectionnés, la Région se substitue alors aux titulaires de l'obligation pour effectuer les études de sol et les travaux de traitement de pollutions orphelines. Ceux-ci peuvent alors bénéficier du soutien financier, technique et administratif nécessaire de Bruxelles Environnement, en collaboration avec CityDev.brussels.
Depuis le lancement du projet en 2017, 66 terrains ont été étudiés (environ 149 ha) pour un montant total de 330.395 euros. Aucune parcelle polluée n’a encore été traitée avec le soutien du traitement public.
- Centrale de marchés OPEN Brussels
OPEN Brussels est une vision fondée par des partenaires bruxellois et flamands à la conservation et la consolidation des espaces ouverts à Bruxelles et dans la périphérie flamande. La centrale de marchés aide les entités régionales et les communes bruxelloises à traduire cette vision des espaces ouverts en projets concrets. Elle est gérée par Bruxelles Environnement depuis mai 2022. Par le biais d'un accord-cadre, la centrale de marchés attribue les marchés directement au prestatairequi fournit un soutien en termes de contenu et sur le plan technique aux projets. Le demandeur finance lui-même les projets.
Depuis 2017, 4 149 646 € ont été dépensés pour des projets mis en œuvre par 41 acteurs publics.
Inventaire de l'état du sol
Indicateur - Actualisation: Août 2023
L’inventaire de l’état du sol est un instrument essentiel pour la gestion des sols en Région bruxelloise. Fin 2022, l’inventaire comprenait 14.640 parcelles cadastrales, ce qui correspond à environ 25% de la superficie régionale. Près de la moitié d’entre elles sont considérées comme potentiellement polluées. Et sur les plus de 10.000 parcelles étudiées et/ou traitées, 59% sont encore considérées comme polluées.
L’objectif de l’inventaire de l’état du sol
Depuis 2001, Bruxelles Environnement tient un inventaire de l’état du sol. L’ inventaire reprend tous les terrains pour lesquels il existe une présomption ou une pollution réelle du sol et/ou des eaux souterraines, ainsi que les terrains non pollués. L'inventaire sert principalement à :
- pouvoir identifier des sites pollués (que ce soit ou non au moyen d’une étude de sol) et à déterminer si le traitement d'une pollution ou une gestion de risque est nécessaire et permettre ainsi leur réaffectation ;
- augmenter la sécurité juridique encadrant les transactions immobilières et le développement de nouvelles activités économiques en fournissant des informations sur l’état du sol d’un terrain donné à quiconque veut en avoir connaissance (propriétaires, acheteurs, notaires, titulaires et demandeurs de permis d'environnementLe permis d'environnement, anciennement appelé permis d'exploiter « commodo-incommodo », est un document qui contient les dispositions techniques que l'exploitant d'une installation (p. ex. station-service, imprimerie, nettoyage à sec, etc.) doit respecter. Les conditions fixées par l'administration ont pour objectif d'assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement, à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur. En savoir plus sur le permis d'environnement, demandeurs d’un permis d'urbanisme, entrepreneurs désirant excaver des terres) avant qu’il ne se voie confronté à d’éventuelles obligations d’assainissementTraitement de la pollution affectant un site (sol, eau) afin de le remettre dans son état initial ou du moins atteindre des valeurs fixées légalement. ou de gestion de risques ;
- aider les pouvoirs publics à effectuer des choix d’affectation tenant compte de la qualité du sol.
L’inventaire de l'état du sol est accessible à tout le monde. Il existe deux moyens de savoir si un terrain en fait partie ou non : la carte de l’état du sol et l’attestation de sol.
Evolution de l’inventaire
L’inventaire est actualisé en permanence en fonction des incidents signalés, des études et traitement réalisés et des permis d'environnement délivrés ou cessés.
L'inventaire compte actuellement quelque 14.640 parcelles, ce qui représente une superficie d’environ 25% du territoire régional (lorsque les parcelles sont effectivement polluées, la pollution peut cependant être localisée à une partie du site.
Les sites actuellement inscrits à l’inventaire de l’état du sol sont répartis en différentes catégories, comme prévu par l’ordonnance sols (du 23 juin 2017) :
- catégorie 0 : parcelles potentiellement polluées ;
Des parcelles sur lesquelles s’exerce ou s’est exercée une activité à risque, où s’est produit un accident ou étant restées inoccupées, avec implication de substances polluantes, ou sur lesquelles a pu se propager une pollution à partir d'une parcelle voisine.
La liste des activités à risque (.pdf) est une sélection opérée parmi la liste des installations classéesInstallation technique ou activité dont l'exploitation nécessite soit l'obtention d'un permis d'environnement, soit une déclaration d'exploitation préalable auprès de la commune. La liste de ces installations est établie par les autorités bruxelloises compétentes. (donc soumises à permis d’environnement) sur base du potentiel de pollution du sol qu’elles représentent actuellement et historiquement.
Pour les terrains repris comme catégorie 0 à l’inventaire, le vendeur du terrain ou le cédant d’une activité à risque doit effectuer une reconnaissance de l’état du sol et prendre à sa charge les obligations qui résulteraient d’un constat de pollution du sol (voir l'indicateur ci-dessus: "Identification et traitement des sols polliués et aides financières »)
- catégorie 1 : parcelles non polluées;
- catégorie 2 : parcelles légèrement polluées sans risque;
- catégorie 3 : parcelles polluées où les risques sont (rendus) acceptables en les mettant sous gestion de risque;
- catégorie 4 : parcelles polluées et en cours d'étude ou de traitement
- catégorie 0+ combinée: parcelles déjà étudiées et/ou traitées mais encore potentiellement polluées ;
Selon l’inventaire, 10.113 parcelles ont déjà été étudiées ou traitées (catégories (0+) 1, 2, 3 et 4), dont 59% sont encore polluées (6.015 parcelles ; cat (0+) 3 ou 4). Sur les parcelles inscrites à l’inventaire de l’état du sol, près de la moitié (47%) sont considérées comme potentiellement polluées (cat 0 ou 0). Ces 6.911 parcelles potentiellement polluées couvrent environ 1/8e de la superficie de la Région bruxelloise. Quelque 11.389 parcelles au total sont (potentiellement) polluées en Région bruxelloise selon l’inventaire de l’état du sol. Le nombre de parcelles se trouvant dans la catégorie 0 diminue avec le temps, tandis que le nombre de parcelles dans les autres catégories augmente ou reste stable. Cela est dû au fait que ces dernières catégories correspondent aux parcelles déjà étudiées. En effet, au fur et à mesure de la progression des études de sol et des travaux qui en résultent, les parcelles étudiées passent de la catégorie 0 à la catégorie 1, 2 ou 3.
Evolution du nombre de parcelles dans les différentes catégories de l’inventaire
Source : Bruxelles Environnement, sous-division Sols, 2023
Les activités à risque qui sont ou ont été les plus fréquentes sur les sites de l'inventaire sont les suivantes : dépôts de liquides inflammables (dont les citernes à mazout et les stations-services), garages d'entretien de véhicules, cabines de peinture, dépôts de déchets dangereuxDéchets de toute provenance possédant des propriétés dangereuses. Ils peuvent être nocifs pour les organismes vivants et l'environnement, inflammables, toxiques, oxydants, corrosifs, radioactifs, etc., dépôts de produits dangereux et les ateliers de travail des métaux.
Carte de l’état du sol
L'inventaire de l’état du sol a été intégré dans une carte interactive qui peut être consultée gratuitement. Fin 2013, cette carte interactive a été mise en ligne par Bruxelles Environnement pour garantir un accès rapide aux informations relatives à la qualité du sol des terrains bruxellois. La carte montre les terrains qui sont repris à l'inventaire et dont les informations détaillées ont déjà été validées, classés selon les 5 catégories décrites ci-dessus. Pour chacun des terrains cartographiés, une fiche d’identification indique des informations telles que l’adresse, les références cadastrales, la superficie, la classe de sensibilité, l’historique des activités à risque, un résumé des études de sol effectuées, etc. Les informations de la carte, constamment mises à jour, sont données à titre indicatif et ne remplacent pas l’attestation de sol.
Carte de l’inventaire de l’état du sol : Région bruxelloise (Avril 2023)
Source : Bruxelles Environnement, sous-division Sols, 2023
Attestations de sol
Lors de la vente d’un terrain à Bruxelles ou lors de la cession d’une activité à risque à un autre exploitant, le cédant est légalement obligé de fournir une attestation de sol. L’attestation de sol indique si le terrain figure ou non à l’inventaire de l’état du sol et, le cas échéant, les informations détaillées que l’on y retrouve. Les attestations sont délivrées par Bruxelles Environnement et sont payantes depuis le 1er novembre 2010 (46€ / parcelle cadastrale depuis Avril 2023). Le montant collecté est principalement utilisé pour financer les primes de sol (voir l'indicateur "Identification et traitement des sols polliués et aides financières").
Bon à savoir
Entre 2005 et décembre 2022, un total de 412.472 attestations de sol ont été délivrées. Le montant total des rétributions perçues pour ces attestations est d’environ 10,6 millions d’euros.
À télécharger
Fiches méthodologiques
- Indicateur: Identification et traitement des sols pollués (.pdf)
- Indicator: Mesures d’aide financière pour une étude de sol et des travaux de traitement de sols pollués (.pdf)
- Indicateur : L'inventaire de l'état du sol (.pdf)
Tableau reprenant les données
- Données liées aux études de sols et de projets de traitement des sols (.xls)
- Données liées au financement des travaux d'assainissement et de gestion des sols pollués l'inventaire de l'état du sol (.xls)
Fiches documentées
- 9. Gestion des sols pollués en Région de Bruxelles-Capitale : cadre général (.pdf)
- 10. Outils d’information : inventaire de l’état du sol (.pdf)
- 11. Outils techniques : identification et traitement des sols pollués (.pdf)
- 12. Outils économiques : financement des travaux d’assainissement et de gestion des sols pollués (.pdf)
Autres publications
- Bruxelles Environnement – Quelles sont les différentes études des sols pollués ?”
- Bruxelles Environnement – Obligations en matière de traitement des sols pollués et techniques d'assainissement
- Bruxelles Environnement – Primes assainissement sol
- Bruxelles Environnement – Votre sol est-il pollué ? Consultez la carte de l'inventaire de l'état du sol
- Bruxelles Environnement – Brusoil
- Carte : L'inventaire de l'état du sol
Arrêtés et ordonnances
Liens utiles
- Bruxelles Environnement - Votre sol est-il pollué ?
- Bruxelles Environnement - Brusoil
- Carte : L'inventaire de l'état du sol